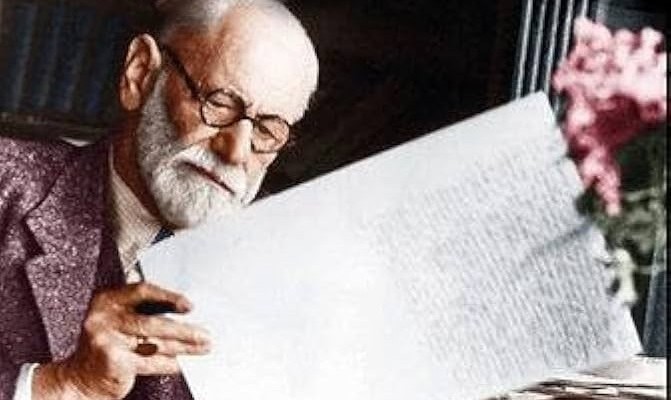« Pendant des années, j’ai vagabondé à l’étranger. Maintenant, je pars errer à la maison. » C’est Itzik Manger, le prince des poètes yiddish, le troubadour, « l’oiseau privé de nid », qui annonce de la sorte son installation en Israël, à la fin des années 1950. Vous vous rappelez peut-être, chers lecteurs, ma première chronique pour K., dans laquelle je donnais des nouvelles de la florissante presse yiddish hassidique d’aujourd’hui. À l’occasion de cette deuxième adresse, je voudrais réfléchir à ce que le yiddish offre à ceux qui l’utilisent. Est-il une langue de l’entre-soi ou de l’échange, ou bien les deux à la fois ?

Vous savez qu’à une certaine époque, au début du XXe siècle, l’hébreu modernisé et le yiddish se sont livré une sorte de guerre : la « guerre des langues ». Pour quelle raison ? Afin de déterminer qui jouerait le rôle de langue nationale juive.
Le yiddish au milieu des autres langues
Une langue sert aux hommes à communiquer entre eux et à percevoir le monde par le prisme de symboles ; elle est la première « monnaie d’échange », celle qui permet à la société d’exister. Ses signes ont donc à l’origine une valeur inestimable. Par ailleurs, un même homme peut parler plusieurs langues, qui revêtiront pour lui différentes valeurs, se complèteront ou se mêleront parfois dans leurs usages. Autrefois dans les grands empires, en Russie, en Austro-Hongrie, dans l’Empire ottoman, il était évident que plusieurs langues étaient requises pour vivre en société, comme aujourd’hui encore dans certaines parties du monde. Par exemple, pensez à un juif de Minsk Mazowiecki en Pologne russe, en 1900. On lui connait une langue intime, la langue maternelle – le yiddish. Une langue d’échange avec les voisins directs, au marché notamment – le polonais. Une langue d’échange destinée aux questions administratives, à la communication avec l’autorité centrale – le russe. Une langue sacrée, pour communiquer avec Dieu ou entre hommes savants, à propos de textes de religion – l’hébreu. Parmi toutes ces langues, il fallait encore choisir une langue de culture : celle dans laquelle on cite des proverbes, on raconte des histoires, on écrit des romans et des essais. Alors que chacune des fonctions pré-citées du langage trouve naturellement son véhicule, dicté par les circonstances, cette dernière place, qui relève à ce moment-là davantage de la volonté, pose question. Car un juif de Minsk Mazowiecki en 1900 peut hésiter entre différentes langues de culture : le russe, l’hébreu en cours de modernisation, le yiddish, le polonais ou encore, s’il voyage, d’autres grandes langues européennes.
C’est donc pour servir de langue de culture et plus particulièrement de langue de culture nationale que le yiddish et l’ivrit, l’hébreu moderne, se sont affrontés. Je ne reviendrai pas sur les factions idéologiques et politiques qui ont organisé cette bataille. Socialisme, bundisme, sionisme, orthodoxie religieuse, hassidisme, assimilationnisme… Ces divers camps juifs étaient divisés en sous-groupes défendant chacun l’usage d’une langue ou de plusieurs sans obéir à une logique systématique – il a par exemple existé des sionistes yiddishistes, comme Ber Borokhov, théoricien du sionisme socialiste et fondateur du Poalei Tzion. De grands écrivains juifs utilisaient le yiddish aussi bien que l’hébreu, d’autres préféraient le russe, l’allemand, utilisant souvent plusieurs de ces langues selon le type de texte qu’ils rédigeaient.
En tout cas, d’un point de vue démographique, au début du XXe siècle, le yiddish occupait sans dispute, au sein de la population juive d’Europe orientale, la place de mame loshn, de langue de la mère, et cela même si un nombre important de familles assimilées avait commencé à cette époque à utiliser le russe, le polonais, le hongrois ou l’allemand, et même si un nombre beaucoup plus restreint de familles opterait dans les années à venir pour l’ivrit en cours de fabrication – l’hébreu n’ayant plus été utilisé comme langue d’échanges quotidiens depuis des siècles, il fallut la force obstinée d’un Ahad Ha’am pour le transformer.
Garder la langue
De nos jours – cela avait fait l’objet de ma première chronique – ce sont les hassidim, notamment de Satmar, qui utilisent le yiddish à la fois comme langue intime et, de plus en plus, comme langue de culture, à travers leur presse, leurs livres de fiction ou de réflexion profane et leurs ouvrages destinés à la jeunesse. En dehors de leur monde, certains orthodoxes transmettent le yiddish comme langue d’étude juive ; il est enseigné dans cette optique dans des yeshivoth de plusieurs pays, y compris en France, à Brunoy. Enfin, des personnes venues de tous horizons, laïques, juives ou non, souvent universitaires, l’apprennent et la cultivent comme objet littéraire. On découvre quelques-unes de ces jeunes figures, impressionnantes d’originalité et d’érudition, dans le film documentaire yiddish de la cinéaste israélienne Nurit Aviv. Ces yiddishistes du monde entier, défenseurs parfois jusqu’à l’obsession d’une cause a priori étrange, permettent la transmission de la culture littéraire yiddish, d’une part, à ceux qui ne parlent pas le yiddish, en œuvrant comme traducteurs ; et d’autre part, en permettant aux hassidim yiddishophones qui le parlent, grâce à la numérisation des textes par exemple, et à leur conservation tout simplement, de savoir que ces textes existent et d’y avoir accès.

Ce qui m’a frappée dans le documentaire de Nurit Aviv que j’ai regardé très récemment, c’est la référence que font plusieurs de ces jeunes yiddishistes au caractère révolutionnaire de cette langue et plus particulièrement de sa poésie – révolutionnaire que ce soit du point de vue politique ou esthétique. Je suis d’accord avec eux. À mon avis aussi, le yiddish est une langue obstinée, têtue, pétrie du sens de la contradiction, énervée ; fatiguée et vivante, perpétuellement lancée dans le jeu ironique des malentendus, des glissements, des doubles sens ; une langue tendre aussi, intime, profonde, mystérieuse, simple, dont chaque mot possède une valeur inestimable. Bien sûr, les dernières de ces caractéristiques peuvent s’appliquer à toutes les langues du monde, et non pas seulement au yiddish.
Le yiddish, langue de l’émancipation juive.
Itzik Manger – j’ai cité les vers d’ouverture de l’un de ses célèbres poèmes – est né en 1901 à Czernowitz, ville multiculturelle de Bucovine où se tint précisément en 1908 la Conférence sur le Yiddish, grand moment juif de la « guerre des langues ». L’écrivain I. L. Peretz, le père de la littérature yiddish (Mendele Moykher Sforim et Sholem Aleichem, ses grands-pères, ayant été excusés pour cause de maladie) y participa. Selon lui, cette conférence constituait la quatrième étape d’un processus de libération juive corrélé à l’évolution de la langue yiddish. Le hassidisme, en proposant une religion populaire dans un monde d’érudits élitistes, avait été la première. La littérature yiddish traditionnelle, deuxième marche, avait permis l’émancipation par écrit des femmes. Dans un troisième temps, les masses du prolétariat juif avaient choisi le yiddish comme langue de lutte. Il s’agissait à présent de travailler pour faire du yiddish une grande langue, en l’enseignant de manière scolaire et en encadrant son écriture.
À cette conférence participait aussi Esther Frumkin, grande leader du mouvement bundiste, provocatrice très éduquée, en lutte contre la religion, les hébraïsants, contre les bourgeois juifs, les sionistes d’Occident, enfermée à plusieurs reprises dans les prisons du Tsar.
Des linguistes aussi y assistèrent, parmi lesquels Matthias Mieses. Né dans une famille de maskilim, c’est-à-dire de juifs de la Haskalah, « éclairés », Mieses parlait au moins une dizaine de langues. Philologue, il publia des ouvrages de linguistique et d’histoire politique principalement en polonais et en allemand. Journaliste, il écrivit beaucoup en hébreu. Mais il défendait, en linguiste, la valeur du yiddish et estimait comme Peretz qu’elle s’avérait bien une langue nationale juive. « Qui perd sa langue perd son âme », déclara-t-il à la conférence de Czernowitz. Selon lui, une langue est toujours issue d’autres langues et possède une histoire complexe. Ceux qui ne veulent entendre parler que de l’hébreu comme langue juive confondent langue et « race » ; entre les deux passe « l’Histoire en constante évolution ».

À ces considérations font écho celles, tenues dans un autre cadre, mais fondamentalement parentes de Claude Lévi-Strauss dans son discours à l’Unesco : Race et histoire : « Il y a simultanément à l’œuvre, dans les sociétés humaines, des forces travaillant dans des directions opposées : les unes tendant au maintien et même à l’accentuation des particularismes ; les autres agissant dans le sens de la convergence et de l’affinité. L’étude du langage offre des exemples frappants de tels phénomènes : ainsi, en même temps que des langues de même origine ont tendance à se différencier les unes par rapport aux autres (tels : le russe, le français et l’anglais), des langues d’origines variées, mais parlées dans des territoires contigus, développent des caractères communs : par exemple, le russe s’est, à certains égards, différencié d’autres langues slaves pour se rapprocher, au moins par certains traits phonétiques, des langues finno-ougriennes et turques parlées dans son voisinage phonétique immédiat ». Et plus loin : « Beaucoup de coutumes sont nées, non de quelque nécessité interne ou accident favorable, mais de la seule volonté de ne pas demeurer en reste par rapport à un groupe voisin qui soumettait à un usage précis un domaine où l’on n’avait pas songé soi-même à édicter des règles. Par conséquent, la diversité des cultures humaines ne doit pas nous inviter à une observation morcelante ou morcelée. Elle est moins fonction de l’isolement des groupes que des relations qui les unissent. »
Le linguiste, en yiddish, et l’anthropologue, en français, disent la même chose à cinquante années de distance : une culture n’existe pas de manière fondamentale, en soi, pure de tout mélange, mais au contraire par réaction, dans l’Histoire, le temps et l’espace, au milieu d’autres cultures.
L’hébreu contre le « jargon »
Les hébraïsants du début du XXe siècle sont révoltés par le caractère « bâtard » du yiddish. À leurs yeux, les juifs croient que le yiddish leur appartient, alors qu’il n’est qu’un emprunt aux « Autres ». Il symbolise la dégradation du peuple juif en exil. Aha Ha-Am, génie torturé de la renaissance de la langue hébraïque, pétri de contradictions internes, qui déplorera, à la fin de sa vie en Palestine de se sentir si nostalgique de ses années londoniennes, aspire à une pureté que le yiddish, le jargon, comme on l’appelle communément à l’époque, ne peut lui offrir. Il écrit en 1899 une lettre à un journal yiddish, « Der Yid » (cité ici): « Un journal en jargon, à quoi cela peut-il servir ? Certes le jargon, c’est la langue maternelle, la langue de la découverte des premiers sentiments et en principe tout le monde aime et défend sa langue maternelle. Nous seuls ne connaissons pas l’amour de la langue maternelle, ce langage ne nous est pas cher car il n’est point nôtre, nous n’avons aucune tendresse pour lui, nous ne nous intéressons pas à son sort, à son évolution. Le jargon est une langue étrangère, la tache de la diaspora en nous. Il faut retrouver nos propres racines. »
Il était courant de catégoriser à l’époque les choses de la manière suivante : l’hébreu, c’est le père. Le yiddish, c’est la mère. Une idée qui croise de manière évidemment fortuite, mais amusante les résultats de recherches en génétique très à la mode en ce moment, selon lesquelles la population juive ashkénaze serait issue, à l’origine, du mariage de quelques voyageurs juifs avec des femmes allemandes. Le yiddish, « féminin », s’opposerait-il de manière essentielle à l’ordre établi et à la Loi, du côté du masculin ? Le yiddish, langue de la mère, contrerait-il les volontés d’émancipation du peuple juif, comme la mère d’un autre poème d’Itzik Manger empêche son fils de s’envoler avec les oiseaux, le couvrant de lourdes épaisseurs d’écharpes et de châles : « Oyfn veg, shteyt a boym, shteyt er ayngeboygn », « Un arbre se tient courbé sur la route, seul face à la tempête, et tous les oiseaux se sont envolés » ? Le yiddish est-il la servitude, le déterminisme, et l’hébreu – la liberté, l’universel ?
Il me semble bien illusoire de prétendre choisir entre les deux. Un homme n’échappe pas à son destin d’homme. Même en réinventant l’hébreu, Ahad Ha’am a été obligé de faire appel aux bâtardises du yiddish pour le rendre plus souple. Car à l’origine d’une identité, il y a toujours une rencontre, il y a toujours de l’autre.
Dans ce poème « Kh’hob zikh yorn gevalgert » / « Pendant des années j’ai vagabondé », qu’Itzik Manger écrit en 1958 à la veille de son immigration en Israël depuis sa précédente terre d’exil aux États-Unis, il déclare : « Je n’embrasserai pas ta poussière comme ce grand poète, / Quoique mon cœur soit empli lui aussi de chants et de peines. / Que signifie embrasser ta poussière ? C’est moi, ta poussière. / Et qui s’embrasse donc soi-même, je vous le demande ? »

Intimité du yiddish
Quel entre-soi le yiddish permet-il ? Celui du dialogue intime, rappel des premiers échanges ? Celui des juifs opposés au reste du monde et vivant en même temps en son sein ? De nos jours, il est intéressant de constater que les hassidim s’entêtent à garder le yiddish, langue de leurs pères, mais langue issue de l’Europe, en même temps que le caftan et le shtreimel de fourrure, vêtements de leurs ancêtres, mais atours empruntés à leurs voisins polonais.
Le premier commandement de la Bible ordonne : « Tu quitteras ton père et ta mère » pour t’unir à ta femme. En suivant l’esprit de cette injonction, on ne rompt pas avec l’engendrement parental pour devenir un pur individu auto-généré mais pour engendrer et transmettre à son tour. On part alors de chez soi, pour rencontrer un homme, une femme, qui n’appartient pas à sa propre famille. C’est qu’aux côtés du langage, le système de la parenté et de l’alliance, fondé sur l’échange des femmes, est bien à l’origine de la société. Et qui n’a jamais rêvé de vivre hors de la société et de ses contraintes ? Claude Lévi-Strauss conclut ainsi Les Structures élémentaires de la parenté : « Aux deux bouts du monde, aux deux extrémités du temps, le mythe sumérien de l’âge d’or et le mythe andaman de la vie future se répondent : l’un [celui de Babel] plaçant la fin du bonheur primitif au moment où la confusion des langues a fait des mots la chose de tous; l’autre, décrivant la béatitude de l’au-delà comme un ciel où les femmes ne seront plus échangées [où l’on se mariera en famille] ; c’est-à-dire rejetant, dans un futur ou dans un passé également hors d’atteinte, la douceur, éternellement déniée à l’homme social, d’un monde où l’on pourrait vivre entre soi. »
Rêve élitiste de lettrés ou utopie nationaliste d’hommes nouveaux, l’hébreu moderne porte l’espoir de retrouvailles pleines et entières avec l’essence de la judéité pure et donc de l’identité pure. Il est agacé, jusqu’à nos jours, par la ballade de l’exil yiddish, qui « meurt, se souvient, et ne veut jamais disparaître » – Manger décrit en ces mots le pas ancestral des chameaux du désert d’Israël, qui transportent sur leur bosse « la Torah, la marchandise, et la vieille chanson errante ». De même peut-être, paradoxalement, que les yiddishistes laïcs et savants, qui ont voulu sacraliser et institutionnaliser le yiddish, en le défendant, depuis le début du XXe siècle, comme grande langue nationale, peuvent être agacés par la bâtardise vivace du yiddish des hassidim d’aujourd’hui, qui emprunte impudiquement à l’anglais le quart de son vocabulaire, persiste à se rire de la grammaire et de l’ordre établi des choses et, sourire moqueur aux lèvres, garde toujours entre ses dents un peu de jeu.
Macha Fogel