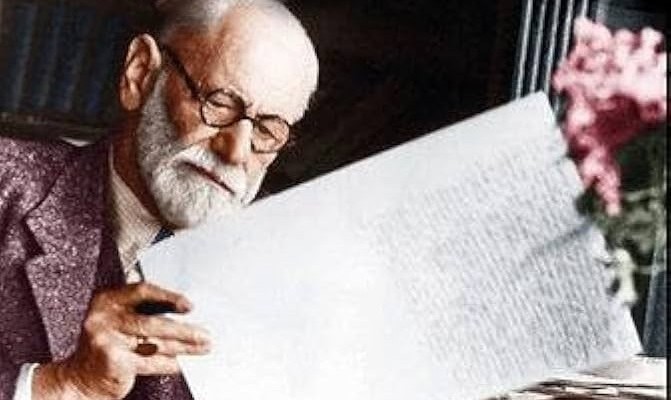Le yiddish, c’est bien connu, est une langue sans pays. C’est ainsi qu’on parle d’elle en tout cas ; et puis comme d’une langue assassinée, disparue, agonisante. Mais moi, je connais un pays yiddish. D’une certaine manière, j’en suis l’une des citoyennes et je vous donnerai régulièrement de ses nouvelles dans K. Premier tour d’horizon aujourd’hui de ce monde multiple et dispersé : les hassidim américains – qui sont aussi encore des Européens – et leur presse.

Ce pays yiddish est habité par ceux qui se désignent eux-mêmes comme des heymishe yidn : des juifs « de la maison ». De l’alter heym, la vieille maison d’Europe de l’Est, à la moderne Amérique, les heymishe yidn sont à la maison partout où ils parlent yiddish. Un ami de New York, hassid appartenant au groupe des Satmar, m’écrivait à ce sujet il y a quelques jours (en yiddish bien sûr) : « Vous, dans le monde séculaire, dites que le yiddish est mort. Mais il est bien vivant ! Aux Etats-Unis, en Israël, en Belgique et en Angleterre, une masse de centaines de milliers de personnes le parle et ne parle que lui, et prospère et fructifie. Les enfants, garçons et filles, les parents, les grands-parents… dans les quartiers heymish, tout parle yiddish. Dans la rue, à la maison, entre amis, à la synagogue, dans les écoles et les magasins, on chante, on étudie, on achète et on vend en yiddish. On ne le fait pas « pour sauvegarder » la langue, non. Chacun parle yiddish parce que c’est sa langue maternelle, celle dans laquelle il a grandi. Il est né avec, il vit avec et c’est dans cette langue qu’il mourra. »
On ignore souvent en France cette vitalité du yiddish non seulement outre-Atlantique mais en Europe même, à Londres, Anvers ou Zurich. Il est vrai que le monde hassidique peut sembler étrange, exotique, fermé sur lui-même. Mais il n’est pas si impénétrable que cela, d’abord parce qu’un grand nombre de ses protagonistes s’avèrent curieux du monde non-hassidique, en particulier lorsqu’ils rencontrent un « laïc » comme moi parlant yiddish. Ensuite parce les réseaux sociaux, qui se développent chez les hassidim comme ailleurs, offrent un accès facile à leurs discussions et à leur vie quotidienne. Pourtant, nombre de yiddishistes, c’est-à-dire de locuteurs séculiers de cette langue attachés à sa sauvegarde, ainsi qu’une majorité semble-t-il de « baby-boomers » ayant entendu le yiddish dans leur enfance et attachés pour cette raison à cette langue, passent à côté de ce dynamisme sans le voir.
Certains même dédaignent ce yiddish-là au prétexte qu’il serait parlé par des gens très religieux, ou bien parce qu’il perdrait de sa pureté en se teintant d’anglais. Cela me semble injuste. Avant l’essor des Lumières juives, au XVIIIe et surtout au XIXe siècle, le yiddish était exclusivement parlé par des juifs pratiquants, dans des sociétés fortement ritualisées. Les personnages de Sholem Aleichem, I.L. Peretz, Chaim Grade, Isaac Bashevis Singer… sont souvent eux-mêmes des hassidim. S’ils restèrent très peu impliqués dans la littérature comme acteurs, ils en furent souvent l’objet. Pourquoi ceux d’aujourd’hui seraient-ils en soi moins intéressants que ceux d’hier ?
Quant à l’évolution linguistique du yiddish : de nos jours, les mots d’anglais remplacent certes largement les anciens slavismes – presqu’aucun mot russe n’est plus utilisé dans le yiddish de Brooklyn. Mais n’est-ce pas naturel, et la preuve même de l’énergie de cette langue ? Le yiddish, né au Moyen-Age d’un mariage entre l’allemand et l’hébreu, a gagné au contact de siècles de pérégrinations est-européennes de nombreux éléments de vocabulaire et de syntaxe slaves, jusqu’à ce que les juifs soient exterminés dans les pays de l’Europe où avaient prospéré leur culture et leur démographie. L’horreur du hourbn (la Destruction) est un désespoir sans fond. L’angoisse endeuillée qui s’attache au souvenir des yiddishophones d’autrefois, revenants éternels, doit-elle fermer nos yeux à la survie et la prospérité du yiddish aujourd’hui ? Même si elle le devait, et je ne le pense pas, elle ne le pourrait pas, car c’est ainsi : la vie l’emporte.
Un troisième point de méfiance éloigne les cercles yiddishistes de la culture hassidique actuelle. Les hassidim parlent en yiddish, certes, mais l’écrivent-ils ? Créent-ils une culture littéraire, artistique dans cette langue ? Je comprends que l’on se sente mal à l’aise dans le monde séculaire d’aujourd’hui vis-à-vis de tout ce qui est pieux, que la pensée cartésienne et libérale se trouve désarçonnée, voire choquée, par le mysticisme comme par le rigorisme hassidique. Mais il n’y a, bien sûr, pas de raison de considérer ces juifs comme des hommes au rabais. Ils ont une tête, un cœur, cinq sens, ils pensent, ils aiment, ils haïssent. Leur accès à la littérature n’est pas nul ; à l’école, ils apprennent par cœur la Bible et ses commentaires – lire ne leur est pas étranger. Pourquoi n’auraient-ils pas soif d’art et de littérature ? Après plusieurs dizaines d’années consacrées à se refabriquer – à se refabriquer littéralement : à se marier et à concevoir des enfants, à travailler pour les nourrir, à étudier le Talmud et la Torah parce qu’ils sont le centre de leur vie – ces sociétés montrent aujourd’hui les signes d’une nette avidité culturelle. Il suffit de s’y promener pour le constater : depuis plusieurs années, les ouvrages de fiction se multiplient sur les étagères des librairies hassidiques de Brooklyn, de Londres et d’ailleurs.
Nul ne peut prédire l’avenir. Je me demande la première si les circonstances historiques du XXIème siècle permettront dans les décennies à venir le développement d’une culture yiddish à l’égal de celle qui a tourbillonné avant de disparaître un siècle plus tôt. Mais pourquoi pas ? Voyons ensemble, déjà, ce qui existe aujourd’hui.
Aux Etats-Unis, on compte environ 150 000 enfants, tous nés dans le monde hassidique, dont le yiddish est la langue maternelle. C’est peu par rapport à la démographie d’avant-guerre mais c’est une croissance gigantesque de la population hassidique telle qu’elle existait en1945, soit quelques dizaines de familles rassemblées à Brooklyn. Le New York Times présentait le portrait, il y a une dizaine d’années, d’une femme née en Hongrie, déportée à Auschwitz, rescapée, partie pour Anvers après la guerre avant de rejoindre en 1953 le quartier de Williamsburg, où les Hassidim de Satmar venaient d’établir leurs nouveaux quartiers. A sa mort en 2010, à l’âge avancé de 93 ans, on lui comptait 2000 descendants, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants[1]. Même à l’échelle satmar, cette « refabrication » est extraordinaire, mais d’une manière générale, la démographie de ce groupe hassidique connaît, avec neuf enfants par femme, une croissance exponentielle. En 2020, Unorthodox – une mini-série sur Netflix qui raconte le voyage d’une jeune femme échappée à son milieu satmar de Williamsburg à Berlin (et au sujet de laquelle je me propose d’écrire plus longuement dans une future chronique pour essayer de comprendre les raisons de son succès inattendu) dresse un portrait noir (et peut-être injuste) du milieu hassidique – même si, davantage que le récit de l’Américaine Deborah Feldman dont elle est tirée, la série des réalisatrices Anna Winger et Alexa Karolinski fait preuve d’une curiosité intellectuelle et artistique vis-à-vis de cette communauté si particulière, qu’elle s’efforce de peindre de manière authentique, notamment dans son usage quotidien du yiddish.
De façon paradoxale, les hassidim de Satmar n’étaient pas particulièrement yiddishophones avant la guerre. Il s’agissait chez eux d’une langue masculine, les femmes parlaient plutôt le hongrois. Leur leader, le rabbin Joel Teitelbaum, né en 1887 et mort en 1979, joua un rôle essentiel dans l’amarrage du yiddish en terres satmar. Il la décréta langue du groupe pour délimiter ses frontières avec la société environnante, américaine, belge, anglaise, australienne, canadienne… sans se laisser happer par le sionisme religieux, qui avait adopté l’hébreu moderne, l’ivrit, en même temps qu’une nouvelle conception territoriale et nationale du judaïsme. Teitelbaum était un leader charismatique. Le « système satmar » s’avéra redoutablement efficace, reposant, d’un point de vue économique, sur une entraide financière très puissante et sur une incitation au travail plutôt qu’à l’étude comme occupation principale des hommes (et assez souvent des femmes) adultes. Au fil des années, des groupes hassidiques minoritaires survivants ont rejoint son orbite, de sorte que ce courant est devenu essentiel dans le paysage mondial du judaïsme religieux actuel.

La culture, au sens laïc du terme, ne fut pas la priorité de Joel Teitelbaum, et c’est un euphémisme. Les premières années après la guerre, le courant satmar s’est développé sans elle. Pas de presse, pas de livres qui ne soient dédiés à l’étude de la Torah ou à la morale. Accès interdit à la littérature et aux journaux yiddish séculaires. Il existait des passerelles pour les individus, bien sûr : rien n’empêchait un hassid de s’acheter pour le glisser sous son caftan le Forverts (En mouvement) ou le Morgn Zhurnal (Le journal du matin) dans un kiosque de Manhattan, ou même Undzer Vort (Notre parole) s’il passait par Paris. C’est peut-être pour lutter contre ces interactions incontrôlées avec le « monde extérieur » que le leadership satmar décida de se doter, au milieu des années 1950, d’un organe de presse, en rachetant le journal Der Yid (Le juif), considéré jusque-là comme la voix de l’orthodoxie juive américaine. Ce journal historique de la communauté satmar put ainsi présenter des lectures convenables à ses hassidim, sur des sujets les intéressant, sous la surveillance d’une stricte censure.
La traductrice Rose Waldman explique très précisément dans un article d’In Geveb, A Journal of Yiddish Studies[2] comment, par la suite, la nécessité de créer du matériel pédagogique pour les écoles de filles permit les premières publications de livres dédiés à la lecture de loisirs, quand bien même il s’agissait alors uniquement de récits de hauts-faits rabbiniques. Les garçons, eux, restaient concentrés sur la Torah. Une chose en entraînant une autre, dans les années 1970, explique Rose Waldman, la publication satmar de livres en yiddish connut un premier élan, encore timide, avec les fictions de l’auteur Menachem Mendel. Le peuple souhaitait entendre des histoires. C’est à partir des années 2000, lorsque le monde hassidique eut atteint un certain poids démographique, que l’on vit réellement sa création artistique se développer sous différentes formes : littérature, musique, médias, divertissements… Depuis dix ans à présent, cinquante nouveaux titres de fiction sont publiés chaque année à destination des adultes, 30 à celle des jeunes enfants. Romans policiers, thrillers, récits dotés d’une analyse psychologique des personnages, bandes dessinées (avec représentation de figures féminines), biographies, ouvrages de développement personnel : on est loin des hagiographies pour écoles de jeunes filles des années 1970, conclut Rose Waldman.
Pour ce qui est de la presse, trois journaux hebdomadaires se font concurrence. En plus de Der Yid, deux organes ont vu le jour à la fin des années 1990 : Di Tsaytung (Le Journal) et Der Blat (Le feuillet). En traduisant des articles de grands journaux anglophones, Di Tsaytun a entamé un dialogue avec le monde « du dehors ». En publiant des photos en couleur, en adoptant un ton informel, à la limite du sensationnalisme, Der Blat en a accepté certains codes, que même le très sérieux Der Yid se permet désormais. Ces trois hebdomadaires ont professionnalisé leur écriture tout comme leur pratique du métier de journaliste. L’orthographe, la grammaire sont vérifiés, un ton de neutralité est de mise. Ces trois hebdomadaires, gros de centaines de pages, paraissent le mercredi. Ils sont achetés jusqu’au shabath, après quoi ils sont considérés comme « de vieux journaux », selon mes interlocuteurs. Ils sont très largement appréciés dans leur version papier mais on peut accéder à leur contenu par internet.

Dans leurs colonnes, on trouve : l’actualité politique nationale (« Les premiers défis de Biden »). Générale (« Tempêtes de neige sur le nord-est des USA »). Locale (« Andrew Yang candidat aux municipales de New York ». « Un projet de construction immobilière pour implanter un nouveau village hassidique au nord de New York soulève l’opposition du voisinage »). Communautaire (« Nomination d’un nouveau directeur à la yeshiva satmar de Lakewood »). Une section dédiée à l’actualité du Covid (« Sanofi propose un deal à Johnson and Johnson pour produire ses vaccins »). Les nouvelles du monde (avec une partie spécifique pour le Moyen-Orient). Les nouvelles des juifs d’Europe (« Abattage rituel interdit en Belgique : boom de la viande cacher en Hongrie ». « Un juif français lègue sa fortune au village du Chambon-sur-Lignon ». « Agression sauvage d’un jeune hassid à Anvers »)… Dans Di Tsaytung, vous verrez des pages saumon (elles sont vraiment de couleur saumon) sur l’actualité de Wall Street et de la finance. Der Yid contient en outre une sorte de « Femina », une section destinée aux enfants, une troisième consacrée à l’étude de la Torah.
A côté de ces trois journaux, des dizaines de brochures quotidiennes ou hebdomadaires sont publiées par chaque communauté et plusieurs magazines complètent l’offre à destination des adultes. Moment, hebdomadaire imprimé depuis 2014 sur un papier glacé des plus tentateurs, revendique 150 000 lecteurs à travers le monde. Il publie des photos à la Voici de célébrités hassidiques – exclusivement masculines – et des articles sophistiqués avec conseils conjugaux, de parentalité, de santé. Di Vokh (La semaine) fait elle aussi le tour des ragots et des photos de la semaine. D’autres encore, parmi lesquels Der shtern (L’étoile), Der blits (L’éclair), Baleykhtungen (Eclairages) proposent une offre du même ordre. A mes yeux, le plus prometteur est entre les mains de la presse jeunesse. En 2014, Kindlayn (Lecture d’enfants), connaît un succès immédiat auprès des enfants et adolescents. Sur la forme, un graphisme professionnel, sur le fond, des histoires, des bandes dessinées, des activités manuelles, des énigmes, des saynètes à mettre en scène, des discussions sur des points de la Loi, des sections scientifiques, historiques… Kindlayn vit sans publicité, uniquement de ses ventes. A tel point qu’un concurrent naît à son tour en 2017, Kinderlekh (Les gamins). Pas de crise de l’impression dans le monde hassidique.
Enfin, il faut parler d’un magazine un peu à part, qui sort tous les trois mois : Der veker (Le réveil)[3]. Ce magazine, qu’on peut acheter en kiosque dans les quartiers hassidiques ou bien commander sur Amazon, est issu de l’activité d’un forum internet hassidique, kaveshtibl (que l’on pourrait traduire par « le salon de thé »). Contrairement à un autre forum, i-velt (« le i-monde »), kaveshtibl n’est pas censuré. Sous pseudonyme, les internautes, en majorité de jeunes hommes mariés, y discutent de leur vie, de leurs difficultés ou de leurs aspirations, de leurs questionnements sur la foi, sur leurs communautés et leurs dirigeants, sur les tracas qu’ils rencontrent dans l’école où ils envoient leurs enfants et sur l’école dont ils rêveraient pour eux. Certains s’y lancent aussi des défis littéraires. Ils s’y échangent des informations sur la poésie anglophone ou yiddish non religieuse, découvrent les règles du style, s’échangent les paroles d’anciens poèmes, de chansons yiddish écrites entre les deux guerres. Der Veker, magazine à visée généraliste est né de ce terreau. Il est lu majoritairement par des hommes jeunes, mais aussi par des femmes. Il se démarque des organes de la presse « orthodoxe » par sa liberté de ton et de fond. D’ailleurs, il est mal vu par les plus sérieux, bien des lecteurs se font discrets pour l’acheter. Signe particulier, Der Veker publie des photos de femmes, pour autant qu’elles apparaissent dans les règles de la pudeur. Surtout, il contient une section aboutie de vulgarisation scientifique, une autre consacrée à l’Histoire, des interviews de personnalités appartenant au monde « du dehors », des réflexions sur le fonctionnement communautaire. Il rend compte librement des débats du moment, les abus envers les enfants par exemple. Il traite de questions personnelles sur la croyance. On n’y trouve pas la censure des journaux classiques évoqués plus haut. Enfin, Der Veker fait ouvertement preuve de curiosité à l’égard de la culture yiddish non religieuse et se montre ouverte aux contributions de tous ; à l’issue d’un concours littéraire lancé en 2017, il a même sélectionné parmi ses trois finalistes la petite-fille du professeur de yiddish parisien Yitskhok Niborski, Ethel Niborski, adolescente laïque de Jerusalem.
Dans un magazine américain de la presse yiddish séculaire (dont le sort est malheureusement plus à plaindre que celui de son équivalent hassidique), plus précisément dans le numéro hiver-printemps 2019 d’Afin shvel (Sur le seuil), le yiddishiste Isaac Bleaman interviewait le directeur du Veker, connu sous le pseudonyme de « Ruvn » (Ruben). Cet entretien mériterait d’être entièrement traduit, mais je me contenterai pour aujourd’hui de vous en livrer la fin. En réponse à une question de Bleaman, « Pensez-vous que Der Veker puisse rapprocher yiddishistes non religieux et hassidim de langue yiddish ? », Ruvn répond : « La langue yiddish a été comme déposée en gage entre les mains des hassidim et nous devons partager ce trésor avec quiconque est intéressé. Il est clair les hassidim peuvent aussi se montrer bons clients d’une information venue des juifs du monde séculaire. Nous sommes tous frères et Der Veker peut jouer un rôle dans un rapprochement si souhaitable ».
Dans un prochain numéro, découvrez la suite des aventures de la presse yiddish…