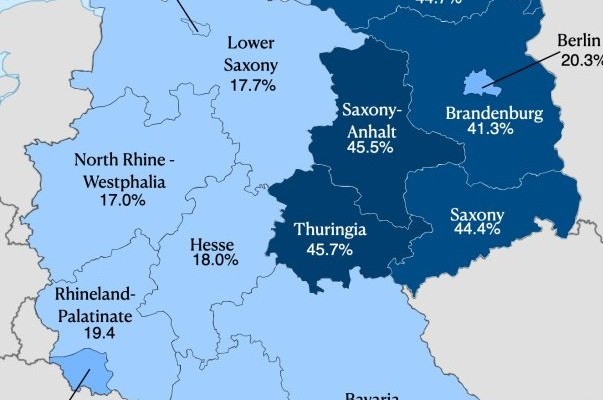Deux mois après le 7 octobre, Bruno Karsenti s’attache à décrire le tournant que représente un tel événement, pour Israël comme pour la diaspora. Une coordonnée existentielle du monde juif a été touchée, et si la réaction a été immédiate et forte de la part du peuple israélien et de son État, ce qui s’est produit n’en emporte pas moins la nécessité de penser à nouveaux frais les contraintes et les devoirs qui pèsent sur le monde juif tout entier. Ce qui engage aussi, et sans doute avant tout, de considérer la question palestinienne autrement qu’on ne l’a fait jusqu’à présent.

Dès qu’ont été connus les actes perpétrés le 7 octobre par les commandos du Hamas dans le sud d’Israël, la stupeur a suscité le besoin de les qualifier et de les nommer conformément à leur nature. Les opinions antisionistes n’ont pas eu d’hésitation : elles les ont convertis immédiatement en « actes de résistance », leur violence et leur cruauté ne se comprenant qu’à l’aune de l’oppression, jugée première et tout aussi inouïe, subie par les Palestiniens depuis la création de l’État juif. Tel ne fut pas le cas de l’opinion occidentale majoritaire, et singulièrement de celle portée par les gouvernants en Europe et aux États-Unis. Globalement, le choc fut grand et provoqua la réflexion. On tenta de prendre la mesure de la violence indiscriminée et de la passion exterminatrice qui s’étaient manifestées. Et l’on se mit en quête du mot juste pour parler du fait.
Un problème de qualification
Certains, qu’ils soient juifs ou non-juifs, ont immédiatement reconnu dans ce qui s’était produit l’expérience ancienne du pogrom. La référence ne fut pas sans soulever des objections – notamment du côté des défenseurs des droits des Palestiniens craignant qu’elle ne revienne à une « instrumentalisation de la mémoire de la Shoah » dans l’encodage d’un conflit dont la perception se trouverait par là-même biaisée. Ces objections se faisaient fort de souligner qu’il n’y a de pogrom stricto sensu, pour quelque population que ce soit, que lorsque la victime est une minorité dans un contexte où les persécuteurs – qu’il s’agisse de soulèvements populaires, de bandes armées organisées, ou d’un mélange des deux – appartiennent au groupe majoritaire. Puisque les violences ont eu lieu en territoire israélien, ce n’est pas le cas du 7 octobre. Là réside en effet la différence notable avec les pogroms répertoriés dans l’histoire moderne et contemporaine, qu’ils aient concerné les juifs ou d’autres peuples.
Et pourtant, c’est justement ce qui rend la catégorie pertinente. La distorsion qu’elle connaît sur ce point (et sur ce point seulement), permet de saisir deux choses : en quoi le fait a, par son mode opératoire, quelque chose de classique[1], sous-tendu par une tradition de violence collective faite à certaines minorités, parmi lesquelles les juifs ; et ce qu’il a, par sa localisation singulière, d’effectivement nouveau, s’agissant des juifs et de l’expérience récurrente qu’ils ont de ce type de crime.
Le terme de pogrom renvoie à ce que subirent les communautés juives de Russie et d’Ukraine entre la fin du XIXème siècle et les premières décennies du XXème siècle. C’est à cette période que s’est formée une catégorie lexicale applicable à rebours et permettant de mieux lire l’histoire juive dans tout son déroulement, depuis le premier siècle de notre ère jusqu’à l’époque contemporaine, la Shoah y figurant comme point d’orgue. De même, c’est à partir de là que l’expression a pu s’appliquer à d’autres groupes minoritaires victimes de crimes analogues.
Pour les juifs, le rayonnement du terme fut toutefois maximal pour une raison qui mérite d’être soulignée. Vivre en exil depuis la perte du temple et du royaume d’Israël en 70, ce que les juifs désignent par leur condition de Galout, signifie être exposé exactement à cela : au pogrom toujours possible, comme à une explosion de violence dont le milieu d’accueil est toujours susceptible, au gré des alliances dans la haine qui peuvent agréger des groupes divers, avec ou sans l’appui des autorités en place. En ce sens, on peut dire que pogrom et Galout ont partie liée. Ensemble, ils définissent l’absence constitutive de sécurité, l’insécurité qu’il est tout au plus possible de limiter, mais pas d’annuler, pour ce peuple qui, dépourvu de souveraineté, s’avère structurellement et pas simplement conjoncturellement minoritaire[2].

La création de l’État juif, et donc d’une souveraineté juive, fut sur ce point la grande nouveauté autour de laquelle s’était ordonnée tout entière l’époque post-Shoah. Non pas en tant qu’État théologique équivalent au royaume restauré – le sionisme, sécrétion de la pensée européenne moderne, ne vise rien d’autre qu’un État de droit où il est exclu que la religion constitue la loi – mais en tant qu’artifice politique modifiant localement l’insécurité juive fondamentale, celle que l’Europe avait rendu plus extrême qu’elle ne l’avait jamais été, l’Allemagne ayant, à l’échelle du continent, élevé la dynamique exterminatrice du pogrom au rang de politique d’État planifiée. La rupture revenait à ceci : il y a un lieu au monde où le pogrom est par principe neutralisé, c’est le lieu où les juifs sont majoritaires et disposent de la souveraineté étatique. Lieu toutefois paradoxal, puisque pour les juifs, l’être majoritaire ne peut-être que conjoncturel, relevant de l’exception. Elle vient se superposer à une perception de soi qui demeure marquée par l’ethos minoritaire, fond inéliminable de la condition juive, puisqu’inhérent à la façon dont le peuple se conçoit et s’organise globalement, répandu comme il l’est dans le monde. Tel est le point qu’il faut saisir : la condition exilique des juifs persiste, alors même que l’État d’Israël vient à l’existence. Et la difficulté est qu’elle persiste pour les juifs israéliens eux-mêmes, non certes en tant qu’ils sont des citoyens de cet État, mais simplement en tant qu’ils sont des juifs. C’est-à-dire en tant qu’ils appartiennent au même peuple que ceux de la diaspora.
Il est arrivé depuis 1948 que les juifs, quelque part, sont conjoncturellement majoritaires, quantitativement et qualitativement, sur le plan démographique et sur le plan politique. La dimension qualitative peut prendre plusieurs acceptions (où se mêlent des facteurs religieux et culturels de degré et de nature variables). Notons toutefois que ce n’est pas là une ambiguïté particulière à cet État, puisqu’elle est consubstantielle de l’idée de « majorité » présente dans toute configuration stato-nationale et au genre d’hégémonie qui en est le corrélat. Ce que le cas a par contre de singulier, c’est que la majorité conjoncturelle juive garde en elle la trace de la minorité structurelle : c’est la marque théologique, en un sens, qui demeure active dans cette construction d’un État moderne constitutivement laïc.
Ce n’est pas de la théologie politique – rien de la théologie ne passe dans la loi – mais c’est de la politique qui, en se disant juive, assume son exception au regard de l’existence juive ordinaire : Galout et pogrom peuvent donc être dissociés en un lieu du monde, dès lors qu’existe un État juif.
Sécurité existentielle : ce qui vient de bouger
De là peuvent suivre différentes conséquences quant à la forme et à la nature de cet État, quant à sa politique interne et à sa politique externe. Les courants de la politique israélienne, pour autant qu’ils restent dans l’orbite du sionisme, se divisent et s’affrontent à ce sujet depuis le début de l’histoire du pays. Ils héritent d’ailleurs en cela des options contradictoires du mouvement sioniste des débuts du XXème siècle. Ces différences peuvent être très significatives, en ce qu’elles présentent des versions plus ou moins conséquentes de la façon dont politique moderne et judaïsme se composent – ce qui a des incidences directes sur les processus sociaux d’intégration à l’œuvre dans le pays, et donc sur la façon d’aborder la question palestinienne. Quoi qu’il en soit, à un niveau qu’on peut dire préalable, l’important est de comprendre que l’État juif n’est pas une négation de la Galout, sans quoi il ne serait plus juif. Pour les laïcs mêmes – et l’on peut dire pour les laïcs surtout, dans la mesure où ils sont juifs – la fin de l’exil est entre les mains de Dieu, pas des hommes. Le trait théologique, ici, emporte paradoxalement une interdiction de théologie politique. Et c’est un trait qui, en droit, est porté par tous, indépendamment de la question de savoir qui est religieux et qui ne l’est pas. Que ceux qui se désignent actuellement comme « sionistes religieux » y fassent défection – introduisant un messianisme où Israël réaliserait la fin de la Galout – ne signifie à cet égard rien d’autre que leur sortie du paradigme sioniste, qu’ils assument d’ailleurs eux-mêmes quand ils évoquent un « nouvel Israël ».
La vraie nouveauté liée à la construction d’un État juif, par contre, c’est que la politique humaine des juifs peut effectivement neutraliser le pogrom. Ici, on a osé intervenir, se charger soi-même de son destin mondain, agir de façon autonome. Mais on l’a fait pour produire cette sécurité au sens juif, cette sécurité qui revient à ne plus être exposé, quelque part, à la forme spécifique de violence qu’est le pogrom.
Que cette sécurité au sens juif, collectivement conçue et perçue, doive se payer d’un accroissement de l’insécurité objective des individus – Israël étant un pays qui connut de fréquents conflits armés et qui se trouve en état de quasi-guerre depuis sa fondation, la population subissant des tirs de missiles et des attentats récurrents – cela n’ôte rien à la conquête sioniste : la sécurité au sens juif s’y réalise, plus et mieux que dans aucun centre de la diaspora, le plus préservé et tranquille qui soit imaginable. Même le centre américain, dont il apparut à certains moments de son histoire qu’il pouvait prétendre constituer l’autre exception n’a pas pu sur la durée tenir ce rôle. Car il ne peut y avoir de sécurité juive en ce sens collectif spécifique, que celle dont les juifs, présents à eux-mêmes de cette manière dans leur État comme ils ne peuvent l’être nulle part ailleurs, se chargent par eux-mêmes, sans s’en remettre à quiconque d’autre.
C’est à ce dispositif que le 7 octobre a porté atteinte, pour la première fois dans l’époque nouvelle de l’histoire des juifs ouverte en 1948. Un pogrom en Israël, dans l’auto-perception des juifs, bouleverse le rééquilibrage qui s’était instauré de leur condition de peuple. C’est le monde juif tout entier – que les individus adhèrent au sionisme ou pas, indépendamment de savoir où ils vivent – qui en est affecté. Une coordonnée d’ordre existentiel a bougé. Aujourd’hui, elle doit être fixée de nouveau. L’équilibre doit se restaurer – ce qui dans la suite directe de l’agression du 7 octobre, a dû forcément commencer par se faire en s’engageant dans une guerre visant l’anéantissement de l’agresseur et la sécurisation des frontières.
Mais cette restauration, si réassurée puisse-t-elle être dans la satisfaction des buts de guerre, n’effacera pas ce que le séisme a ouvert et a rendu présent à toutes les consciences. À quelle conséquences politiques cette prise de conscience donnera-t-elle lieu ? À quelle transformation de la politique de l’État juif, c’est-à-dire de ses orientations fondamentales – puisqu’il ne s’agit de rien moins que d’une reformulation du sionisme, dont la lancée sur l’axe de 1948 ne peut pas ne pas connaître une inflexion après 2023 – assistera-t-on ?
Israël-Palestine
Impossible évidemment de le dire à si peu de distance de l’événement. Ce qui est certain, c’est qu’il y aura forcément transformation, puisque le séisme a été profond et a touché aux fondations. Décrire le tournant pris, avec les options qu’il comporte, et sous réserve du cours que prendra la guerre et de ses répercutions, est néanmoins possible dès à présent. Le geste est même nécessaire si l’on ne veut pas se contenter de subir ce qui va arriver. Car il est clair que des choix décisifs ne peuvent plus être évités : ceux qui portent sur la contradiction qu’il y a à différer ou recouvrir le règlement de la question palestinienne, qui comprend celle de l’occupation et de la colonisation juives de territoires qui n’appartiennent pas à l’État juif. Ou encore, les choix décisifs qui consistent à affronter les conditions réelles de coexistence de deux peuples aux visées nationales contradictoires, dans un espace toujours en attente de sa structuration sociale et politique viable pour l’ensemble des parties en présence.
Ce que la lucidité tragique du 7 octobre a rendu manifeste, au travers même des actes antisémites génocidaires accomplis en Israël par le parti palestinien au pouvoir à Gaza, et dont la puissance s’étend à l’ensemble des territoires, c’est qu’il n’y aura pas de sécurité au sens juif, c’est-à-dire de neutralisation du pogrom, hors de la reconstruction, par-delà la guerre requise, de cette coexistence des peuples, avec le double mouvement qu’elle implique d’intégration et de séparation. Bref que si le sionisme veut aller au bout de son sens, alors la question palestinienne, sous tous ses aspects, doit devenir le centre de la politique israélienne.
Soulignons : ce qui l’exige maintenant, ce n’est pas simplement le droit international, les droits de l’homme, les droits des peuples à disposer d’eux-mêmes tels que tout État moderne se doit de les respecter. Ces standards, Israël s’est toujours efforcé d’y satisfaire dans les frontières du pays, menant une politique d’intégration de la minorité arabe fondée sur l’égalité des droits civils et politiques, un approfondissement des droits sociaux, et une reconnaissance étendue des droits collectifs revendiqués par les communautés. Ce qu’on a souvent manqué de relever, c’est qu’il l’a fait autant en tant qu’État de droit de facture européenne, qu’en tant que réalisation originale de la politique juive, dans son appréhension spécifique de la question des droits des minorités, où la sécurité au sens juif qu’on vient de décrire est enchâssée. Il demeure que la politique israélienne des deux dernières décennies, menée par une droite de plus en plus irresponsable, aveuglée par des crédos néolibéraux et conservateurs, a montré à travers l’illégalité entérinée de la colonisation dans les territoires occupés qu’elle pouvait déroger à ces principes, soit en invoquant la raison d’État, soit en faisant dériver l’État dans un sens expansionniste et colonisateur.
Or ce qui ne tient plus désormais, c’est la dérogation à ces standards, sous quelque forme qu’elle prenne. S’impose le respect le plus scrupuleux, au nom de l’État juif – non pas seulement en tant qu’il est démocratique et doit s’ordonner au respect des droits des peuples, mais bien en tant qu’il est juif. Car les deux paramètres, en Israël, ont toujours été intimement liés, et renvoient souterrainement l’un à l’autre. C’est exactement ce qu’il y a de juif dans l’État juif qui exige à présent de rompre avec la politique qui a prévalu depuis l’assassinat de Rabin en 1995, où l’on a recouvert la question palestinienne sous une question « sécuritaire » de facture classique – réprimer, « tondre régulièrement la pelouse », et ne pas se préoccuper de ce que les progrès des droits des Palestiniens en Israël et dans les territoires expriment de fondamental pour Israël même – qui est aux antipodes de son sens juif.

Le tournant du 7 octobre, pour autant que le 7 octobre a été un pogrom, fait toucher l’autre socle, c’est-à-dire l’autre idée de la sécurité, celle vraiment constitutive de l’État juif. Une idée pas moins exigeante quant à l’éradication de l’ennemi qui s’est montré plus actif que jamais, c’est-à-dire de tous ceux qui veulent la mort des juifs, dont le programme est la négation d’Israël comme État souverain légitime à majorité juive. Mais une idée qui se place néanmoins dans un tout autre horizon, puisque ce qui est visé, c’est en l’occurrence l’instauration du rapport singulier, exceptionnel historiquement et politiquement, entre majorité et minorité, encore et toujours à même de neutraliser la menace existentielle du pogrom.
Dans un tel horizon, la centralité de la question palestinienne resurgit autrement, car elle demande maintenant à être prise sous toutes ses dimensions – sans les confondre les unes avec les autres, mais sans en exclure aucune de l’équation à résoudre. Ces dimensions sont multiples, et la politique israélienne ne peut faire comme si certaines seulement, et pas les autres, la concernaient directement. L’appui premier demeure l’intégration sociale et politique qui ne cesse pas de se poursuivre dans les frontières du pays pour les Arabes israéliens, distincte de celle des Palestiniens des territoires, considérés comme engagés dans un processus de construction étatique et de nationalisation qui leur est propre. Si distinctes qu’elles soient, ces deux dimensions de la question palestinienne ne sont pas indépendantes l’une de l’autre pour Israël même. C’est l’ensemble de la problématique qui doit être embrassée, sur son versant de constitution d’une majorité palestinienne de ce qui doit devenir un État-nation, comme sur son versant d’intégration accrue de la minorité palestinienne au sein de l’État juif. Car, comme pour les juifs, il s’agit du problème national qui se pose pour un peuple qui ne laisse pas d’être le même peuple, dont l’existence se distribue sur des territoires et dans des entités politiques séparées.
Au fond, toute la difficulté se tient là : c’est d’un peuple un, mais affecté d’une distribution régionale différenciée et répartie sur plusieurs pays, comprenant à ce titre plusieurs diasporas très inégalement traitées – en l’occurrence, surtout jordanienne et israélienne, la dernière seule bénéficiant, il faut le souligner, de droits civils et politiques égalitaires – et en attente de la constitution de son État où il serait majoritaire, autonome et souverain, que l’on parle en fait lorsqu’on désigne « les Palestiniens ».
De cette population composite, mais dont il est nécessaire qu’elle soit en mesure de se reprendre dans son unité, la politique de droite israélienne s’est détournée, ou n’a voulu voir que la portion qui lui convient. À cet égard, elle a été profondément délétère. Mais il faut aussi noter qu’elle n’a pas été la seule à agir ainsi. L’opinion internationale s’est comportée exactement de la même manière, à la différence près qu’elle n’a le plus souvent voulu voir que l’autre portion de la même réalité. C’est ainsi que l’antisionisme qui a été croissant ces dernières décennies, subjugué par un anticolonialisme désajusté à la situation, a abstraitement massifié le peuple pour lequel il prenait fait et cause, avec pour seul gradient la situation d’occupation et de colonisation vécue en Cisjordanie et celle de blocus égypto-israélien vécue à Gaza. De même, c’est ce que les pays arabes engagés dans les accords d’Abraham, en connivence avec la droite israélienne, ont à leur tour recouvert. Et c’est enfin ce que les partis politiques palestiniens – car eux d’abord ont toute leur responsabilité – ne sont pas parvenus à articuler, ce qui a donné à l’islamisme, avec l’appui extérieur de la partie du monde musulman cette fois farouchement hostile à Israël – l’Iran, au premier chef – la place dominante qui est la sienne aujourd’hui, partout ailleurs en tout cas que dans l’opinion exprimée des Arabes israéliens.
Contentons-nous pour notre part de décrire le point de vue d’Israël. Aujourd’hui, sous l’effet du 7 octobre, cette problématique émerge à la surface et apparaît à nu. Il y a des Palestiniens au Proche-Orient, et ils comptent non pas à titre secondaire, mais à titre principal, dans la reconstitution de la sécurité au sens juif – c’est-à-dire de la raison d’être d’Israël. Leur intégration demande à être opérée à deux niveaux : en tant que minorité en Israël (comme dans d’autres pays où vit une minorité palestinienne, du reste) ; et en tant que majorité en attente d’auto-constitution dans ce qui sera leur État.
Celui-ci se devra d’être intégré intérieurement, comprenant donc des minorités qu’il intégrera en leur accordant des droits comme cela doit se produire dans un État de droit – la possibilité qu’une minorité juive y subsiste étant toutefois trop peu crédible pour que ne s’imposent pas d’autres solutions, soit d’évacuation, soit de redécoupage territorial avec cessions proportionnées, comme certains projets le formulent.
Mais cet Etat devra aussi être intégré extérieurement, c’est-à-dire dans un rapport pacifique et coopératif avec les autres États de la zone, parmi lesquels Israël. Bien entendu, un axe international régional consistant, centré cette fois sur la question palestinienne, est ici nécessaire – et l’on sait que des discussions vont déjà en ce sens – pour que le mouvement puisse espérer s’amorcer. Autrement dit, Israël n’est certes pas seul à compter dans l’élaboration de cette politique. Mais il doit y jouer sa partition, et il le doit d’autant plus que, se reconsidérant lui-même après le 7 octobre, il comprend qu’il en va dans son engagement de rien moins que de la restauration de son identité d’État juif, attaché à la construction et à la consolidation de la sécurité au sens juif.
Israël-diaspora
Il y a plus. Si l’on est ici conduit à reconnaître qu’intérieurement différenciés, les Palestiniens n’en sont pas moins un peuple un, légitimes à soutenir une revendication nationale pour l’ensemble de ceux qui se reconnaissent comme appartenant à ce peuple, si l’on ne cède ni sur sa différenciation interne ni sur son unité – puisque l’une et l’autre sont les paramètres réels de l’équation – c’est surtout parce que l’on part du point de vue juif, et pas seulement du point de vue israélien. Autrement dit, c’est parce qu’on adopte le regard des juifs sur eux-mêmes, éminemment conscients qu’ils sont d’être un peuple un – sensibles constitutivement, qu’ils soient sionistes ou pas, à ce curieux aphorisme de Herzl lancé dans l’État des juifs : « Nous sommes un peuple, un peuple un ». Et en somme, l’expérience actuelle en atteste. Ce qu’on vient de vivre ne concerne Israël que parce qu’il concerne le monde juif dans son ensemble, le peuple dans son extension et son unité. Tous, de par le monde, ont subi l’onde de choc et ont perçu qu’une modification de leur condition s’était produite. Comme si s’enclenchait une redécouverte de l’intégralité de ce monde disséminé, considéré dans son équilibre dynamique, c’est-à-dire dans sa reconfiguration sur le fil de sa longue histoire.
Le 7 octobre résonne ici d’une manière particulière, qui déborde Israël, ou plutôt l’enveloppe et le requalifie. Ce à quoi on a assisté, ce à quoi ont assisté tous les juifs, situés pour ainsi dire au premier rang et fixant leur regard sur ce qui s’est produit dans les villages et les kibboutz frontaliers de Gaza, c’est à la reconduction brutale, pour un temps bref mais qui fut d’une cruauté implacable, du centre israélien au statut de centre diasporique comme un autre – voué à la même insécurité que n’importe quel autre, et donc toujours susceptible d’être destitué de son exceptionnalité.
La leçon existentielle de l’événement, qui vaut pour les juifs israéliens comme pour les juifs du monde entier, repose sur cet énoncé : la neutralisation miraculeuse et pourtant humaine réalisée par l’État juif ayant failli, l’homogénéité de la condition juive comme existence diasporique en Galout a refait surface, et s’est imposée avec un coefficient de réalité supérieur à ce qui était perceptible auparavant. Tandis que pogrom et Galout, partout associés, s’étaient dissociés en un lieu unique, il est arrivé qu’ils se soient réassociés en ce même lieu unique. Il y eu un pogrom en Israël. Plus encore, celui-ci fut de loin le plus meurtrier que les juifs aient connu depuis le nazisme. L’unicité s’est renversée, le pire s’y est réalisé. De sorte que ce n’est plus le savoir que le peuple dans son ensemble est toujours et encore en Galout, mais celui qu’un pogrom puisse toujours advenir n’importe où, qui homogénéise aujourd’hui de nouveau l’expérience juive.

De nouveau ? Le présent d’après le 7 octobre, dans lequel nous sommes déjà, ne serait-il alors qu’un retour dans le passé ? En un sens, il peut sembler que ce soit le cas. Il semble que l’on renoue avec la condition juive d’avant 1948, celle de la possibilité du pogrom partout, sans exception territoriale. La condition diasporique juive dont la prééminence resurgit, comme ce qui s’est toujours tenu sous le rapport entre les juifs répartis dans les nations étrangères et l’État juif qu’ils se sont donnés, mais qui a pu, dans la séquence 1948-2023, être inscrite dans une polarité relativement stable, de sorte qu’il semblait qu’à chacun des deux pôles, on pouvait presque s’abstenir d’y penser.
Pratiquement, il semblait qu’on vivait dans un espace ainsi structuré : insécurité juive versus sécurité juive, diaspora versus Israël. Tout le monde s’en était accommodé. Or ce n’est plus ainsi que les choses se présentent maintenant aux esprits. Après le 7 octobre, le versus a été atteint. Et c’est une autre liaison que l’on doit chercher à lui substituer. Sans que les deux pôles se confondent, leur distinction et leur articulation sont à scruter, et au fond à redéfinir.
L’exception que représente Israël demeure, mais après ce qui est arrivé, inexorablement, elle se complique d’une inquiétude quant au véritable sens qu’elle prend et aux conditions actuelles de sa préservation. Soulignons : l’altération ne tient pas au fait que sa fragilité soit perçue en tant qu’État menacé – cela, il n’a jamais cessé de l’être, et jamais le regard juif ne s’est départi de cette pensée inquiète, attentive aux dangers qu’on savait permanents. Que son armée puisse être défaite sur le champ de bataille, que le territoire puisse être envahi par des armées ennemies, c’est là une éventualité avec laquelle l’État s’est pour ainsi dire construit, et que les juifs de la diaspora ont eu constamment à l’esprit. 48, 67 et 73 ont été des pics dont la mémoire ne s’est jamais effacée. Mais il faut ici le répéter : l’insécurité des Israéliens n’est pas en contradiction avec la sécurité juive. L’une et l’autre ne se situent pas sur le même plan : en tant que peuple, les juifs vivent en sécurité en Israël, parce que leur survie de peuple y expérimente au quotidien – le 7 octobre faisant pour la première fois rupture sur ce point exact – sa condition fondamentale : la neutralisation du pogrom, qui n’est pas la guerre.
Disons-le autrement. L’insécurité en Israël vient exclusivement de la guerre. C’est pourquoi, si obsédante soit-elle, elle n’a jamais porté préjudice au ressort existentiel qui non seulement fait tenir, mais anime en profondeur l’existence des juifs dans ce pays. Et qui fait que, quoi qu’on en dise et qu’on en veuille, quoi qu’il en soit des difficultés objectives qu’il y a à y vivre, les juifs y respirent un autre air que partout ailleurs. Bref, le fait d’être ou de ne pas être en guerre ne touche pas le niveau existentiel de la vie juive, comme vie en Galout. Ce qui y touche en revanche, c’est d’être ou ne pas être menacé par les complexions de violences de degrés et de nature variables émanant des forces sociales et politiques non-juives, qui peuvent à tout moment se déchaîner. Et le 7 octobre a affecté exactement cela. Il a même été leur déchaînement inouï.
C’est pourquoi, au-delà des considérations ayant trait à la guerre et à la restauration de l’hégémonie militaire, au-delà de la dissuasion rétablie, au-delà des relations internationales reconfigurées à l’avantage de l’État, au-delà même de l’élimination de l’ennemi désigné du moment (à savoir l’islamisme politique représenté par le Hamas et par l’ensemble des mouvements qui peuvent s’y apparenter dans leur volonté de détruire et d’éliminer toute présence juive au Proche-Orient), demeure le problème crucial du moment, le nouveau problème juif en somme. Il a son épicentre en Israël mais, il rayonne dans l’ensemble du monde juif : fonder un nouveau ressort vital, en configurant autrement la grande polarité qui a prévalu pendant soixante-quinze ans. L’exception, donc, vient se placer à nouveau sous la lumière de la règle, elle qui avait depuis 1948 éclairé la règle en se marquant comme exception. Le foyer lumineux s’inverse. Et il n’est pas d’autre option que d’édifier le monde juif sur des bases nouvelles, où il puisse venir ré-adhèrer à sa propre règle en repensant ce qui lui permet de se structurer à l’aide d’un État juif, qui puisse faire véritablement et définitivement exception à la règle – dissociant à nouveau, en un point devenu pour cela essentiel à l’expérience juive, pogrom et Galout.
Cette tâche, on voit bien qu’elle est impartie au monde juif tout entier, et pas à Israël seul. Son épicentre se trouve dans la poursuite d’un travail intellectuel et culturel, et pas seulement d’une stratégie politique. Comme c’est le cas à tout moment où un degré plus élevé de conscience collective est exigé, c’est toute l’histoire des juifs qu’il faut rependre, en fonction des interrogations et dilemmes que le présent déterminé par le 7 octobre a fait naître.
Mais c’est un travail intellectuel qui ne quitte pas l’épaisseur du présent. En l’espèce, le levier gît au cœur de l’événement déclencheur, dans ce qu’il a mis en évidence, ou du moins a fait affleurer de sorte qu’il est impossible de l’oublier : l’unité d’expérience du peuple, qui fait que la polarité entre Israël et la diaspora reste asymétrique, le fond existentiel juif résidant dans la seconde et surdéterminant le premier. À partir de 1948, certes, cette unité a fait place à une dualité intérieure qui a permis aux juifs – en tout premier lieu aux juifs européens – de retrouver force et vitalité. Mais c’est maintenant d’un autre rapport à soi que ces éléments dépendent. En somme, c’est au tour de la diaspora, spirituellement et dans les faits, en éclairant depuis elle-même le sens et l’inclinaison de la polarité, d’aider Israël à se reconstruire après le 7 octobre.
Bruno Karsenti
Notes
| 1 | Dans un entretien du 18 octobre 2023, paru dans K., Michael Walzer parlait ainsi, avec beaucoup de justesse, d’un « pogrom à l’ancienne, d’une grande amplitude ». |
| 2 | Je prolonge ici les analyses que nous avons développées Danny Trom et moi dans plusieurs articles de la revue K. Voire en particulier celui, consécutif au 7 octobre, « Depuis le pogrom ». |