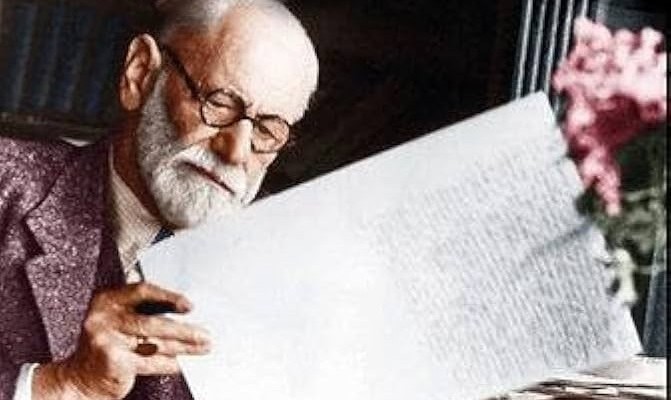Vladimir Jankélévitch est né il y a 120 ans, en 1903. La biographie de ce métaphysicien et moraliste, mais aussi résistant entré en clandestinité en 1941 – Vladimir Jankélévitch. Le charme irrésistible du je-ne-sais-quoi, de Françoise Schwab (Albin Michel, 2023) – est parue cette année. Elle a été suivie d’un Cahier de l’Herne et de l’édition d’un volume entièrement consacré à ses textes sur le judaïsme : La conscience juive (L’Herne, 2023). Dans ce contexte éditorial, Avishag Zafrani s’interroge sur quelques aspects de son rapport à la conscience juive après la Shoah, à partir d’une interprétation du temps juif, qui se distingue notamment du temps tragique.

Dans le film Bleu du réalisateur Kieslowski, il est une scène dans laquelle Juliette Binoche, installée dans un café parisien, prend le temps de faire fondre son sucre dans son café chaud, lentement, présente et absente à son propre geste anodin. Et pourtant l’entre-deux de la dissolution du sucre dans le café illustre une transition et sans doute la métamorphose d’une personne qui doit apprendre à vivre seule, frappée par une tragédie dont la douleur est indicible. Kieslowski explique, lors d’un cours, la teneur de ses cadres, la mesure du temps nécessaire à la fonte du sucre, les prises de vue devant signifier que le monde devient son monde, qu’il s’unifie et se singularise simultanément autour d’une intériorité rendue ici visible.
La durée dynamique, le drame vécu et son dépassement, sont quelques-uns des termes par lesquels Jankélévitch aborde le temps de la condition et de la conscience juive, oscillant entre la futurition des prophètes et l’expectative messianique. Ce faisant, il ne s’agit pas seulement d’essayer de déterminer les contours de la conscience juive, notamment après la Shoah, mais aussi de critiquer les philosophes pseudo-tragiques, et probablement celui dont il ne veut plus prononcer le nom : Heidegger.
Autre fait d’importance : les phrases les plus claires à cet égard, se trouvent dans un des chapitres ajoutés après la guerre, dans son Henri Bergson, paru initialement en 1931 — en réalité un appendice intitulé « Bergson et le judaïsme ». Nous aurons en effet reconnu dans l’expression de durée dynamique un motif temporel bergsonien. Par cette entrée, Jankélévitch va situer Bergson encore du côté du judaïsme – tandis qu’il sait que ça ne lui aurait pas plu. Mais il va également dire quelque chose de son propre positionnement philosophique, moral, distinct des philosophes contemporains du désespoir et de la déréliction, manifestant sans doute une complaisance pour l’angoisse, de type romantique-pessimiste, alors qu’ils « n’ont pas vécu les tragédies que nous avons vécues[1] ». Ce morceau de phrase extraordinaire, car il contient une accusation de complaisance, mais aussi une accusation d’usurpation de la posture tragique, se situe donc dans le chapitre « Bergson et le judaïsme », dans lequel les temps juifs et bergsoniens[2] sont rapprochés. « De même, écrit Jankélévitch, que Bergson doit attendre que le sucre fonde dans son verre (car personne ne peut comprimer le temps de fusion, ni en général la durée des changements d’état, et le temps physique est aussi incompressible que le temps biologique d’une fièvre), de même Israël doit attendre la venue de son messie ».

Bergson ne se serait finalement pas converti au christianisme, alors que les conclusions des Deux sources de la morale et de la religion semblaient indiquer le contraire, par l’intérêt manifeste porté aux mystiques chrétiens, mais aussi à cause de la place diminuée faite au judaïsme, effet au moins d’une profonde méconnaissance selon Noé Gottlieb[3], cité par Jankélévitch dans son texte. Quelles sont les raisons de cette non-conversion, si elle était avérée[4] ? S’agissait-il de ne pas se désolidariser de ses coreligionnaires dans un temps de persécution ? La raison a été avancée, mais elle ne paraît pas suffisante à Jankélévitch. Dans les Cahiers de l’Herne qui lui ont récemment été consacrés, on trouve ces lignes extraites d’un entretien datant de 1967 : « En fait, une non-conversion pour des raisons exclusives de circonstance pour ne pas quitter ses coreligionnaires me paraîtrait injurieuse pour la religion de ses pères, le judaïsme. En réalité, il y avait des raisons philosophiques à cette non-conversion. D’ailleurs il aurait pu se convertir après son ouvrage écrit entre 1925 et 1930 : Les deux sources de la morale et de la religion. Rien ne l’en empêchait : pas les circonstances en tout cas. S’il ne l’a pas fait c’est qu’il ne pouvait trouver dans la religion de satisfaction philosophique complète. Il avait seulement une philosophie de la charité ». Bergson, par le détour d’une philosophie de la durée, attendait peut-être encore patiemment son messie. Jankélévitch ajoute « Oui, Bergson a révélé des traits juifs : cet optimisme, ce refus du problème de la mort, sa recherche de la plénitude de la vie, l’influence des prophètes. Mais il n’aurait pas aimé qu’on le dise. Du fait justement de son flirt avec l’Église catholique, lequel lui valait d’ailleurs l’inimitié de Juifs comme Edmond Fleg qui voyait en lui le futur converti. Cet attachement aux siens le poussa à vouloir rester avec eux à Paris au début de l’Occupation. C’est ainsi qu’il prit froid début 1941, mourut et eut un véritable enterrement « à la sauvette » [5]». Jankélévitch a donc sans doute ajouté l’appendice « Bergson et le judaïsme » après la guerre, pour ne pas le heurter d’une part, et puis aussi parce que les « traits juifs » de Bergson devaient lui apparaître plus clairement encore dans son opposition personnelle mais « d’instinct métaphysique » aux philosophes pseudo-tragiques, tandis que toute la philosophie de Bergson se distingue d’un « pathos » de la mort.

Autre philosophe à la marge du judaïsme, qui rompt avec toute possibilité d’un pathos de la mort : Spinoza, dont le nom apparaît à plusieurs reprises dans ce chapitre et dans le livre tout entier. Mise en abîme supplémentaire de la contradiction : Bergson, lors de la première publication du texte de Jankélévitch sur sa pensée, le félicite de l’avoir aussi bien compris et souligne l’importance de la mobilisation de Spinoza, pensée qui lui est un foyer, alors même que ses thèses lui sont opposées. Trouver un foyer à l’opposé de soi-même, chez un auteur Juif dont on dit également que l’intérêt pour le Christ (dans le Traité Théologico-politique par exemple) dénotait une valorisation du christianisme et un désir de conversion – mais qui ne s’est pas converti — est un pas-de-deux qui revient peut-être au même endroit. Quel est donc ce lieu, « au carrefour » ? Est-ce un non-lieu de type finalement utopique, expliquant la conversion impossible, et inutile, en dépit de l’excommunication, en dépit de l’assimilation ?
Quoi qu’il en soit de ces spéculations, la réflexion en sourdine, dans le silence du nom de Heidegger, porte non seulement sur la possibilité d’une « nihilisation » de la mort, mais sur l’affirmation d’une transcendance de la durée, qui fonderaient une philosophie morale de la liberté, concrète, ainsi qu’une éthique de la joie. La nihilisation de la mort doit s’entendre de la manière suivante : non pas nier la mort évidemment, dont la conscience est un aiguillon de l’existence, mais décider de la primauté d’une persévérance dans l’être. Plus encore, car tout ceci peut paraître abstrait, il faut lier l’angoisse et le désespoir à un contexte réel, et non pas à un positionnement ontologique séparé des drames qui engendrent ces conséquences « psychologiques ». Est-ce l’être-au-monde qui génère une angoisse consubstantielle à l’existence ? Nous avons eu l’occasion de montrer ailleurs[6] que ce positionnement indiquait une préférence pour un sentiment d’aliénation de type gnostique (et qu’il y avait un antisémitisme métaphysique de la gnose). Lorsque Jankélévitch évoque les philosophes pseudo-tragiques, il indique l’absence de réel contexte tragique de ces philosophes, tout comme il écrira que pour avoir été un philosophe engagé, il faut avoir couru un danger, au-delà du danger de vivre en soi. Quelles sont les causes prochaines du danger, de la mort ? Sans doute, par exemple, dans le fait de résister, ou d’être persécuté, semble dire Jankélévitch. L’engagé est paradoxalement celui qui n’en a pas fait une philosophie, ainsi le lieutenant et philosophe Jean Cavaillès. Il ajoute un élément qui permet de montrer un usage corrompu de l’angoisse comme moteur philosophique, dans la mesure où une philosophie morale prend en charge de la dépasser.
Notons que la philosophie, selon Jankélévitch, est de nature morale, dans la mesure où elle doit permettre les conditions du jugement, autrement dit de l’application pratique de la pensée – il n’y a ainsi pas de « tour d’ivoire » du philosophe (Jankélévitch écrit exactement, « il n’y a pas de tour et elle n’est pas en ivoire »), semblant répondre à la considération de la position d’Heidegger pendant la guerre (et même avant et après) par Hannah Arendt, successivement dans une tour d’ivoire et dans un terrier de renard. Cependant, la philosophie morale n’est pas ostentatoire, sinon elle tombe dans les affres d’une philosophie de l’engagement critiquée par Jankélévitch. Elle ne revendique pas sa propre vertu, elle n’a pas non plus l’ambition de dire, ou de récupérer, la totalité de l’Être oublié ou perdu. Elle s’effectue sous l’angle du je-ne-sais-quoi et du presque-rien, qui sont les deux concepts de la pensée non systématique, mais bien dialectique, de Jankélévitch. Il faut voir comme elle s’exerce, au fil de ses textes, subtilement, dans son sens littéral, sous la toile, donc bien de manière non ostentatoire, évoquant les divers sens d’un mot, d’un propos, leurs dimensions littéraires, leurs échos musicaux, et tout ce que l’on peut en dire ensuite à l’inverse, à un rythme soutenu – comme s’il avait trouvé le secret de la pensée perpétuelle et montrant par là qu’il n’y a pas de thèse définitive. D’où la difficulté à trouver une pensée capable d’orienter l’action juste, autrement dit, la vie morale. Précisément celle-ci naît d’une volonté libre, entre les circonstances et les contraintes, comme « surplus » indéterminé, ce qu’une philosophie du je-ne-sais-quoi et du presque-rien indique. Sans pouvoir par conséquent en dire plus, on notera cependant que la possibilité de l’indéterminé s’oppose à l’aliénation comme premier et dernier diagnostic de la vie, c’est-à-dire aux théories où la vie est déjà épuisée d’exister. Parmi les traits juifs de Bergson, Jankélévitch circonscrit aussi cet espace pour la « novation », dans l’inachevé de la création biblique, ainsi que dans la futurition des prophètes, de sorte que « la lévitation l’emporte sur la gravitation[7] ».
On sait que Jankélévitch, qui fut spécialiste de Schelling, mais aussi musicien et musicologue, renonça à la philosophie allemande et à la musique allemande, après la guerre. Ce qui était l’expression d’une pensée nocturne, romantique, appréhendant le mystère, idéaliste, avant la guerre, est devenue l’origine d’une pensée de la confusion, détournée voire méprisant la raison, mais surtout se retournant contre elle. A la recherche d’une philosophie concrète, il retrouve dans la littérature russe et en particulier chez Tolstoï les marques de la plénitude et de la béatitude bergsonienne, mais, point essentiel, les récits tolstoïens lui inspirent non seulement la pensée de « nihilisation » de la mort, mais aussi celle du « drame vécu ». Il est sans doute important d’y revenir brièvement, car ces distinctions doivent nous permettre de comprendre les différences entre le tragique et le drame vécu, et par conséquent à nouveau le « pseudo-tragique ».
Selon Jankélévitch, Léon Chestov est un philosophe tragique, mais aussi comme Tolstoï, philosophe du drame vécu. On trouve précisément dans Philosophie de la tragédie de Chestov de précieuses indications sur ce sujet, notamment à partir des vies et des écrits de Dostoïevski et Nietzsche. Les cheminements conjoints de ces deux figures mènent à la fin des idéaux, des illusions, et soit à un genre de conversion, soit à une transmutation des valeurs pour le second. Seulement, pour en arriver à « briser les idoles », qu’il s’agisse de Bielinski ou de Wagner, il faut une expérience intérieure profonde, le reniement d’un passé provoquant une nouvelle lecture de la réalité. Cette chute produit déjà le cadre d’une perception tragique du monde, elle est une remise en cause radicale des croyances, révolutionnaires ou autres. Elle produit aussi le sens psychologique abordant la connaissance de l’homme par ses motifs viscéraux, sa vie souterraine pulsionnelle, amorale, qui devient dès lors la matière littéraire privilégiée d’un réalisme cruel. Mais, il n’y a pas de « goût » pour le tragique. Chestov écrit « …ceux qui expriment les instants tragiques, craignent les tragédies réelles, les tragédies de l’existence, tout autant que les autres hommes (…) Dostoïevski n’avait nul goût pour la tragédie et évitait autant que possible le tragique dans sa propre existence (…) Il s’efforça d’oublier le bagne mais le bagne ne l’oublia pas.[8] » Le tragique pour Chestov renouvelle le dualisme chair-esprit, dans un temps où l’idéalisme assurait la raison de la maîtrise de la nature. Il exprime cette tension et cette lutte qui confine à la folie, et cherche aussi des rédemptions.
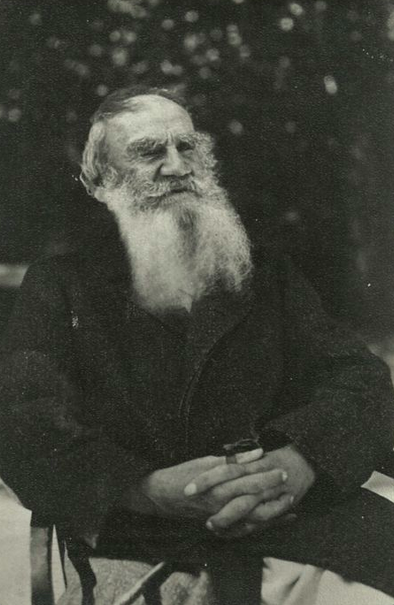
Tolstoï, auquel Chestov consacre également des écrits (notamment dans les textes de Sur la balance de Job) s’il ne renonce pas à l’idéalisme, est cependant aussi dominé par la question du pêché. Mais il devient chez Jankélévitch l’écrivain du « drame vécu », expression similaire à celle qu’il utilise pour critiquer les pseudos-tragiques, et pour faire référence à ses propres drames, et à ceux des juifs, à ceux des résistants. Si Jankélévitch lui-même, comme Bergson, n’est pas un philosophe tragique, il travaille la question de la mort, notamment à partir de 1940, lorsqu’il s’est réfugié à Toulouse, auprès d’étudiants dont certains rejoindront la résistance française. La véracité du drame vécu chez Tolstoï est décelée grâce au regard médical de son père, Samuel Jankélévitch. Né à Odessa, devenu médecin à Montpellier, premier traducteur de Freud en France, il préparait un livre sur la mort chez Tolstoï, non achevé, et avait fait remarquer à son fils combien les descriptions des agonisants étaient justes et précises dans ses récits. De sorte que, ici le drame vécu signifie une connaissance sensible du réel, mais aussi dans la perspective tolstoïenne, indique la volonté, tragique, d’accéder au mystère de la mort, et à un aperçu de l’immortalité déduit d’une forme de panthéisme universel. Le tragique s’exprime dans cette volonté de « nihiliser » la mort[9] tandis qu’elle est connue et décrite de manière si concrète, par une conjuration de la mort ou de l’angoisse.
A la lecture des textes sur la mort, le drame vécu, le tragique, de Jankélévitch, doit-on en déduire tout simplement que le pseudo-tragique pêche par excès d’abstraction, et qu’il ne sait pas de quoi il parle ? A ce point que lorsqu’il s’agira d’évoquer la mort sous la forme de l’assassinat par extermination, il emploiera l’expression indifférente de « la fabrication de cadavres » ? Peut-être. Le sujet devrait évidemment être infléchi du côté de la mort non naturelle, mais ces éléments ne peuvent manquer d’interpeller étant donné leurs récurrences et leur capacité à informer sur la perception du drame.
La morphologie judaïque qui demeure dans la pensée de Bergson, telle que l’entrevoit Jankélévitch, montre pour sa part que le centre de réflexion est déplacé, le néant n’apparaît plus digne d’intérêt, il est plutôt un motif d’ « embourgeoisement » de la pensée, il n’en naît pas en tout cas une philosophie. « Dans la Bible, comme chez Bergson, le rapport de l’homme au temps est un rapport affirmatif »[10]. La durée intensive articule cette affirmation et le processus continué du temps, forme de mobilisme universel plutôt que de panthéisme.
Avishag Zafrani
Notes
| 1 | Vladimir Jankélévitch, Henri Bergson, P.U.F., Paris, 1959, p. 269. |
| 2 | Ibid., p. 261. |
| 3 | Noé Gottlieb, « D’une erreur fondamentale dans les « Deux sources » de M. Bergson », Revue des Études juives, XCV, n°189 (1933), p.4. |
| 4 | Les avis divergent. Cependant dans le livre de Philippe Soulez, Bergson Politique, Bergson n’aurait pas été baptisé. Il est question dans les dernières lignes du chapitre « Conclusion – De l’action à l’acte, le testament de Bergson. Bergson face au nazisme » d’un non-baptême de Bergson, puis Soulez écrit : d’autres actes significatifs furent posés par Bergson. L’Encyclopedia Judaïca indique que Bergson s’est fait enregistrer comme Juif en dépit de la dispense dont Vichy voulut le faire bénéficier. Le témoignage de M. Neuburger ainsi qu’une lettre de J. Chevalier dont nous avons pu prendre connaissance nous amènent à penser qu’il en fut bien ainsi. L’Encyclopedia Judaïca ajoute que Bergson aurait démissionné de toutes ses « fonctions honorifiques » ». (Philippe Soulez, Bergson Politique, P.U.F, Paris, 1989, p. 327). Néanmoins, la question de la non-conversion n’est pas isolée d’une phrase de Bergson sur les Juifs, leur attribuant une responsabilité dans la montée de l’antisémitisme, dès lors que certains s’étaient engagés dans le bolchévisme. Que fait donc Jankélévitch lorsqu’il revient, après la guerre sur ce sujet ? Il projette certainement un Bergson qui a traversé la guerre, su pour ses coreligionnaires, et pour l’extermination. Ce Bergson fictif aurait-il maintenu cette attribution de responsabilité de l’antisémitisme à quelques Juifs dont les engagements idéologiques ne lui plaisaient pas ? Jankélévitch suppose, et espère, que non. |
| 5 | In Jankélévitch, dir. Françoise Schwab, Jean-François Rey, Pierre-Alban Gutkin-Guinfolleau, Editions de l’Herne, Paris, 2023, p.156. |
| 6 | Avishag Zafrani, « De l’antisémitisme métaphysique« , K., 19 janvier 2022. |
| 7 | Vladimir Jankélévitch, Henri Bergson, op.cit., p. 281 |
| 8 | In Léon Chestov, Philosophie de la Tragédie, Dostoïewsky et Nietzsche, Éditions de la Pléiade, Paris, 1926, p. 24. |
| 9 | Voir notamment l’article « Tolstoï et la mort », et l’entretien « L’insupportable mystère de la mort », in Jankélévitch, op.cit., p. 149 et p.154. |
| 10 | Vladimir Jankélévitch, Henri Bergson, op.cit., p. 280. |