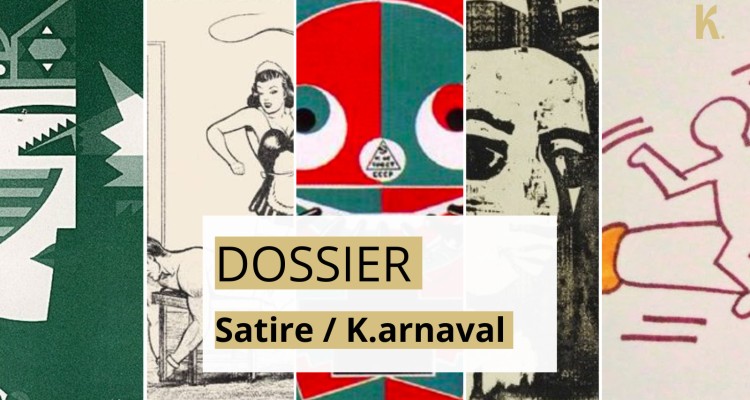Où les Rothschild du « petit lieu » apprennent qu’il y a aussi des Rothschild à Londres et à Paris…

Tous les Juifs du « petit lieu »[1] appelaient Itsik – le fils du préposé aux bains Avigdor – non pas par le nom qui lui fut donné à sa naissance, mais par son patronyme précédé de l’immanquable épithète « pauvre ». Même de la bouche du rabbin Hillel, qui connaissait sur le bout des doigts le nom de chaque Juif que Dieu avait mis sous ses auspices, le sobriquet finissait par s’échapper :
— Comment vas-tu, Pauvre Rothschild ?
— Dieu soit loué, je mène une vie sans offense, comme s’il devait en être ainsi, répondait Itsik.
— Que tu loues notre Seigneur, c’est très bien, mon agneau – gloire et honneur te soient rendus – pourtant, avec un nom de famille aussi célèbre, tu pourrais vivre encore mieux.
— Qui doit vivre mieux, rabbi, et qui moins bien, ce n’est pas nous qui en décidons mais Lui, pointait le Pauvre Rothschild son index écorché vers un ciel indifférent.
— Non, rétorqua le rabbin Hillel. Dieu n’est pas trésorier. Ce n’est pas d’argent dont Il s’occupe et Il n’en distribue pas aux hommes. Il se soucie de notre âme, pas de notre fortune. Il est en ce monde des pauvres riches et forts en esprit, et il est des riches dont le corsage brille tout entier de bijoux en or sous lequel bâillent le néant et l’abîme. Un cœur sec est bien pire qu’un portefeuille vide.
Du vivant du vieux préposé aux bains, le rabbin Hillel n’avait jamais eu affaire à son unique fils et héritier, Itsik. Le chef des bains du petit lieu, alors, n’était pas le Pauvre Rothschild, mais son père Avigdor. C’est chez Avigdor que le rabbin Hillel se rendait tous les vendredis après la prière du matin, prendre un bain de vapeur, se prélasser sur la banquette brûlante, transpirer un bon coup, se fouetter avec le petit balai en feuillage de bouleau et, pour finir, s’asperger d’une bassine d’eau froide afin de se donner du nerf – par chance, rivière-la-douce coulait juste au-dessous de la côte. Marchant avec précaution sur le plancher mouillé, il se faufilait tout nu dans le vestiaire, ôtait de sa tête le fichu en soie qui remplaçait sa kippa de velours le temps du lavage et revêtait des habits propres – une chemise blanche et des caleçons tout aussi immaculés, un large pantalon en toile et une veste courte avec des boutons gros comme des griottes bien mûres –, puis il mettait ses bottines de fête, laissait son dû sur un banc et rentrait chez lui accueillir la reine-samedi.
Lorsque, sur ses vieux jours, les mains du préposé aux bains Avigdor s’étaient mises à trembler et que ses mots s’étaient soudain émiettés en d’indéchiffrables syllabes, la gouverne du purgatoire du petit lieu est passée à Itsik, qui trouvait le temps de veiller sur son père malade, d’aller chercher des seaux d’eau à la rivière, de chauffer le poêle, de tresser les branches de bouleau et de nettoyer les bassines. Ça leur en bouchait un coin aux habitués de la banya[2] qu’un jeune homme comme lui, grand de taille, pas vilain de visage et habile comme pas deux, n’ait toujours pas trouvé de compagne convenable et vive au milieu de nulle part comme un homme des bois. De même s’en indignaient les femmes : Qu’est-ce donc que des bains sans gardienne ? Il est grand temps que le Pauvre Rothschild se marie et se dégote une aide. Mais ce dernier demeurait intraitable et éconduisait poliment de chez lui tous les marieurs qui portaient atteinte à sa liberté. Même les arrangements du rabbin Hillel, qui lui promettait sa nièce Rivka, n’avaient mené nulle part.
— Tu recevras pour elle une belle dot. Ainsi était appâté le Pauvre Rothschild par le mentor des perdus et des égarés, lorsque celui se rhabillait, lentement et méthodiquement, dans le vestiaire.
— Et pourquoi aurais-je besoin d’une dot, rabbi ?
— Tu poses des questions bien étranges, mon agneau. Réfléchis : qu’est-ce qui est plus fort, un amour avec dot ou sans dot ?
— Et pourquoi, dites-moi je vous prie, aurais-je besoin d’amour ?
Le rabbin Hillel n’était point surpris par les bizarreries de ses fidèles. Au long d’une vie de service au Seigneur (service qui durait depuis près d’un demi-siècle), il acquit la certitude qu’il n’existait pas de Juifs sans bizarrerie : certains aimaient la dot plus que leur épouse, d’autres aimaient davantage leur moitié que sa dot, et d’autres encore préféraient rester, comme le Tout-Puissant, célibataires jusqu’à la tombe et considéraient le mariage non pas comme une œuvre de Dieu mais comme une punition divine.
— Si tout le monde pensait comme toi, Itsik, nous aurions disparu depuis longtemps. La lignée du peuple d’Israël se serait éteinte. Ne veux-tu pas donner naissance à un autre Rothschild ?
— Non. Que ce soit d’autres jeunes mariés qui fabriquent des garçons de bains, rabbi, trancha Itsik.
— Mais, peut-être que tu fabriqueras non pas un pauvre garçon de bains mais un baron ou un lord ?
— Un baron ? Et qui est ce baron, rabbi ?
— Rothschild… Tu n’en as donc jamais entendu parler ?
— Jamais, non… Au petit lieu il n’y a que deux Rothschild – mon père et moi.
— C’est ici, au petit lieu, qu’il y en a deux, dit le rabbin Hillel. Moi, je te parle des Rothschild qui vivent à l’étranger, à Paris et à Londres. Ils sont connus dans le monde entier. Ce ne sont ni des préposés aux bains ni des rabbins. L’argent de ces Rothschild, tu peux le compter une année entière, tu n’en finiras pas de le compter… D’eux dépendent même les rois et les ministres.
Le rabbin Hillel sourit, caressa tendrement sa barbe grise et ondoyante de sainteté, et poursuivit :
— Aucun illusionniste ne peut se mesurer avec la vie. Elle fait des merveilles telles que ça donne le tournis. Peut-être, disais-je, que toi et ton vénérable père Avigdor n’êtes pas simplement les homonymes de ces nantis de Paris et de Londres mais des parents ? Seulement, de cette parenté, ni vous ni eux n’en avaient jamais eu vent. Tu es ici, en Lituanie, dans notre petit lieu étroit comme une boîte d’allumettes, et eux – dans des villes géantes, à Paris et à Londres, qui sont trois fois plus grandes que la Lituanie et sa Lettonie voisine rassemblées.
Il caressa à nouveau sa barbe, l’ébouriffant comme s’il écartait un nuage léger et duveteux.
— À part ma tante Feiga, la dure d’oreille, nous n’avons de parents nulle part, ni proches ni éloignés. Et même ma tante, depuis qu’elle a pris le nom de son mari, le charpentier Eine, ne s’appelle plus Rothschild mais Oumanskaïa.
— C’est aussi ce que disait le balagula[3] Weiner autrefois. Qu’il n’a aucun parent au monde. Et voilà que sans crier gare – tu étais alors haut comme trois pommes – a débarqué chez lui un cousin d’Amérique et – qu’est-ce que tu crois ? – juste avant de rentrer chez lui à New-York, il a acheté pour son germain un cadeau d’adieu : un fiacre flambant neuf et deux chevaux pur-sang.
— Et pourquoi, rabbi, aurais-je besoin de chevaux et d’un fiacre ? continuait le Pauvre Rothschild de torturer son protecteur.
— Rendez-vous compte, on lui veut du bien et il martèle comme un perroquet : pourquoi, pourquoi ? Pour que tu ne demeures pas garçon des bains jusqu’à ta dernière heure… Pour que tu ne passes pas la sainte journée à fendre du bois, à tresser des balais et à trimballer des seaux d’eau.
— Merci, rabbi. Mais quelqu’un doit bien être simple garçon des bains. Aussi fort que le moineau – par exemple – désire être un aigle, il ne le sera jamais. Et qui sait, peut-être que le moineau est simplement heureux de voler de seuil en seuil, de miette en miette, et de picorer joyeusement. Le Seigneur donne sa juste part à chacun – certains en reçoivent plus, d’autres moins.
— Et toi, petit moineau, es-tu heureux ? demanda tout à coup le rabbin Hillel au jeune homme.
— Et vous, rabbi, êtes-vous heureux ? décocha le Pauvre Rothschild : une réponse juive à l’honorable enseignant des lois.
— Moi ? demanda le vieil homme, déconcerté. À vrai dire, je n’y avais jamais pensé.
— Pourquoi ?
— Pourquoi ? répéta le rabbin Hillel embarrassé. J’ai toujours pensé au bonheur des autres, pas au mien. Quand les autres seront heureux, je serai heureux moi aussi… Sans doute…
— Cela n’arrivera jamais.
— Mais c’est ce que le Seigneur lui-même veut.
Ils se quittèrent jusqu’au vendredi suivant, mais le rabbin Hillel avait semé dans l’âme du Pauvre Rothschild une étincelle de tentation qui tantôt sourdait à peine, tantôt éclatait d’une lumière vive et éphémère. Souvent, l’envie le prenait lui-même de quitter le petit lieu, de faire ses adieux à la rivière, au joug de la palanche, de fendre d’un coup de hache non pas une bûche de bouleau mais sa vie d’avant en entier et de tout recommencer ailleurs – que ce soit à Kaunas, où il n’avait encore jamais mis les pieds, ou dans quelque autre ville inconnue, pas nécessairement en Lituanie. Il était jeune, plein de force et dégourdi, comme l’affirmait le rabbin Hillel, il pouvait encore changer son destin, acquérir un autre métier, plus digne, ou même apprendre une langue étrangère, pour se débarrasser une fois pour toutes de cette épithète de malheur et être enfin et aux yeux de tous non plus le Pauvre Rothschild mais Itsik Rothschild. Mais comment pourrait-il abandonner son père malade ? Qui veillerait sur lui ? Qui lui fermerait les yeux et l’emmènerait au cimetière du petit lieu auprès de feu son épouse si, Dieu nous en préserve, il lui arrivait quelque chose de terrible ?
Le vieux Avigdor gardait le lit depuis plus d’un an. Il se desséchait comme un peuplier rabougri sur un bord de route. Ses yeux, comme ceux d’un mort, restaient hermétiquement clos. Rien de surprenant à cela. Quelle joie peut-on trouver à regarder du matin au soir les murs écaillés, sur lesquels rôdent des termites, et le plafond qui les surplombe, où des araignées laborieuses tissent lentement et assidûment leurs pièges mortels. Une joie pareille peut vous rendre fou. Si seulement le long de ces murs, autrefois blanchis à la chaux et désormais rongés par l’humidité, coulait, douce et mélodieuse, la rivière-nourricière… Si seulement des hirondelles agiles et éprises de liberté y faisaient leur nid, cisaillant, des journées entières, le chaste bleu du ciel de leurs ailes… Mais avant de mourir, l’homme reçoit une dernière consolation – la possibilité de voir les yeux fermés toute la beauté du monde.
Si quelque chose dans cette maison déserte rappelait encore la vie, c’étaient les mains calleuses et sans cesse tremblantes d’Avigdor.
— C’est leur vengeance pour tout ce que je leur ai fait subir, murmurait sans relâche, comme dans un rêve, le vieil Avigdor, en fixant le plafond envahi d’araignées ou le mur vide.
— C’est de rester couché que toute sorte de sottises te viennent à l’esprit, d’ennui et de désœuvrement – le rassurait Itsik avec des reproches sans méchanceté. Qui s’est vengé ? De quoi ? En quoi et devant qui serais-tu coupable ? Quelqu’un n’aurait pas eu assez de vapeur chaude ? Aurais-tu tressé des balais avec des orties ? Aurais-tu volé quelque chose à quelqu’un ou renversé par inadvertance de l’eau brûlante sur quelqu’un un jour de bain ?
— Mes mains se sont vengées, Itsik. Je ne les ai ni épargnées ni choyées, je ne leur ai jamais donné un instant de répit. Il me semblait parfois avoir porté toute la rivière jusqu’aux bains, avoir découpé en échardes un bosquet entier… Elles se sont vengées… Elles se sont rebellées et ont refusé de servir.
Le Pauvre Rothschild ne savait plus comment consoler le malade. Les mots de réconfort ne faisaient qu’irriter son père et, d’émotion, le tremblement qui privait ses mains de leur raison d’être devenait encore plus insupportable.
— Plutôt que de me consoler, donne-moi ta parole que tu partiras d’ici, quand je serai mort, s’entêtait Avigdor. Qu’un autre Itsik chauffe les bains, qu’un autre Itsik aille chercher des seaux d’eau à la rivière. Je ne veux pas que sur tes vieux jours tes mains tremblent comme les miennes.
La requête du père laissa le Pauvre Rothschild stupéfait. Elle coïncidait non seulement avec son propre désir enfoui de quitter le petit lieu, mais aussi avec les paroles tentatrices du très sage rabbin Hillel à propos de Londres, de Paris et des parents qui y vivaient, qui possédaient des fortunes prodigieuses et qui imposaient aux rois de quémander leurs bonnes grâces. Itsik ne croyait pas à sa parenté avec ces millionnaires étrangers. Mais les pensées qu’il existât, quelque part en ce monde, des Rothschild d’une branche différente, particulière, fourmillaient dans sa tête. Il retenait son souffle lorsque le rabbin Hillel racontait que, les vendredis, ces banquiers n’allaient pas aux bains comme les autres Juifs, mais se lavaient chez eux. Car leur banya n’était pas ordinaire ; elle n’avait ni bassine ni balai en feuillage, mais des murs et un plancher en marbre pur, chauffés jour et nuit non pas avec du bois de bouleau mais à l’électricité, et un robinet plaqué-or d’où coulaient des rivières d’eau chaude et froide – lave toi à plaisir et délecte-toi autant que veux !
Le pauvre Itsik avait beau essayer de sortir de sa tête Paris et Londres et de se concentrer sur autre chose, il n’y parvenait pas. Qu’il descende à la rivière avec les seaux et la palanche, qu’il fende du bois dans la cour, qu’il file chercher des médicaments pour son père à la pharmacie du petit lieu, où régnaient des odeurs paradisiaques, ses prétendus parents le suivaient où qu’il aille. Même la nuit, ils lui apparaissaient dans de drôles de rêves – voilà que lui, le Pauvre Rothschild du tout petit lieu, se tient dans la salle immense et inondée de lumière d’un palais royal, à côté de ces célèbres nantis, du seigneur-roi des lieux et de toute sa famille. Tous ses parents londoniens sont vêtus de corsages dont les diamants hors de prix brillent comme des étoiles, tandis que lui se ratatine dans sa camisole élimée et son vieux pantalon.
— Votre majesté, dit l’aîné des Rothschild londoniens au roi, je vous présente notre cousin arrière-issu de germain, Itsik, dont, à notre honte, nous ignorions l’existence et que nous avons retrouvé par hasard en Lituanie, dans un petit lieu, étroit comme une boîte d’allumettes, sur la Vilia… Il y a peu, il était garçon de bains, mais il s’avère qu’il a un rêve – devenir pharmacien. Il dit que la pharmacie est le seul paradis sur terre où l’on ne se tue pas à la tâche. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, Majesté, pour que Itsik reçoive une instruction et que son rêve devienne réalité. Il restera pour toujours sous notre protection en Angleterre et, ainsi que nous l’espérons tous, il ne déshonorera pas notre lignée, loin s’en faut, mais la glorifiera.
— Enchanté, dit le roi en souriant et tend à Itsik sa main délicate.
— Enchanté, répond Itsik en serrant la main du roi, poignée de main qui le réveille.
À suivre
Gregory Kanovitch
Traduction originale du russe par Elena Guritanu
>>> Episode 2 : ICI
>>> A lire : « La saga litvak de Grigory Kanovich », par Elena Guritanu et Elie Petit