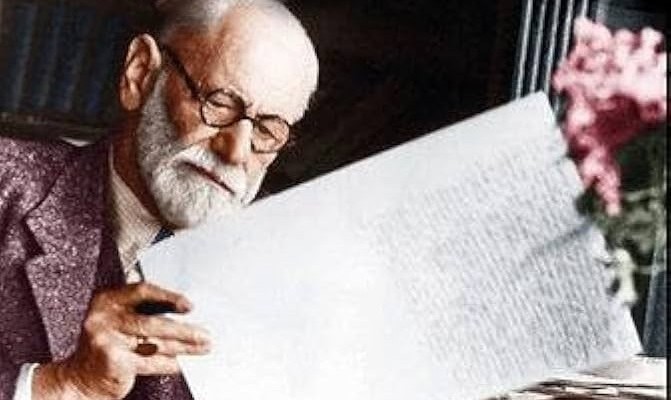L’exposition pensée par la commissaire Isabelle Cahn et scénographiée par Joris Lipsch au mahJ – Proust du côté de la mère – recueille les traces mnésiques de la condition juive de Proust[1]. Elle sollicite aussi une réflexion plastique sur le sens de l’art et de son histoire, sur l’institution muséale elle-même, sur la puissance de l’image et son effet sur le regard comme sur la pensée – autant de thèmes, incessamment travaillés dans La Recherche du temps perdu, sur lesquels Avishag Zafrani revient pour K.

Sur la scène de John Ruskin[3] allant revoir une dernière fois les tableaux de Rembrandt dans un musée, Marcel Proust projetait, comme souvent, un principe de renaissance et de résurrection, soit l’ultime contemplation d’« une réalité qui devait dominer la mort[4]» et conjurer l’effacement des années. Si le musée est un foyer pour Ruskin, selon Proust, il est également le lieu où s’entreposent des œuvres agissant comme un dépaysement moral, un déplacement des représentations du monde. Il s’agit donc bien de maisons qui abritent des pensées, mais un genre de pensée singulière qui façonne la narration de l’auteur de la recherche : une pensée picturale. Aussi, deux choses nous importent dans une exposition consacrée à Marcel Proust : de retrouver l’essence de cette contemplation, et de percevoir une atmosphère esthétique au sein de laquelle un esprit s’est tendu d’une certaine manière pour saisir la réalité. Deux choses déjà difficiles à réaliser qui demandent certainement une disposition au carrefour de l’art, de la philosophie, et de la littérature. Ajoutons une difficulté que le Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme s’est proposé d’aborder : exposer aussi la dimension juive de l’œuvre.
Plusieurs parcours d’exposition peuvent alors se dessiner, celui des faits : la généalogie, la filiation, qui ouvrent l’exposition se situant du côté de la mère, Jeanne Weil, petite fille de Baruch Weil, fondateur d’une manufacture de porcelaine, et circonciseur. Celui d’une condition juive qui se modifie notamment au fil de l’affaire Dreyfus. Celui des figures juives qui apparaissent dans l’œuvre, religieuses ou non, comme Esther, Bloch et Swann. Enfin, celui des signes d’un attachement à des traditions distinctives, comme celle des petits cailloux déposés sur la tombe du grand-père juif de Proust, et que ce dernier regrette de ne pas pouvoir perpétuer, quand la maladie l’en empêche. Ces indices sont explicites, mais comme la source de l’écriture et de la création artistique sont aussi du côté d’un fond secret de la vie psychique, nous aimerions décliner la réception de cette exposition sous un autre angle, plus formel. Comme s’il y avait dans le regard proustien sur l’art, le signe d’une morphologie de la pensée racontant quelque chose de sa (la) judéité, et la dissimulant simultanément.

Il serait peut-être plus simple de partir du souvenir, de la survivance des images, de la mémoire, qui sont des thèmes plus juifs – mais nous les retrouverons. La Recherche est elle-même un musée imaginaire fait aussi d’œuvres réelles, ornée de références à la peinture italienne ou à la lumière de la peinture flamande, servant de miroir aux sentiments des personnages, qui, inclinés d’une certaine manière font penser à l’allure d’un tableau de la renaissance, et ainsi augmentent la beauté et l’importance de l’un et l’autre. L’art médiatise un redoublement de l’existence, qui est le moteur de la recherche, et de l’écriture de Proust. À cet égard, il fallait que de nombreux tableaux interviennent dans l’exposition ; comme ils interviennent dans ses textes, notamment par les critiques sur l’art et la peinture de Proust. Ainsi il est possible de voir au mahJ des chefs d’œuvres qui illustrent en fonction des peintres et des sujets, par exemple, l’organisation d’un environnement social (le tableau de James Tissot notamment), des anecdotes de la Recherche (l’Asperge de Manet), le procès de Dreyfus (les dessins de Maurice Feuillet). Ou encore, des perspectives et des atmosphères, (les tableaux de Caillebotte, ceux de Vuillard, lequel fréquentait les mêmes cercles que Proust), et les peintures d’Helleu et d’Eugène Boudin pour retrouver la vie des jeunes filles en fleurs au bord de la mer.

Enfin, le pouvoir onirique et cathartique de Venise (d’après les dessins de Whistler, et le chef d’œuvre de Claude Monet, issu d’une collection privée – et qu’il sera certainement très difficile de revoir). Plus que de simples illustrations, les tableaux renvoient à la pensée picturale qui est le « sol mental[5] », à partir duquel Proust fait émerger une réalité intérieure, « le génie consistant dans le pouvoir réfléchissant[6] » dit-il. Or ce sol mental qu’il a en partage avec les peintres, indique une situation du sujet, qui fait « tourner autour de lui un monde »[7]. Le goût de Proust pour l’art qui a le don de renouveler son désir et d’approfondir la perception de la réalité lui indique une position d’observateur-narrateur. Recevant et nous immergeant dans la « substance anonyme[8]» d’une société mondaine – qui est, à partir des tomes Sodome et Gomorrhe, divisée en deux par l’affaire Dreyfus – il devient un sujet singulier qui, selon Walter Benjamin, rapproche Proust de Kafka. Les deux auteurs, dit Benjamin dans une note manuscrite, ont le même « Je », « transparent, de verre ». « En ces écrivains le sujet revêt la couleur de camouflage de la planète[9]»
Proust, miroir d’une réalité, sujet de verre transparent et faisant dès lors transparaître une configuration de la société, réinitie le processus d’assimilation politique, en une assimilation esthétique de la réalité par le courant de conscience. Il inverse un rapport de pouvoir et produit une nouvelle forme narrative qui inaugure paradoxalement une tradition dans l’écriture de la réalité (et de soi). Marguerite Duras disait aussi que la leçon de Proust était la suivante : « supposons qu’un homme n’ai lu qu’une seule œuvre, et que cette œuvre soit celle de Proust, on pourrait penser que lui-même pourrait passer à l’écriture ». Elle aussi suppose qu’il y a une transparence des formes chez Proust, inaugurale, puisque chaque lecteur pourra à nouveau emprunter le sentier de cette narration – ce qui est un écho lointain du « Maintenant écrivez ce cantique », dans le Deutéronome, comme la forme qui reste, du commandement juif d’écrire la Torah, de devenir scribe en somme. Or l’écriture qui demeure est identique au langage de l’art, sans contenu religieux, et pourtant aussi selon Proust, lieu d’une foi expérimentale. Ruskin était l’apôtre d’une religion de la beauté, notamment cristallisée dans ses études de l’art chrétien, qui a perdu un contenu pour un autre, fait de pierres, mais de pierres érigées par la foi. Tandis que la foi expérimentale de Proust est celle qui subordonne les raisonnements à des « puissances autres », celles sans doute du souvenir, et de la mémoire involontaire, des images d’un passé qui ressurgissent spontanément, ou brusquement, et donnent ainsi la mesure du temps perdu et retrouvé.
Avec Benjamin nous pouvons avancer que la narration proustienne commémore l’existence, et en cela prolonge un motif juif. Seulement, il faut y ajouter le langage de l’art, qui est un langage intuitif, empli de la vie des formes[10], à partir desquelles sont engendrées des idées. « Je dessine ce que je vois, dit Turner, non ce que je sais »[11], et ce faisant il délivre un genre de savoir sur la réalité, surtout il en pérennise une image motrice, puisqu’en elle Proust trouve les ressorts d’un désir. On ne se déplacerait pas tellement pour voir un champ de coquelicots, mais on se déplacerait pour voir un champ de coquelicots peint par Monet, dit encore Proust. Ainsi la pérennisation d’une image de la réalité commémore aussi l’existence, selon cependant une tonalité esthétique, et un fond affectif, d’attachement.

Le tableau de Claude Monet qui dépeint Venise, toujours comme émergeante des flots, à la frontière du rêve et de la réalité, de l’occident et de l’orient, correspond aux descriptions de Proust. Venise aux « eaux de saphir », dont le flot est instable et rend « le voisinage mobile », dont les rues sont ombragées par les « palais de porphyre et de jaspe »[12], se mue en une Venise intérieure, qui cependant perdra son âme lorsque Proust laissera provisoirement sa mère partir avant lui. De sorte que si les lieux importent et se juxtaposent (ainsi Combray et Venise), ils le font toujours sur ce sol mental perméable qui nourrit le regard de l’écrivain et du peintre. Il permet aussi d’ajuster le regard sur une société vacillante, mise en question par les exclusions qu’elle génère. Ce contexte indique comment le regard du narrateur est amené à voir, non pas seulement la beauté mais aussi la vérité. Le regard de l’inverti et du Juif chez Proust, dont les conditions sont mises en parallèles pour éclairer les ressemblances de deux genres de réprobations collectives, est précisément un regard qui doit neutraliser les stigmates de la persécution, et se frayer un chemin vers la résolution d’abord optique de la justice. D’où voient les invertis et les Juifs ? Depuis quel lieu intérieur qu’ils ont dû sceller à la réprobation extérieure ? À plusieurs égards, ce lieu de la conscience correspond à la métaphore de la lanterne sourde de l’écrivain Stevenson (aussi friand des comparaisons narration/dessin), un accessoire étrange qui permet de voir sans être vu. Ce faisant le regard accède à des secrets.
Avishag Zafrani
Notes
| 1 | Voir également dans K, « Proust pivot des juifs modernes » de Milo Lévy-Bruhl, à propos du livre Marcel Proust du côté juif, d’Antoine Compagnon – qui fut conseiller de l’exposition proposée par le mahJ. |
| 2 | In Quatre peintres, « Rembrandt » éditions Marguerite Waknine, collection livres d’art, Angoulême, 2018. |
| 3 | John Ruskin était un célèbre critique d’art anglais, lu abondamment par Marcel Proust, ainsi que traduit par lui et sa mère, notamment La Bible d’Amiens, paru en 1884 (1904 pour l’édition française). |
| 4 | Quatre peintres, op. cit. |
| 5 | Expression extraite de Du côté de chez Swann. « Mais c’est surtout comme à des gisements profonds de mon sol mental, comme aux terrains résistants sur lesquels je m’appuie encore, que je dois penser au côté de Méseglise et au côté de Guermantes », Gallimard Folio, Paris, 1988, p.182 |
| 6 | A l’ombre des jeunes filles en fleurs, Gallimard Folio, Paris, 1988, p.125. |
| 7 | Marguerite Duras, Leçons de Marcel Proust, émission radiophonique de Robert Valette et Georges Gravier, 1963. |
| 8 | D’après une expression de Nathalie Sarraute, ibid. |
| 9 | Walter Benjamin, Sur Proust, trad. et présentation Robert Kahn, Editions Nous, 2015, p.149 |
| 10 | Ernst Cassirer, « Langage et art », Ecrits sur l’art, Edition du Cerf, 1995, p.171 |
| 11 | Marcel Proust, « Ruskin », Ecrits sur l’art, Flammarion, Paris, 1999. |
| 12 | Albertine Disparue, Gallimard Folio, Paris, 1990, Chapitre III. |