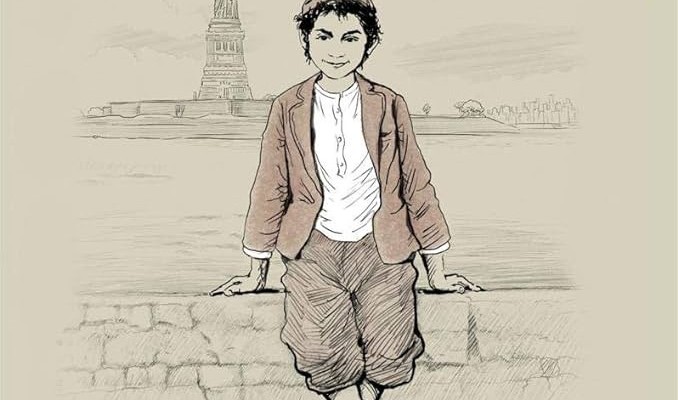L’année 2022 marque les cent ans de la mort de Marcel Proust. Pour l’occasion, le « côté juif » de l’auteur de La Recherche a fait l’objet d’une attention inédite. Le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme (mahJ) lui a consacré une excellente exposition « Marcel Proust. Du côté de la mère », dont la commissaire est Isabelle Cahn et le conseiller scientifique Antoine Compagnon. Ce dernier a par ailleurs fait paraître « Marcel Proust du côté juif » (Gallimard). Le livre enquête sur les réceptions de l’œuvre qui se sont intéressées à son aspect « juif ». À la suite de sa lecture de l’ouvrage, Milo Lévy-Bruhl a écrit pour K. cet article dans lequel il se penche à son tour sur le cas de Proust. Plutôt que de tenter de qualifier son hypothétique judaïsme, il propose de faire un pas de côté pour saisir le rôle pivot du grand romancier à l’intérieur d’un judaïsme moderne traversé à la fois par des dynamiques d’émancipation et de retour.

Les travaux consacrés à la judéité de Proust ne manquent pas. D’un Proust non-juif allant jusqu’à mobiliser des tropes antisémites dans sa description d’Albert Bloch à un Proust revenant au judaïsme comme Charles Swann ; d’un Proust « juif-ésotérique », connaisseur secret du Zohar ou talmudiste subtil dont le grand œuvre reproduirait les motifs, à un Proust marrane… toutes les hypothèses semblent avoir d’ores et déjà été formulées pour caractériser la marque qu’aurait laissée sur l’auteur de La Recherche le judaïsme de sa famille maternelle. L’ouvrage d’Antoine Compagnon les restitue et les explore toutes : riche et savante, agréable à lire et stimulante, cette synthèse du thème juif dans la critique proustienne justifierait à elle seule l’existence de cet excellent livre.
Mais parmi toutes les réceptions de Proust attentives à ce thème juif, il en est une qui intéresse particulièrement Compagnon : celle que propose dans les années vingt un groupe de jeunes juifs ou, comme il les appelle, de « jeunes sionistes ». C’est dans ce monde oublié, notamment parce que partiellement englouti par la Shoah, que nous plonge une grande partie de l’ouvrage.
Le « renouveau juif » autour de la Grande Guerre
Dans la décennie de l’après-première-guerre mondiale, la force de l’Union Sacrée continue d’embaumer les Juifs, dont le sacrifice est reconnu jusque par les antisémites d’hier qui sont désormais enclins à intégrer ces israélites aux Diverses familles spirituelles de la France. Dans ce contexte, une affirmation juive, un « réveil juif »[1], se fait jour, notamment à travers la littérature, dont la plus fameuse expression demeure la Revue juive d’Albert Cohen. Parmi les animateurs de la revue, on trouve le poète André Spire. Malheureusement oublié aujourd’hui, malgré l’admirable travail de publication de sa fille[2], Spire est une figure majeure et fascinante du judaïsme français du XXe siècle. Dans l’après-guerre, déjà quadragénaire, il fait le lien entre la génération de Cohen et celle des jeunes juifs de la fin du XIXe (Henri Franck, Léon Blum, Edmond Fleg, etc.) dont l’affirmation juive au moment de l’affaire Dreyfus s’était déjà heurtée à l’idéal d’assimilation d’israélites qui tiennent à leur discrétion, a fortiori dans le contexte d’antisémitisme triomphant d’alors. La figure d’André Spire démontre à elle seule que le « réveil juif » commence en réalité bien avant la Grande Guerre. Mais si elle importe, c’est aussi parce que personne ne s’est autant confronté aux israélites que Spire lui-même. Entre la fin du XIXe siècle et les années vingt, Spire n’aura de cesse d’attaquer les grandes figures israélites de son époque, moquant les frères Reinach, se déchaînant contre Sylvain Lévi.
La confrontation porte notamment sur le sionisme dont Spire est le premier des soutiens en France mais que la majorité des israélites refuse, de crainte qu’il n’alimente le reproche de double allégeance. En 1919, Sylvain Lévi, indologue, professeur au Collège de France, président de la Société d’études juives et de l’Alliance Israélite Universelle, a le malheur de s’opposer à Spire et aux leaders sionistes qu’il accompagne lors de la Conférence de Paix qui doit décider de l’attribution du mandat britannique à la Palestine. La réaction de Spire est cinglante : « Lorsque Rabbi Schimon ben Yochaï, dit la légende, quitta la caverne où il avait vécu de nombreuses années s’occupant uniquement des études sacrées, il vit des paysans, dégoutant de sueur, les pieds et les jambes éclaboussés de la terre qu’ils labouraient. – Qu’ils sont sales, s’écria-t-il ! Que leurs mains sont rudes, leurs dos arrondis ; leurs yeux rusés ! Les malheureux qui, pour des biens matériels, négligent leur salut dans le monde à venir ! – Préférerais-tu, murmura une voix céleste, qu’ils eussent les mains et l’âme blanche comme toi et que le monde ne mangeât pas ce soir. Va, mon ami. Laisse ces hommes d’un jour à leur pluie, à leur bourrasque, à leur sueur, à leurs larmes, à leurs rires, à leur soleil, à leur moisson. Il fait trop jour ici, tu ne peux rien comprendre. Il te faut ton lumignon, ton escabeau, tes toiles d’araignées, tes cloportes et les choses éternelles… Rentre dans ta caverne.[3]»
Dans les années vingt, c’est ce même André Spire qui « annexe » Proust du côté des jeunes sionistes de la Revue juive. Ce que Spire trouve dans la Recherche c’est une critique des extrémités de l’assimilation à travers le personnage d’Albert Bloch devenu Jacques du Rozier dans Le Temps retrouvé et l’abandon par Gilberte du nom de son père Swann pour celui du nouveau mari de sa mère, le comte de Forcheville. Tels quels, La Recherche et Proust lui-même, intègrent donc avec Spire l’arsenal argumentatif d’une critique interne au judaïsme français. Les jeunes sionistes de La Revue juive se confrontent aux tendances à l’assimilation excessive des israélites et trouvent en Proust un allié.
Spire, Proust et Halévy
Chez Spire, la critique de l’assimilation va de pair avec une affirmation juive. Mais cette affirmation se fait depuis une trajectoire d’assimilation avancée. Démobilisé pendant la Grande Guerre en raison de son âge, Spire est chargé de veiller sur un soldat marocain du nom de Séban. Dans ses Souvenirs à bâtons rompus, il raconte son admiration, autant que la distance qui le sépare de ce jeune juif qui demeure, lui, parti d’un peuple bien vivant : « Toutes ses pensées, toutes ses visions étaient palestiniennes, bibliques. Pour lui, la vie de Moïse n’était pas une vie légendaire. Mais quelque chose de réel, d’éternellement présent, actif. Il se réjouissait à Pourim de la disgrâce d’Aman et du triomphe d’Esther, à Hanouca de la rentrée de Judas Macchabée à Jérusalem, du renversement des idoles et de la purification du sanctuaire, à Tichah-Béav, il jeûnait et récitait les lamentations de Jérémie en souvenir de la destruction du Temple par Nabuchodonosor et par Titus.[4]» L’affirmation juive de Spire est donc celle d’un israélite revenu de l’assimilation : Spire revient parmi les Juifs. Mais il est notable que sur cette trajectoire de retour, il trouve en Proust un appui.
Pourtant, on trouve peu de traces chez Proust d’une affirmation juive similaire à celle de Spire. Plus exactement, on n’en trouve qu’une : « Il n’y a plus personne, pas même moi qui ne peux me lever, qui aille visiter, le long de la rue du Repos, le petit cimetière juif où mon grand-père, suivant un rite qu’il ne comprenait déjà plus, allait mettre tous les ans un caillou sur la tombe de ses parents. » Cet extrait d’une lettre de Proust recopiée par Spire est l’objet de l’enquête qui constitue le fil directeur de l’ouvrage de Compagnon. À travers ces quelques mots se formulerait une discrète affirmation juive dont l’importance nécessiterait, pour la mesurer exactement, de connaître le contexte d’écriture et le destinataire de la lettre. Or, c’est précisément ce qu’Antoine Compagnon a réussi à découvrir.
Le mystérieux destinataire n’est autre que l’historien Daniel Halévy. Ami de Spire, Halévy a fréquenté Proust, lequel, dans sa jeunesse, vouait une grande admiration à son père, l’académicien, librettiste d’Offenbach et de Bizet, Ludovic Halévy. Pour qui s’intéresse aux trajectoires des juifs dans la modernité, la famille Halévy incarne évidemment la réussite mondaine et l’excellence intellectuelle mais aussi l’assimilation poussée jusqu’aux mariages mixtes et aux conversions. Or, cette lettre, adressée par Proust à son ancien camarade de lycée, est une lettre de condoléance après le décès de son père. Dans ce contexte, l’évocation par Proust du petit cimetière juif et du caillou posé sur la tombe arrière-grand-paternelle sonne comme un reproche, à tout le moins comme un rappel. Alors que le lien avec son père vient d’être rompu, Proust écrit implicitement à Halévy : Souviens-toi Israël !
Des effets inattendus de la Franc-maçonnerie
Point d’appui d’un Spire dans son affirmation juive, corde de rappel d’un Halévy qui s’en éloigne, Proust se trouve ici placé au cœur des dynamiques que connait le judaïsme à l’âge de l’émancipation, au cœur de la tension entre individualisation totale et persistance comme groupe. Mais comment expliquer cette position particulière que semble tenir Proust parmi sa génération ?
Dans le premier chapitre de l’ouvrage, Antoine Compagnon retrace la généalogie maternelle de Proust. On y apprend que cet arrière-grand-père sur la tombe duquel était rituellement déposé un caillou fut une figure majeure de la communauté juive parisienne des premières décennies du XIXe siècle. Baruch Weil, dont la famille venait d’Allemagne, s’installa dans la périphérie de la capitale française sous le Directoire. Reprenant une fabrique de porcelaine, il la fit prospérer, ouvrit plusieurs magasins et, symbole de son impressionnante réussite, fut nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1825 comme « fondateur de la belle manufacture de porcelaine établie à Fontainebleau ». Mais Baruch Weil s’illustra aussi dans la vie communautaire : président du comité de bienfaisance israélite parisien, il fut élu à la direction du Consistoire de Paris dont il assura la vice-présidence entre 1819 et sa mort en 1828. Toute sa vie durant, Baruch fut également le mohel de la communauté juive de la capitale. Après sa mort, Les Archives israélites de Paris rappellent son souvenir : « Pendant vingt-cinq ans que feu M. Baruch Weil a exercé à Paris avec tant de zèle, de piété et de désintéressement, nul, du plus riche jusqu’au plus pauvre, n’eût consenti à faire circoncire un enfant par un mohel étranger. » Au départ de la trajectoire française de la famille Weil, aucune trace de déjudaïsation donc.
À sa mort, Baruch Weil laissa onze enfants, de deux mariages successifs, parmi lesquels Nathé Weil, le grand-père maternel de Proust. Nathé Weil eut lui-même trois enfants, dont une fille, Jeanne Weil, future femme du docteur Adrien Proust et mère de Marcel. Fils du mohel de la communauté juive de Paris, Nathé autorisa pourtant sa seule fille à épouser un non juif. Cette incongruité a conduit Antoine Compagnon à s’intéresser de plus près à la vie du grand-père de Proust. À sa vie et surtout à sa mort, laquelle lui réservait une surprise. En effet, décédé le 2 juillet 1896, Nathé Weil a été incinéré. En France, la crémation n’est alors autorisée que depuis une dizaine d’années. Interdite par le judaïsme et par le christianisme, la choisir c’est, comme le note Antoine Compagnon « faire profession d’athéisme, s’afficher comme libre-penseur ». Les rares français qui optent alors pour la crémation se recrutent parmi les anarchistes, les socialistes, les anticléricaux et… les francs-maçons. L’hypothèse d’un Nathé Weil franc-maçon permettrait d’expliquer ce mariage mixte dans un milieu juif qui demeure alors extrêmement homogamique. Adrien Proust, médecin hygiéniste et notable républicain, qui écrivait sur la crémation dès les années 1870, aurait été franc-maçon lui-même et ainsi c’est en toute logique que cette union aurait été patronnée par ce cousin pourtant éloigné dont Jeanne Weil fit son témoin de mariage : Adolphe Crémieux, ministre de la Justice en 1848 et en 1870 mais aussi commandeur suprême du Conseil de France du rite écossais ancien et accepté.
Le faisceau d’indices réuni par Antoine Compagnon tendant à prouver que Nathé Weil, le grand-père maternel, et Adrien Proust, le père, furent francs-maçons emporteront vraisemblablement l’adhésion des lecteurs. L’information, inédite, a un autre mérite : celle d’expliquer la trajectoire spécifique de Marcel Proust au sein du judaïsme français. Émancipés en 1791, les Juifs du royaume ont été appelés par les Révolutionnaires à se considérer comme des individus juifs et non plus comme les membres Juifs d’une « nation ». Sortant de leurs communautés traditionnelles, ils ont connu une mobilité sociale et des possibilités d’intégration inédites qui ont conduit une partie d’entre eux à s’éloigner du collectif juif dont ils provenaient, parfois jusqu’à l’oubli définitif. Le XIXe siècle avançant, l’individualisation des Juifs est allée s’accroissant et les éloignements d’un Halévy, comme celui du Bloch de la Recherche, se sont multipliés. Ses éloignements du collectif purent occasionner des désirs de retour, à l’approche de la mort comme chez Swann, ou des désirs de réaffirmation juive comme chez Spire. Sur le long terme, les descendants des Bloch deviennent parfois des Spire et inversement : la dynamique est toujours en cours. C’est cette forme inédite de la mobilité, entre individualisation et retour au collectif, que la modernité permet aussi aux juifs. Or, dans cet espace, la trajectoire dont procède Proust a un caractère différent. À l’assimilation individuelle permise par la Révolution, le fils du mohel de Paris a préféré une autre option : l’intégration d’un autre groupe minoritaire. Il n’y a pas eu dans cette lignée de processus de déjudaïsation comme chez un Bloch ou un Halévy parce qu’il n’y a pas eu de sortie du sous-groupe pour se fondre individuellement dans la société globale. Mais puisque la sortie s’est arrêtée avant que d’être achevée, il n’y a pas non plus de volonté de retour comme chez un Swann ou de besoin de réaffirmation comme chez Spire. La trajectoire de l’individualisation s’est gelée en trouvant refuge dans un autre groupe minoritaire qui permettait une émancipation du groupe d’origine mais sans assimilation individuelle à la société.
Il est certain que l’héritage de cette position donne à Proust une acuité particulière sur l’ensemble des trajectoires juives modernes ; acuité que manifeste la variété des personnages juifs de la Recherche. Mais volontairement ou non, directement ou par le biais de son œuvre, elle lui alloue également un rôle dans ces dynamiques qu’il décrit ; rôle que l’ouvrage d’Antoine Compagnon permet plus qu’aucun autre de saisir. Depuis sa position, Proust peut aussi bien rappeler au collectif dont ils procèdent ceux qui s’en éloignent trop, qu’arrimer ceux chez qui un désir de retour se fait manifeste. Au sein du judaïsme moderne, Proust est le nom d’une position singulière, d’une position latérale, mais d’une position nécessaire pour que persiste un collectif juif dans une société d’individus.
Milo Lévy-Bruhl
Notes
| 1 | Sur le « réveil juif » ou la « renaissance juive » des années vingt. Voir par exemple, Catherine Fhima, « Au cœur de la « renaissance juive » des années 1920 : littérature et judéité », Le « réveil juif » des années vingt, Archives Juives, 2006/1 (vol. 39), Les Belles lettres et Nadia Malinovich, Heureux comme un juif en France : intégration, identité, culture (1900-1932), Honoré Champion, 2010 (traduction française de French and Jewish: Culture and the Politics of Identity, 2008). |
| 2 | Outre la republication des œuvres de son père – les « Poèmes juifs » et bientôt les « Souvenirs à bâtons rompus » – Marie-Brunette Spire-Uran a réalisé l’excellente édition de plusieurs de ses correspondances : celle avec Ludmila Saviztky, Une amitié tenace, Les Belles Lettres, 2010, celle avec Jean-Richard Bloch, Sommes-nous d’accord ?, Éditions Claire Paulhan, 2011 et récemment celle avec Daniel Haléy, Des ponts et des abîmes : une amitié à l’épreuve de l’histoire, Honoré Champion, 2020. |
| 3 | André Spire, « Du Mahayâna-Sutrâlankâra à la Conférence de la Paix – Essai de contribution à l’éclaircissement du cas de Sylvain Lévi », Souvenirs à bâtons rompus, Paris, Albin Michel, 1962, page 114. |
| 4 | André Spire, « Séban, soldat juif », Souvenirs à bâtons rompus, Paris, Albin Michel, 1962, page 94. |