Le résultat du sionisme réalisé, c’est-à-dire l’accès à la souveraineté politique, a aussi signifié pour l’État des juifs la nécessité d’exercer une violence. Dans ce texte, Danny Trom revient sur les difficultés à devoir se confronter à cette violence infligée, et sur son articulation avec la violence subie par les juifs. Comme si, après la révolution sioniste, les juifs ne pouvaient qu’osciller dans leur rapport à la violence.
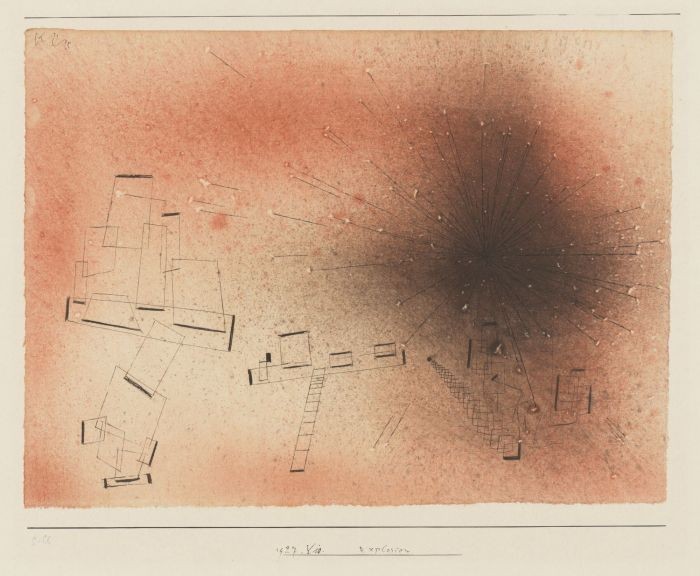
La violence exercée, voilà un sujet qui met régulièrement la sphère publique juive en ébullition. Sur cette scène, par définition transnationale et émiettée, elle s’expose comme une question indéfiniment relancée. Et pour cause : la violence subie est au cœur de l’histoire des juifs dès lors qu’ils ont partout formé des minorités vulnérables. Selon les lieux et les époques, cette violence avait pour source les sociétés dans lesquelles ils étaient immergés, mais aussi le pouvoir, son indifférence, sa complicité si ce n’est son hostilité active. La vulnérabilité structurelle a fait des juifs un groupe opprimé, une minorité objet de violences. Cette appréhension a été dénoncée pour la première fois par l’historien Salo Baron dans un fameux article paru en 1928[1], selon lequel le récit « lacrymal », ce regard sombre jeté habituellement sur le passé, voile les nombreux moments de tranquillité, de bonheur, et de prospérité que connurent les communautés juives au Moyen Âge.
Bien que, comme il a souvent été remarqué, l’historien estimât que les Temps modernes suivis de l’ère de l’émancipation ont connu une dégradation relative des conditions d’existence des juifs, S. Baron invitait à porter un regard plus optimiste sur l’histoire des juifs d’Europe. Son approche connut un si considérable retentissement que le travers consistant à mouiller l’histoire juive de larmes est devenu, depuis des décennies, ce dont tout historien juif respectable dit vouloir se garder. Et même si la réévaluation de Baron portait essentiellement sur la période médiévale, perçue jusqu’alors comme particulièrement noire, sa réception allait dilater son propos en une thèse de portée générale qu’il ne démentit jamais explicitement. Éviter le misérabilisme devint ainsi la devise ouvrant sur la normalisation de l’histoire juive et, avec elle, celle du métier d’historien des juifs, lequel se conformait désormais à la norme professionnelle commune, ménageant à celui qui s’engage dans la carrière la promesse de s’intégrer sans accroc dans la corporation internationale des historiens.
Mais avec son appel à abandonner la vision lacrymale de l’histoire juive, du moins dans la compréhension stylisée qui a prévalu, Baron, depuis peu professeur à Columbia, était, en 1928, à contretemps. Il formulait sa perspective au moment même où la détérioration de la situation des juifs d’Europe était palpable[2]. Rien de l’ampleur de ce qui se profilait ne pouvait bien entendu être anticipé, mais la vision historique de l’européen Salo Baron, originaire de Galicie, détenteur d’une thèse dirigée par Hans Kelsen à l’Université de Vienne, socialisé dans l’Empire des Habsbourg en voie de réforme, semble, vue d’aujourd’hui, comme par avance irriguée par le contexte américain où il fit carrière. Car cette invite à aborder autrement l’histoire juive nous révèle, nous qui vivons à l’ère post-Shoah, ce qu’elle renfermait de préférence et d’espoir pour l’avenir des juifs, qui trouvait en Amérique son lieu de réalisation. Sa monumentale histoire des communautés juives, depuis l’exil jusqu’à nos jours, fit de Salo Baron le chantre académique d’une histoire juive certes particulière, mais globalement positive, plastique, mouvante, créative et résiliente, ce dont attestait son prolongement américain, par-delà la Shoah. Le diasporisme de l’historien russe Shimon Doubnov auquel Salo Baron doit tant, englouti avec la destruction des juifs d’Europe, refit ainsi surface aux États-Unis, nouvelle terre promise des juifs.
Avec la naissance de l’État d’Israël, dans la guerre, on entrait de plain-pied dans une configuration inédite où s’expose aux yeux de tous la violence organisée, institutionnalisée dans une armée, de juifs majoritaires dans un État.
Mais pour cet autre historien des juifs qu’était Fritz Baer, rien ne devait être plus étrange que cet appel à se défaire de la vision traditionnelle de l’aventure juive, lui qui immigra d’Allemagne vers la Palestine en 1930, se renomma Yitzhak Baer et proclama dans son essai Galout, publié en 1936, l’effacement de l’histoire des juifs dans une tourmente prévisible, donc la fin de la diaspora. Le médiéviste Baer, décelant l’ironie de la formule « vision lacrymale des juifs », se sentit à coup sûr visé par cette métaphore. Il riposta en 1936, à l’occasion de sa recension de l’Histoire religieuse et sociale des juifs de Baron – dans la revue d’histoire Zion, nouvellement créée à l’Université hébraïque de Jérusalem –, en la contestant. Bien que sa critique portât, elle-aussi, sur la période médiévale, où les juifs vivaient selon lui une condition d’insécurité chronique, la conjoncture de la fin des années 1930 démentait effectivement qu’elle ne fût qu’une parenthèse refermée depuis longtemps[3]. Retraçant la trajectoire des juifs depuis les temps les plus reculés, Baer en vint à conclure dans Galout que la condition exilique en tant que telle n’était qu’un consentement à la soumission qui finira en catastrophe, que le destin des juifs était de quitter l’Europe pour s’assembler en Palestine et y former une entité politique majoritaire et autonome.
Dans ce face-à-face, diasporisme et sionisme s’opposent telles deux visions de l’histoire aux prolongements politiques tendanciellement incompatibles : autonomie paisible des communautés juives dispersées et synthèses créatrices avec leurs environnements, d’un côté ; nécessité de s’arracher à la servitude de l’exil, de s’assembler en Terre d’Israël en rejoignant les rangs des nations combattantes, de l’autre. Euphémisation de la détresse juive afin de conserver une vie politique juive dispersée qui se tient séparée d’une terre et d’un État à soi, d’une part ; emphatisation du tragique de l’histoire juive afin d’approcher une condition politique alternative, de l’autre. Dans cette division schématique, la communauté juive des États-Unis figure le pôle de la continuité de l’histoire diasporique, tandis que les juifs du yichouv, puis de l’État d’Israël, figurent le pôle de la rupture. Entre les deux, l’Europe, où les deux visions furent élaborées, mais désormais presque Judenrein, discréditée, exclue ou marginalisée dans la conversation juive internationale, jusqu’aujourd’hui.
Cette division schématique recèle cependant un paradoxe, car, sous un autre angle, continuité et rupture s’interpolent. En effet, la vision issue de la réception de Salo Baron en appelle à se secouer du joug de l’imaginaire de l’exil, et avec lui de son caractère expiatoire, pour mieux édifier une vie durable en diaspora, tandis que le maintien de la vision traditionnelle de l’exil conduit tendanciellement à vouloir y mettre un terme, dès lors qu’elle est portée, comme le fait Baer, jusqu’au diagnostic de son effondrement dans la violence. Alors que Baron s’inscrit ici peu ou prou dans cette tradition apologétique consistant à valoriser l’apport des juifs à leur société d’accueil et réciproquement, Baer, tel le prophète de malheur, met les juifs en garde contre une vaine volonté de contribuer aux sociétés qui les abritent et de plaire aux autres, d’autant plus si cela débouche sur un renoncement à soi. Il s’ensuit que la révolution dans la pratique de l’histoire juive, celle qui tend à la couper de son cadre d’interprétation exilique, débouche sur un conservatisme politique, tandis que du conservatisme historique arc-bouté sur le schème traditionnel découle potentiellement une révolution politique. Cette dernière ne devait pas nécessairement déboucher sur la création d’un État juif souverain au sens plein du terme, bien qu’elle y mena finalement, mais, s’arrachant à la dépendance des « nations », elle pointait en direction d’une autonomie plus complète, ce qui impliquait aussi la possibilité que la violence juive infligée soit assumée.
Désormais, et pour la première fois dans leur histoire, les juifs, qui se tenaient jusqu’alors en exception sous l’angle de la violence offensive, s’exposaient à devoir assumer la violence infligée, comme les « autres nations » dotées d’un État, ni plus ni moins. Ceci suscita un malaise durable, allant croissant, caractéristique d’une condition juive où la violence offensive était par construction exclue du champ des possibilités, si ce n’est sous la forme d’un souhait que dieu, leur protecteur, l’exerce à terme sur leurs oppresseurs. La nouvelle donne politique engendrera alors une indisposition qui travaillera continument une sphère polémique juive incluant désormais les citoyens juifs de l’État d’Israël. Alors que les dilemmes autour du recours à la force dans le yichouv pouvaient encore maintenir le cadrage craquelant d’une violence juive essentiellement subie, avec la naissance de l’État d’Israël, dans la guerre, on entrait de plain-pied dans une configuration inédite où s’expose aux yeux de tous la violence organisée, institutionnalisée dans une armée, de juifs majoritaires dans un État. Que la guerre d’indépendance — indépendance prise au sens fort d’émancipation des sociétés d’origines — fut défensive, n’y change rien : la violence d’État entrait dans la réalité juive, tel un fait.
La sphère publique juive qui se compose depuis lors des communautés juives du monde et des juifs assemblés dans un État, les deux vivants des conditions politiques radicalement distinctes, sera désormais traversée de tensions générées par cette contradiction. Ce n’est pas que la violence infligée soit rejetée ou endossée selon cette ligne de partage : le rapport contrarié à la violence infligée, intrinsèque à l’imaginaire de l’exil, traverse l’ensemble de la sphère, certes de manière inégale, mais tel un élément commun, par-delà cette asymétrie. Ici aussi, la production historiographique concentre et explicite ces tensions. Le retour que firent les historiens israéliens, quelques trente ans après, sur la naissance de l’État dans la violence guerrière, allait documenter cette violence d’État et la controverse qui s’étala sur des années allait finir par acter cette réalité. Il se disait que ce dévoilement scellait la fin du mythe de l’innocence de cet État — mythe entretenu par un récit national hégémonique, rétif à l’auto-révision. Cette réticence avait cependant deux sources, difficiles à démêler : un récit officiel légitimant un État contesté jusque dans son existence, que la violence infligée pouvait mettre à mal ; un mouvement de libération national juif nommé sionisme qui ne s’est résolu au recours à la force que lorsqu’il y fut contraint. La révision historique était douloureuse parce qu’elle touchait à l’auto-compréhension que les Israéliens avaient d’eux-mêmes, en tant que citoyens de cet État et en tant que juifs, indissociablement. Le récit national israélien se voulait en rupture avec l’histoire juive exilique, de sorte que la doxa sioniste pouvait affirmer que l’ethos du nouveau citoyen se substituait à l’ethos exilique, mais cette transmutation demeurait imparfaite, confusément tributaire d’un refus latent d’assumer la violence infligée, qu’elle soit justifiée ou pas. Sinon, à quoi bon vouloir préserver une innocence pourtant incompatible avec la détention d’une souveraineté dans un contexte chaotique ?
La doxa sioniste pouvait affirmer que l’ethos du nouveau citoyen se substituait à l’ethos exilique, mais cette transmutation demeurait imparfaite, confusément tributaire d’un refus latent d’assumer la violence infligée, qu’elle soit justifiée ou pas.
Mais cette révision, où s’exprime avant tout le dépit devant la violence offensive, allait se répercuter, dans la foulée, sur l’historiographie des juifs venue de l’académie israélienne, se fixant cette fois-ci sur l’Europe médiévale, laquelle cristallisa jadis le désaccord entre Baron et Baer. Confinée dans un cadre spatio-temporel où la violence infligée devint une réalité objective, elle déborda dans le cadre spatio-temporel où elle était essentiellement subie. C’est ainsi qu’il convient, par exemple, de contextualiser l’ouvrage Rites imprudents (2007) du médiéviste américano-israélien Elliott Horowitz, dont l’ambition était de démontrer que les juifs de l’Europe médiévale, lors du festival de Pourim, infligeaient publiquement à leur voisins chrétiens une violence symbolique, agressivité qui engendra, en retour, des violences physiques[4]. Le vif débat soulevé par cette publication révélait combien, derrière la volonté de rendre la violence infligée symétrique, exercée de part et d’autre, quitte à forcer le trait ou à tordre la réalité, se profilait la volonté à peine voilée de l’auteur d’exhumer le caractère juif d’une violence offensive qui se prolonge jusque dans la conduite de l’État d’Israël. Un autre cas, lui aberrant[5], qui déboucha sur un scandale public, fut l’ouvrage Pâques de sang de l’historien médiéviste italo-israélien Arieh Toaff, paru en 2008, défendant la thèse selon laquelle l’offense portée par les juifs à leurs voisins chrétiens était manifeste dans l’Italie médiévale, et ajoutant que l’accusation anti-juive traditionnelle de meurtre rituel contre eux était en réalité crédible. Peu importe si l’énorme affaire qui éclata à la publication de l’ouvrage conduisit finalement à son retrait des ventes, aux regrets contrits de l’éditeur et de l’auteur assailli de toutes parts, d’autant plus qu’il était le fils du grand rabbin de Rome : était ici visée l’image du juif opprimé, soumis, subissant la violence, avec cette suggestion que la violence infligée dans le cadre institutionnalisé de l’État d’Israël trouve son impulsion dans les profondeurs de l’histoire juive.
Il s’ensuit que la violence infligée émergea subitement dans l’histoire juive elle-même, comme si se manifestait, depuis la perspective des juifs citoyens de l’État d’Israël, une volonté d’ancrer dans l’histoire juive ce qui n’est somme toute que le produit très récent d’une révolution politique appelée sionisme. L’appel à mettre fin à l’histoire lacrymale des juifs se renverse ici en un récit où les larmes coulent de toutes parts. Le projet de déconstruire l’image du juif soumis, opprimé, incapable de répliquer à la violence, pour lui substituer celle du juif provocateur, si ce n’est agressif et vengeur, en la portant parfois à la limite, parfois en consonance immédiate avec une topique antisémite ancestrale mais inoxydable, doit donc se lire comme une répercussion de la révolution politique que fut le sionisme sur l’appréhension du monde juif demeuré pourtant à l’écart de cette mutation.
Mais l’on peut aussi bien inverser la perspective en identifiant une tendance à percevoir la prolongation d’une violence essentiellement subie dans la politique même de l’État d’Israël. Dans cette inversion, l’État d’Israël surgit comme la figure du juif parmi les nations comme l’a bien documenté l’affaire « Mohammed al-Durah », du nom de l’enfant palestinien dont la mort fut saisie en direct par une caméra de France 2 lors de la seconde intifada. Cette polémique qui porta d’abord sur la question technique de savoir d’où provenait le tir, a fini par mettre en balance la nécessaire documentation de la violence infligée par Tsahal, une affaire interne à cette entité qui possède les moyens de la violence d’État, et le retour de l’accusation diffamante de meurtre rituel d’enfants par les juifs qui annonçait depuis l’époque médiévale la licence d’exercer la violence à leur encontre. Depuis l’espace dérégulé, dominé par la hantise de l’accusation d’une violence infligée, se détermine ici un cadrage de l’événement qui retentit à l’intérieur de l’espace où la violence juive infligée est assumée et ses éventuels excès régulés par des institutions étatiques. Ici, le récit exilique, depuis son espace propre, projette son rapport à la violence subie sur l’espace travaillé par la doxa sioniste où elle est plus ou moins normalisée. Ce transfert se produit d’autant plus aisément dans des contextes où la conduite de l’État d’Israël produit des effets directs sur la situation des juifs du monde.
En Europe, le cadre exilique est maintenu, de sorte que la violence infligée par l’État d’Israël est aussi pensée dans le prolongement du récit exilique, donc tendanciellement métabolisée comme violence défensive.
Prises ensemble, ces controverses sont symptomatiques d’une sphère polémique juive divisée selon des lignes de fracture instables mais structurées autour de la question des évaluations et des jugements sur la violence en excès. L’évaluation de sa proportionnalité unit précisément la sphère polémique juive, en la clivant. Ce clivage, rendu visible sur la scène savante ou journalistique, divise intérieurement chacun de ses participants, qu’il donne de la voix ou demeure silencieux. On peut schématiquement retracer les logiques sous-jacentes qui traversent cette sphère en les rapportant aux positions sociohistoriques qui les déterminent. Là où domine la normalisation diasporique, dans le sillage de la vision de S. Baron, donc essentiellement aux États-Unis, la distance avec l’État d’Israël est d’emblée marquée, de sorte que la violence en excès est perçue avec acuité. Ici, la désimplication relative autorise, dans un pays où le sionisme est compris comme l’affaire des juifs vivant une situation anormale, à porter un regard détaché des urgences du moment, dès lors qu’il s’ancre dans un sentiment de sécurité. Là où la révolution sioniste a livré son produit nommé État d’Israël, la distance est abolie, de sorte que la critique de la violence est soit assumée soit désapprouvée, mais généralement déliée du cadre exilique avec lequel cet État revendique souvent avoir opéré une rupture plus moins consommée. Mais qu’en est-il des juifs d’Europe, pris en étaux entre ces deux perspectives ? En Europe, le cadre exilique est maintenu, dans le sillage de Baer, de sorte que la violence infligée par l’État d’Israël est aussi pensée dans le prolongement du récit exilique, donc tendanciellement métabolisée comme violence défensive. La distance critique s’y conjugue avec une critique de la critique, d’autant que l’accusation de violence excessive y consonne avec la violence traditionnellement subie.
Nulle surprise que le 7 octobre et l’offensive israélienne consécutive sur Gaza ravivent cette scène avec une intensité jamais égalée, tant cette séquence voit la violence poussée à son paroxysme, tant elle mêle violence subie, cadrée comme un épisode relevant du récit exilique, et réplique israélienne relevant de la violence infligée, dans un espace où elle est assumée même si elle est critiquée. Et dès lors que violence subie et infligée se télescopent si brutalement, chacun éprouve en son for intérieur le déchirement caractéristique de la sphère polémique juive. Ceci conduit à vouloir trancher ce que la politique juive génère aujourd’hui de tensions parfois insupportables : agréer sans états d’âme la violence infligée ou la refuser par principe ; se ranger derrière le nationalisme brutal de l’extrême droite israélienne ou garder les mains propres parfois au prix de l’existence-même de l’État d’Israël. Voilà deux manières d’échapper à la condition politique juive telle que la naissance de l’État d’Israël l’a altérée pour le monde juif dans sa totalité, depuis que la violence d’un État qui porte le nom juif est devenu une donnée objective de la politique. Mais ces deux échappées trahissent finalement ce que cette condition a de constitutivement ambivalent.
Cette ambivalence s’éprouve avec une grande netteté à partir de l’espace juif-européen. Elle ne consonne ni avec le diasporisme généré par l’espace américain, quelle qu’en soit la version, favorable ou défavorable au sionisme, ni avec l’adhésion au sionisme réalisé de l’intérieur de l’espace israélien, y compris dans sa version radicalement critique qui n’en est qu’une modalité. Depuis l’espace juif-européen, qui conjugue condition exilique et nécessité objective de préserver l’existence de l’État d’Israël, on est conduit à osciller. L’oscillation tient premièrement à ce que la violence infligée, fut-elle justifiée, est toujours d’abord examinée comme si elle était en excès, quitte à se raviser. Elle tient ensuite à une perception acérée que les assauts lancés contre l’État d’Israël relèvent décidément encore et toujours d’une condition exilique que cet État échoue à neutraliser. Assumer cet inconfort, hésiter dans la pondération entre violence subie et infligée, continuer d’osciller sans jamais s’arrêter, voilà la manière dont nous, juifs européens, nous inscrivons dans le prolongement de la tradition politique des juifs.
Danny Trom
Notes
| 1 | Salo Baron, « Ghetto and Emancipation : shall we revise the traditional view ? », The Menorah Journal, IV, 1928. |
| 2 | Pierre Birnbaum, Géographie de l’espoir, Paris, Gallimard, 2004, p.342sq |
| 3 | Y. Baer, “Ha-historyah ha-datit ve-ha-khevratit chel ha-yehudim : He‘arot la-sifro ha-khadash chel S. Baron,” Ẓion, 3, 1936, p.277-299. |
| 4 | Elliott Horowitz, Reckless Rites : Purim and the Legacy of Jewish Violence, Princeton, Princeton University Press, 2006. |
| 5 | Ariel Toaff, Pasque di sangue. Ebrei d’Europa e omicidi rituali, Bologne, Le edizioni del Mulino, 2007. Sur l’affaire Toaff : Sabina Loriga, « Une vieille affaire? Les « Pâques de sang » » d’Ariel Toaff, Annales. HSS, 2008/1, p.143-172. |












