1934. Venu de New York, où il vit depuis vingt ans, Jacob Glatstein s’installe dans une pension de famille de sa ville natale. Lui, le poète yiddish, n’a de cesse de dresser alors le portrait des pensionnaires, de faire parler ses interlocuteurs et de les écouter. Il se régale à livrer ainsi une photographie de la Pologne, ce pays qu’il a quitté vingt ans plus tôt. Séjour à rebours, de Jacob Glatstein, traduit par Rachel Ertel, vient de paraître aux éditions de l’Antilope. Bonnes feuilles.

En 2023 paraît aux éditions de L’Antilope Voyage à rebours, titre en français de Ven Yash iz Geforn, « Quand Yash est parti » : premier récit, publié à New York en 1938, de ce que Jacob Glatstein avait conçu comme une trilogie mais dont, dans le tumulte de la Seconde Guerre mondiale, il n’écrira que des ébauches d’un troisième volume. Les lecteurs qui avaient suivi Yash, double de l’auteur portant son surnom, tout au long de son fascinant voyage entre New York et Lublin – l’accompagnant en paquebot jusqu’au Havre, faisant halte avec le narrateur à Paris puis à Varsovie, traversant en même temps que lui une Europe en proie à la montée du nazisme – attendaient impatiemment la suite annoncée : l’arrivée de Yash dans sa ville natale, Lublin, et ses retrouvailles avec sa mère se trouvant au seuil de la mort.
Au grand contentement des lecteurs, Yash a atteint sa destination : vient de paraître aux éditions de L’Antilope la suite tant attendue, Séjour à rebours, en yiddish Ven Yash iz Gekumen, « Quand Yash est arrivé ». Nous sommes toujours en 1934, en plein épicentre de l’effondrement européen, mais ce deuxième récit de la trilogie inachevée de Glatstein ne trace pas de ligne de continuité. Du moins, celle-ci n’est pas exactement droite. Nous retrouvons Yash non pas à Lublin, auprès de sa mère mourante et de ceux qu’il y a laissés adolescent, en immigrant à New York en 1914, mais séjournant dans l’hôtel de ce qu’on comprend être un lieu de cure situé près de Kuzmir, étrange sanatorium dont ne nous est dévoilé ni le nom ni l’endroit.
En ce surréaliste lieu de villégiature, où le héros du périple par-delà l’Atlantique est venu chercher du repos après avoir enterré sa mère, les lecteurs redécouvriront Yash/Glatstein, entouré – tel Hans Castorp dans La Montagne magique de Thomas Mann, ou encore Max Blecher dans son récit de cure sanatoriale Cœurs cicatrisés – de personnages plus pittoresques les uns que les autres, mais reprenant imperceptiblement le fil de son récit. Aux nouvelles rencontres et aux confidences que lui font les pensionnaires de l’hôtel se mêlent des souvenirs d’enfance et des apparitions de vieilles connaissances de Lublin, pour in fine nous restituer un homme recherchant, encore et toujours, « un cœur juif chaleureux qui l’aiderait à pleurer, à rire, avec une émotion juive ». Elena Guritanu
*
Séjour à rebours, Jacob Glatstein [traduit par Rachel Ertel]. Extrait du Chapitre 1.
Mes paupières closes, comme un tamis, ne laissaient passer qu’une fine lumière. Je sentais que tout était inondé de soleil.
Ici je pouvais me reposer de ces quelques semaines en Pologne, j’allais pouvoir affronter le voyage de retour.
Cela faisait vingt ans que j’éprouvais une terrible nostalgie du pays et maintenant me voici contre cette terre avec mon corps dolent, et des pensées confuses et oniriques.
Par moments, je ne pouvais résister à la tentation et j’ouvrais les yeux. À droite se dressait un arbre sur lequel était suspendue la silhouette d’un vieux saint gravée sur une plaque de cuivre. Il avait une longue barbe et un air soucieux. J’admirais le merveilleux travail de l’artisan. L’idée de mettre la plaque de cuivre dans ma poche me traversa l’esprit. Mais je me suis dit que toutes les cloches des églises prévenues par des canaux secrets se mettraient à sonner si j’osais toucher à cette icône. J’avais beau savoir que c’était une pensée idiote, j’avais peur de toucher à la gravure sacrée qui me regardait avec des yeux, l’air vivant. Ils reflétaient le Nouveau Testament. La sculpture m’évoquait aussi le patriarche Jacob. Mais la sainte image soufflait une froideur glaciale. Elle était des nôtres, mais convertie. J’étais stupéfait qu’une main humaine ait réussi à intégrer tous ces traits disparates. Le vieux me regardait d’un air sévère. Je me suis rappelé que peu de temps avant j’avais joué sur scène un passage du Pentateuque, qui remontait à une époque plus lointaine. Le rôle avait été très difficile, j’en sentais encore la fatigue dans mes membres.
Je me trouvais dans le local de la communauté. Sur les murs, les tableaux d’un peintre que j’avais connu dans mon enfance et qui se trouvait maintenant dans le monde de vérité. On m’avait envoyé chercher le fils américain.
Autour d’une longue table nue, qu’on utilise pour les mariages, se tenaient des hommes aux visages graves. Quand je suis entré, ils se mirent debout, s’inclinèrent et se rassirent en silence.
– Pourquoi avez-vous besoin de moi en ces circonstances ?
La réponse ne vint pas des originaires de Lublin, mais des hommes du Pentateuque, les enfants de la Confrérie funèbre. L’un d’eux, à la longue barbe grise et pointue, me répondit : la concession que la communauté destinait à ma mère valait au moins mille dollars, mais comme ma mère était une personne juste et charitable, que moi j’étais un hôte de l’étranger, et qu’on voulait faire une faveur à un hôte, elle ne me coûterait que cinq cents dollars.
– De vous à moi, cinq cents dollars, c’est une bagatelle, dit le porte-parole. Et ton cadavre se trouvera enterré.
– Nous sommes vendredi, ta mère a reçu une grande faveur du ciel : mourir la veille du shabbat, cela veut dire qu’elle ira directement au paradis. On ne peut pas perdre de temps, dit un autre membre de la confrérie, et la concession est un bijou, tu verras toi-même, juste à côté du tombeau du rabbin, nous profiterons de son privilège. Là se trouve le tombeau, indiqua-t-il de la main, et là sa tombe à elle que nous cédons pour trois fois rien, pour ne pas qu’on nous accuse de t’avoir escroqué, et ta mère vaut bien que tu agisses comme un fils dévoué.
Et la vie d’Itè-Rokhl, ma mère, avait à peine atteint soixante-dix ans d’après son acte de naissance russe. C’étaient là les années de la vie d’Itè-Rokhl. Elles se déroulaient devant moi comme un petit Pentateuque. Itè-Rokhl, étendue sur son lit de mort, attendait. Elle était impatiente. Le paradis était ouvert pour elle. Les clepsydres aux grandes lettres d’alphabet marquaient son nom en noir sur les murs de la maison. Moi je devais faire affaire avec les hommes de la confrérie, la tombe, juste à côté de celle du rabbin.
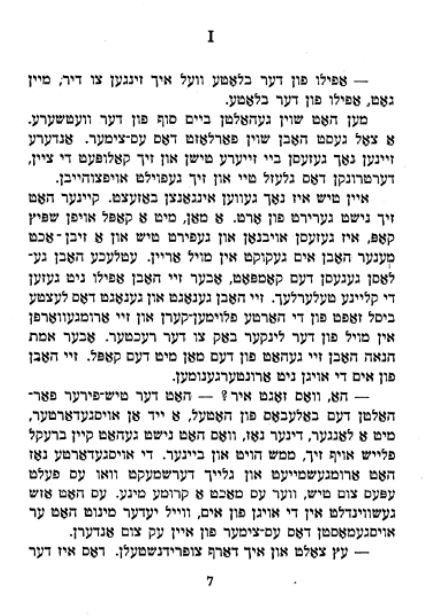
Je me suis levé et me suis incliné profondément.
– Je suis un étranger mais un de vos résidents. C’est là que j’ai grandi et je suis venu enterrer ma mère.
– Tu reçois le meilleur choix de nos tombes, parce qu’elle était une fervente croyante, ajouta un autre membre de la confrérie.
J’ai sorti les billets, j’ai pesé les pièces d’argent polonais et l’affaire était faite. Toute la confrérie se mit debout et s’inclina.
– L’enterrement aura lieu dans une demi-heure !
Maintenant le soleil pesait lourd sur mes paupières. Je savais que les rues étaient apeurées et que, dans le tronc à aumônes, les pièces tintaient, on avait peur d’en perdre. Le corbillard avançait lentement, les hommes et les femmes qui l’accompagnaient, et les cris autour qui s’interrompaient au milieu mais continuaient de retentir dans l’air – ce n’était pas une marche, ni un tintement, ni un mouvement, mais un arrêt, un arrêt absolu. Ce n’était pas le silence, c’était le mutisme en chacun. Il n’y avait rien à en tirer, c’était la fin. Cela peut signifier cent, mille, un million, mais c’était fini. Moi je voulais penser au commencement, aux premiers pas. Que signifie un ? Cinquante peut aussi bien être un, vingt peut être un et dix aussi un ?
Ce peut être un petit garçon en costume bleu marine, en casquette à visière qui marchait à pas de danse. Les chaussures que sa mère venait de lacer grinçaient. C’était déjà loin de la ville, les chaussures étaient couvertes de poussière, les maisons se faisaient petites jusqu’à disparaître complètement. On pouvait voir des vergers, avec divers arbres fruitiers, les poires commençaient à rosir, les pommes verdissaient à agacer les dents rien qu’à les regarder, de grosses groseilles charnues. Des fleurs perçaient les haies en fil de fer des jardins. Dans une prairie tachetée de jaune, une vache était comme tombée à genoux et avait la flemme de se relever.
Le petit garçon était enivré, ensauvagé par les odeurs et les couleurs. Il courait et ses chaussures amassaient de plus en plus de poussière.
– Du calme, petit voyou, tu vas tomber !
C’était sa tante Etkè qui le grondait. Elle portait dans une main un lourd panier et de l’autre elle essayait en vain d’attraper la paume du petit garçon.
Sa tante, éblouie par le soleil, plissait les yeux. Le petit garçon la taquinait, il s’éloignait d’elle en sautillant, comme s’il « était à cheval ». Par chance, de temps en temps, on entendait les aboiements de chiens et le petit garçon courait vers sa tante pour se mettre à l’abri.
– Attention, ne te fourre pas dans le panier, tu vas renverser le bouillon, ton papa n’aura rien à manger.
Le petit garçon avait peur qu’il ne reste plus une gorgée de bouillon pour son père. Le panier débordant de toutes parts laissait un sillon humide derrière lui sur le sable.
Tante Etkè s’asseyait sur une pierre et épongeait la sueur de son front.
– En voilà une chaleur, elle passait sa main dans les cheveux. Ne t’assois pas. Tu vas te salir et abîmer ton nouveau pantalon.
Le panier était encore chaud, malgré la distance qui les séparait de la maison. Le petit garçon était joyeux et criait à tue-tête.
– On est encore loin de la caserne ?
– Est-ce que je sais, une bonne trotte. Quelle chaleur !
– Est-ce que papa sert vraiment dans l’armée ? Tante Etkè continuait à s’éponger la sueur.
– Est-ce qu’il a le choix ?
– Qui est-ce qu’il sert ?
– Le Russkof.
Le petit garçon savait qu’un grand soldat, avec un grand nez de soldat, se tenait au-dessus de son père et lui ordonnait de viser et de faire boum ! Plus d’une fois, son papa avait pris un bâton et lui avait montré comment on vise.
– Qu’est-ce que ça veut dire “sert”, tante Etkè ?
– Servir veut dire être soldat.
– Qu’est-ce que c’est un soldat ?
Tante Etkè s’était remise en marche et portait avec précaution le panier. Elle se taisait, tandis que le petit garçon continuait à lui demander :
– Qu’est-ce que c’est un soldat ? insistait le petit garçon s’arrêtant, tapant des pieds et projetant de la poussière.
– Je n’en sais rien, je te dis, je n’en sais rien.
– Montre-moi que tu ne sais pas, montre-moi, il exigeait des preuves et se mettait à pleurer sans larmes, parce qu’il était très content des odeurs des vergers, du soleil brûlant, et des chiens qui n’aboyaient plus.
Sa tante allait tous les jours porter à manger à papa qui était parti pour trois semaines. Comme ça il n’aurait pas à manger les cochonneries du tsar. Mais aujourd’hui s’était collé à elle, comme une sangsue, le petit garçon qui voulait à tout prix voir son père avec son casque de soldat et ses épaulettes.
– Sluzba, service militaire, la tante prononçait ce terme dur dont le petit garçon s’emparait aussitôt.
Il le répétait en sautant sur son cheval imaginaire.
– Arrête donc, sauvageon !
Tante Etkè riait rarement. Aux yeux du petit garçon, son visage ressemblait à une bougie qui fondait. Chaque année il s’amenuisait. Il devenait de plus en plus fin et de plus en plus mou.
Mais maintenant, en route vers la caserne, le visage de la tante avait toute sa rondeur. Le goutte-à-goutte n’avait pas encore commencé.
Maman restait à la maison qui se trouvait sous le château. Au loin, dans la caserne, le père faisait son service militaire. Les mains de maman étaient douces quand, après avoir peigné les boucles du petit, elle lui caressait la tête. Le garçonnet et sa tête parcouraient l’espace entre les deux.
– Tu dois baiser la main de ton père quand vous arriverez, lui avait recommandé sa mère.
Il marchait et marchait dans une ville étrangère. Personne ne le suivait, personne ne le regardait ni devant ni derrière. Ils étaient alors seuls, sa tante et lui. Et parfois, les yeux du jeune homme qu’il était devenu, pâle et maigre, la peau sur les os, les suivaient du regard, car ce regard se déplaçait aussi, seul, même quand il y avait foule. Mais ce jeune homme était alors seul, sans sa tante. En dehors du regard attentif de ce jeune homme, des années plus tard, personne, dans cette ville étrangère, ne savait qu’il y avait eu un jour un garçonnet en costume bleu marine avec une casquette à visière sur la tête.
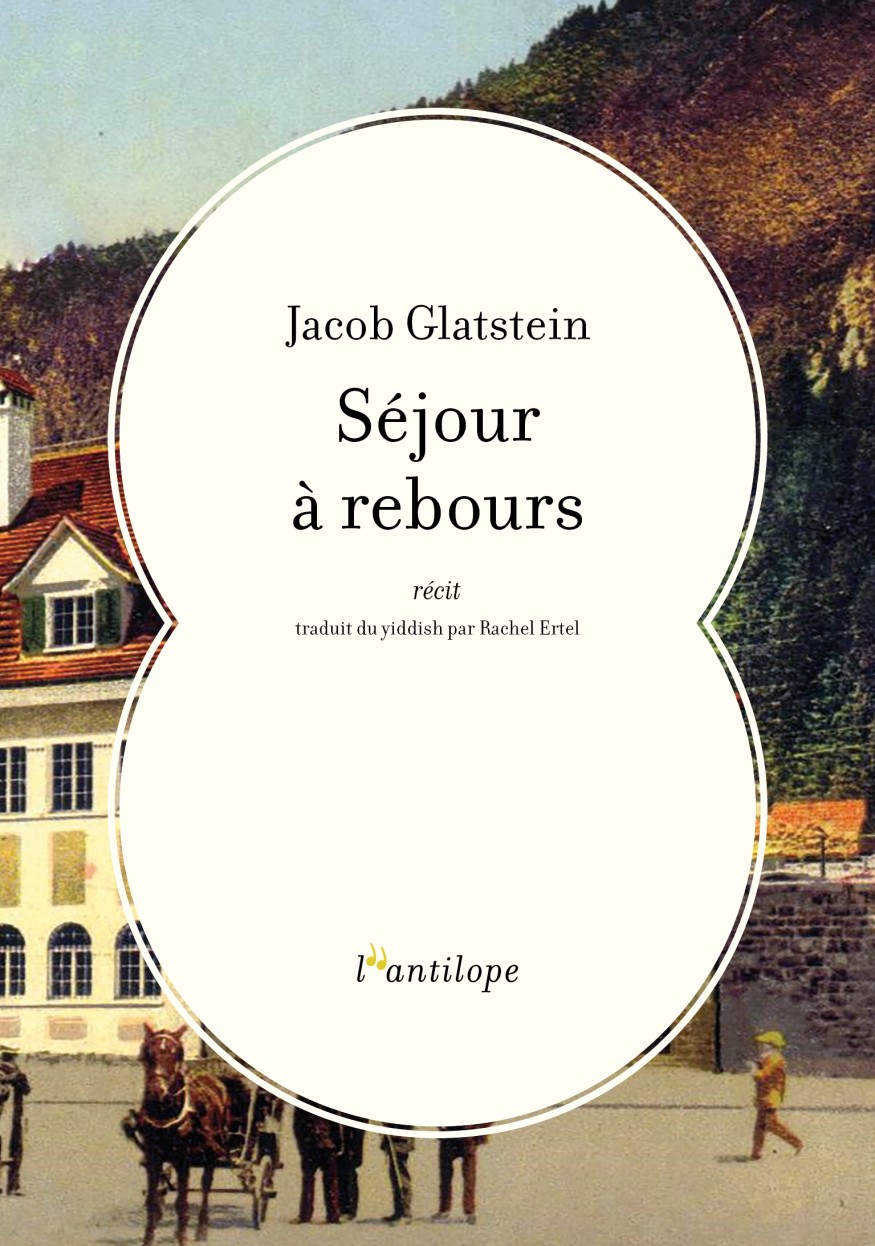
Une odeur de melon rouge et de tomates trop mûres montait des chariots des marchands des quatre-saisons : « Trois tomates pour trois cents, trois pour trois. Petites dames, dépêchez-vous, c’est pas cher, six pour un nickel ! »
L’air était frais, léger. Les vitres éclairées, la douceur de l’air, les affiches des cinémas, l’homme sur le chariot avec les melons, les Juifs devant les synagogues entre la prière du matin et celle de l’après-midi, tout cela enveloppé d’une sorte de voile sentait la grande ville étrangère, le monde étranger même. Incompréhensible, mais les choses les plus ordinaires baignaient dans une atmosphère étrangère, dans un lointain légendaire. Cela s’imbriquait avec les nuits et ses lampadaires, avec leurs couleurs clignotantes, leur scintillement nocturne, et les ténèbres qui se glissaient sous la peau et se posaient sur le cœur, s’infiltraient sous les ongles, et faisaient chanter chaque doigt.
C’était un monde étranger, mais dans le proche East Side qui venait d’élire comme maire Meyer London, au visage délicat, aux yeux espiègles, au nez fin et sensible. Il faisait partie du peuple qui venait d’élire un des siens, dans un monde étranger, où il est tout seul, serré dans la foule, avec qui il marche et marche et n’est peut-être qu’un regard qui ne perd pas de vue le garçonnet et la tante avec son panier.
Car ce regard, dans toute la joie étrangère, ne cessait d’épier le garçonnet, la mère dans la maison sous le château, le père à la caserne, le tout premier souvenir de la promenade entre le père et la mère comme sur un pont de corde au-dessus de la rivière. Pourvu que Dieu le protège de tomber dans l’eau, craint le regard du jeune homme qui marche, marche en avant, en avant au milieu de la foule, mais séparé d’elle.
Sans ce regard tourné vers l’arrière, cherchant sans cesse le lointain là-bas, personne ne verrait la tante et le garçonnet. Ils se dilueraient comme une fumée, ils entreraient dans la caserne, vus par personne. Le garçonnet ne verrait pas le père en casque militaire. De stupéfaction il oublierait de déposer un baiser sur la main de son père qui ne l’emmènerait pas voir les fusils dressés en triangles maintenus par des ronds en cuir avec leurs baïonnettes brillantes, l’officier à la moustache noire ne le soulèverait pas et ne le poserait pas sur ses larges épaules, et il n’aurait pas peur de pleurer.
Le casque ne ferait pas paraître son père étranger, il ne resterait pas à l’écart et ne verrait pas son père nettoyer l’assiette avec un bout de pain. Il ne l’entendrait pas dire à la tante, assise à côté, sur le seuil, dans son propre silence, les yeux baissés, qui avait le tournis de voir toute cette soldatesque, toutes ces bottes de soldats.
– Dis à Itè-Rokhl que Dieu lui accorde autant de plaisir que m’accordent ces déjeuners. Ses mains méritent des baisers.
Les mains de ma mère pétrissent des biscuits aux raisins et à la cannelle. Quand elle les sort du four, ils embaument la maison. Elle pétrit ses propres mains qui en dégagent les arômes et la chaleur de toutes sortes de pâtisseries.
Tout cela serait arrivé en fin de compte. Le garçonnet serait revenu par le même chemin, le long des vergers, des jardins fleuris, au milieu des aboiements des chiens, sous un soleil moins chaud. Mais personne ne l’aurait vu si le regard solitaire de l’East Side ne l’avait pas fait ressurgir de si loin, dans le temps et l’espace, d’un début qui était comme un premier pas.
Et ce regard qui cherchait et fouillait, tant d’années plus tard, et le faisait ressurgir, parce qu’il sentait que lui-même était un début qui pouvait se perdre dans la foule et disparaître, si personne ne le saisissait, ne l’écrivait, si personne ne le suivait pas à pas dans l’East Side qui dégageait la familière chaleur humaine, les fruits des marchands des quatre-saisons, les jeunes filles qui allaient au cinéma, la fraîcheur des soirées, les lumières lasses, la dureté du monde étranger qui pénétrait par les narines avec l’air, avec cette blessante et vivifiante matérialité.
Jacob Glatstein












