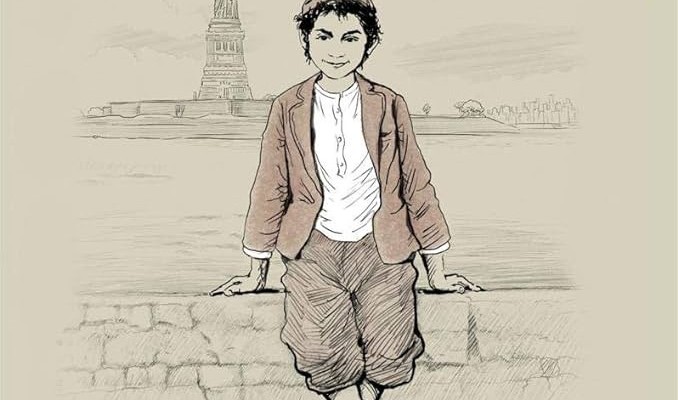En 1926, Samuel Schwarzbard assassine Symon Petloura, le général en chef de la révolution nationaliste ukrainienne, dont les hommes furent responsables d’environ 40% des exactions commises lors des pogromes qui frappèrent l’Ukraine durant la guerre civile (1918-1926). C’est à Czernowitz, où Schwarzbard résida un temps et aujourd’hui en Ukraine, que Paul Celan est né. Une part de sa poésie évoque « le plus large des fleuves », soit la longue histoire du crime antisémite qui relie l’histoire des pogromes à celle de la Shoah. Ivan Segré plonge dans la poésie de Celan et interroge, à partir d’elle, une mémoire de l’Ukraine ; comme le geste de Samuel Schwarzbard.

« un drap ! / que je m’y enveloppe devant le scintillement des heaumes »
Paul Celan, « Flocons noirs »
A Paris, au 6 rue de Palestine, se trouve la Bibliothèque Ukrainienne Symon Petloura, fondée en 1926. Sa présidente actuelle, Jaroslava Josypyszyn, en retrace l’histoire dans un article paru en novembre 2017 sur le site de « L’Immigration Ukrainienne en France »[1], quelques jours après qu’un monument à la mémoire de Petloura (ou Petlioura, ou Petliura, selon les translittérations depuis l’ukrainien) a été inauguré à Vinnitsa, en Ukraine, dans un quartier de la ville autrefois connu sous le nom de Yerusalimka (Jérusalem), autrement dit dans un quartier qui fut jadis « juif ». Certains y ont vu une provocation ; d’autres la légitime construction d’une mémoire nationale, Symon Petloura, le général en chef, le « hetman » de la révolution nationaliste de 1918-1921, étant considéré par beaucoup, en Ukraine, comme un héros.

Après la défaite des armées nationalistes et la prise de Kiev par l’armée rouge, Petloura se réfugie à Paris, où il conçoit le projet de fonder une bibliothèque ukrainienne, l’enjeu étant d’affirmer l’appartenance de l’Ukraine à l’Europe : « Oui, nous sommes européens territorialement, physiquement, psychologiquement. Nous sommes européens par notre conception du monde et par nos traditions héritées de nos ancêtres ». Hélas, le « héros » de la révolution nationaliste ne pourra concrétiser son projet, puisqu’il fut assassiné à Paris par « un agent de Moscou ». C’est du moins ce qu’assure l’actuelle présidente de la Bibliothèque Ukrainienne Symon Petloura dans l’article en question. Elle reprend ce faisant un argument avancé par les parties civiles au procès de son meurtrier, Scholem Schwartzbard, en 1927, argument devenu un lieu commun de l’historiographie nationaliste ukrainienne.
Schwartzbard était-il donc un « agent de Moscou » ? S’il était certes un agitateur révolutionnaire, anarchiste et communiste, ses motivations étaient cependant, à l’en croire, intimement personnelles : il considérait que Petloura était le responsable des pogromes antisémites auxquels s’étaient livrées les armées nationalistes pendant la guerre civile. Schwartzbard y avait perdu quinze membres de sa famille. Il ne semble donc pas qu’il ait eu besoin d’obéir à un ordre venu de Moscou.
Petloura était-il donc responsable des pogromes antisémites qui frappèrent l’Ukraine durant la guerre civile (1918-1921) ? La situation était alors anarchique, le pays étant la proie de bandes armées de toutes les couleurs : les « blancs », contre-révolutionnaires fidèles au Tzar ; les « rouges », révolutionnaires trotskystes et léninistes ; les « bleus et jaunes », nationalistes ukrainiens ; enfin des forces fidèles à l’autorité politique installée au pouvoir par les armées allemandes occupant Kiev. Et il semble que chacune de ces forces armées se soit rendue coupable, à des degrés divers, d’assassinats antisémites. Reste que d’après les historiens qui se sont penchés sur la question, ce sont les hommes de Petloura qui ont été les plus zélés d’entre les pogromistes, étant responsables d’environ 40% des exactions antisémites qui ont coûté la vie à des dizaines de milliers de juifs ukrainiens (entre 60.000 et 200.000 selon les estimations). Ce qui reste débattu, en revanche, c’est la question de savoir si Petloura a poussé ses hommes au crime ou s’il a au contraire cherché à les en empêcher, à moins, tout simplement, qu’il n’ait jugé la question secondaire au regard de ce qui seul importait alors, à savoir la révolution nationaliste ukrainienne et la conviction qui la portait : « Oui, nous sommes européens territorialement, physiquement, psychologiquement ».
Quoi qu’il en soit, dans son Histoire générale du Bund, Henri Minczeles observe : « Les armées de Koltchak, Denikine et Petlioura, avec la tolérance bienveillante du Directoire, instance suprême de l’État [ukrainien], donnèrent la nausée au monde entier. Les pogromes des années 1919 et 1921 furent infiniment plus meurtriers que ceux de la période tsariste des années 1880 et 1905. […] Depuis les massacres de Chmielnicki en 1648, jamais la communauté juive n’avait connu une telle tragédie[2] ».
A l’issue de son procès à Paris, Schwatzbard fut acquitté. Ses avocats parvinrent en effet à transformer le procès du meurtrier en procès de la victime, jugé responsable des pogromes. Et c’est ainsi que de la défense de Schwartzbard naquit la Ligue Contre les Pogromes, devenue ensuite la LICA, puis la LICRA.
Aujourd’hui, Petloura est honoré en Ukraine, tandis que Schwartzbard l’est en Israël (interdit de séjour en Palestine par les Britanniques, il est décédé en 1938 en Afrique du Sud, puis sa dépouille a été transportée en Israël en 1967). Est-ce à dire que chacun voit midi à sa porte ? C’est en effet une question de point de vue, c’est-à-dire, en dernière analyse, de bibliothèque. Et plutôt qu’en historien[3], nous proposons ici d’aborder la question à la lumière, subjective par définition, de la littérature.

*
Paul Pessach Antschel, alias Paul Celan, est né en 1920 à Czernowitz, en Bucovine, alors situé en territoire roumain. Devenue russe au sortir de la guerre, Czernowitz est aujourd’hui en Ukraine. Un monument y est érigé à la mémoire du poète. De taille modeste, il suffit cependant à défier les monuments érigés ailleurs à la gloire du cosaque Chmielnicki, du « hetman » Petloura ou du nationaliste Stepan Bandera, trois éminentes figures du nationalisme ukrainien dont les faits d’armes et/ou l’idéologie ont marqué l’histoire des persécutions antisémites (respectivement en 1648-1650, en 1919-1921 et en 1941-1944).
Durant la seconde guerre mondiale, les parents de Celan sont déportés depuis Czernowicz dans un camp en Ukraine, où ils meurent assassinés par les nazis. L’événement traumatique est évoqué notamment dans Le Sable des urnes (1948), un premier recueil que Celan retire aussitôt des ventes en raison des coquilles qui le parsèment. Mais certains des poèmes qui le composent seront repris dans le recueil suivant, Pavot et mémoire, paru en 1952, dont celui-ci : « Tremble aux feuilles qui brillent blanches dans les ténèbres. / Ma mère jamais n’eut les cheveux blancs. / L’Ukraine est verte comme les dents-de-lion. / Ma Mère si blonde n’est pas rentrée […] »[4].
Le « tremble », arbre de la famille des peupliers, est ainsi nommé du fait du tremblement de ses feuilles au moindre bruissement du vent ; et si ses feuilles sont vertes, ses fruits sont des graines revêtues d’un fin duvet blanc, telle une chevelure de neige. De nombreuses légendes sont associées à cet arbre, et selon certaines le bois de la Croix en serait issu. Plus loin dans ce poème, il est dit : « Etoile ronde, tu enroules la traîne d’or. / Ma mère avait au cœur une blessure de plomb ». A l’étoile qui signale aux mages la naissance de Jésus dans l’évangile selon Mathieu, ferait pendant l’étoile qui évoque la blondeur de la mère du poète, victime de la Shoah par balles.
« Löwenzahn, so grün ist die Ukraine » ; « Dents-de-lion, ainsi est le vert d’Ukraine ». En allemand comme en français, « dent-de-lion » désigne une fleur, le pissenlit, dont la particularité est de refleurir dès la fonte des neiges : du fait qu’elle est profondément enracinée dans le sol, seule sa partie supérieure meurt durant la saison glaciale, si bien qu’elle refleurit dès les premières lueurs du printemps, sa blondeur paraissant surgir de l’hiver, comme ressuscitée. Le jaune des pissenlits annonce ainsi la verdeur à venir des prairies ukrainiennes, en une comparaison dont l’apparent paradoxe évoque le vers d’Eluard : « la terre est bleue comme une orange ». Mais la couleur de cette fleur est aussi, et d’abord, l’évocation de la blondeur de la mère de Celan, morte en Ukraine.
Un autre poème du même recueil commence par ces mots : « Des souliers de fer crissent dans la cerisaie ». Et il se conclut ainsi : « Le cerise saigne pour lui ». Dans un poème posthume daté de 1968, il est de nouveau question d’une « cerisaie », mais cette fois au sujet de la mort du père : « Dans mon genou criblé de balles / il y avait mon père, / plus grand / que nature, mort, il était / là, / Mikhaïlovka et / la cerisaie étaient autour de lui, / je savais que cela / se passerait ainsi, dit-il »[5]. Dans un article intitulé « Celan, les eaux du Boug », Marc Sagnol, ancien directeur de l’Institut français de Kiev, relate son voyage sur les traces du meurtre des parents du poète et cite ce poème. Il y explique que « Mikhaïlovka et la cerisaie » évoque le lieu où des Juifs déportés en Ukraine depuis Czernowitz furent assassinés : « L’éditrice des Œuvres posthumes, Barbara Wiedemann, suppose dans son commentaire que le mot ‘‘cerisaie’’ fait allusion à la pièce de Tchekhov, mais il s’agit bien plutôt d’un témoignage de la lecture, par Celan, du livre de Daghani, La tombe est dans la cerisaie, son journal de Mikhaïlovka où il est question, à la fin, de la ‘‘liquidation’’ du camp[6] ». Si la « cerisaie », en effet, ne peut pas ne pas évoquer la pièce de Tchekov, l’erreur d’appréciation de Wiedemann est cependant d’autant plus flagrante que dans un autre poème posthume, cette fois daté de 1959, Celan écrit : « Loin, à Mikhaïlovka, en / Ukraine, où / ils ont battu à mort mon père et ma mère : qu’est-ce qui fleurissait là-bas, qu’est-ce / qui fleurit là-bas : (…)[7] ». Nous avons vu la réponse qu’apportait le poème de Pavot et mémoire : « la cerisaie saigne pour lui ». La rougeur du fruit du jardin est une blessure intime, de même que la blondeur du pissenlit surgie de la neige ukrainienne. Il faudra dès lors à Celan surmonter l’abîme de l’insensé, et réinventer le poème, pour reconquérir la puissance salvatrice du mot « fleur ».

Du premier recueil, Le sable des urnes, un poème, en particulier, éclaire la lumière dont la cerisaie est baignée : « Schwarze Flocken », « Flocons noirs ». Non réintégré dans Pavot et mémoire, il est demeuré inédit en français jusqu’à ce que Jean Bollack en propose une traduction dans un article intitulé « Le testament d’Ukraine ». Il l’introduit par ces mots : « En 1943, dans le camp de travail de Roumanie où il était interné, Celan écrivit un poème contenant un message poétique que, dans la fiction du texte, sa mère lui fait parvenir de l’Est ». C’est l’annonce de la mort de son père :
La neige est tombée, sans lumière. Une lune / déjà ou deux depuis que l’automne sous le froc d’un moine / m’a porté le message, à moi aussi, une feuille des coteaux de l’Ukraine : / « Pense qu’il fait hiver ici aussi, pour la millième fois à présent, / dans le pays où coule le plus large des fleuves : / sang céleste de Jacob, béni par les haches. / Glace qui n’est pas la terre – et l’on patauge, le bourreau avec toute / sa bande dans les soleils qui s’enténèbrent… Enfant, un drap ! / que je m’y enveloppe devant le scintillement des heaumes, / quand la motte, la rosâtre, se fend, quand, neigeâtres, les ossements tourbillonnent, la poussière / de ton père, / que crisse le chant du cèdre sous les sabots… / Un drap, un petit drap, tout mince, pour que je garde / à présent, où tu apprends à pleurer, le détroit du monde / à mes côtés, qui jamais ne verdoie, mon enfant, pour ton enfant ! » / L’automne mourait dans le sang, mère, la neige me brûla : / je cherchai mon cœur pour le faire pleurer, je trouvai, ah !, l’haleine de l’été, / elle était comme toi. / La larme me vint. Je tissai le drap petit[8].
Qu’est-ce que peut un « drap » (« Tuch »), un « drap petit », un bout de tissu (« Tüchlein »), contre les armures des cavaliers, leurs « haches » et leur casques (« heaumes ») ? Et d’abord, qu’est-ce que ce « drap » ? C’est ce dont la mère s’enveloppe, vraisemblablement pour couvrir sa nudité, et ce que le poète, au terme du poème, entreprend de « tisser » ; c’est donc son œuvre. C’est aussi, plus prosaïquement, le mouchoir qui recueille la larme. C’est enfin, inévitablement, le châle de prière traditionnel, le talith avec lequel on enveloppe le défunt dans la tradition juive. Le père assassiné, jeté dans la fosse commune, n’a pas été enveloppé de son châle : « neigeâtres, les ossements tourbillonnent, la poussière/ de ton père ». En tissant ce « drap », le poète œuvre-t-il à la résurrection du père, en une vision parente de celle d’Ezéchiel ? Le compte des lunaisons au début du poème, n’est-ce pas en effet une allusion au calendrier hébraïque, axé sur les renaissances de la lune ?
Mais l’allemand « Tuch » s’entend également, et peut-être d’abord, à la lumière du yiddish : « Tukh – טוך », un petit vêtement, ou tissu, notamment l’étoffe dont on recouvre le pain sur la table du Shabbat. Et dans le contexte du poème, le mot renvoie immanquablement à une expression populaire yiddish (glanée sur un site anglophone) : « Kozakn forn, falt dos fartekh (קאזאקן פארן, פאלט דאס פארטעך) – When Cossacks are marauding, the apron falls (i.e. out of fear, people drop what they’re doing and run) ». Traduisons : « Quand rôdent les Cosaques, les tabliers tombent », c’est-à-dire que tout Juif cesse son activité pour aller se cacher.
Revenons au poème : « le plus large des fleuves » n’est pas tant le Jourdain, comme le désigne un chant yiddish, que la longue histoire du crime antisémite depuis les cosaques jusqu’aux nazis ; et en remontant plus loin encore dans le temps, ce fleuve prend sa source dans le Psaume 74, où les « adversaires » d’Israël pénètrent dans l’enceinte du Temple, y imposent leurs « emblèmes » et y « brandissent la hache ». Face aux cavaliers de l’apocalypse, de quelle arme dispose le poète ? Une mince étoffe, qu’il tisse. L’étoffe du langage, plus exactement d’un langage, où résonne l’expression populaire yiddish : « quand les cosaques rôdent, les tabliers tombent ». Mais Celan, par un tour qui lui deviendra propre, en revisite la forme et le sens, puisque loin de laisser tomber le drap-tablier et de fuir se cacher, la mère s’en enveloppe et le fils, lui, le tisse pour y bâtir son œuvre.
En un sens, reprenant et inversant le proverbe yiddish, Celan écrit, en hommage à son père converti au sionisme, son propre « chant du cèdre ». Il ne s’agit évidemment pas d’un chant nationaliste et guerrier. Mais il s’agit bel et bien, au travers du poème, de regarder l’histoire dans le blanc des yeux. Et dans l’Ukraine des années 1940, l’histoire est donc celle d’une continuité depuis les pogromes antisémites perpétrés par les cosaques emmenés par Chmielnicki (ou Khmelnitski) jusqu’au génocide perpétré par les nazis et leurs collaborateurs roumains, lituaniens ou ukrainiens.
Reste que cet admirable poème, Celan ne l’a pas moins retiré, sinon renié. Sans doute qu’il le jugeait encore trop redevable d’une esthétique et d’un lyrisme dont il s’agira dorénavant de s’affranchir afin de réinventer, « après Auschwitz », le poème, et singulièrement le poème de langue allemande.
C’est avec La rose de personne, recueil paru en 1963, que son œuvre s’impose comme l’une les plus incontournables du XXe siècle. Il y réinvente non seulement le poème allemand, mais le « psaume » : « Personne ne nous repétrira de terre et de limon, / personne ne bénira notre poussière. / Personne. / Loué sois-tu, Personne. / Pour l’amour de toi nous voulons / fleurir. / Contre / toi » (trad. Martine Broda).
« Personne », en allemand « Niemand », qui est-ce donc ? Voilà sans doute ce dont nul ne peut prétendre connaître la réponse. En revanche, la question posée est bien : qui est-ce ? Et non pas : qu’est-ce que c’est ? Ainsi que le relève Martine Broda commentant l’Entretien dans la montagne : « [Celan] compare la nature à une langue qui exclut le Juif ». Et en guise d’illustration, elle cite ce propos de l’Entretien au sujet d’une ontologie sans altérité : « une langue de toujours, sans Je et sans Toi, rien que Lui, rien que Ça, comprends-tu ». Tout à l’inverse de la « langue qui exclut le Juif », le poème de Celan est adressé à un « Toi ». Et c’est là, selon Broda, ce qui justifie que le recueil La rose de personne soit dédié au poète Ossip Mandelstam, mort en déportation sous Staline. Au sujet d’un écrit théorique de Mandelstam, De l’interlocuteur, elle explique :
Jamais perceptible dans la traduction Blot, pas assez littérale, une opposition travaille De l’interlocuteur dans sa langue d’origine, de part en part. Celan y a sans doute été sensible, qui lisait, lui, le russe à la lettre. C’est celle de nikto et niekto. Nikto, indéterminé, est l’équivalent exact de « personne » ou de niemand. Nietko, indéterminé-déterminé, qu’on pourrait traduire par « une personne » ou « une certaine personne », est très proche du quidam latin (quelqu’un que je pourrais connaître, mais ne veux nommer). Mandelstam lie ces deux mots, presque homophones, à sa réflexion sur l’interlocuteur. Je reprends les principales articulations de son raisonnement : le poète à l’air de ne s’adresser à personne (nikto). C’est que, contrairement au littérateur, il ne s’adresse pas à une certaine personne (nietko), son contemporain, son voisin, l’ami-dans-la-génération, ou même le contemporain de l’avenir. Il fait un pari sur l’inconnu, en visant un indéterminé lointain : le lecteur dans la postérité. Cet interlocuteur secret existe cependant. C’est le poème qui l’élit, le crée, puisque celui qui ramasse la bouteille jetée à la mer sait qu’elle lui était personnellement destinée. En retour, c’est l’existence de l’interlocuteur qui est le garant de la légitimité, du bon droit du poème[9].
A cette lumière « personne », niemand, nietko, c’est donc « l’interlocuteur secret » du poème qui, s’il se tient éloigné, voire nulle-part, « existe cependant ». Mais il y a aussi un sens du mot personne, niemand, nietko, qui est à rechercher dans l’œuvre d’un autre écrivain russe, Boulgakov, ami de Mandelstam, dont le chef d’œuvre, Le Maître et Marguerite, serait une sorte d’oraison funèbre à la mémoire du poète déporté par Staline, ainsi que l’explique André Markowicz dans un entretien : « Selon nous, Le Maître et Marguerite est avant tout un hommage à Ossip Mandelstam, immense poète, proche de Boulgakov, arrêté et déporté pour des vers incendiaires à l’égard de Staline. »

Boulgakov est aussi l’auteur de La garde blanche, écrit entre 1923 et 1926. Le roman a pour contexte la guerre civile ukrainienne. Kiev est sous l’autorité d’un hetman placé au pouvoir par les troupes d’occupation allemandes, mais les armées nationalistes de « Petlioura » (selon l’orthographie de la traduction française) approchent, tandis qu’à l’Est gronde la révolution bolchevique. Dès l’incipit, le narrateur signale que la guerre civile est perçue comme l’enfantement d’un monde nouveau : « Grande et terrible fut cette année-là, mil neuf cent dix-huitième depuis la naissance du Christ, et seconde depuis le début de la révolution ». Comme on l’a souvent remarqué, La garde blanche est à certains égards une réécriture tragi-comique du chef d’œuvre de Tolstoï, Guerre et paix. Car « cette année-là », 1918, en Ukraine, il n’est pas question de déceler dans les événements historiques une quelconque providence messianique, mais bien sa parodie. Les autorités de Kiev, soumises à l’occupant, décampent, tandis que les armées de Petlioura, le chef nationaliste attendu comme le messie, s’avancent…
C’est sur un deuil personnel que débute La garde blanche : « Maman, radieuse reine, où es-tu ? ». Le narrateur, comme Boulgakov à cette époque, vient de perdre sa mère. La manière dont l’histoire avec un grand « H » rencontre l’histoire personnelle, individuelle, constitue la trame du roman, tout au long duquel Boulgakov joue avec le signifiant « Petlioura », prononcé « Petourra » par les Allemands. Tel un « Christ », un messie, les gens assurent qu’il existe, sans toutefois que son existence ne parvienne à s’incarner autrement que sous la forme d’un signifiant : Petlioura, Petourra, petliouriser. Lorsque les armées nationalistes s’emparent de la ville, les uns croient le reconnaître ici, tandis que d’autres assurent l’avoir vu là. Il est partout et nulle part à la fois. Existe-t-il réellement ? Ou est-ce une illusion aussi tenace que le sens qu’on prête à l’Histoire ? Et est-ce une figure messianique ou diabolique ? C’est au terme du roman que la réponse est donnée, lorsque Boulgakov place au centre du récit le leitmotiv jusque-là discret, mais insistant, de l’antisémitisme. Car contrairement au roman de Sienkiewicz (Par le fer et le feu, 1884), où l’apothéose antisémite de la révolution cosaque reste un détail de l’histoire, Boulgakov l’érige, pour sa part, en motif ultime de son récit. Nous sommes alors en 1919, année « encore plus terrible » que la précédente, précise le narrateur, qui relate aussitôt un micro-événement survenu à Kiev, après que les armées de Petlioura ont conquis la ville : un juif, vêtu de noir, est battu à mort sur un pont par des cosaques. Ceci fait, les cavaliers cosaques disparaissent. « Seul demeura le cadavre froid du Juif en manteau noir près de l’entrée du pont, avec quelques poignées de foin piétiné et du crottin de cheval ». Intervient alors la leçon de l’Histoire :
Seul ce cadavre témoignait que Pétourra n’était pas un mythe, qu’il avait réellement existé… Dzing… Trenn… guitare, Turc… réverbère en fer forgé, rue Bronnaïa… nattes de jeunes filles balayant la neige, blessures par balles, luttes sauvages dans la nuit, le gel… Tout cela avait donc réellement existé. Et Grits va au travail… Ses bottes sont déchirées…
Mais pourquoi ? Personne ne peut le dire. Quelqu’un paiera-t-il pour le sang versé ?
Non. Personne.
Simplement, la neige fondra, la verte herbe ukrainienne sortira et flottera comme une chevelure sur la terre… les épis splendides mûriront… l’air brûlant vibrera sur les champs, et toute trace de sang aura disparu. Le sang ne coûte pas cher sur les terres rouges, et personne ne le rachètera.
Personne.
Évoquant l’écriture de La Garde blanche et les obstacles à sa parution, Laure Troubetzkoy, la traductrice de l’édition française, explique : « Les circonstances à la fois rocambolesques et dramatiques de cette publication avortée furent plus tard évoquées dans les premiers chapitres du Roman théâtral, dont le héros, auteur malheureux du roman La Neige noire, hérita non seulement des infortunes de Boulgakov mais aussi de sa prédilection pour les titres colorés[10] ».
La Neige noire, titre fictif de La garde blanche, voilà donc qui nous renvoie à « Schwarze Flocken », « Flocons noirs », le poème de Celan où il est question de « l’hetman » et des « sabots » des cavaliers cosaques qui « en crissant écrasent la chanson du cèdre ». Et « la verte herbe ukrainienne » qui, au printemps, « sortira et flottera comme une chevelure sur la terre », nous évoque aussitôt les pissenlits du poème de Pavot et mémoire et la blondeur des cheveux de la mère assassinée. Enfin, à la conclusion de Boulgakov au sujet des pogromes perpétrés par les armées de Petlioura, condensés en l’image de ce « cadavre froid du Juif en manteau noir », fait donc écho le « psaume » de Celan : « « Personne ne nous repétrira de terre et de limon, / personne ne bénira notre poussière. / Personne ».
La question est ainsi posée, à la lumière du poème : l’anarchiste juif Scholem Schwartzbard qui assassina Petloura à Paris, était-ce un « agent de Moscou » ou un agent de personne ?
Ivan Segré
Notes
| 1 | http://ukraine-memoire.fr/lhistoire-mouvementee-de-la-bibliotheque-ukrainienne-symon-petlura-a-paris/ |
| 2 | Henri Minczeles, Histoire générale du Bund, Denoël, 1999, pp. 263-264 |
| 3 | Voir, à ce sujet : Thomas Chopard, « Le procès Schwartzbard et le métier d’historien », Cahiers du monde russe [En ligne], 58/4 | 2017, mis en ligne le 01 octobre 2017, consulté le 19 juillet 2022. URL : http://journals.openedition.org/monderusse/10160 ; DOI : https://doi.org/10.4000/monderusse.10160 |
| 4 | Trad. V. Briet, éd. C. Bourgois, 1987. |
| 5 | Cité et traduit par Marc Sagnol, « Celan, les eaux du Boug », in Les Temps Modernes, 2016/4, n°690, pp. 1 à 27. |
| 6 | « Celan, les eaux du Boug », art. cit. |
| 7 | Cité et traduit par M. Sagnol « Celan, les eaux du Boug », art. cit. |
| 8 | Jean Bollack, Poésie contre poésie. Celan et la littérature, Puf, 2011, p. 36-37. |
| 9 | Martine Broda, « La leçon de Mandelstam », in Contre-jour. Etudes sur Paul Celan, Cerf, 1986, p. 31-32. |
| 10 | Ed. Robert Laffont, 1970. |