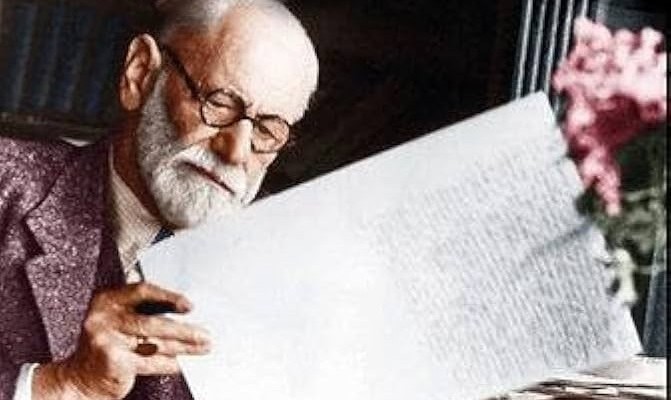Yudit Kiss est née à Budapest en 1956, l’année même où les chars soviétiques entraient dans la ville. Après une enfance et une jeunesse en Hongrie, elle passe de l’autre côté du rideau de fer. Son père, lui, rescapé de la Shoah et communiste convaincu, y demeurera toute sa vie. Coincé entre les craintes nées des persécutions antisémites, et les espoirs suscités par l’avènement de l’homme nouveau, il apparait dans le portrait qu’en fait sa fille comme à la fois incapable d’être juif et incapable de ne pas l’être. C’est à la quête de son identité juive que se lance Yudit Kiss dans L’été où mon père est mort – qui sort aux Éditions de l’Antilope. K. en publie les bonnes feuilles en exclusivité.

Dans le temps qu’il lui resta à vivre, mon père fut capable d’admettre une autre fois et à contrecœur sa judéité : après avoir lu, à son corps défendant, Être sans destin d’Imre Kertész. Ce devait être au début des années 1990, au cours d’un séjour chez nous à Genève. Par un paisible après-midi, sans avertir, le passé revint saisir mon père à la gorge, l’étranglant d’une poigne de fer et l’obligeant à se confronter à une fin qu’il avait personnellement réussi à éviter et qu’il avait déclarée, à la suite de cet heureux hasard, n’avoir jamais existé à l’échelle de sa propre vie. Pour mon père, ce qui était arrivé aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale était une manifestation de la nature destructrice du système capitaliste, un génocide parmi tant d’autres aussi effroyables, visibles et invisibles, qu’il condamnait par principe en tant que communiste, mais qui n’avait rien à voir avec lui. Pourtant, en ce jour de printemps tardif, chez nous à Genève, mon père eut l’imprudence de s’égarer parmi les méandres chaotiques et en apparence inoffensifs de notre bibliothèque. Se réveillant de la sieste dans un appartement vide, alors que ma mère et moi nous promenions au parc avec les enfants, il avait cherché de la lecture. Et ce fut Être sans destin que le destin versatile et capricieux lui mit entre les mains, le livre dans sa première édition de poche, celle dont la couverture arbore La Melencolia de Dürer. C’était un cadeau de Tamás qui me l’avait donné quelques années plus tôt en le qualifiant de chef-d’œuvre inconnu de la littérature hongroise du XXe siècle – je prévoyais depuis de le lire sans en avoir eu le temps.
Le hasard avait conduit dans la même cuisine deux personnages secondaires du drame vieux de plus d’un demi-siècle, drame toujours aussi inconcevable et impardonnable : d’une part mon père, à présent courbé au-dessus de la table, le visage enfoui dans les mains, et qui a survécu avec une chance incroyable à « l’époque du péril », doux euphémisme choisi en hongrois par la postérité pour ne pas avoir à vivre avec des expressions autrement plus désagréables ; et d’autre part l’incarnation romanesque du survivant, qui n’a pu échapper au jugement et qui, des années plus tard, a décidé de raconter comment l’enfer s’infiltre dans chaque strate de l’existence humaine. À ce que je sache, mon père était familier de la « littérature de la Shoah » : lorsque nous étions adolescentes, l’une de nos lectures de base était le Grand Voyage, du moins jusqu’à ce que le camarade Jorge Semprún s’aventure sur le terrain glissant de l’eurocommunisme, par quoi il réussit à être persona non grata dans nos étagères ; mon père connaissait certainement les récits des écrivains Béla Zsolt ou Mária Ember, mais il devait se préparer avant de les lire, savoir d’avance dans quel recoin secret de sa conscience il pourrait ensevelir les horreurs pour ne pas en mourir.
Pourtant, en cette fin d’après-midi à Genève où il ne connaissait ni l’environnement ni la langue, quand il tomba par hasard sur un roman en hongrois affichant sur sa couverture une figure féminine charnelle et rêveuse, sa vigilance l’abandonna et, le temps qu’il comprît que le roman parlait de lui, un garçon solitaire aux yeux brillants qui voulait vivre, de parents divorcés, d’un père tué au travail forcé, de ce qu’ils avaient été avant que le destin revêtu d’un uniforme de nazi ou de croix fléchée ne s’abattît sur eux, il était trop tard. Il ne pouvait déjà plus échapper au cauchemar. Il se perdit pour de bon dans ce palais des glaces sans issue qui, à chaque tournant, lui renvoyait le portrait dont il s’était efforcé de se libérer, dont il avait même voulu effacer le souvenir de la mémoire du monde, et qu’il redoutait comme le feu et le soufre de l’enfer. Un seul regard du petit garçon juif condamné à mort qu’avait été mon père eût suffi à démolir la forteresse d’idéologie, de mensonges et de mécanismes d’autodéfense dans laquelle il s’était abrité en devenant adulte.
En commençant d’errer dans le labyrinthe, peut-être faisait-il la différence entre lui et son reflet intangible. Mais au bout d’un temps, il dut perdre la notion de qui, de lui ou de son double condamné à mort, venait lui faire face ; il ne parvint plus à distinguer lequel il était, ni même à savoir qui il était, lui, quel geste était réel ou simple illusion d’optique ; quelqu’un derrière la surface froide du miroir lui jouait-il un tour cruel, le dépouillant furtivement de la vie où il s’était soigneusement emmitouflé comme dans un manteau prêté et usurpé indûment, ou n’était-ce qu’une illusion, un jeu de mauvais goût ? Le jeu s’était transformé en traque et il n’était pas sûr qu’il en ressortît vivant. Un long moment dut s’écouler avant que mon père, accélérant le pas, haletant et se cognant contre tous les coins, ne finît par trouver le chemin de la sortie.
Quand je l’ai retrouvé au milieu de la cuisine plongée dans le noir, il était recroquevillé sur sa chaise, le visage enfoui entre ses mains. En m’entendant, il a levé la tête et jeté un regard confus autour de lui. Il respirait difficilement et ses pupilles étaient dilatées, comme lorsqu’on vient de se réveiller. Peut-être même avait-il pleuré, mais je ne pouvais pas en être sûre car, ne l’ayant jamais vu pleurer, je ne connaissais pas son visage en pareille circonstance. Et dans l’obscurité je ne pouvais pas distinguer ses traits. J’ai allumé et je me suis affairée autour de lui afin de le ramener à la réalité. Il est resté longtemps immobile sur sa chaise en serrant le livre dans sa main, comme s’il craignait que le sombre démon ne surgisse devant lui.
Quelques heures plus tard, après avoir couché les enfants, je lui ai demandé s’il voulait prendre un peu l’air. Nous sommes allés nous promener au bord du lac. Nous avons déambulé lentement, sans prononcer un mot, sous le ciel pourpre, attendant que les lampadaires s’allument.
– Bon, on peut aller jusqu’à dire que c’est un chef- d’œuvre, a brusquement déclaré mon père.
De telles affirmations ne sortaient pas de sa bouche d’ordinaire, je n’ai donc pas voulu le railler en lui demandant pourquoi il ne le disait pas tout simplement. Curieuse, j’ai commencé à lui poser des questions, mais il répondait de mauvais gré et a rapidement changé de sujet.
J’ai mis sept bonnes années encore avant de pouvoir me plonger dans Être sans destin. J’avais lu les autres œuvres de Kertész, arpentant prudemment le terrain pour voir ce qui m’attendait. Mais chaque fois que je commençais Être sans destin et que j’arrivais au passage où le protagoniste repousse son assiette devant lui, saisi d’un haut-le-cœur quand son père le touche, mon ventre se nouait au point que je devais reposer le livre. Ce n’est que des années après la mort de mon père que j’ai compris ce qui lui était arrivé cet après-midi-là à Genève. Par-delà la rencontre dramatique de deux survivants, deux visions du monde s’étaient affrontées au-dessus de la table de la cuisine : un messianisme libérateur contre la poésie du néant. D’un côté, l’idéal plaçant sa foi dans le progrès de l’histoire, l’humanité avançant vers la lumière, de l’autre, la nudité de la vie humaine dépossédée du sublime de la vocation. Le froid glaçant du non-être.

De ce courant de pensée, je n’avais que des connaissances fortuites. Mon père avait pris en main la formation de ma vision du monde à un âge relativement tendre, mais quand j’ai eu treize ans, cette formation a soudainement été interrompue au chapitre Giordano Bruno. Son histoire m’apprenait comment les forces rétrogrades traitaient les représentants des idées progressistes. Dès lors mon père me jugea mûre pour passer aux œuvres choisies de Marx-Engels-Lénine, par la lecture de la Critique du programme de Gotha et du Manifeste du parti communiste. Ce n’était certes pas aussi beau et dramatique que le pauvre Italien sur son bûcher pour lequel j’avais versé des larmes brûlantes, mais cela semblait conduire plus directement au salut de l’humanité. Avec de telles lacunes en histoire des idées, on imagine sans peine mon ahurissement lorsqu’une dizaine d’années plus tard, lors d’un camp d’université dédié à l’étude du Capital – où l’on disséquait des semaines durant l’œuvre révolutionnaire du grand penseur avec la méthodologie théologique propre à ses traditions –, un professeur de philosophie invité nous fit lire du Parménide. Pour la première fois, une source crédible me faisait prendre conscience que la vie pouvait n’avoir aucun sens. Mais mon éducation et ma constitution psychique refusèrent d’enquêter plus avant ce prédicat. Du moins jusqu’à ma lecture d’Être sans destin. L’histoire de Köves place chacun devant une existence aussi dépouillée de tout que les axiomes de Parménide. Un individu parcourait le chemin du bout duquel aucun voyageur n’était encore revenu, gardant tout en mémoire et, vingt ans plus tard, il racontait son expérience. Même vingt ans après, il était résolu à ne faire aucune concession à la souffrance, la compassion ou le désespoir. Il établissait un inventaire précis de ce dont l’homme est capable – capable de commettre, de supporter. Il ajoutait qu’au bout du chemin les personnages ne sortiraient pas grandis, qu’ils ne subiraient ni jugement ni rédemption. Ils seraient tous balayés par le temps impassible avec les autres déchets occupés de leurs propres métamorphoses.
La vie de mon père, elle, avait été guidée par la conviction que tout avait un sens, que le progrès était irréversible et que l’humanité pouvait être sauvée. Qu’il ait pu imaginer cette rédemption d’une seule façon, et qu’il ait jugé admissible, voire désirable, que les gens soient sauvés contre leur gré, est une autre question. La dictature était justifiable puisque les masses manquaient de maturité pour reconnaître leurs propres intérêts. On leur enfoncera la rédemption dans le crâne ! Mais cette foi aveugle et résolue dans l’humanité et le progrès, que ses convictions politiques avaient profondément infusée, était ce qui rendait mon père digne d’amour. Même lorsque je n’acceptais déjà plus ni ses positions, ni ses travaux, je devais me battre pour échapper aux rets qu’il me tendait en exploitant nos instincts communs afin de me convaincre d’être d’accord avec lui et de le suivre.
Si mon père avait anticipé le coup que lui infligea Être sans destin, il l’aurait rejeté avec sa fougue coutumière au nom du saint progressisme et aurait jugé la vision du monde de l’œuvre comme un inacceptable galimatias existentialiste. Le livre aurait été sagement reposé dans notre bibliothèque et son auteur aurait été classé parmi ceux dont les expériences, les pensées et les idées sont sans intérêt puisque fausses. Mais voilà qu’un enfant l’avait interpellé du passé réduit en fumée, un enfant qui n’était autre que lui, ou son meilleur ami. Cet enfant, il était incapable de le tuer de nouveau. Il écouta ses propos jusqu’au bout et il en eut plus d’une nuit d’insomnie. Heureusement, de cela aussi, il finit par se remettre.
Un bon conseil : ne vous fiez pas à la couverture d’un livre !
*
Pour ce qui était de nos origines, ma sœur et moi avons longtemps vécu dans une parfaite ignorance. Nous pouvions réciter par cœur un nombre incalculable d’épisodes de la vie de notre mère, mais de notre père, nous ne connaissions que des bribes d’histoires sur la méchante grand-mère et le grand-père martyr tué pour ses convictions socialistes. Mon père avait fait des études d’histoire mais n’aimait guère parler du passé parce que, disait-il, sa vision du monde était tournée vers l’avenir. Nos parents nous ont élevées dans l’esprit du communisme imprégné des Lumières, selon lequel tous les hommes étaient égaux quels que soient leurs origines, la couleur de leur peau ou leur genre. Ainsi serais-je restée à mille lieues de me croire juive si, dans les situations-clés de ma vie, de l’école à mes divers lieux de travail, il ne s’était toujours trouvé quelqu’un pour déclarer que je l’étais et qu’en conséquence, il y avait quelque chose de différent chez moi. Quoi exactement, cela dépendait de la situation et ce n’était pas forcément désagréable. Ainsi, lorsque l’excellence de mes activités professionnelles fut attribuée à mes gènes. C’était tout de même plus flatteur que d’apprendre que l’une de mes amies d’enfance ne pouvait plus me voir parce que l’odeur de ces mêmes gènes était insupportable au nez de son nouvel époux.
À cette époque, en Hongrie, on ne parlait quasiment pas de judéité, ni en famille, ni dans les cercles amicaux, ni dans les débats publics, d’où ma surprise chaque fois qu’elle était évoquée devant moi. Comme souvent, le monde extérieur paraissait plus informé que moi. Au début, je rentrais sagement à la maison et je demandais à mes parents si nous étions juifs.
– Nous ne sommes pas juifs, parce que c’est une religion et nous, nous sommes athées.
La réponse me rassurait.
Les brumes de mes origines ne me préoccupaient pas le moins du monde au moment où, par une belle matinée d’août, je suis partie en Pologne. J’avais travaillé tout l’été dans une briqueterie pour gagner de quoi me payer mon premier voyage en solo à l’étranger. Pendant un mois, j’ai vadrouillé à pied, en train, en auto-stop dans ce généreux pays, plein d’énergies régénératrices, où je n’ai fait que des rencontres enrichissantes. J’ai dû avoir de la chance, l’époque était bien différente d’aujourd’hui. Quand j’y repense, le début des années 1970 m’apparaît comme le temps de l’innocence.
Mes tribulations m’ont menée à Cracovie. Il pleuvait depuis des jours et j’avais l’impression que l’humidité suintait de mes pores. J’étais fatiguée, j’avais faim, j’en avais assez de parler à des étrangers, de découvrir des beautés inconnues. J’étais lasse des merveilles du monde. Je me suis installée dans une auberge de jeunesse, me suis jetée sur le lit et ai passé quelques journées à contempler le plafond. J’écoutais la pluie tambouriner à la fenêtre et sentais la vie s’écouler lentement hors de moi ; tout ce qui me paraissait important jadis se diluait dans l’eau qui ruisselait le long des rues pour disparaître dans les bouches béantes des égouts. La seule pensée d’avoir quelque chose à voir avec ce monde de bric et de broc me semblait absurde.
Au matin du quatrième jour, je me suis traînée à la cantine du coin, me suis commandé un café fumant et me suis obligée à reprendre la route. J’ai traîné ma méchante humeur dans les rues humides. Quand j’ai quitté la berge de la Vistule pour m’enfoncer dans un dédale de ruelles étroites, un rayon de soleil perçait la grisaille qui enveloppait les toits. Le soleil a brillé timidement puis de plus en plus fort. Ce fut comme un éveil : j’ai commencé à prendre conscience des beautés de la ville. Il y avait là une place médiévale avec des saints de pierre, des pavés polis par le temps et des toits de mosaïques colorées. Non loin, des femmes coiffées de fichus et des apprentis en blouses de cuir s’affairaient dans un marché bruyant. J’ai acheté une poignée de mirabelles à une marchande de primeurs et j’ai poursuivi ma route, toute revigorée. C’est seulement en quittant la place que je me suis rendu compte que je me promenais sur le plateau d’un tournage. Après le coin, dans une rue étroite, une enseigne rouillée pendait : « Synagogue ». En dessous, une flèche pointait à droite. Allons voir ça tout de même, me suis-je dit, après avoir cherché à jeter mes noyaux de fruits. Fraîchement blanchie à la chaux, la synagogue était enfoncée sur le côté d’une petite place. J’ai tapé à la porte noire en fer avant d’appuyer prudemment sur la sonnette. Au bout d’un moment, une jolie jeune fille en longue jupe a ouvert. Derrière elle se tenait une fille plus petite qui pouvait être sa sœur, aux cheveux plus clairs.
– Bonjour, je voudrais visiter, ai-je dit.
– Je regrette, nous ne sommes pas ouverts, a répondu poliment la fille.
Elle s’apprêtait à refermer la porte mais comme je ne faisais pas signe de partir, elle a rajouté :
– On ouvre au début de la semaine prochaine.
Je voulais lui dire que je ne serais plus là la semaine prochaine, et en fin de compte ce n’était pas si important. J’hésitais sur le pas de la porte. J’aurais pu m’en aller mais mes jambes refusaient de bouger. La fille m’a jeté un regard curieux. J’ai alors senti se former un sourire embarrassé au coin de mes lèvres. Je me suis éclairci la gorge sans pouvoir me décider entre insister, puisque j’étais là, ou m’en retourner comme une étrangère bien élevée, et laisser la porte se refermer. La fille me regardait toujours. Soudain elle dit :
– Bon, si vous y tenez, entrez.
Il y avait quelque chose de délicat dans la façon dont les Polonais employaient le voussoiement accompagné de mademoiselle pour s’adresser à moi. Je ne parlais pas le polonais mais ma maîtrise du russe et ma soif de tout comprendre facilitaient la communication. Je suis entrée dans le local vide qui embaumait la peinture et j’ai poliment fait le tour. Au milieu se dressait une estrade entourée d’une grille en fer forgé. C’était sans doute là qu’on lisait la Bible, ai-je pensé.
– Il y a une exposition dans la pièce d’à côté si cela vous intéresse, a dit la jeune fille.
Je suis passée dans la pièce voisine. Le long des murs blancs, de grandes vitrines exposaient des photos et des objets, souvenirs de la vie juive d’antan à Cracovie. J’ai tout scruté. Seul l’écho de mes pas résonnait et, au loin, je devinais le caquetage des deux filles. La dernière vitrine présentait des photos de déportation. Les rues que je venais d’arpenter à la recherche d’une poubelle étaient pleines de gens portant baluchons et valises. J’ai étudié chaque visage, un par un. Mon regard revenait sans cesse sur la photo d’une femme d’âge moyen qui marchait seule au milieu de la rue. Il était impossible de dire si elle était avec des gens. D’une main, elle ramenait les pans de son manteau sur sa poitrine, de l’autre elle agrippait sa valise. Son fichu avait glissé en arrière, découvrant ses cheveux ; elle regardait droit devant elle d’un air calme et grave. Une voix en moi a surgi : « Cette femme pourrait être ta grand-mère. Ou bien toi. » Mon regard était vissé avec force sur l’inconnue comme si je pensais pouvoir la sauver de la destruction qui l’attendait au bout de la route. L’instant d’après, j’étais penchée sur la vitrine, le visage entre mes deux mains, et je titubais d’avant en arrière prête à tomber. Mon corps était secoué de sanglots muets. Le bavardage derrière moi s’était arrêté. Dès que j’ai pris conscience du silence, je me suis dépêchée de poser mon sac à dos par terre, j’ai sorti un mouchoir et je me suis mouchée bruyamment. Puis j’ai refermé mon sac, j’ai souri aux deux filles et je me suis dirigée vers la sortie. Quand elles ont ouvert la porte, je me suis tournée vers elles et j’ai réussi à marmonner :
– Merci.
– Merci à vous, a répondu celle aux cheveux plus foncés.
Sa main s’est attardée sur la poignée, elle semblait attendre quelque chose.
Je suis sortie sur la petite place inondée de soleil. J’ai traîné un peu devant les murs blancs puis, comme si j’avais peur d’être suivie, je suis partie en avançant à pas incertains.

Cet après-midi-là, je crois, j’ai décidé que j’étais juive. Le vide qui m’avait toujours habitée rencontrait celui des décors à l’absence béante des murs de Cracovie, et j’ai compris à quoi j’appartenais et là où j’étais perdue.
De retour à la maison, j’ai tenté, avec le zèle adolescent d’une néophyte pénétrée de freudisme, de faire revenir mon père à ses racines juives. J’ai lu toute la littérature sur le sujet, visité tous les lieux de mémoire, apporté à mon père des gâteaux de Pourim achetés à la pâtisserie Fröhlich dans l’espoir de susciter en lui des réflexes proustiens. Mais seuls les réflexes du camarade Pavlov ont agi : mon père avala les gâteaux sans se replonger dans le passé. Quand, à court d’idées, je finis par lui demander pourquoi, il répondit qu’à ses yeux la judéité, c’était du passé. Elle était la manifestation d’une détermination tribale avec laquelle il n’avait, fort heureusement, rien à voir, puisque, grâce à l’éveil précoce de sa conscience, il faisait partie d’un mouvement universel dont l’objectif était la libération du monde, et il n’était membre d’aucun particularisme. Tout comme Marx, ajouta-t-il avec modestie.
À ce raisonnement je ne pouvais répondre que par le silence et je n’ai plus demandé à mon père d’explications sur son identité. D’autant que moi aussi, je considérais appartenir à un mouvement universel dont l’objectif était la libération du monde. Mais je n’oubliais pas le particularisme. Après de longues ruminations, je finis par conclure que, contrairement aux temps anciens, être juif aujourd’hui n’était pas une question de sang mais d’engagement. Les identités purement décidées par le sang étaient suspectes et conduisaient souvent à des monstruosités.
J’ai continué à bombarder mon père de pâtisseries pendant encore un temps mais sans arrière-pensée, seulement parce que, comme tous les survivants que j’ai connus, il était gourmand. Puis ça n’a plus été nécessaire. À l’époque de la première maladie de mon père, ma mère a renoncé à sa chaire de vice-rectrice de l’université pour lui apporter les soins indispensables. Elle perfectionna tellement ses compétences en pâtisserie qu’elle dépassa souvent les desserts des professionnels.
Tout cela aurait été différent si notre monde n’avait pas bafoué l’autodétermination toute théorique de mon père en lui remettant régulièrement sa judéité sous le nez. Cuirassé dans sa foi en la supériorité de ses idées, mon père n’en avait généralement pas conscience. Mais je ne suis pas certaine qu’il n’en ait pas souffert au fond de lui jusqu’à son dernier souffle. Qu’il n’ait pas souffert tant des vexations que de l’absence d’un foyer où revenir.