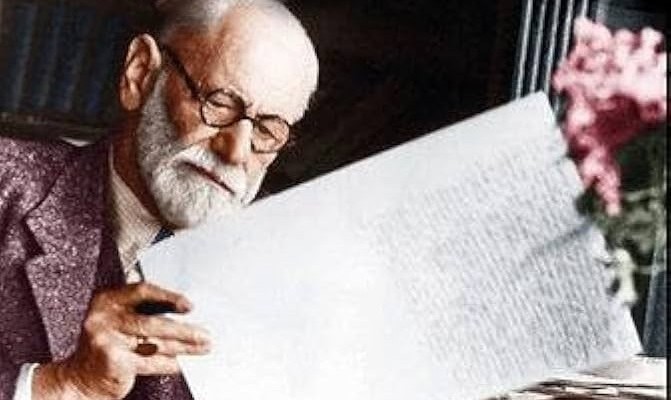Que signifiait l’œuvre de Kafka pour la jeune génération de juifs allemands qui s’en est saisi avec ferveur dans les années 1910 et 1920 ? Quelle expérience du juif européen moderne se réfractait pour eux dans ses écrits ? Fidèle au cri de cœur de Kafka « Plus jamais de la psychologie », Bruno Karsenti retrace la voie profondément moderne que Kafka représentait aux yeux de cette génération, une voie que l’on emprunte sans céder à la nostalgie d’un monde orthodoxe perdu, mais sur laquelle on puise ses forces dans une tradition qui ne saurait se taire, jusqu’au point de nous mouvoir par son silence.

Il y a, dans la trajectoire relativement courte des Juifs émancipés, des générations qui continuent de servir de repère à celles qui les suivent dans les nouvelles situations problématiques que l’histoire leur réserve. C’est particulièrement le cas de la jeunesse juive allemande ou germanophone de l’entre-deux guerres. S’y rapporter aujourd’hui permet sans doute de mesurer les écarts, mais aussi de se faire une idée du genre de tâche qui peut toujours incomber à ceux qui, lorsque l’incertitude domine l’époque, cherchent à se doter de nouvelles prises sur la réalité, en puisant à la fois dans ce que leur temps leur concède et dans ce qu’ils sont. Pour les jeunes juifs des années vingt et trente, ce geste a incidemment revêtu un nom propre : Kafka. Depuis lors, il a perduré presqu’intact, réinvesti différemment, mais avec un degré à chaque fois égal d’anxiété, de passion et d’exaltation.
Dès qu’on fait l’effort pour remonter le fil de l’histoire, on s’aperçoit pourtant qu’il est assez difficile de se représenter la façon dont la prose de Kafka a résonné aux oreilles de ses premiers lecteurs. Un mot résume cette génération, celui de rébellion. Les illusions bourgeoises ne tiennent plus, la nationalisation allemande des juifs est un leurre, des forces inconnues percent sous le carcan et cherchent à le faire sauter. Parmi les illusions dont on voulait se défaire, au premier rang, il y avait cet accommodement, cette domestication prônée par les pères, qu’il s’agisse d’assimilation, de réformisme ou de conciliation philosophique, où chaque fois l’Allemagne passait, à grand renfort de démonstration, pour la vraie patrie. À tout cela s’opposait, dans la nouvelle génération, une quête de vitalité, de rénovation et de retour. Mais de retour à quoi ? Et pour aller où ?

Le sionisme, du moins dans sa veine culturelle, se présentait comme une option, la plus attirante peut-être, bien que non dépourvue d’ambiguïtés. Car qu’est-ce qui, de l’Europe, ou plus exactement du judaïsme européen, était alors transporté dans ce pays lointain à titre de « patrie portative »[1] ? Franz Rosenzweig, l’un des acteurs de la rébellion, démasque la limite de l’opération : c’est plutôt une « absence portative de patrie » que devra se résoudre à illustrer le sionisme[2]. Il se peut qu’il y parvienne, mais cela ne fera pas de lui la fin attendue, plutôt un pli supplémentaire de la même expérience inapaisable. Car si les juifs sont juifs, alors leur seule vraie patrie portative, depuis l’exil, n’est autre que la Torah. Privés de territoire et de temple, ils sont chez eux dans leur texte, vivent de lui et en lui, même lorsqu’ils n’en ont plus tout à fait conscience et s’en sont notablement éloignés. Dans cet éloignement, maintes situations se sont déterminées, qui ont aménagé l’exil, compensé la perte et la faiblesse politique de façon plus ou moins viable et plus ou moins supportable. Disons même : plus ou moins oublieuse de ce que l’exil représente de constitutif pour ce peuple. L’effort pour reconstruire des communautés et des formes d’existence où être juif retrouverait la plénitude de son sens est une réaction à ce genre d’oubli. Les mouvements de jeunesse, en Allemagne même, l’ont poursuivi sur le plan pratique. On conçoit qu’ils s’ouvraient alors particulièrement à ce qui, venant de l’Est, recélait une authenticité juive dont ils se sentaient quant à eux privés : une réalité qui leur paraissait à la fois lointaine et vivante, extrêmement lointaine et étonnamment vivante.

C’est ce vent d’Est qui se présente alors comme ressourcement. Les récits hassidiques exhumés par Martin Buber ont beaucoup compté, tout comme l’importation d’une littérature yiddish ancienne et florissante, dont la richesse laissait les lecteurs quelque peu ébahis. Dans chaque texte, dans chaque pièce de théâtre, dans chaque conte et dans chaque poème, on partait à la recherche de ressorts secrets, d’harmoniques oubliées. On imaginait que ce fond bigarré, palpitant, pouvait être rejoint à l’encontre de la volonté des pères, eux qui s’épuisaient à faire tenir debout ce qui n’était plus qu’un squelette. La fascination exercée par les Ostjuden, les juifs de Russie, de Lituanie et de Pologne, ne peut être minimisée dans ce contexte. Gershom Scholem, lorsqu’il relate ces années, la résume ainsi : chaque immigrant perdu qu’on croisait dans les rues de Berlin surgissait comme la réincarnation du Baal Shem Tov[3].
Mais précisément, ce n’est pas ainsi qu’a été entendu Kafka, lui dont la prose venait de Prague, lui qui parle et écrit en allemand et peut être qualifié sans hésitation d’Européen de l’Ouest. On se méprendrait tout à fait en pensant que c’est à ce type d’étrangeté que ses textes doivent leur résonnance. Au contraire, Kafka se tient du côté de ceux qui cherchent à l’aveugle, tâtonnent et s’efforcent de reprendre pied sans rien céder sur leur désir de rupture. Lui aussi est un acteur de la rébellion. Ce qui le singularise, c’est qu’il lui donne une tournure qu’on n’attendait pas. Il représente, si l’on veut, l’étonnement intérieur.
Quant à l’aspect de rébellion, peu de lignes l’expriment mieux que celles qu’on trouve dans la Lettre au père. Kafka y raconte son ennui à la synagogue : les moments censément solennels d’ouverture de l’Arche sainte où, prisonnier sur sa chaise aux côtés de son père, il s’imagine face à une baraque de tir dans une foire. Devant lui, il voit « une boite s’ouvrir quand on faisait mouche, sauf que c’était toujours quelque chose d’amusant qui sortait, alors qu’ici, ce n’était jamais que les mêmes vieilles poupées sans tête »[4]. Personnages dérisoires et décapités, les rouleaux de la Torah tels qu’ils se présentent au fils n’ont plus leur statut de texte.

On comprend que pour Kafka aussi, le vent de l’Est a dû souffler très fort. Son discours prononcé à la Maison juive de Prague en 1912 commence par ces mots : « Je tiens à vous dire, Mesdames et Messieurs, combien vous comprenez plus de yiddish que vous ne le croyez ». Entendez : vous comprenez plus que vous ne le croyez cette langue faite de rapines accumulées sur les chemins de l’exil, et dont les mots volés composent comme un filet robuste pour les auditeurs autrement européanisés (c’est-à-dire, au fond, nationalisés, qu’ils soient allemands, autrichiens ou tchèques), qui peuvent toujours s’en laisser envelopper. Certes, dit Kafka, ils éprouveront à l’écoute de cette langue une sorte de peur. Mais il s’agit d’une peur envoûtante, bénéfique : une peur, non du yiddish, mais d’eux-mêmes. Un fort sentiment de confiance en est comme la contrepartie. Car la peur provient seulement de ce qu’on sent pousser en soi des forces qu’on ne soupçonnait pas, que tout le contexte culturel s’évertuait à étouffer, mais qui restent disponibles à qui sait s’en saisir[5].
Kafka est donc du côté de Scholem et de Benjamin, ses lecteurs émerveillés. De quelques années leur aîné, il connaît les mêmes dilemmes. Il écoute, inquiet, une tradition en tout point différente de la forme creuse et asséchée qu’on prétend lui léguer. Mais comme eux, il sait que la solution ne peut pas avoir la simplicité d’une évocation, si réconfortante fût-elle. Car ce qui vient de l’Est ne peut être entendu par les juifs de l’Ouest que sur fond de perte. C’est donc cette perte même qu’il leur faut réfléchir, ausculter, approfondir. Et c’est dans ce mouvement qu’ils se font les analystes d’un problème de portée générale, débordant leur situation singulière. Ils questionnent ce que veut dire désormais écouter, depuis l’abandon ou le mutisme théologique moderne dont ils font une expérience redoublée, puisqu’ils savent cette fois devoir inventer complètement leur propre version du retour. Un retour qui leur correspond, qui n’appartient qu’à leur génération, aussi bien en opposition à leurs pères et qu’à distance de ces témoins qu’ils imaginent être, à tort ou raison, des preuves d’intemporalité.
Dans cette constellation, la place de Kafka est unique. Pour Scholem et Benjamin au cours de ces années qui s’assombrissent à grande vitesse et signent l’effondrement de la symbiose judéo-allemande, elle surgit comme un aimant qui attire vers soi les individualités dispersées dans le désordre de la rébellion. Lire Kafka revient à s’analyser, à lire en soi-même. Mais alors, c’est aussi mieux voir se dessiner les options qui s’ouvrent, selon le sens qu’on tire de la lecture. Tâchons de préciser les termes de ce qui, en bout de course, ressemble à une alternative entre ces deux figures majeures de la pensée européenne, toutes les deux irriguées, ou plutôt emportées par Kafka.
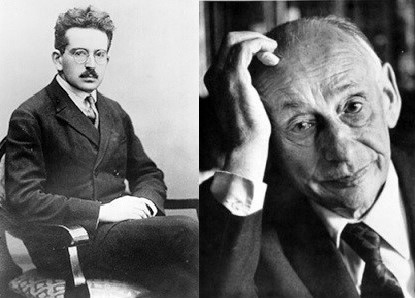
Pour l’un comme pour l’autre, il est clair que l’œuvre de Kafka tranche complètement au sein de la littérature moderne. Car elle parvient à sortir du problème de l’écoute, ou du raccordement à la tradition, par un brusque renversement. Sans rien devoir aux productions des Ostjuden, sans puiser dans des canons d’aucune sorte et sans s’inspirer des Ecritures, et donc d’une sacralité déjà constituée, Kafka agit à son tour, sinon comme une source, du moins comme un transmetteur absolument fiable.
C’est là tout le mystère : Kafka transmet, il réalise la transmission, bien qu’étant intégralement situé du côté de la réception interrompue. Dit plus simplement : par sa langue, par ses tropes et ses images, dans un style et à l’aide de contenus apparemment déthéologisés, il parvient à replacer les lecteurs modernes en général, et les juifs au milieu d’eux, dans l’orbite de la révélation. Il les remet en position d’écoute, eux qui, massivement, par des voies séculières ou non, s’en étaient coupés. Ce que l’on désigne comme l’ «aura kafkaïenne » est de cette espèce. Elle traduit le fait qu’on puisse encore écrire à la lumière d’une révélation qui, évidée de son contenu traditionnel, continue de manifester sa puissance, c’est-à-dire conserve force de loi. Mais quel prix nous faut-il payer pour ce genre de replacement ? Entendons : quel rapport à la loi se tisse dans cette langue non-sacrée, mais pas moins impérieuse, que Kafka réussit à nous faire entendre comme un envers inconnu de notre langue profane ? Chaque texte de Kafka, sous un biais particulier, vient soulever ce genre de questions.
C’est le cas du Silence des sirènes, qui a tant captivé Benjamin. Soit la variation sur ce morceau de mythologie païenne qu’est le récit homérique d’Ulysse se prémunissant par la ruse contre la séduction des sirènes[6]. L’intrigue est légèrement détournée. En vérité, le silence des sirènes est plus dangereux que leur chant, dit Kafka. Ulysse passe auprès d’elles les oreilles bouchées, et les sirènes se taisent. Il ne sait pas à quoi il aura échappé – non à leur chant, donc, mais à leur silence – mais il y échappe cependant, et obtient par là son salut. Le récit n’est pas modifié quant à sa fin, Ulysse paraissant seulement ridicule d’avoir cru à un stratagème aussi naïf (de la cire dans les oreilles, difficile de croire que personne n’y avait pensé avant). Ce qui en ressort, c’est surtout une très paradoxale rédemption, puisqu’elle tient en définitive à l’évitement d’un silence qui ne s’est pas révélé, et dont nul ne s’est même aperçu.

Par ce déplacement s’ouvre une série d’embranchements interprétatifs. Le premier d’entre eux concerne évidemment le rapatriement du mythe dans une problématique théologique qui fait de la révélation, ou du couple révélation-rédemption, son enjeu.
Faut-il y voir une proximité avec la situation des juifs allemands de l’entre-deux-guerres, et de leur legs au judaïsme européen ? Sans doute, mais son sens reste difficile à déterminer. Il tient au genre de mythe, ou de réaménagement du mythe, qui se trouve requis dans une configuration historique où la révélation est, simultanément, héritée et récusée, proposée et retirée, à la manière de ces portes ouvertes et refermées qui jalonnent l’œuvre de Kafka. A travers ces questions se formule notre rapport à Ulysse, la façon dont il faut entendre son ingénuité. Toute parabole a pour but de circonscrire un espace suffisamment large pour relancer la recherche sans prédéterminer son issue. On notera seulement ce que Kafka, subrepticement, a glissé dans cette parabole-ci : une clé pour comprendre l’effet de sa propre prose, ce qu’elle avait de saisissant pour toute une génération unie dans une même expérience historique.
Il se peut que la tradition se taise, mais cela n’a pas la signification qu’on croit. Il se peut que son silence, contre toute attente, soit son arme, qu’il soit la marque qu’elle prend pour signifier son absentement, et nous mettre devant nos propres choix, en tout cas ceux, décisifs, où nous jouons encore ce qui mérite pour nous, sujets sécularisés, le nom de salut. À ce titre, Ulysse est le témoin du monde ancien où, à l’exception des sirènes (dont d’ailleurs il ignorait les vraies puissances), ce sont les chants qui guident ou égarent. Il est très différent de nous, bien peu moderne en somme. Mais il nous enseigne précisément pour cette raison, en vertu de la distance où il se tient. Ce que nous apprenons de sa ruse, qui s’avère pour nous puérile et de toute façon décalée de son but, c’est ce que lui-même s’était épargné d’entendre : le fait qu’il y ait des silences qu’il nous faut vaincre, et pas seulement de mauvais chants.
Traduisons la parabole dans un langage juif plus direct, le langage de la loi. La vie sous la loi, dans le régime moderne où nous prétendons être à son principe, ne nous sépare pas de son caractère révélé. Mais elle nous reconduit plutôt à l’ambiguïté que la révélation comporte désormais, au silence dont elle se pare pour se manifester. L’œuvre entière de Kafka tourne autour de ce centre obscur : la loi est frappée d’inaccessibilité, de telle sorte que le problème n’est pas tant de lever son secret que d’admettre qu’elle n’en a pas. Le jugement et la justification sont scindés, leur communication obstruée par une foule de personnages qui peuvent être bavards ou mutiques, agités ou calmes, mais qui ont toujours pour fonction de différer ou de suspendre toute velléité de coïncidence. Les sujets modernes, en tout cas les sujets juifs pour lesquels la modernité prend ce caractère problématique éminent, ne sont pas du tout comme Ulysse : ils sont dans l’écoute, anxieusement, pour autant qu’ils soient sincères et entreprennent de rompre avec leur sommeil culturel.
Pour eux, c’est alors comme si la révélation se réduisait à une négation : tu ne sauras pas, il n’y a rien à savoir. Ce qu’ils discernent est de ce type : le fond de la loi n’est pas de l’ordre de ce qu’on pourrait scruter, entendre et réarticuler. Il est un fond silencieux, mais signifiant en tant que silencieux, un socle sur lequel repose, sans jamais pouvoir s’y rapporter positivement, tout ce qui, dans notre langage, relève de la justification – de la morale, du droit ou de la politique. Ou encore, nous n’avons pas d’autre tradition que celle qui répète indéfiniment son retrait, enveloppant dans ce mouvement chacune de nos paroles d’un halo de perte où réside son sens profond.
Ainsi peut être brièvement exprimé le mélange de révolte et de reviviscence que Kafka a délivré à ses quasi-contemporains, ces juifs allemands qui voyaient se refléter dans ses textes le noyau de leurs perplexités, et s’en servaient, en les commentant, comme d’un métier sur lequel tisser leur vêtement d’exil – étant entendu que l’exil, pour eux, ne pouvait pas avoir le même sens que la Galout des Ostjuden. Fascinés par les juifs de l’Est, ils n’en étaient pas moins des juifs de l’Ouest, les nouveaux « perplexes ».
Selon que l’on se tourne vers Benjamin ou Scholem, les résultats obtenus diffèrent. Ils sont élaborés dans le dialogue et sur fond de commune opposition à un réenchantement de la tradition et à une théologisation trop abrupte (celle, par exemple, de Max Brod). Mais, à partir de là, leur divergence est nette. Chez Benjamin, la voie choisie est celle d’une théorie du langage et du mythe d’où le motif théologique n’est certes pas expulsé, mais où il est ramené à une interrogation, au croisement de la métaphysique et de l’anthropologie philosophique, sur la nature des symboles et des signes[7]. Chez Scholem, c’est le refus d’affaiblir le « nerf juif central de cette œuvre »[8] qui domine, dans un cadre qui est celui de l’histoire du judaïsme complètement refondée. L’aspect théologique n’en est alors que plus fortement assumé, au détriment de la dimension mythologique. C’est que la portée de l’œuvre tient pour Scholem bien plus à sa capacité à reposer le problème de la révélation sur la ligne tendue de la durée juive, qu’à mettre en lumière un « monde primitif » sous-tendant le langage.
Un point unit les versions. Dans chaque cas, la transmission d’un intransmissible demeure le cœur de la question. Mais l’alternative n’en est que plus nette entre, d’une part, une tradition devenue illisible qui est appelée à recueillir le néant de la révélation comme son unique vérité (de sorte que l’expérience du langage reconduit à son fond silencieux semble devenir, chez Benjamin, une nouvelle polarité), et une méditation sur la transmission de la loi où ce qu’elle a d’indéchiffrable joue comme mise à l’épreuve de son caractère expressément révélé. Dans ce second cas, Kafka fait figure de kabbaliste perdu, ou plutôt renaissant, dans le monde moderne. Dans le premier, il est surtout un guide inestimable – aux côtés d’autres auteurs modernes, comme Proust – dans les strates de la vie des signes où l’on est constamment menacé de se perdre.

On le voit, le « silence des sirènes » peut venir résumer, en une formule cryptée, une certaine expérience de modernité, vécue spécifiquement d’un point de vue juif, et en cela même signifiante pour tous. Il peut y faire office d’aiguillage, le point de bifurcation se fixant dans une intense expérience de lecture. Une lecture non-religieuse, non conduite dans les règles de la tradition, qu’elle vienne de loin ou de près, mais pas moins intense. C’est-à-dire intensément juive et moderne à la fois.
Bruno Karsenti
Notes
| 1 | La formule est de Heinrich Heine, Mémoires et Aveux, Les éditions de Paris, 1997, p.125. |
| 2 | F. Rosenzweig, Confluences. Politique, histoire, judaïsme, Vrin, 2003, p.256. |
| 3 | G. Scholem, De Berlin à Jérusalem, Albin Michel, 1984, p.80. |
| 4 | Préparatifs de noces à la campagne, Gallimard, 1985, p.238-239. |
| 5 | Ibid, p.483. |
| 6 | Voir la nouvelle traduction dirigée par Jean-Pierre Lefebvre dans La Pléiade, Kafka, Nouvelles et récits, Gallimard, 2018, p.711-713. |
| 7 | Voir à ce sujet le livre de Veronica Ciantelli, Le Silence des sirènes. Walter Benjamin et le mythe, Hermann, Paris, 2020. Une première version du présent texte a paru en préface de ce livre. |
| 8 | Lettre à Benjamin du 20 septembre 1934, in Walter Benjamin et Gershom Scholem, Théologie et utopie. Correspondance 1933-1940, L’Eclat, 2010, p.157. |