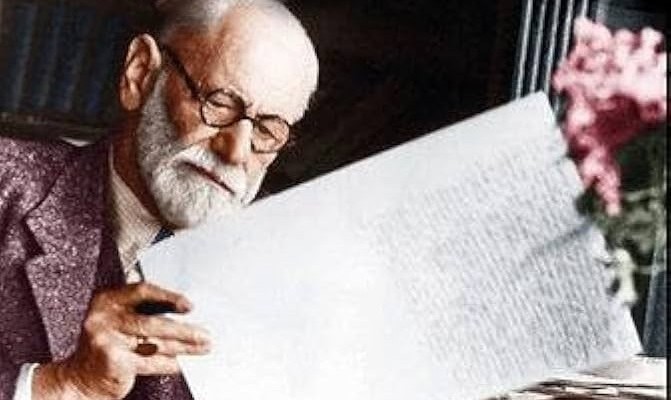Anna Freud, la fille de Freud, déclara que sa grand-mère était « dévouée et fière de son [fils], comme le sont les mères juives ». Le fait est que cette mère, Amalia, Galicienne superstitieuse qui parlait essentiellement le yiddish, avait prédit que son Sigmund, sur lequel elle projeta ses rêves de grandeur, deviendrait un grand homme. Mais qui était la mère du fondateur de la psychanalyse ? Et, d’ailleurs, combien de mères a-t-il eues ? Joel Whitebook, l’auteur d’une biographie intellectuelle de Freud[1], met à mal ce mythe de la « bonne mère aimante » qu’aurait été Amalia. K. publie cette semaine la première partie de son analyse de la relation de Freud à ses figures maternelles. Car on rencontrera la semaine prochaine la seconde mère de Freud, sa « nannie » catholique, vieille et laide celle-là, mais pas moins importante pour le jeune Freud en pleine phase de curiosité sexuelle…

Introduction
La psychanalyse a-t-elle encore quelque chose à nous dire de l’évolution des sociétés contemporaines ? Peut-on encore y puiser des ressources intellectuelles pour nous comprendre et comprendre ce qui s’y passe ? De science critique majeure dans les années 1960 et 1970 – que l’on songe seulement au succès mondial d’un Marcuse ou à la centralité de Lacan pour le développement de la pensée critique – la psychanalyse est devenue une affaire privée, certes la plus sophistiquée parmi les techniques qui prennent en charge les âmes meurtries du monde contemporain, mais sans conserver son statut de science humaine capable de nous éclairer, collectivement, sur notre présent. Or Freud, pour soucieux qu’il ait été du bien-être de ses analysants, visait plus haut. Quand il découvre la névrose obsessionnelle, il y voit un effet des transformations de l’injonction à l’autonomie dans le monde moderne que les individus gèrent autant qu’ils peuvent et parfois ne gèrent pas. Quand il parle de « malaise dans la civilisation », quand il analyse des phénomènes de formation de foules possiblement meurtrières, il part certes du sujet individuel et de ses souffrances mais pour élucider le monde contemporain.
Joel Whitebook, philosophe et psychanalyste né à Los Angeles en 1947 et élevé dans une famille juive laïque et libérale, est un des rares psychanalystes qui poursuivent encore ce projet. Actuellement professeur au Center for Psychoanalytic Training and Research de l’Université de Columbia, clinicien dans le privé, il est le contradicteur principal des théories sociales qui essaient de faire une place à la science du sujet qu’est la psychanalyse. Contradicteur non pas pour garder la psychanalyse pure de tout engagement politique, mais pour contrer les tentatives de l’apprivoiser, d’en faire une énième théorie de l’humain qui tourne mal parce qu’il manquerait d’empathie, de bienveillance, de reconnaissance ou encore de possibilité de dire ce qu’il ressent. Car le sujet de la théorie analytique est plus complexe. Vacillant entre amour et haine, fragile autant que grandiose, destructeur et créatif, en détresse et tout-puissant, voilà l’être humain compliqué auquel l’analyse à affaire et dont elle ne juge pas les « mauvais penchants » ni essaie de les « réparer » ou de les corriger.
C’est dans cet esprit d’ouverture que Joel Whitebook a écrit un portrait de la relation de Freud à la figure maternelle. Entre sa mère juive galicienne, source de vitalité autant que de mépris pour soi-même, et une nourrice catholique terrifiante mais initiatrice à une sensualité lourde d’ambiguïtés, on découvre un petit Schlomo (le nom hébreu de Sigmund) bousculé par la vie qui essaie de faire au mieux qu’il peut. Mais on découvre aussi les sources de la structure profonde de Freud adulte, ce géant de la pensée pour qui un seul continent est resté vierge : la femme, la féminité, cette passivité honnie par Freud devant laquelle il détourne le regard comme Moïse face à Dieu. Terreur et foi dans la loi se rejoignent également chez Freud. Si bien qu’à la lecture de Whitebook on se demande si la psychanalyse n’est pas également une « science juive » (Yerushalmi) par héritage maternel. – Julia Christ.
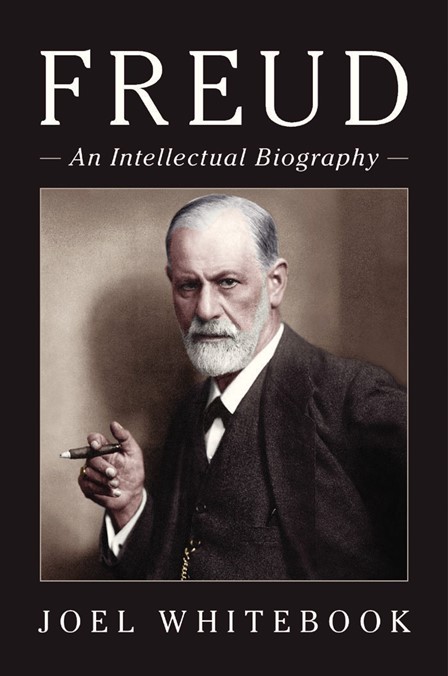
Le mythe de mein goldener Sigi
L’image de la mère de Freud, Amalie, comme jeune mère belle et vive qui adorait inconditionnellement son « goldener Sigi » est en grande partie un mythe – une idéalisation défensive, d’abord propagée par Freud lui-même, puis reprise sans critique par nombre de ses disciples. Selon presque tous les témoignages, Amalie était une femme difficile : infantile, dépendante, exigeante et égocentrique. Bien qu’elle fût belle, vive, sociable et une maîtresse de maison efficace, elle était tout sauf une épouse et une mère aimante. Empruntant à l’imagerie du vautour qui apparaît à plusieurs endroits clés de l’œuvre de Freud, l’historien de la psychanalyse Paul Roazen observe qu’elle était « un vieil oiseau dur »[2]. Judith Heller Bernays, la nièce new-yorkaise de Freud, qui lui rendait régulièrement visite à Vienne, confirme cette évaluation. Elle souligne la personnalité égoïste et tyrannique qui se cachait derrière la face « charmante et souriante » que sa grand-mère présentait aux étrangers. Pour Heller Bernays, l’insensibilité de sa grand-mère peut être illustrée par la façon dont elle utilisait sa surdité pour éviter de s’occuper de tout ce qui « pourrait exiger d’elle d’accorder de la sympathie ou de la consolation à un membre de la famille »[3]. Par exemple, lorsque l’une de ses petites-filles est décédée à l’âge de vingt-trois ans, Amalie a ignoré l’atmosphère de détresse qui régnait dans la maison et a simplement fait comme si de rien n’était. Bien que cette petite-fille lui eût fréquemment rendu visite par le passé, Amalie n’a jamais mentionné cette mort tragique, même avec la mère de sa petite-fille. Amalie était singulièrement incapable de se préoccuper de la douleur émotionnelle des autres. Elle n’offrait ni consolation ni protection. Au lieu de cela, elle a exigé d’être protégée de tout qui pourrait lui causer de la douleur ou l’écarter du centre de la scène.

Martin, le fils de Freud, qui, lui aussi, décrit Amalie comme une femme égoïste et exaspérante, ajoute une dimension socioculturelle à cette évaluation. Les « Juifs galiciens », note Martin, « étaient une race particulière, non seulement différente de toutes les autres races habitant l’Europe, mais absolument différente des Juifs qui vivaient en Occident depuis quelques générations ». Ces Ostjuden, poursuit-il, « avaient peu de grâce et aucune manière ; et leurs femmes n’étaient certainement pas ce que nous pourrions appeler des ‘dames’. Elles étaient très émotives et se laissaient facilement emporter par leurs sentiments ». En « véritable représentante de sa race », Amalie – qui, semble-t-il, n’a jamais appris l’allemand, mais a continué toute sa vie à parler le yiddish – n’était « pas facile à vivre ». Quand elle était « troublée et perturbée », elle ne cachait nullement ses sentiments pour protéger « la paix de son entourage »[4]. Au contraire, Amalie n’avait aucune difficulté à déverser directement ses émotions volatiles lorsqu’elles s’emparaient d’elle.
Il serait erroné de penser que le portrait que Martin dessine de sa grand-mère reflète simplement les préjugés d’un citoyen assimilé, d’un juif germanophone – d’un Yekke, comme les Ostjuden les appellent par dérision – résidant en Angleterre. Car Martin exprime également une profonde admiration pour la vitalité et la ténacité de ses frères d’Europe de l’Est : « Bien que, à bien des égards », les Juifs de Galice « semblent être, pour des personnes plus civilisées, des barbares indomptés, ils ont été les seuls, parmi toutes les minorités, à résister aux nazis. Ce sont des hommes de la race d’Amalie qui ont combattu l’armée allemande sur les ruines de Varsovie.[5]» On peut supposer que la pugnacité de Freud, ainsi que sa superstition tout autant que sa crédulité – caractéristiques très inattendues chez un homme de raison comme lui – étaient en partie héritées de sa mère galicienne, têtue, fougueuse et irrationnelle. Dans une remarque qui ne se veut pas tout à fait positive, Anna Freud, la fille de Freud, observe que sa grand-mère était « dévouée et fière de son [fils], comme le sont les mères juives ». La critique implicite est que, derrière sa façade d’abnégation, l’amour maternel juif proverbial contient généralement une bonne dose de narcissisme. Alors qu’Amalie a quasiment séquestré sa fille Dolfi pour qu’elle s’occupe d’elle et de la maison, elle n’a pas employé la même stratégie avec Sigmund. Hautement narcissique et socialement ambitieuse elle plaçait tous ses espoirs dans son fils premier-né. Il fallait qu’il aille par le monde et terrasse des dragons afin qu’elle puisse se délecter de sa gloire.
Amalie n’a en effet eu de cesse d’exprimer, en privé et en public, le sentiment que son fils relevait de sa propriété privée, même lorsqu’il était un homme d’âge mûr. « Le fait qu’Amalie était câline, douce et drôle ne le rendait pas [Freud] moins terrifié par cette mère autoritaire, épuisante sur le plan émotionnel et obstinée, une mère qui se voyait dans ses enfants mais ne pouvait pas les voir, eux.[6] » Le sentiment de Freud de ne pas être digne d’être aimé, qui a participé à créer les couches les plus vulnérables de son « moi », a dû en partie venir du sentiment que sa mère ne l’aimait pas pour lui-même mais seulement comme « objet narcissique ». En tant que fils dévoué qui, selon Anna Freud, « subissait sa mère » plutôt qu’il n’était « dépendant d’elle », Freud se rendait chez Amalie tous les dimanches après-midi pour déjeuner. Toutefois, en raison de son ambivalence, il arrivait invariablement en retard. Avant les visites du dimanche, l’anxiété qu’il ressentait lui causait souvent des troubles gastro-intestinaux, et il tergiversait à la Berggasse 19 pendant qu’Amalie faisait nerveusement les cent pas dans l’attente de son arrivée.
Pour autant, une mère volatile et égocentrique ne suffit pas à créer une enfance traumatisante. Il y avait quelque chose de plus ; en l’occurrence, la dépression maternelle, causée par les nombreuses pertes qu’Amalie a successivement subies. Avant même la naissance de Sigmund, la famille avait connu plusieurs décès douloureux.

Jacob, le père de Freud, avait perdu au moins une épouse (peut-être deux), et son père Schlomo est mort peu avant la naissance de l’enfant. De plus, ces décès avaient été suivis, au cours des années suivantes, par une série de pertes qui eurent un effet traumatique puissant sur le jeune garçon. Julius, le frère d’Amalie, mourut un mois avant la naissance de son deuxième fils qui portera son nom. Mais la perte la plus catastrophique fut sûrement la mort de ce garçon lui-même, le jeune Julius, né alors que Sigmund avait onze mois et qui mourut six à huit mois plus tard. Il y a de bonnes raisons de supposer qu’Amalie est alors devenue dépressive, renfermée et psychologiquement indisponible pour Freud et qu’elle a même pu passer un certain temps loin de lui à Roznau, une station thermale où elle se retirait régulièrement.
Le moment durant lequel un événement survient dans la vie d’une personne détermine souvent si cet événement deviendra traumatique. Or, toutes ces pertes eurent lieu quand Freud avait entre 18 et 24 mois, un moment critique dans le développement de l’enfant, où le moi est en train de se consolider et où le jeune Sigmund était particulièrement vulnérable. De plus, étant donné que la famille vivait dans un appartement d’une seule pièce, il est probable que le jeune Freud ait été directement exposé à la maladie de son frère et peut-être même à sa mort. Et bien que la dépression d’une mère puisse se développer pour différentes raisons (par exemple : « post-partum », décès d’un parent, difficultés conjugales), la dépression la plus désastreuse est celle qui suit la mort d’un enfant en bas âge.
Le syndrome de la « mère morte ».
Avec la mort de Julius, et dans un contexte marqué par les nombreuses pertes antérieures, Amalie est devenue ce qu’André Green appelle « une mère morte ». Il faut préciser que le concept de « mère morte » ne se réfère pas aux conséquences psychiques de la mort d’une mère réelle. Il s’agit de la mort psychologique d’une mère suite à une dépression maternelle. Le caractère catastrophique du « syndrome de la mère morte » résulte du fait que la mort psychologique de la mère met un terme brutal à une relation entre la mère et l’enfant qui, d’après Green, était bonne, c’est-à-dire riche et heureuse et marquée par une vitalité authentique. Il est raisonnable de supposer qu’il y avait une part importante de « bonté » dans la relation d’Amalie avec Freud, au moins avant sa mort psychologique, car ensuite la relation mère-fils d’Amalie et de Sigmund et la situation décrite par Green s’accordent pour une large partie. Green soutient que la mort psychologique de la mère – qui, en règle générale, survient de façon soudaine et inattendue – transforme brutalement l’image que l’enfant a d’elle, la transformant d’un objet vivant et qui était source de vitalité en une figure distante, atone et pratiquement inanimée… En bref, elle devient une mère qui reste vivante et physiquement présente mais qui est psychiquement morte aux yeux du jeune enfant dont elle a la charge. Ce caractère « figé » de l’objet maternel empêche les intériorisations nécessaires à un développement sain, ce qui crée des lacunes importantes dans la structure psychique de l’individu. Dans une tentative de compenser ces lacunes dans le tissu du « moi » et de faire face à la perte de sens massive que la catastrophe précipite, les individus souffrant du « syndrome de la mère morte » ont souvent recours à une intellectualisation excessive et s’adonnent à une recherche compulsive de sens. Qui correspond mieux à cette description que Freud ?
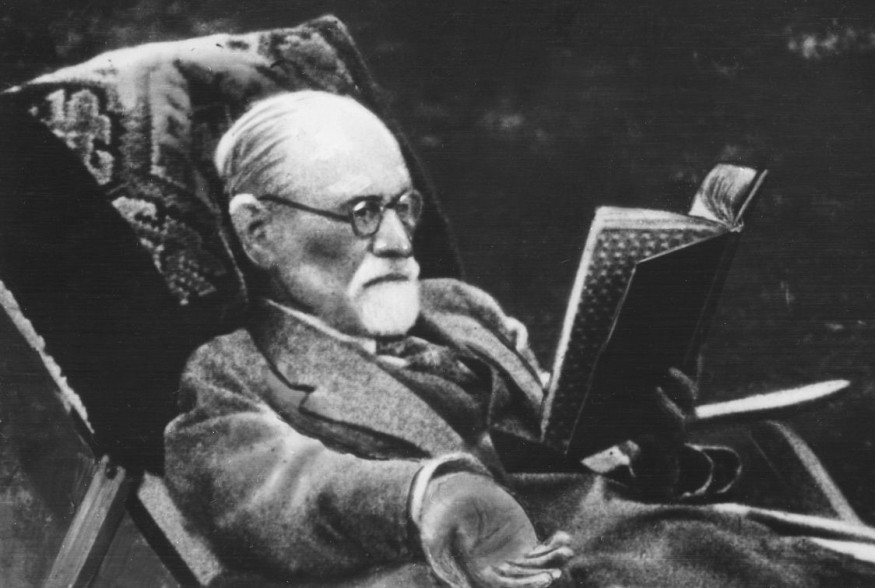
À la lumière de la relation troublée de Freud avec Amalie, de son comportement difficile et narcissique, et de sa dépression après la mort de Julius, l’idéalisation par Freud de la relation mère-fils est clairement plus compliquée que l’interprétation courante voudrait nous le faire croire. Dans une phrase bien connue, Freud affirme que la relation mère-fils « est la plus parfaite, la plus dépourvue d’ambivalence de toutes les relations humaines »[7] (tard dans sa vie, et à juste titre, Freud s’est corrigé et a affirmé qu’une relation avec son chien constitue la relation la plus dépourvue d’ambivalence qui puisse être atteinte au sein de la civilisation). Les lecteurs ont généralement compris qu’il s’agissait là d’une relation autonome, réciproque et incomparablement gratifiante – la seule relation au sein de la civilisation qui soit exempte d’hostilité mutuelle. Et dans la mesure où il avait besoin d’idéaliser sa relation avec Amalie, Freud, lui aussi, aurait préféré cette lecture. La phrase qui précède cette fameuse description, cependant, indique un autre aspect de l’histoire : « Une mère n’est que par sa relation avec son fils. » Plutôt qu’une relation réciproque mère-fils, Freud semble se référer exclusivement à l’amour de la mère pour son fils et à ce qu’elle en retire. Il y a plusieurs types d’amour, et vu sous cet angle, le fils est effectivement aimé par sa mère, mais aimé comme un objet narcissique. Les remarques souvent citées de Freud sur la relation mère-fils, ne sont pas « des réflexions sur l’amour maternel, comme on le croit généralement, mais plutôt des commentaires ironiques sur les exactions maternelles. On peut soutenir que « lorsqu’il décrit la relation mère-fils comme étant ‘dépourvue d’ambivalence’, Freud voulait clairement dire qu’elle l’était pour la mère plutôt que pour le fils.[8] » Amalie n’aimait pas Freud maternellement au sens plein du terme, c’est-à-dire inconditionnellement, mais seulement dans la mesure où elle pouvait se prélasser narcissiquement dans l’éclat de son talent et de ses réalisations.

Dans sa tentative de déchiffrer la signification du sourire énigmatique de la Joconde Freud affirme que Léonard a refondé l’imago de sa mère dans le visage de son modèle et l’a reproduit dans sa peinture de La Giaconda. On peut dire la même chose de la relation de Freud au tableau de Léonard – à savoir qu’il y a projeté le visage d’Amalie. Sa thèse est que la nature énigmatique du sourire de Mona Lisa résulte de son « double sens » :« la promesse d’une tendresse illimitée comme la menace annonciatrice de malheur[9] ». La mère, au stade précoce du développement de l’enfant, peut être source d’une satisfaction absolue aussi bien que d’atroces privations. De même, la description par Freud de la mère « insatisfaite » de l’artiste peut aussi s’appliquer à la relation insatisfaisante entre Amalie et Jacob : « Alors, comme toutes les mères insatisfaites, elle a pris son jeune fils à la place de son mari ». Et, de nouveau, il commente le plaisir incomparable que la mère éprouve avec son enfant (fils) :
« L’amour de la mère pour le nouveau-né qu’elle nourrit et soigne est une chose qui s’enracine bien plus profondément que son affection ultérieure pour l’enfant qui grandit. Il est de la nature d’un rapport amoureux pleinement satisfaisant, lequel ne comble pas seulement tous les désirs psychiques, mais aussi tous les besoins du corps »[10].
Notons que dans la description par Freud du plaisir profond qui peut être atteint dans la relation mère-enfant, ce dernier est unilatéral ; il ne concerne que la mère. De plus, en supposant qu’il s’appuie sur des souvenirs de sa propre enfance, son analyse de la relation de Léonard avec sa mère confirme le soupçon de Green que la théorie de la « mère morte » s’applique à Freud – une théorie qui suppose qu’il y avait de la bonté en abondance dans la relation entre Amalie et son fils avant qu’elle ne succombe à la dépression après la mort de Julius. Freud pensait que la mère de Léonard avait une « tendresse sans bornes » à son égard. Mais son affection contenait une « menace » dans la mesure où elle rendait « les privations qui lui étaient réservées » d’autant plus difficiles à supporter. Le sourire séducteur d’une mère est sinistre, parce que le plaisir qu’il promet et même qu’il procure ne peut pas durer, ce qui rend les privations qui suivent encore plus douloureuses.

Soif de grandeur
Un incident à la limite du comique montre l’ampleur de l’ambition de Jacob et d’Amalie :il advient lorsque, comme tous les Juifs de l’Empire, ces deux Ostjuden furent contraints de choisir leur date de naissance dans le calendrier grégorien plutôt que dans le calendrier juif et qu’ils choisirent respectivement celle de Bismarck et de l’empereur François-Joseph.
Par ailleurs, Amalie a pris le fait que son enfant était né dans une calèche comme une indication de son bonheur et de sa célébrité future. Elle semble avoir scruté l’environnement à la recherche de signes qui confirmeraient ses ambitions pour son fils. Lorsqu’une vieille dame dans une pâtisserie a prophétisé que son bébé grandirait et deviendrait un grand homme, la Galicienne superstitieuse a traité cette déclaration comme une prédiction inattaquable. Freud, cependant, a accueilli la prédiction de la vieille dame avec plus de scepticisme : « Ce genre de prophéties sont certainement très fréquentes, tant il y a de mères dans la joie de l’attente et de vieilles paysannes ou d’autres vieilles femmes qui ont perdu le pouvoir qu’elles avaient sur cette terre et se sont donc tournées vers l’avenir »[11]. La folie des grandeurs considérable d’Amalie – ainsi que celle de Jacob – se manifestait sans doute dans son ambition pour Freud. En réfléchissant à l’influence de sa mère, Freud se demandait : « Serait-ce la source de ma soif de grandeur ? » Il observe que ce genre d’idéalisation maternelle précoce peut en fait déboucher sur la réussite dans la vie ultérieure, et nous dit qu’il a constaté « que les personnes qui se savent préférées ou distinguées par la mère manifestent dans l’existence cette confiance particulière en eux-mêmes, cet inébranlable optimisme qui bien souvent sont perçus comme héroïques et forcent la réussite dans la réalité »[12].
Même s’il pourrait sembler certain que Freud se réfère à lui-même dans ce passage et dans d’autres passages similaires – ce qui n’est pas le cas – l’idéalisation par Amalie de son goldener Sigi est plus compliquée et moins bénigne que la description semble le suggérer. Elle est en fait traversée par des contradictions qui correspondent aux nombreuses contradictions de la personnalité polytropique de Freud. D’une part, il ne fait guère de doute que l’intériorisation de l’amour idéalisant précoce que Freud a reçu d’Amalie, mais aussi de son père et de sa nourrice, a joué un rôle essentiel dans la formation des parties solides de sa personnalité – ses points forts – sans lesquels il n’aurait pas été capable d’endurer une extrême adversité et de réaliser ses accomplissements monumentaux. D’autre part, en plus de ces effets positifs, l’intense (sur)investissement d’Amalie pour son fils contenait également un côté extrêmement narcissique qui a eu des conséquences plus néfastes sur son développement. En effet, coexistent dans la structure du « moi » de Freud, à côté de ses forces exceptionnelles, un grand nombre de failles et de vulnérabilités qui découlent typiquement de perturbations dans la période précoce de l’enfance. La conviction qu’il n’était pas digne d’être aimé, malgré l’énorme reconnaissance qu’il recevait, une anxiété de séparation extrême et une haute exigence concernant ses objets d’amour, un besoin d’idéalisation, une dépendance orale et une tendance à la somatisation.
Examinons par exemple les remarques qu’il fait concernant les effets de l’ambition de ses parents sur lui. Il ne se réfère pas à la confiance en soi ou à l’optimisme qu’elle a engendré en lui, mais à sa « soif de grandeur », qui, tout comme son penchant pour l’héroïsme, peut être interprété comme un effort (parfois désespéré) de réparer de graves défauts en soi-même. L’incertitude d’être aimé alimente souvent la soif de gloire du narcissique. Dans ses lettres à Martha, Fliess, et Jung, Freud confesse à plusieurs reprises ses doutes tenaces sur lui-même et son sentiment qu’il ne mérite pas d’être aimé. L’image qui se dessine semble être la suivante : dans la mesure où Freud pouvait s’identifier et intérioriser l’amour idéalisant de sa mère, ainsi que celui de son père et de sa nourrice, il était capable de maintenir sa confiance en lui, même face à de profonds doutes et à une extrême adversité. Mais dans la mesure où il sentait que l’amour d’Amalie était narcissique et que ses louanges étaient creuses, ces identifications et intériorisations étaient précaires, et son sens du moi avait tendance à être vulnérable et fragile. Sa prodigieuse mais coûteuse capacité de maîtrise de soi, cependant, lui permettait souvent de masquer ces vulnérabilités. Il se peut, d’ailleurs, que chez Freud, comme chez de nombreuses autres personnes remarquables, ces contrastes radicaux dans sa personnalité ont contribué à engendrer une structure de caractère de créateur.

La catastrophe originelle
La représentation que Freud se faisait de l’image maternelle était rendue encore plus complexe, par le fait qu’il avait une « deuxième mère » : une nourrice catholique tchèque, la Kinderfrau qui s’est occupée de lui pendant les deux premières années et demie de sa vie. Nous ne savons pas avec certitude à quel point Amalie s’est appuyée sur la Kinderfrau avant la mort de Julius, bien que l’on puisse supposer, étant donné le stress qu’elle a dû subir et son manque d’expérience dans la prise en charge d’un nourrisson, qu’elle ait beaucoup eu recours à elle. Cependant, après la mort de Julius, il est clair que la nourrice tchèque est devenue la « seule gardienne » de Sigmund – une position qu’elle a conservée jusqu’à sa disparition brutale six mois plus tard.
La Kinderfrau de Freud ne s’est pas seulement occupée de ses besoins physiques. Après la mort psychologique de sa mère, elle est également devenue sa principale source de soutien émotionnel. Elle est devenue, en d’autres termes, ce que les psychanalystes appellent « un objet de substitution ». Il est important de noter que les souvenirs oubliés de la Kinderfrau sont apparus au début de la phase critique de l’auto-analyse de Freud qu’il avait officiellement entreprise en réponse à la mort de son père Jacob. Il était entré dans une période de deuil intense, au cours de laquelle de nombreuses pertes significatives de son enfance étaient réactivées par la mort de son père. Le moment de la découverte de ces souvenirs refoulés indique la position importante que la Kinderfrau occupa dans le développement psychique de Freud. Et bien que peu abondant, ce que Freud dit d’elle est tellement chargé de sens que ça nous donne une idée de la signification qu’elle avait pour lui.
Suite et fin du texte « Les deux mères de Freud » de Joel Whitebook : ICI.
Joel Whitebook
Joel Whitebook est un philosophe et un psychanalyste. Il fait actuellement partie de la faculté du Centre de formation et de recherche psychanalytique de l’Université de Columbia où il est directeur du programme d’études psychanalytiques de l’Université. Il est l’auteur de ‘Perversion and Utopia‘ (1995), de ‘Freud: an intellectual biography’ (2017) et de nombreux articles.
Notes
| 1 | Joel Whitebook. Freud An Intellectual Biography. Cambridge University Press, UK, 2017. |
| 2 | Paul Roazen, Freud and his followers (New York: New American Library, 1974), p.45. |
| 3 | Heller, “Freud’s mother and father,” 338, in Freud as we knew him. Ed. Hendrik M. Ruitenbeck. Detroit, MI: Wayne State University Press. 334–340 |
| 4 | Freud, Martin. 1957. Glory reflected: Sigmund Freud – man and father. London: Angus and Robertson, p. 11–12. |
| 5 | Ibid. |
| 6 | Rizzuto, Why did Freud reject God?, 197–198. |
| 7 | Sigmund Freud, Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse, 5e conférence, Paris, Gallimard (folio), 1984. |
| 8 | Krüll, Freud and his father, p. 117- 118. |
| 9 | Sigmund Freud, « Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci », in, id. Ecrits philosophiques et littéraires, Paris, Le Seuil, 2015, p. 935. |
| 10 | Idem. |
| 11 | Freud, L’interprétation du rêve, trad. Jean-Pierre Lefebvre, Paris, Le Seuil, 2007, p. 309. |
| 12 | Ibid., p. 750. |