Une résolution déposée par le député communiste Jean-Paul Lecoq visant à condamner « l’institutionnalisation par l’État d’Israël d’un régime d’apartheid » a été défendue le jeudi 4 mai dernier à l’Assemblée, avant d’être rejetée. Bruno Karsenti revient sur le texte de cette résolution et montre à quoi sert réellement le spectre de l’apartheid brandi par la partie aujourd’hui hégémonique de la gauche française. Il montre aussi comment, tout en cherchant à tirer profit du mouvement d’opposition au gouvernement qui se manifeste en ce moment en Israël, les rédacteurs de la résolution s’interdisent d’en comprendre le sens et la portée.
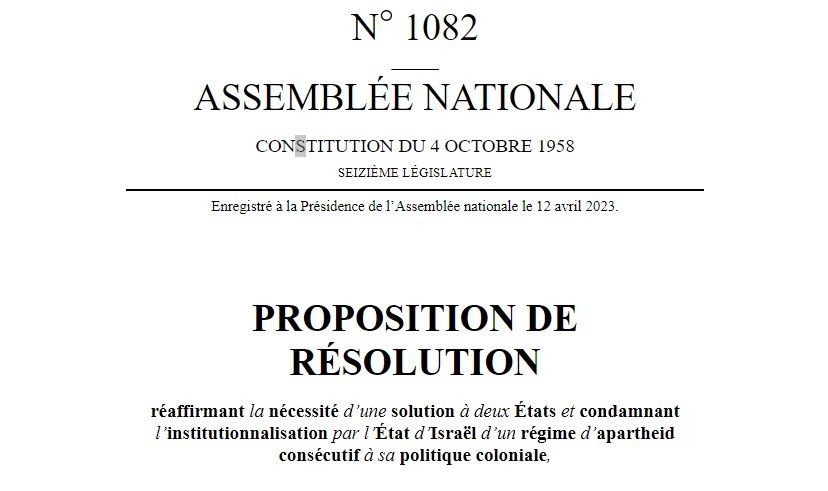
La confrontation qui se déroule actuellement en Israël, entre une droite nationaliste où le camp religieux pèse de tout son poids et un large mouvement d’opposition démocratique, suscite de nombreux commentaires dans les différents pays européens. Ces commentaires varient en fonction de plusieurs facteurs : l’importance des communautés juives, les traditions plus ou moins ancrées d’adhésion ou de défiance à l’égard du projet sioniste, les pressions sociales et politiques internes, ou encore les relations extérieures privilégiées par chaque État. Autant d’éléments qui colorent différemment les réactions auxquelles on assiste. Et celles-ci varient encore, évidemment, selon les partis politiques nationaux. Ceux-ci n’ont pas sur Israël de point de vue homogène qui les rassemble et unifie chacun en eux-mêmes. Au contraire, des césures profondes se font jour en leur sein, les courants et les tendances s’y affrontent souvent durement, signe que sur ce sujet, ce qu’il en est de l’État juif, des questions sont soulevées que le débat politique, tant qu’on le prend à sa surface, recouvre bien plus qu’il ne les exprime.
En juillet dernier, alors qu’une période très instable s’ouvrait en France – avec une majorité relative du parti de gouvernement à l’Assemblée, et une colère sociale croissante qui aujourd’hui atteint un seuil critique – et qu’en Israël le changement de gouvernement n’avait pas encore eu lieu et n’était pas même prévisible, tant le système parlementaire et les rapports de forces rendaient les résultats électoraux incertains, la Nupes, fraichement formée et tout juste en place dans l’hémicycle, avait présenté une résolution visant à condamner Israël comme régime d’apartheid et à apposer un sceau officiel au mouvement en faveur du boycott (BDS). L’initiative venait des communistes, était soutenue par LFI, sans que le PS et les Verts n’y voient rien à redire. Elle n’avait eu ni les suites et ni l’écho politiques escomptés, l’Assemblée ayant dû traiter d’autres sujets plus urgents, sur le plan international avec l’aggravation de la guerre en Ukraine, et sur le plan national avec les réformes structurelles que le gouvernement entendait faire passer coûte que coûte.
Il n’en va plus de même aujourd’hui. De nouvelles conditions sont créées pour que les mêmes acteurs reprennent leur bâton de pèlerin et fassent avancer leur cause.

Une seconde résolution a été ainsi présentée ces jours-ci, une fois encore par un communiste, le député Jean-Paul Lecoq. Elle a été rejetée par l’Assemblée, n’étant soutenue que par la gauche, avec le plein des voix communistes, LFI et Verts. Les socialistes, de leur côté, bien qu’ayant voté au sein du parti une résolution qui allait dans une toute autre direction, ont étrangement décidé de ne pas prendre part au vote. Un seul d’entre eux (Jérôme Guedj, qui avait déjà fait entendre son désaccord en juillet) a voté contre. Il aura donc été la seule voix de gauche à dire par son vote dans l’hémicycle que non, Israël n’est pas un régime d’apartheid.
Le contraste entre les moments et les deux textes, quand on le regarde de près, est riche d’enseignements. On s’aperçoit vite que la nouvelle résolution n’est pas identique à la précédente, en ce qu’elle se veut cette fois en prise directe sur la situation. Le but, toutefois, est inchangé. Israël doit être qualifié, sans réserve et définitivement, d’État d’apartheid. La différence la plus notable par rapport à juillet est que l’accusation vient s’inscrire dans un cadre positif. La construction de deux États est mise en avant, afin de donner tout son sens à la sentence prononcée. C’est que, en écho à ce qui se passe « là-bas », on se veut maintenant plus constructif. Mais c’est pour ajouter que cela exige la condamnation renforcée du seul des deux États actuellement en place, l’État d’Israël. Autrement dit, ce qu’on avance, c’est qu’abaisser plus résolument l’un est la condition indispensable pour faire monter l’autre. En interdisant à l’un de persister dans son être actuel, on pourra vraiment s’acheminer vers la naissance de l’autre. La solution, conçue il y a plusieurs décennies par les accords d’Oslo (sur lesquels la résolution se fait néanmoins très discrète, puisque cela engagerait une distribution des torts qui ici n’est pas de mise), de deux États établis dans leurs frontières et nouant des relations pacifiques, serait donc forcément à ce prix.
Un prix qu’il est évidemment plus facile de payer si l’on se place sur la ligne de l’antisionisme. Celui-ci, on le sait, a de puissantes racines dans la gauche française. Certes, on dira – et on aura raison – que son contraire, à savoir le soutien et l’intérêt pour le sionisme, ne fut pas moins réel. Cela fut d’ailleurs longtemps une ligne de partage à gauche, l’un de ces diviseurs qui condensent des enjeux dont certains sont avouables – le tiers-mondisme contre l’expérimentation socialiste, l’anticolonialisme contre l’issue à une impasse européenne – et d’autres beaucoup moins – le positionnement par rapport aux juifs et à leur droit à se défendre et à exister politiquement à notre époque. Quoi qu’il en soit, il faut noter que le soutien apporté par une partie de la gauche française à Israël reposait sur des relations nourries et continues entre les partis socialistes de chaque État, en un temps où ils étaient encore des forces de premier plan. Pour des raisons différentes, ce n’est plus le cas dans aucun des deux pays. De cet affaiblissement général des socialistes – qui ne peut pas ne pas s’exprimer aujourd’hui dans l’orientation de la Nupes, dominée par LFI – il était prévisible que l’antisionisme sorte renforcé. Depuis le début des années 2000, c’est bien ce qui a lieu, et la tendance paraît inéluctable ; tout au plus peut-on la freiner, mais pas la renverser. L’intervention de juillet, à cet égard, ne contenait aucune surprise. Elle annonçait simplement la couleur, c’est pourquoi elle fut d’ailleurs si rapide, et même un peu précipitée. L’enjeu n’était pas tant de dire quelque chose de la situation au Moyen-Orient – en général, il ne s’agit aucunement de cela – que d’afficher clairement une hégémonie en interne, c’est-à-dire au sein de la gauche et dans le paysage politique français. Puisque les élections présidentielles et législatives avaient eu une issue favorable pour un camp déterminé, il fallait allumer les signaux que tout le monde comprend. Le geste, en bref, mettait le PS un peu plus à terre qu’il ne l’était déjà, et permettait de lui faire sentir le joug dès le départ de l’aventure « commune » de la Nupes.

Mais voilà que l’histoire rattrape les stratégies et les pousse à se rectifier. « Il s’est passé quelque chose… » Pour une fois, il va donc falloir regarder quoi. Pour l’antisionisme de principe, l’exercice est assez inusuel. Il se révèle même en l’occurrence plutôt gênant. On trouve une trace de cet embarras dans la première phrase d’ouverture de la nouvelle résolution : « L’attachement profond à l’existence de l’État d’Israël ne saurait interdire tout regard critique sur sa dérive illibérale et coloniale. » On est loin de la citation de Nelson Mandela par laquelle la précédente commençait. Ne nous réjouissons pas toutefois, car cet exergue, auquel tout progressiste peut aisément souscrire, est en décalage complet avec ce qui suit ; et l’on s’aperçoit vite que son seul intérêt, au-delà de la rhétorique, est de permettre de ratisser au plus large, emportant dans son sillage tout ce qui serait maintenant du côté du « regard critique ». La résolution entend en effet se brancher sur ce qui est en train de se produire en Israël ; elle veut profiter du moment présent. Mais pour cela, il faut que le « regard critique » prenne une extension qui équivaut à un retournement par rapport à ce qui se passe réellement en Israël. Il faut qu’il se convertisse en tout autre chose que ce qui s’y manifeste dans la rue : à savoir un « attachement profond » à Israël, sans ambiguïté aucune.
Car c’est exactement ce qu’on voit dès qu’on regarde vraiment « là-bas », et qu’on s’abstient un instant de penser aux manœuvres qu’on entend conduire ici. Ce qu’on voit, c’est que le sionisme, entendons sa version historique des plus classiques, manifeste dans la rue et dans toutes les arènes possibles depuis près de deux mois. Qu’il se pare de drapeaux israéliens, chante l’hymne national, brandit le texte de la déclaration d’indépendance. Et qu’il le fait pour faire pièce à ce qu’il estime lui porter gravement atteinte : un gouvernement qui projette, sans pour l’instant y parvenir, de modifier les lois fondamentales afin d’avoir les mains libres ; un exécutif qui menace de toucher à la séparation des pouvoirs, à la laïcité, aux droits des minorités (dont au premier chef, ceux des Palestiniens d’Israël, dotés de droits civils et politiques égaux à ceux des citoyens juifs) ; une politique qui risque de faire basculer le pays de la colonisation des territoires occupés depuis 67 à leur annexion, le « Grand Israël » ainsi réalisé impliquant que la population palestinienne qui y vit serait alors placée dans un statut inférieur à celui des autres citoyens d’un seul et même État aux frontières étendues – État qui correspondrait alors effectivement à un État d’apartheid, tel que qualifié et condamné par le droit international.
Bref, ce que voit l’antisionisme de gauche dans sa version européenne, c’est le sionisme réel, et pas imaginé, s’opposer vigoureusement et implacablement à l’antisionisme de droite dans sa version israélienne. Et ce qu’il est bien obligé de constater, c’est que cet antisionisme de droite, qui se projette en politique à réaliser et se trouve en ce moment en position d’agir, correspond trait pour trait à ce que lui, l’antisionisme européen, ne cesse de dire que le sionisme était déjà – puisqu’il le serait nativement, dès le départ et tant qu’Israël existe.
On comprend l’embarras à gauche. Qu’Israël soit une démocratie, et que cette forme démocratique tienne justement à son inspiration sioniste et à nulle autre chose, c’est ce que rend patent la situation actuelle, du fait même de sa polarisation.

Dans ces conditions, impossible d’écrire la même résolution qu’en juillet. Mais comme le but des auteurs reste le même – et que ce but est essentiellement domestique – il faut que le changement de discours ne soit pas un changement de cap. Comment faire alors ? La nouvelle résolution, sans surprise là-encore, après avoir déclaré son « attachement profond », fait feu de tout bois pour exprimer le contraire, c’est-à-dire sa détestation et son rejet. Elle procède par accumulation de faits sans trop se préoccuper des contradictions accumulées en cours de route. Le qualificatif d’apartheid est martelé, sur fond de confusion entre les situations internes et externes à l’État, les villes mixtes dans l’État et les zones occupées militairement par ce même État, l’administration militaire dans les secondes et les tensions intercommunautaires dans les premières, où la vie civile repose sur l’égalité de tous les citoyens, qu’ils soient juifs ou non-juifs. Sans parler du fait que ces villes sont parfois administrées par des élus issus des partis arabes, présents au parlement. Dans l’ignorance de cette réalité israélienne, où les droits collectifs des communautés se négocient sur fond d’une stricte égalité des droits individuels sans distinction d’origine ou de confession, la résolution s’efforce autant qu’elle peut de faire parler des voix singulières, irréductibles les unes aux autres mais réunies par l’épreuve qu’elles ont faite d’une injustice avérée. La généralisation est la règle, mais surtout il s’agit de charger autant que possible par l’accumulation de cas une catégorie qui, sous sa forme juridique, est inapplicable. Rien de nouveau par rapport au procédé en vigueur depuis longtemps, plus ou moins rationalisé et coordonné par le BDS ? Et pourtant si. C’est que l’argument de l’apartheid peut maintenant, compte tenu de ce qui est en train de se passer sur la scène politique israélienne, être investi autrement, chargé d’une nouvelle fonction, voire même exempté cette fois de toute mise en discussion.
C’est le pas que souhaite en tout cas accomplir la nouvelle résolution. Certes, il y a bien une difficulté de départ, qu’on ne peut écarter d’un revers de main. Ce qui se produit sur la scène israélienne n’atteste-t-il pas que l’apartheid n’est justement pas actuel, puisque la société démocratique, dont on salue la vitalité au passage, réagit au fait qu’il pourrait le devenir si jamais la « dérive illibérale » dont l’ère Netanyahou a été le terreau parvenait à ses fins ? C’est bien le sens de l’événement, en effet. Mais il comporte un aspect qui ne laisse pas la critique antisioniste sans ressource, et lui donne même un nouvel élan : c’est que monte en puissance une critique qui pourrait s’interpréter comme portant sur l’État lui-même, si l’on sait la requalifier. C’est-à-dire si l’on parvient à montrer que c’est en tant qu’État actuellement existant, et tandis que l’autre État, celui palestinien, est actuellement inexistant, que se trouve en fait impliqué ce qu’on entend réellement par « apartheid. » Tout l’effort de la nouvelle résolution tourne autour de ce point. C’est là son déplacement spécifique. « Apartheid » ne désigne rien d’autre que l’existence d’un seul État, assortie de l’inexistence du second. D’où le recours essentiel à l’argument des deux États, qui devraient être établis en même temps et conjointement dans la zone, ici et maintenant, comme cela aurait dû être le cas dès l’origine. Autrement dit, tant qu’un seul État existe, peu importe ce qu’il est ou fait, il ne peut être qu’un État d’apartheid. Et ce n’est que lorsque deux États existeront que l’apartheid sera enfin conjuré.
Conjuré comme peut l’être un spectre. Avec la nouvelle résolution, la gauche française a trouvé le moyen de convertir la réalité introuvable de l’apartheid israélien en un spectre toujours déjà agissant, par-delà les contextes et l’enchaînement historique des faits. La méthode choisie pour l’attester, sans plus de souci de cohérence, est donc logiquement régressive. Bien voir, c’est voir qu’en dépit des apparences, l’apartheid a été toujours déjà à l’œuvre, aussi loin qu’on remonte dans le temps. C’est ainsi que l’on passe d’un apartheid qui serait déjà effectif sous l’ère Netanyahou, à un apartheid initié depuis l’ascendant pris par le Likoud dans les années 90, puis à un apartheid ouvert par l’occupation de 67, et enfin à un apartheid amorcé dès 48 – l’exode palestinien de 49 étant alors reconduit tout entier à ce qu’il a comporté d’expulsions et de violences, et la situation des arabes israéliens depuis lors, c’est-à-dire depuis tout de même trois quarts de siècle, se voyant réduite à une invariable stagnation dans la domination et l’oppression. Si tel est le cas, notons qu’on ne voit pas très bien à quoi se réfère « l’attachement profond » déclaré au départ. Car ne reste plus que la dénonciation. A aucun moment il ne s’agit de décrire la composition historique de la société israélienne et les dynamiques plus ou moins réussies d’intégration des différentes communautés, autochtones et d’immigration plus ou moins récente, qui l’ont conduite jusqu’à sa forme présente. A aucun moment la stratification qui en résulte, avec ses tensions spécifiques, ne fait l’objet du moindre examen. C’est qu’elle est sans intérêt. Seule compte la permanence du spectre et l’accroissement continue de son emprise.

Au fondement du raisonnement, il y a bien un état de fait : non pas des dispositions institutionnelles ou légales qui seraient sources de pratiques discriminatoires et de ségrégation raciale, mais la réalité même de l’État, en tant qu’il est un et un seul. L’autre État n’existe pas, l’État d’Israël existe, et cela suffit. Voilà le scandale par lequel tient maintenant le spectre de l’apartheid, et que son évocation a inlassablement pour fonction de rappeler. Si Israël continue à exister alors que l’État palestinien n’existe pas, alors c’est qu’il y a apartheid. Non pas juridiquement, non pas politiquement, mais existentiellement. Il faut donc, c’est la proposition principale de la résolution, proférer le nom du spectre, l’entériner dans toutes les instances nationales et internationales, pour que l’autre État puisse advenir. Le boycott en découle évidemment. Il faut nier, par les mots et par les actes, qu’un seul État soit, si l’on veut que deux États puissent advenir. Et nier qu’un seul État soit, c’est le nommer, quoi qu’il en soit de ce qu’il est réellement, État d’apartheid. C’est lui accrocher ce signifiant disqualifiant, quoi qu’il en soit du signifié censé lui correspondre.
Et pour cela, il faut profiter du moment opportun d’une agitation sans précédent, en Israël même, qui ne manifeste rien d’autre qu’une crise de l’État. C’est sans doute sur ce point que les auteurs de la résolution ont malgré eux vu juste. En convertissant la crainte et le rejet qu’exprime la rue israélienne qu’une situation d’apartheid ne soit créée de facto par le passage d’une administration militaire à une administration civile dans les territoires occupés, en une attestation que la colonisation actuelle en Cisjordanie équivaut à une ségrégation raciale au sein d’un État unifié, elle vient souligner d’un trait (quelque peu épais, il est vrai) un point incontestable : Israël est actuellement plongé dans une réflexion sur ce qu’il est en tant qu’État et dans un exercice collectif de reformulation des idéaux qui le structurent sur la lancée de 1948. Et dans cette optique, c’est la colonisation qui est avant tout sur la sellette. Elle met en crise l’État, c’est ce que dit en somme l’opinion, massivement, en attaquant la volonté du gouvernement dans ses intentions les plus destructrices, à commencer par celle d’opérer le basculement de la colonisation à l’annexion. La redéfinition du sionisme, dans les conditions formées par la situation israélienne actuelle ressaisie dans toute sa complexité et où la colonisation est facteur de dénaturation et de dissolution, est à l’ordre du jour. Et donc, non pas un rejet de soi en tant qu’État, mais un renouvellement de l’acte par lequel on se fait État, au présent.
Or c’est bien ce qui, par contre, est tout à fait hors de vue de la nouvelle résolution déposée par la Nupes, et de façon en vérité très symptomatique de la difficulté qu’il y a aujourd’hui à penser sérieusement ce genre de phénomène en Europe de l’Ouest, où il est devenu si facile, toutes options politiques confondues, d’oublier ce que signifie vraiment de vouloir et de faire un État.

Les États ne sont pas des coquilles vides, des constructions institutionnelles destinées à outiller une action publique quelconque et à garantir le bon déroulement d’existences privées tout aussi quelconques. Ce sont des formes qui ne valent qu’à être investies d’un sens, et ce sens s’élabore forcément dans autre chose que l’État lui-même, c’est-à-dire dans ce genre de collectif que la modernité nomme une « nation », faisant du lien entre un État et sa nation le produit d’un autre lien, primordial et de direction inverse, entre une certaine nation et son État à elle. « Mon État », dit une nation qui n’est jamais quelconque – telle est la formule que la modernité a choisi pour mode d’existence politique et sociale dominant, non sans fixer les conditions idéales pour la composer correctement, mais sans pour autant l’imposer. Toutes les nations n’ont pas d’État, et toutes n’ont pas vocation à en avoir un. Le peuple juif, hésitant à se dire nation – car l’appellation a une connotation politique forte que la nationalisation des juifs dans les États d’accueil, effective en diaspora, rend problématique – a quant à lui éprouvé toutes les réticences à s’engager dans cette voie de construction étatique. Il l’a fait à travers le sionisme tel qu’il s’est réalisé en 1948. Le mouvement n’avait rien d’univoque, pas plus avant qu’après la déclaration d’indépendance qui actait la création de l’État. Une fois celui-ci créé, les débats ont continué, sur l’identité des juifs, sur les éléments qu’on faisait entrer dans ce peuple afin de justifier qu’il puisse s’affirmer désormais de cette manière, à travers un État qui n’était certes pas quelconque, et qui devait même s’avérer très singulier au regard des exemples qu’on trouvait du côté de cette Europe qu’on avait quittée. Un État seul, unique au sens de l’unicité qualitative et de l’unité numérique, était devenu celui des Israéliens, majoritairement juifs et minoritairement chrétiens et musulmans, tous égaux et respectés dans leurs droits. Bref, le choix fut celui d’un État démocratique à majorité juive, parce qu’investi d’un sens juif – la façon dont ce sens se remplissait et se déterminait restant sujet à discussion, voire à conflit, notamment entre religieux et laïcs. Mais du point de vue de la loi supérieure, c’est-à-dire des lois fondamentales donnant forme à l’État, tous s’en remettaient à l’État de droit laïc, neutre en matière de culte, qu’on avait emporté avec soi dans l’exil d’Europe.
Voilà ce qui est en question avec la montée du camp religieux réactionnaire, et voilà ce que le sionisme historique classique réaffirme contre lui, et se met en position de repenser dans ses fondements en cette période de crise.
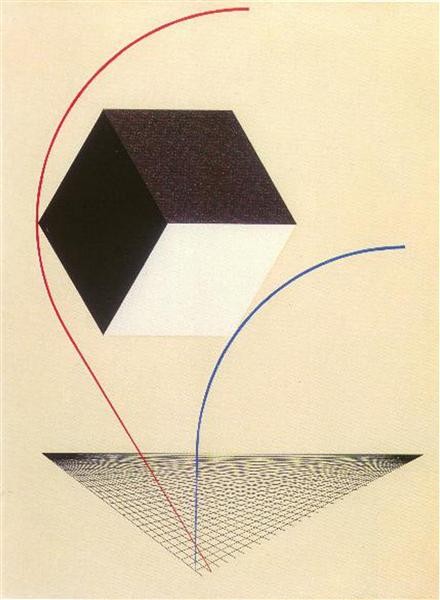
Qu’en est-il alors dans ce contexte de la question des deux États, sur laquelle la gauche française décide maintenant de revenir ? Elle est devenue un axe du sionisme dans son évolution récente, du fait du choix concerté entre Israéliens et Palestiniens en 1993. Mais elle l’est devenue parce que les Palestiniens se sont engagés eux-mêmes dans un processus d’étatisation, processus que les partenaires internationaux, dont Israël, se sont engagés à favoriser – non pas bien entendu à construire, puisque cette construction dépend, dans sa forme et dans son sens, de l’intention politique des Palestiniens en tant que peuple ou nation. Pour eux aussi, il s’agit de vouloir, et de savoir ce qu’on veut quand on le veut. Le vouloir, pour une nation quelconque, n’est jamais une nécessité, mais c’est un vouloir qui engage fortement. La nation s’astreint à revenir sur elle-même pour savoir qui elle est, et comment elle veut vivre et s’auto-organiser, selon quel genre de loi, quelle politique interne et externe. En l’occurrence, ce qui ressortait des accords d’Oslo, c’est la projection d’un État palestinien de type démocratique et laïc, muni d’une identité culturelle forte avivée dans l’épreuve, source d’intenses débats qui restaient largement à conduire, et résolu à une politique extérieure pacifique à l’égard de ses voisins, à commencer par Israël.
Rien de tout cela ne s’est produit, pour des raisons qui requerraient qu’on les analyse objectivement, en revenant sur l’histoire de la politique israélienne et palestinienne des vingt ou trente dernières années. C’est ce qu’on ne fait pratiquement jamais, actant par devers soi que les accords d’Oslo ont fait long feu, mais ressassant dans le même temps l’urgence d’y revenir, et donc en appelant à la solution à deux États.
Et oubliant dans le même temps que les deux États n’ont jamais été, ne sont pas et ne peuvent pas être une solution d’urgence. La seule urgence réelle, c’est de se replacer dans le processus où un État existant se réengage à favoriser l’avènement d’un État inexistant, tandis que la nation de cet État actuellement inexistant agit sur elle-même afin qu’il puisse exister. A moins de n’avoir strictement aucun attachement à l’État d’Israël, de vouloir au contraire sa destruction, et de n’avoir cure du destin réel des Palestiniens (alors même qu’on prétend s’en préoccuper beaucoup), c’est à cette urgence qu’il faut songer. Et c’est elle au fond qu’on rejoint si l’auto-analyse du mouvement de protestation actuelle des Israéliens, dans ce qu’il a de réellement sioniste, est menée de façon conséquente.
La gauche française à la manœuvre dans l’écriture de la résolution de mai, tout comme celle de juillet dernier, n’a aucune conscience de ce qu’on vient de décrire. En quoi elle reste fidèle à l’antisionisme de gauche dans sa version bien française, et s’éloigne complètement des voix qui pouvaient encore se faire entendre lorsque le Parti socialiste avait toute sa place dans le paysage politique français. Elle se rue sur le spectre de l’apartheid pour poursuivre de sa vindicte ancienne et toujours vive un État qu’elle honnit. Quand elle parle de l’État palestinien, ou de deux États, peu lui importe d’assumer ce qu’elle énonce, car son problème est ailleurs. Il est de bien délimiter la position franco-centrée où ce qui importe vraiment, c’est qu’Israël soit enfin inexistant.
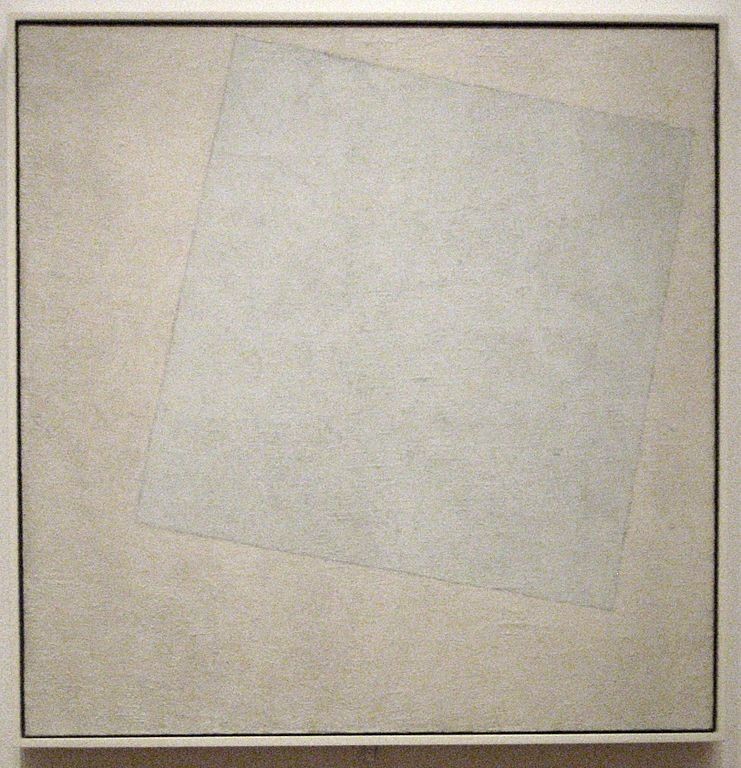
Il en allait tout autrement à l’époque où, au sein d’un socialisme vivant, l’inspiration juive des principaux auteurs de la déclaration de 48 rencontrait dans ce camp politique des échos évidents, et les rencontrait d’autant plus que, dans la tradition même du socialisme français, se trouvaient des ferments qui poussaient dans la même direction : celle d’une forme de démocratie sociale adossée à un réseau coopératif élargi et à des modes collectifs de d’existence et de production tels que l’État juif s’efforçait alors effectivement de les dessiner.
Du passé, encore du passé ? Sans doute. Mais il y a deux sortes de passé. Il y a celui qu’on évoque avec nostalgie, dans la déploration de la situation présente. Et il y a le passé que le présent fait resurgir comme ce qui permet précisément de le comprendre, de faire tomber les écrans qui bouchent la vue et de suivre la tendance nouvelle qu’il comporte. A propos de la situation israélienne, la gauche française est maintenant face à ce défi : se souvenir et réactiver une attitude que son déclin a recouvert, pour mieux adhérer à ce qui se passe en ce moment même et aux perspectives qui se dessinent. En rappelant un certain passé, on ne fait donc que renouer avec la motivation dont il témoigne dans ce qu’elle a d’éminemment actuel. Et on affirme qu’il devrait revenir à la mémoire de celles et ceux qui prétendent encore avoir une voix propre aujourd’hui au sein du concert assourdissant de la gauche lorsque, en un seul mouvement, elle s’acharne à brandir des spectres et déploie toute son énergie pour que surtout rien ne progresse en Palestine et en Israël.










