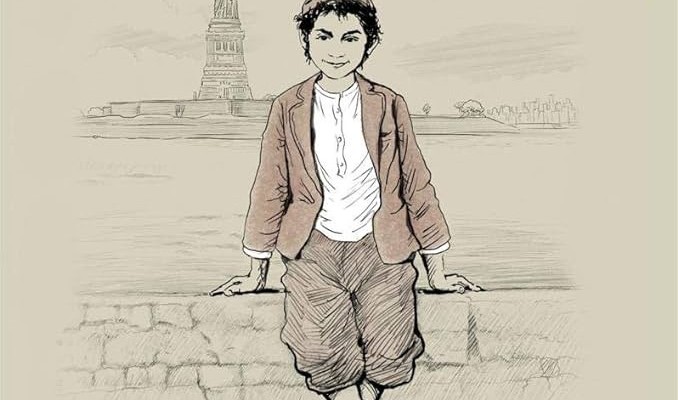J’aime bien Soukot.
Pendant une semaine, les juifs sont tenus de prendre leurs repas dans un habitat éphémère, en hébreu une souka qu’on traduit, faute de mieux, par « cabane » pour aiguiser la curiosité des enfants et peut-être aussi attendrir les antisémites. Ses murs peuvent être en béton armé et ses fenêtres en plexiglas mais la toiture doit être faite de végétaux à la fois suffisamment denses pour ne pas sentir le ciel tomber sur sa tête et assez espacés pour apercevoir les étoiles à travers le feuillage. Une savante construction solide-fragile dans laquelle on migre trois fois par jour, chariot à la main. En s’installant provisoirement à l’extérieur tout en gardant un pied à la maison, le dedans et le dehors se confondent, résidence principale et secondaire s’inversent. Bref, on met en scène son propre exil. Et comme je n’arrive jamais à me sentir totalement bien là où je me trouve, espérant à chaque station que la prochaine sera la bonne, cette fête de la bougeotte me convient parfaitement.
Durant mon enfance nous n’avions pas de souka. La cour de notre immeuble était immense mais elle ne nous servait à rien car un panneau rouge prévenait qu’il était « interdit de jouer dans la cour ». Notre voisine du dessus, une alsacienne éternellement blonde peroxydée s’avisait à faire respecter la loi en jetant un regard réprobateur par-dessus son balcon au moindre enfant qui s’y aventurait. Un pince-sans-rire de la copropriété en avait révélé l’esprit par une boutade : il noircit le e de jouer et le surmonta d’un point, sentant bien que c’était jouir qui posait problème dans cet espace. Pas exactement l’ambiance adéquate donc pour y planter sa souka une semaine par an. Précisément parce que la fête de Soukot est, dans la Tora, la seule qui comporte une injonction à se réjouir[1]. La joie sur commande, pile au moment – le début de l’automne – où l’on lit l’Ecclésiaste et son « tout est vanité » à la synagogue, est appliquée à une fête qui se déroule dans une tension permanente du qu’en-dira-t-on.
Qu’en dira d’abord le voisinage : on craint toujours qu’un voisin s’oppose à la construction de la cabane, au vacarme qu’elle charrie et à la mise entre parenthèse du principe de la vie religieuse confinée à la sphère privée. Sept jours durant, le judaïsme ne s’accommode plus de la laïcité, l’intime s’extériorise, la rue devient lieu de séjour et l’espace commun est occupé. Si ‘Hanouka joue sur la lisière – les lumières du miracle doivent être vues du dehors mais placées à l’intérieur du foyer – Soukot subvertit privé et public.

Qu’en dira ensuite l’autre juif : quand on ne peut pas la construire sur son balcon ou dans sa cour, on en est réduit à se rendre dans une souka communautaire. On s’y retrouve attablé avec les fidèles que l’on croise toute l’année dans sa synagogue, à qui l’on souhaite « chabat chalom », avec lesquels on échange peut-être 2-3 phrases, mais que l’on maintient aussi scrupuleusement à distance en vertu de la règle selon laquelle le peuple juif se divise entre ceux avec qui on prie et ceux avec qui on parle. A Soukot les deux groupes fusionnent, ce qui est à la fois plaisant et gênant pour tout le monde. Chaque famille apporte ses propres plats et coutumes et d’une table à l’autre on s’observe, se toise, se compare à voix basse, tout le monde se sait sur écoute.
Ce camping communautaire contraint à demander le tire-bouchon oublié au barbu hirsute un peu intimidant qui prie toujours plus intensément que les autres ou à emprunter la salière au frimeur à gourmette que l’on évite soigneusement le reste du temps. Parfois se produisent des rencontres gastronomiques et humaines. On se fait goûter les plats, on s’échange des recettes, on s’apprend des chants. Les célibataires font leur marché, les ados se dragouillent, les enfants se glissent sous les tables. On se prend le bec pour une place qu’on avait réservée, pour un mot déplacé. Régulièrement des disputes éclatent et parfois même des bagarres. La joie de Soukot on appelle ça.
Il faut dire que la première occurrence biblique du terme souka apparait également dans un contexte de rivalité-fraternité, bien avant la mention de la fête biblique éponyme. Cela se produit dans le livre de la Genèse, immédiatement après les retrouvailles pacifiques entre Esaü et Jacob qui vient tout juste de devenir Israël[2]. Esaü, l’ainé dupé apparemment apaisé, propose à son cadet ruseur de cheminer avec lui. Mais Jacob le boiteux refuse, il ne peut aller aussi vite que ce rouleau compresseur d’Esaü, traditionnellement perçu depuis le triomphe du christianisme comme personnification de l’Occident, le faux-frère bâtisseur de l’Empire-monde du frêle Israël. Leurs voies se séparent donc et Jacob conduit troupeau et famille en un lieu appelé Soukot où il construit des huttes. Ce qui pose une difficulté : étant donné que la hache de guerre vient d’être enterrée avec Esaü, de qui veut-il se protéger ? Peut-être lui faut-il se mettre à l’abri de sa malveillance, traduction moderne du « mauvais œil », c’est-à-dire de la capacité de nuire à distance, par les simples armes du langage, du regard, de la pensée, produits d’un reliquat de rancune, de jalousie, de conviction que l’autre occupe illégitimement une place qui nous revient sans qu’on la désire.
Soukot c’est aussi le festival des 50 nuances de pratique juives. Puisque le Texte dit seulement qu’il faut résider dans la souka[3] mais sans préciser ce que « résider » signifie exactement, chacun y va de sa propre interprétation. Il y a ceux, les Loubavitch par exemple, qui ne consomment pas la moindre miette ni goutte en dehors de la souka mais n’y dorment surtout pas (ce serait profaner la sainteté de la bicoque). D’autres mettent au contraire un point d’honneur à y dormir. Et puis il y a les accommodements de ceux qui n’y mangent que le plat de résistance et montent prendre dessert et café à la maison. Sans oublier la version sur-le-fil-de-la-loi de ceux qui n’y mangent que la quantité de pain minimale requise pour que cela puisse légalement être considéré comme un « repas » puis rentrent se baffrer au chaud – mais sans consommer de pain, bien entendu. J’en ai même connu un qui construisait sa souka directement dans son salon à toit ouvrant, les pieds dedans, la tête dehors.
Mon père a peut-être pris le panneau de la grande cour trop à la lettre et n’a pas construit de souka pendant ses trente premiers Soukot à Strasbourg. Pour un exfiltré de RDA, où l’individu comme la religion étaient niés, cela représentait probablement trop d’un coup que d’empiéter rituellement sur la sphère publique et de s’y afficher comme personne religieuse. On ne quitte pas un État communiste en un jour, surtout quand l’espace y était strictement figé et délimité par un mur infranchissable. À Soukot, le juif explore et explose les frontières d’un même mouvement, transportant son espace avec lui, comme une tortue.

Durant cette période nous nous rendions donc à la souka de la Yechiva qui nous tenait lieu de communauté.
Comme ma mère combine le fait d’ériger en valeur suprême sa gemütlichkeit (un des mots allemands intraduisibles que « confort » ne rend que très imparfaitement) et de remercier chaque jour le Créateur de l’avoir faite femme – et donc de l’avoir dispensée d’un certain nombre de commandements dont, le moins gemütlich d’entre eux, la souka – Soukot était toujours un moment de tête à tête entre moi et mon père.
Je n’ai aucun souvenir des discussions que nous avons pu avoir, seul à seul dans la souka, mais je me souviens de la préparation du panier à provisions, du trajet en voiture jusqu’à la Yechiva et de l’effet de surprise que produisait la découverte de nos voisins de table pour ce repas. À chaque Soukot me revient la sensation très prégnante d’avoir passé un moment avec lui, et que j’étais content.
Un jour mon père a pris son courage à deux mains et a construit sa propre souka. Peut-être avait-il attendu que nous ne soyons plus des enfants turbulents et que la voisine du dessus soit trop vieille pour donner de la voix. Toujours est-il qu’il a construit dans la cour la plus petite souka qui soit. À peine plus grande que les dimensions lilliputiennes requises par le Talmud pour qu’une souka soit considérée comme telle : elle doit contenir la tête, la majeure partie (du corps) et la table de son propriétaire[4]. Je me suis souvent imaginé une telle souka pour juif-tronc, sans chaise et les pieds dehors. Le minimum radical exigé pour que la précarité ne devienne pas clochardise et pour que la conscience de la furtivité de nos existences ne se transforme en manifeste nihiliste.
Comme mes parents sont des juifs sans tradition, leurs propres ancêtres s’étant déjà assimilés depuis plusieurs générations, ils ont dû se raccrocher aux branches – c’est particulièrement le cas de la dire à Soukot – d’une tradition culinaire perdue en route. Mon père s’est donc mis à cuisiner son propre tcholent, un ragoût que les puristes mangent tous les Chabat, équivalent achkénaze de la dafina marocaine.
Mon fils, dont la grand-mère tunisienne cuisine pourtant divinement bien, déclare un jour par an, à Soukot, que le-tcholent-de-Opa-Peter est son plat préféré. Le met en question en est pourtant à son stade pré-expérimental, il n’en a que les ingrédients sans la saveur ni la profondeur, mais le petit-fils reconnait apparemment l’effort de son grand père pour raccrocher les wagons d’une tradition interrompue et l’audace de remettre les compteurs gastronomiques à zéro.
La petitesse de la souka de mon père m’a longtemps agacé. On doit s’y plier en quatre, ne peut y recevoir qu’un seul invité et les enfants y deviennent vite encombrants. Avec le temps, je me suis néanmoins attaché à cet espace où chaque centimètre compte et où le moindre geste est un luxe. Elle oblige à se satisfaire de ce qui est et à voir du grand dans l’infime, tel le peuple juif dont la noblesse cohabite avec la médiocrité, la distinction avec le trivial et l’indestructibilité avec la vulnérabilité.
Une fois, nous nous sommes retrouvés à trois dans cette souka. Mes enfants n’étaient pas encore nés. Il y avait mon père et moi avec un homme que je perçois à la fois comme une figure de maître, de tonton et de « dernier des juifs ». Aussi érudit que sceptique, on ne saurait dire s’il n’aime pas autant la Tora que le hareng qu’il prépare et sert à ses disciples, au point qu’on finit par ne plus savoir lequel des deux – du Texte ou du poisson – accompagne et procure sa sacralité à l’autre.
Surtout, je le voyais comme le chainon manquant entre notre germanité toute domestique et notre socialité française par nécessité, entre lesquels subsistait toujours un douloureux fossé mental et culturel. Élevé entre Strasbourg, la Suisse et Jérusalem, familier des plus grands maîtres yiddishophones rescapés de la Shoah et parlant un français parfait qui semblait être le faux-nez d’une achkénazité impossible à exprimer pleinement en France, j’avais projeté sur lui qu’il serait la passerelle tant espérée entre les deux rives. Qu’il soit notre unique hôte dans ce dedans-dehors qu’est la souka avait donc tout son sens.
La relation entre lui et mon père n’a jamais été simple. Pas l’ombre d’une fâcherie – ce serait trop simple – mais disons que la rencontre entre un baal techouva[5] prussien anciennement communiste et un polonais tombé-dans-la-Tora-quand-il-était-petit-mais-extirpé-de-la-marmite n’allait pas de soi. Le repas s’annonçait long en plus d’être serré, j’allais jouer ma partition naturelle mais épuisante de passeur de plats et de paratonnerre des tensions latentes. Et l’inattendu se produisit : un vent violent, venu de nulle part dans cette cour isolée, souffla littéralement notre souka qui se retrouva l’espace d’un instant, furtif mais interminable, en lévitation. La soupe sur les genoux, le toit par terre, indemnes mais sonnés, la tornade avait foutu la cabane en l’air et toutes nos crispations avec.
Me vint l’image de la hutte en paille soufflée par le grand méchant loup. C’est dans l’adversité que les trois petits cochons se réunissent comme c’est aussi à Soukot que les quatre types de juifs, symbolisés par autant de végétaux[6], forment un bouquet. La palme de dattier, le cédrat, la myrte et la branche de saule possèdent chacun une caractéristique relative à leur parfum (l’étude, abstraite et éthérée) et à leur goût (la pratique palpable, concrète, des commandements). Qu’ils combinent les deux propriétés, renferment seulement l’un ou l’autre ou aucun des deux, les quatre tiendraient-ils ensemble sans une conscience commune de leur insignifiance fondamentale ?

Il est d’usage de décorer la souka. Celle de mon père a un unique ornement, des plus étranges. Non contents de passer pour des Indiens en agitant des branches pendant une semaine, les juifs rhénans – et uniquement eux – ont élaboré une coutume qui consiste à suspendre un oignon transpercé d’une plume dans leur souka. Un montage qui repose sur un jeu de mots : on associe la souka aux ailes divines à l’ombre desquelles nous nous réfugions. Comme l’hébreu n’a pas de voyelles écrites, le verset « à l’ombre de Tes ailes »[7] (betsel kenafé’ha) peut aussi se lire batsal kenafe’ha, littéralement l’oignon de tes ailes. Les justifications sémantiques fonctionnent après coup et je me suis toujours demandé ce que ce bulbe façon Jérôme Bosch pouvait bien représenter pour ces juifs issus de contrées où ils vivaient surtout à l’ombre de l’Église, des brimades et des pogroms.
Une cabane qui s’envole sans s’effondrer, fragile mais pérenne, un oignon – le cœur humain – transpercé mais hors de portée, la souka de mon père contient l’essentiel : la condition juive en exil, précaire mais tenace.
Je n’ai encore jamais construit ma propre souka. Je trouve toujours un alibi. Avant, je n’avais pas de balcon, seulement une minuscule cour intérieure et j’avais la flemme de demander l’autorisation à tout le voisinage et un manque de confiance dans mes capacités de bricoleur. À présent j’ai un balcon, mais il est couvert, ce qui invaliderait la souka qui doit donner sur le soleil dont elle nous ombrage et les fameuses étoiles qui doivent tapisser son plafond.
Bref, je squatte encore les soukot des autres, en particulier celle de mon père, minuscule mais attachante, dans sa cour à Strasbourg où il a conquis la possibilité de jouir, même imperceptiblement.
Ruben Honigmann
Notes
| 1 | « Tu feras la fête des soukot durant sept jours […] et tu te réjouiras durant ta fête, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, l’étranger, la veuve et l’orphelin qui sont en tes portes » (Deutéronome ch.16, v.13-14) |
| 2 | Genèse 33,17 |
| 3 | Lévitique 23,42 |
| 4 | Talmud de Babylone, Traité Souca, Chapitre 2 Michna 7 |
| 5 | Un « revenu » (à la Tora) |
| 6 | Lévitique ch. 23, v.40 |
| 7 | Psaumes 36,8 |