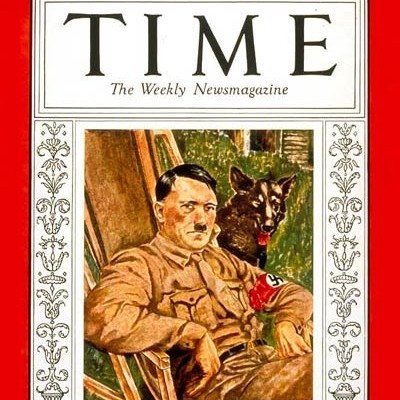« Je n’ai pas d’autre pays » écrit l’Israélien Ehud Manor dans un poème cité par Nancy Pelosi devant le Congrès américain. « Il n’y a pas d’Israël pour moi » dit le narrateur de Soumission, le roman de Michel Houellebecq. Danny Trom propose, à partir d’une analyse conjointe de ces deux énoncés, une distinction entre plusieurs expériences du rapport politique à son propre pays : celle de n’avoir qu’un seul pays, celle de ne plus en avoir d’autre, et celle d’avoir une alternative fut-elle impraticable. Se pose ici la question : tout citoyen de son État en Europe, à présent, n’est-il pas en situation de toucher du doigt l’expérience juive?

« Je ne reconnais plus mon pays », voilà la clameur qui s’est faite partout entendre, aux États-Unis lors de l’élection de Trump en 2016, en France lorsque Marine Le Pen arriva au second tour de l’élection présidentielle de 2017, en Grande-Bretagne quand le vote référendaire de 2016 décida du Brexit. Et lorsque le 6 janvier 2020, Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des Représentants, exhortait le Congrès américain de voter la destitution du président Donald Trump pour avoir refusé sa défaite et incité les citoyens à la rébellion. Elle prononça ces mots : « Surtout en cette triste période, je me souviens des paroles du grand poète israélien Ehud Manor […] quand il a affirmé : “Je ne garderai pas le silence alors que mon pays a changé de visage, je n’arrêterai pas d’essayer de le lui rappeler. Dans ses oreilles, je chanterai mes cris jusqu’à ce qu’il ouvre les yeux”. »[1] La citation est tirée du poème de Manor « Je n’ai pas d’autre pays ».
Exil intérieur
Le poète en question, grandi pour la circonstance par Nancy Pelosi, est Ehud Manor, chansonnier et traducteur de pièces de théâtre en hébreu. Personnage télévisuel, Manor est connu du grand public israélien pour avoir entre autres composé un chant à la paix intitulé « l’année prochaine » (bachana ha-ba’a) que chaque israélien connait par cœur, ainsi que la chanson qui remporta l’Eurovision en 1978. Il a effectivement écrit le poème « Je n’ai pas d’autre pays » en 1982, lequel, dans le contexte de la critique de la première guerre du Liban, fut mis en chanson et connut un succès populaire considérable. Mais la notoriété de Manor ne déborda jamais le cadre de l’État d’Israël. La gauche israélienne mobilisa la chanson pour pleurer l’assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin en 1995, tandis que la droite l’a exploitée pour s’opposer à l’évacuation de la bande de Gaza en 2005. Le texte vient à l’esprit de l’Israélien qui déplore que son pays « a changé de visage », d’une manière ou d’une autre. Et il est supposé transposable à quiconque « a un seul pays », comme l’atteste son appropriation enthousiaste par Nancy Pelosi.
Des confidences faites à l’agence de presse Jewish Telegraph Agency (ici et ici), venues de proches conseillers de Pelosi, ont attiré l’attention sur la petite histoire qui la conduisit à cette citation. Invitée en décembre 2016 à une réunion annuelle de dirigeants politiques et de la sécurité nationale israéliens et américains, la leader de la minorité démocrate à la Chambre des États-Unis d’alors, était assise à côté d’Isaac Herzog, son homologue, le chef du Parti travailliste et de l’opposition à la Knesset, l’actuel président de l’État d’Israël. S’engagea une discussion sur la défaite électorale — celle redoutée de Hilary Clinton face à Trump, celle de Herzog face à Netanyahu quelques mois plus tôt. C’est alors que Pelosi griffonna pour mémoire les quelques mots sur une serviette, « Je n’ai pas d’autre pays », que Herzog lui souffla. Plus tard, elle chargera un de ses assistants d’obtenir de Herzog le poème dans sa totalité. Herzog le lui envoya en mai 2017, lui précisant que le poème permet d’apaiser les douleurs de celui qui voit son pays dangereusement dériver. Depuis, Pelosi, emballée, le citera souvent, jusqu’à son discours devant le Congrès. La circulation de la citation de l’espace israélien à l’espace américain se fait visiblement en toute fluidité.
Cette fluidité tient à notre tradition critique partagée, telle qu’elle s’est consolidée en Europe. « Le véritable exil n’est pas d’être arraché de son pays, c’est d’y vivre et de n’y plus rien trouver de ce qui le faisait aimer », écrit Edgar Quinet alors qu’il quitte la France après le coup d’État de Louis Napoléon Bonaparte en 1851. Le véritable exil est donc intérieur, il procède du sentiment d’être aliéné de son propre pays, de la douleur de ne plus pouvoir l’aimer. Intérieur, l’exil l’est en ce sens que l’éloignement n’obère en rien la relation exclusive avec le pays dont on s’est temporairement éloigné. En somme, il n’y a dans cette tradition critique aucune échappée de son propre pays, même en cas de désamour.
Soumission de Michel Houellebecq a donné à cette fatalité une expression remarquable. L’amie du narrateur l’informe qu’elle quitte la France pour Israël. Plus tard, elle lui annonce laconiquement « J’ai rencontré quelqu’un », en guise de rupture. Dépité, le narrateur commente : « quelqu’un », c’est toujours « quelqu’un d’autre que moi » ; comme si, absolument insignifiant, il n’était personne. Le voilà doublement abandonné : son amie le quitte pour quelque part, puis pour quelqu’un. Esseulé, le narrateur constate laconiquement : « il n’y a pas d’Israël pour moi ».

Est-ce dire que le poème de Manor « je n’ai pas d’autre pays » aurait pu venir à l’esprit du narrateur de Soumission, s’il l’avait connu ? Assurément, non, du moins pas dans le sens qu’y mettait Nancy Pelosi. Car ici, le narrateur ne dit pas qu’il n’a qu’un seul pays mais qu’il n’en a pas d’autres, ce qui change tout. Certes, son pays, la France, change aussi de visage, mais lui, quitté par son amie, se retrouve confronté à une alternative ; une alternative qui cependant ne vaut pas pour lui. Or, la tradition critique d’origine européenne, d’Edgar Quinet à Nancy Pelosi, ne pose aucune alternative : leur pays est le leur, qu’il ait changé de visage ou pas. Ou plutôt : même s’il prend un visage répulsif, il demeure le leur. Précisément, lorsqu’il dérive, qu’il ne ressemble plus à ce qu’il était, qu’il n’est plus fidèle à lui-même, qu’il ne mérite plus l’amour qu’il inspirait, la tradition critique pose son diagnostic en demeurant rivée au seul pays que l’on ait, telle une réalité sans échappatoire.
Le narrateur de Soumission voit partir son amie, mais lui reste sur place. Dans cette stase gît son affinité avec le poème de Manor. Car le poème de l’israélien Manor « Je n’ai pas d’autre pays » ne se comprend que si on le replonge dans le contexte de l’État d’Israël qui a aboli le passé juif ou du moins, a vocation à le faire. Manor évoque, tacitement, une expérience antérieure : l’expérience des juifs d’Europe, structurellement ouverte aux alternatives. Demeurer quelque part, dans un pays, fut-ce dans son propre pays, équivalait toujours, pour eux, à y rester. Et « rester » signifiait « se poser, se reposer » (to rest, en langue anglaise, ce qui implique d’être en chemin), donc ne pas partir, ne pas encore partir. Les juifs formaient traditionnellement, et pour certains encore toujours, à jamais, un peuple-invité, un Gastvolk, selon l’expression de Max Weber, partout où ils se posent. Ils résident sous condition, de sorte qu’ils sont aussi virtuellement sur le départ. Avec la modernité politique, avec l’émancipation des juifs en Europe, cette structure s’effaça mais demeura latente, même pour ceux des juifs qui devinrent citoyens des États-nations. Désormais, ils étaient réputés, comme tout individu nationalisé, tout citoyen, n’avoir qu’un seul pays. Avec l’émancipation, le poids de la condition juive s’atténuait, mais sans s’effacer complètement, toujours ravivée qu’elle était par le doute jeté, de l’extérieur, sur l’appartenance pleine et entière des juifs à leurs nations respectives.
Ne pas avoir ou ne plus avoir un autre pays
Le narrateur de Soumission, pour parvenir à son constat, dut en venir à penser préalablement l’alternative, même si elle n’est pas praticable. Cette alternative est figurée par son amie qui lui annonce son départ. L’alternative lui vient à l’esprit dans le contexte d’un éloignement qui augure d’une rupture amoureuse. Et c’est cette rupture qui fissure ce rapport simple, direct, à son pays, qui, dès lors, ne va pas de soi, pour lui non plus. L’expérience du narrateur s’avère commune puisque le départ de juifs de France pour Israël est désormais de notoriété publique, répercutée dans les médias. Dès lors, il s’avère que le narrateur de Soumission se tient plus près de l’expérience de Manor que de celle qui alimente la tradition critique européenne. En tout cas, il exhume la dimension presque implicite du poème de Manor qui échappe à Nancy Pelosi. Abandonné, il l’exprime avec cette nonchalance détachée qui néanmoins laisse transparaître une différence.

Rester : l’expérience juive fait de l’immobilité une option. Par contraste, la tradition critique européenne conçoit l’immobilité comme un destin. Le sionisme, précisément, se voulait un passage de l’un à l’autre : il œuvrait à refermer volontairement et définitivement l’alternative. Désormais, le juif, comme chacun, n’aura plus d’autre pays, puisqu’il aura le sien. Il n’en aura pas d’autres que le sien, l’État destiné aux juifs. Manor, le juif nationalisé dans son Etat s’étonne encore de ce qui lui arrive : ce n’est pas seulement qu’il n’a pas d’autre pays, mais qu’à présent il n’en a plus d’autres. Or, ne plus en avoir, suppose qu’il transporte le souvenir de l’alternative. La condition juive est surmontée mais la mémoire de l’expérience juive qui prévalait antérieurement est sauvegardée. La territorialisation étatique des juifs affecte alors aussi leur carte mentale. Tel est le sens de la poésie de Manor, que l’Israélien comprend immédiatement, spontanément. « Je n’ai pas d’autre pays » renferme une expérience de l’alternative qui est désormais hors de portée dans l’État destiné aux juifs, pour le meilleur et pour le pire. Cette transformation historique étant toute récente, elle peut encore se vivre et s’exprimer sur le mode de l’étonnement. « Je n’ai pas d’autre pays » signifie alors qu’il n’y a pas de retour possible vers le pays que l’on a quitté lorsque l’alternative était opérante, même si l’État juif change de visage.
Prononcé par Nancy Pelosi, « Je n’ai pas d’autre pays » exprime simplement l’inquiétude de celui qui déplore que son pays change de visage. Elle n’est pas affectée par une pensée de l’alternative. Herzog confirma Pelosi dans cette interprétation superficielle. Est-ce dire qu’il savait que les paroles qu’il lui instilla contiennent un sens sans pertinence aucune pour la leader de l’opposition démocrate à la Chambre ? Ou bien ce sens lui a-t-il aussi échappé, tant ce sabra, député travailliste — fils du sixième président de l’État d’Israël et arrière-petit-fils du grand rabbin ashkénaze de Palestine, puis de l’État d’Israël — est lui-même un produit de la transformation historique destinée à rendre l’expérience juive inaccessible ? On peut supposer que Herzog, élu entretemps Président de l’État, souffla la poésie à Pelosi en sachant que le sens littéral de « je n’ai pas d’autre pays » lui suffirait à toute fin pratique.
« Il n’y a pas d’Israël pour moi »
Mais le narrateur de Soumission, quitté par son amie, dispose d’une connaissance latérale de cette transformation de l’expérience juive. Il voit partir son amie. Il la voit choisir. Il nous fait décrocher du sens obvie de la citation. Il est le spectateur d’un mouvement de sécession. « Il n’y a pas d’Israël pour moi » : telle est la manière tragicomique dont une différence, souvent imperceptible, qui sépare juif et non juif en Europe, s’exprime dans la conjoncture actuelle. Cette différence de condition, ce léger décalage, qui distingue le juif de ses autres concitoyens, longtemps considéré comme une injustice résiduelle, apparait soudain comme un privilège. Traditionnellement, les juifs étaient privés de la certitude de n’avoir aucune alternative. L’exil est une condition inconfortable. Ils étaient toujours virtuellement sur le départ. Et la persistance d’une pensée de l’alternative était corrélée aux ratés de l’émancipation. À présent, le non-juif fait l’expérience d’être privé d’une alternative, sur le mode du regret. Dans la crise, il voit le juif activer le levier de l’alternative, mais cette dernière ne vaut pas pour lui. « Il n’y a pas d’Israël pour moi » : telle est cette manière singulière dont la pensée critique européenne se rapporte désormais aux juifs.

Ceci ouvre sur une curieuse dialectique européenne. L’alternative existe, elle se dresse devant le narrateur de Soumission, mais elle ne vaut pas pour lui. L’ouverture d’une faille où s’engouffrer est perceptible, mais pas praticable, ou, pour reprendre les mots du narrateur, pas praticable pour quelqu’un. Cette impossible possibilité, celle de partir, est-elle alors le legs des juifs à l’Europe ? Dans un sens élémentaire, ce serait l’inverse : l’État d’Israël, fondé comme un refuge pour ceux des juifs qui fuyaient l’Europe, procède de la crise de l’État en Europe. L’État d’Israël serait alors plutôt un legs involontaire, heureux ou malencontreux, selon les opinions, de l’Europe aux juifs. Mais alors, la condition des juifs n’est évaluée ici que dans sa dimension de départ potentiel : avec la naissance de l’État réputé leur être destiné, les juifs ont un pays où partir — un pays qui sera le leur, sans alternative, affirme la doctrine sioniste. Pourtant, le narrateur de Soumission pointe vers une autre possibilité, celle de rester. « Rester », au sens donné ici, n’est plus un état de stase. Rester prend le sens d’une mobilité entravée. Et elle met tout le monde, juif et non juif, en mouvement. Soit que l’on soit obligé de rester parce que l’on n’a pas où partir. Soit que l’on choisit de rester, de demeurer dans son pays avec la claire conscience que ce geste implique la possibilité non-remplie d’un départ.
« Mon pays a changé de visage », associé à la clause « je n’ai pas d’autre pays » transforme alors la condition des Européens. L’Europe n’est pas seulement potentiellement quittée, abandonnée à elle-même. Les Européens, juifs et pas juifs, partagent désormais une condition commune, en doutant qu’ils aient un seul pays. L’Europe éprouve ce décalage de soi à soi, jadis réservé aux juifs. La chrétienté avait spiritualisé Jérusalem, elle était aimantée par le « Royaume du ciel », et lorsque la sécularisation évida le ciel, l’Europe se riva à sa terre, à son pays. Les juifs d’Europe sauvegardèrent un regard vers la Jérusalem mondaine, qu’aucune sécularisation ne pouvait vider, ce qui favorisa une pensée du dédoublement virtuel de son destin. L’État juif n’en est que le produit moderne, partiellement fortuit, parmi d’autres alternatives. En déplorant qu’il n’y ait pas d’Israël pour lui, le narrateur, déboussolé, exprime alors un manque, que tous éprouvent désormais, les juifs depuis toujours, les autres Européens depuis peu. L’avantage relatif des juifs, c’est qu’à force de l’éprouver dans l’urgence, ce manque fut institutionnalisé sous la forme d’un État, qui, lui, leur est destiné, à eux seuls.
Danny Trom
Notes
| 1 | Nancy Pelosi citant Ehud Manor devant le Congrès américain : |