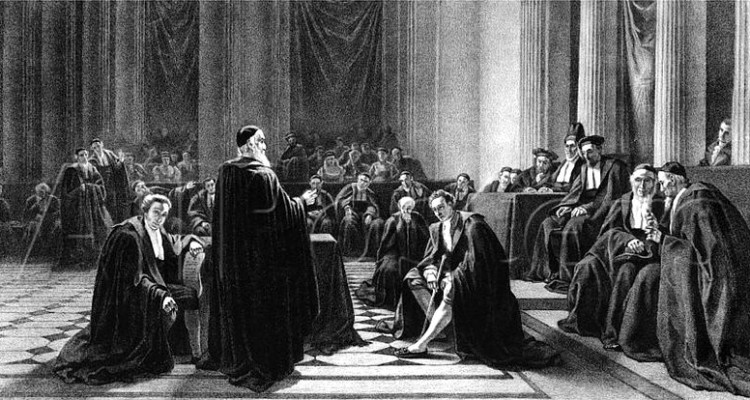En février dernier, Gabriel Abensour se désolait dans nos colonnes d’un désarroi du franco-judaïsme, déplorant sa tiédeur et l’oubli de ses héritages spirituels. Après David Haziza, c’est au tour de Julien Darmon de lui adresser une réponse amicale. Plutôt que de lorgner du côté du modèle allemand du XIXe, ou d’envier la diffusion des penseurs juifs anglo-saxons, ne ferait-on pas mieux d’apprécier et d’encourager la créativité intellectuelle du monde juif français, dans sa spécificité ?

Gabriel Abensour nous a, en février dernier, offert son regard sur l’état actuel du judaïsme français et sur les racines profondes de l’ignorance de son double héritage, à la fois français et sépharade. Les multiples réactions que son texte a suscitées, notamment la réponse de David Isaac Haziza dans ces mêmes pages, mais aussi les multiples commentaires et partages en ligne, montrent à tout le moins qu’une partie des Juifs français contemporains n’est pas indifférente à cette question – ce qui est, en soi, un début de réfutation de ce « désarroi ». L’équipe de la Revue K m’a fait l’honneur de me proposer de réagir à mon tour ; acteur engagé dans une réflexion prospective sur l’avenir du judaïsme français et européen, modeste cheville ouvrière de l’Histoire juive de la France dirigée par Sylvie Anne Goldberg et parue aux Éditions Albin Michel en octobre 2023, je ne pouvais que répondre positivement à cette invite.
Un constat largement partagé
Le texte de Gabriel Abensour mérite d’être analysé dans son argumentation. Il s’articule en deux parties : le constat et l’explication. Le constat est le suivant : le judaïsme français s’inscrit dans la continuité de deux héritages, celui du franco-judaïsme représenté par « Joseph Salvador, Salomon Munk, Lazare Wogue et Zadoc Kahn » et, à un siècle d’écart, « André Neher, Léon Ashkénazi et Emmanuel Levinas », d’autre part, celui de la culture sépharade ou maghrébine dont le parangon est pour lui Rabbi Yossef Messas ; mais, écrit-il, « il suffit de se pencher sur les jeunes générations pour constater que quelque chose s’est brisé dans la chaîne de transmission. Ni le franco-judaïsme, ni le judaïsme sépharade ne se transmet en France, encore moins le fruit béni de leur union.
Ce qui nourrit le judaïsme français contemporain, c’est principalement un judaïsme importé d’ailleurs, tant d’un point de vue géographique avec Israël que culturellement avec l’ultra-orthodoxie d’Europe de l’Est. L’apport extérieur en lui-même n’est pas nécessairement problématique. Les différentes communautés juives ont toujours communiqué, échangé et se sont enrichies mutuellement. Cependant, la condition préalable à une intégration réussie de cet apport extérieur est une identité préexistante solidement ancrée. C’est là que le judaïsme français contemporain semble faillir. Amnésique par rapport à ses propres héritages français et sépharades, il ne détient plus que des fragments de mémoire, auxquels s’ajoutent des emprunts greffés de manière plus ou moins abrupte. »
Ce constat, nous sommes nombreux à le partager. Là où je me permettrais d’exprimer un désaccord avec Gabriel Abensour, c’est sur l’analyse des causes de cet état de fait.
La première tiendrait, selon lui, à la « tiédeur », au « manque d’audace » d’un judaïsme consistorial au XIXe siècle, dont l’hégémonisme conciliateur aurait étouffé tout débat d’idées, à rebours du modèle allemand où l’émergence de judaïsmes réformé, conservative et néo-orthodoxe aurait stimulé le débat d’idées et produit ainsi des œuvres qui continueraient d’irriguer la vie juive contemporaine. La seconde serait à chercher dans un refoulement colonial de l’héritage sépharade au profit d’une « soumission totale à l’ultra-orthodoxie ashkénaze ». Ces deux aspects sont largement indépendants et méritent un traitement différencié.
La grande différence entre la France et l’Allemagne au XIXe siècle, c’est que les juifs de France sont pleinement émancipés et peuvent exercer leurs talents dans les institutions publiques, quand les juifs allemands sont encore tenus en marge de l’Université.
Le franco-judaïsme est-il trop mou ?
Concernant le premier point : l’apathie d’un franco-judaïsme consistorial en regard du vigoureux pluralisme germanique. Cette analyse est très critiquable. Tout d’abord, comment concilier cette accusation avec la mention déjà évoquée des figures de « Joseph Salvador, Salomon Munk, Lazare Wogue et Zadoc Kahn », auxquelles on pourrait adjoindre bien d’autres noms, comme Samuel Cahen et Godchaux Weil, voire, en élargissant un peu la focale, James et Arsène Darmesteter ou encore les frères Reinach ? La grande différence entre la France et l’Allemagne au XIXe siècle, c’est que les Juifs de France sont pleinement émancipés et peuvent exercer leurs talents dans les institutions publiques, quand les Juifs allemands sont encore tenus en marge de l’Université. De fait, à cette époque, on constate une compénétration entre les milieux savants et rabbiniques en France alors que ceux-ci restent bien distincts en Allemagne – et, a fortiori, en Europe de l’Est. Alors oui, la France « produit » sans doute moins de grandes figures rabbiniques, elle n’a pas son Rav Shimshon Raphael Hirsch. Mais elle n’a pas à rougir de ses grands savants, lesquels, en outre, se montrent très actifs dans l’aide apportée aux Juifs opprimés dans le monde entier, que ce soit à travers le réseau d’écoles de l’Alliance israélite universelle ou par les voies diplomatiques, notamment à l’occasion de l’affaire Mortara ou de l’affaire de Damas. Soit dit en passant, j’ai du mal à comprendre dans quelle mesure Gabriel Abensour peut glorifier l’éclatement du judaïsme allemand en dénominations réformée, orthodoxe, etc., qu’il compare favorablement à la culture du « compromis permanent » qu’il attribue au judaïsme consistorial et, dans le même temps, déplorer depuis des années le sectarisme du monde harédi ashkénaze et lui préférer une prétendue « souplesse » du rabbinat sépharade. Mais passons.
Au demeurant, la France de la fin du XIXe siècle n’est pas hermétique aux évolutions venues d’outre-Rhin. Plus encore, l’intégration de l’Alsace et de la Moselle au Reich entre 1870 et 1918 fait de ces régions une voie de passage pour la néo-orthodoxie et, au-delà, initie une communication plus large avec le judaïsme d’Europe centrale et orientale. Un bon exemple de cette prégnance est le parcours d’Ernest Weill (1865-1847). Alsacien, ayant donc connu une jeunesse allemande, il se forme au Hildeseimer Seminar de Berlin où la doctrine de Torah im Derekh Eretz de Rav Shimshon Raphael Hirsch est pour lui une révélation qui orientera toute sa vie. Il soutient à l’université de Strasbourg une thèse portant sur le commentaire en arabe de Maïmonide au traité Berakhot de la Mishna, sous la direction de Theodor Nöldeke, éminent spécialiste du Coran. Nommé Grand Rabbin de Colmar par le Consistoire après la Première Guerre mondiale, il cherche dès 1932 à créer une yéchiva en France et sollicite le plus grand talmudiste de son temps, le Lituanien Rabbi Elhanan Wasserman, pour qu’il lui envoie un directeur de yéchiva. Celui-ci lui dépêche son fils Simha Wasserman, auquel succède bientôt Rav Chaim Yitzchak Chajkin, élève du Hafets Haïm. Face à la menace de l’invasion nazie, la yéchiva déménage à Aix-les-Bains et sera après-guerre l’un des points nodaux de la reconstruction du judaïsme européen. En quoi un tel parcours n’est-il pas exemplaire d’un franco-judaïsme auquel ni la yéchiva, ni l’université ne sont étrangers ?

Ne pas mélanger les époques
L’un des problèmes majeurs de l’analyse de Gabriel Abensour est qu’elle mêle indistinctement des époques très différentes. Ce que j’ai dit du dynamisme du modèle consistorial s’étiole, il faut le reconnaître, dans les premières décennies du XXe siècle. Pourtant, ce n’est pas faute d’un manque de pluralisme, puisque la loi de 1905 permet précisément la création de communautés non consistoriales, notamment réformées. Seulement, ce modèle a fait son temps, et l’on voit émerger d’autres formes de religiosité et de pensée juives, dont les figures marquantes sont André Spire, Edmond Fleg et Robert Gamzon. Là aussi, l’audace intellectuelle, pour datée qu’elle puisse paraître aujourd’hui, n’a rien ou presque à envier à celle d’un Buber ou d’un Rosenzweig (qu’il serait fort abusif de dépeindre en héritiers du modèle hirschien au seul motif qu’ils sont comme lui allemands) et s’exprime naturellement dans un activisme associatif (les EIFF, pour ne citer qu’eux).
L’hégémonisme culturel des mêmes judaïsmes américain et israélien n’explique-t-il pas l’obscurité dans laquelle a été rejetée la tradition judéo-française, bien plus que de prétendues tares intrinsèques à cette dernière ?
Ces intellectuels juifs engagés, au nom et de l’esprit juif et des valeurs françaises, jouent un rôle essentiel dans la résistance tant armée que spirituelle sous l’Occupation et Vichy. Les maîtres de la génération suivante, celle de l’après-guerre, les Gordin, Levinas, Manitou, Amado Levi-Valensi, Neher, Chouraqui, etc., en sont les héritiers directs. Dans les années 1940 à 1970, le rabbinat ne se montre pas en reste, créant des collections éditoriales telles que Les Chantiers du Rabbinat ou encore Présences du judaïsme afin de traduire en français le commentaire de Rashi et la Mishna, mais aussi les œuvres de Levinas et de tous les courants de la pensée juive, sans oublier La Voix de la Torah d’Elie Munk. Il serait sans doute fastidieux de continuer à dérouler ainsi le fil de ces générations de penseurs juifs français jusqu’à Benny Levy, Charles Mopsik et bien d’autres dont nous sommes les élèves directs.
Je pense avoir suffisamment démontré que le monde juif français a sans cesse fait preuve de créativité intellectuelle. Certes, celle-ci s’est peut-être moins souvent exprimée dans un cadre strictement rabbinique que son homologue allemand ; est-ce une raison pour la disqualifier ? En réalité, j’oserais dire que Gabriel Abensour souffre d’un biais qu’il connaît pourtant bien : celui de mesurer la qualité et l’authenticité d’une culture juive à l’aune de critères rabbiniques, et même orthodoxes, voire ashkénormatifs. Certes, le commentaire de Rav Shimshon Raphael Hirsch a eu l’heur d’être traduit d’allemand en hébreu et a intégré le canon orthodoxe ; plus généralement, le patrimoine intellectuel juif allemand a rayonné aux États-Unis et en Israël plus que les œuvres du franco-judaïsme. Mais n’est-ce pas en bonne partie parce que les Juifs allemands fuyant le nazisme ont ensemencé les judaïsmes américain et israélien, alors que les intellectuels juifs français sont largement restés en France ? Et l’hégémonisme culturel des mêmes judaïsmes américain et israélien n’explique-t-il pas l’obscurité dans laquelle a été rejetée la tradition judéo-française, bien plus que de prétendues tares intrinsèques à cette dernière ? En dernière analyse, présenter le modèle consistorial puis celui de l’intégration des Juifs à la vie intellectuelle française comme une assimilation, comme une compromission, n’est-ce pas reprendre à son compte, de manière non critique, le portrait qu’en a toujours dressé une ultraorthodoxie à vocation elle aussi hégémonique ?
La nostalgie des orangers
Venons-en au second point, celui d’une occultation de l’héritage sépharade, victime d’un traitement colonialiste de la part des ultraorthodoxes ashkénazes. Là aussi, il convient de fortement nuancer. Dès l’abord, cela ne fait pas grand sens de parler pêle-mêle d’un judaïsme sépharade allant de 1492 à 1962 et du Maroc à Salonique (pour ne reprendre que des lieux explicitement mentionnés par Gabriel Abensour). Contre une longue durée qui gomme les causes efficientes, j’insisterais sur une lecture serrée dans le temps comme dans l’espace. Entre les années 1830 et 1960, c’est-à-dire l’époque de la colonisation, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie connaissent des situations politiques et communautaires très différentes. Le Maroc garde très longtemps des structures rabbiniques fortes et des traditions religieuses distinctes ; en outre, dès avant la Seconde Guerre mondiale, il voit s’implanter des « yéchivot », en réalité des établissements secondaires religieux, où l’influence de l’orthodoxie d’Europe orientale est très prégnante et déterminera après-guerre la trajectoire de nombre de ses représentants. Le judaïsme d’Algérie est avant la conquête française dans un état déplorable, et ses rabbins accueillent majoritairement les Français avec enthousiasme : c’est pour eux l’avènement d’un État de droit qui met fin à l’arbitraire du Dey. Il connaît ensuite peu ou prou la même évolution sociologique et intellectuelle que le judaïsme de la métropole. La Tunisie, enfin, est beaucoup plus en lien avec les maîtres rabbiniques d’Erets Israël, et, sociologiquement, c’est une communauté bien moins nombreuse et plus modeste économiquement. Ces différences internes vont largement modeler des trajectoires divergentes.
Si l’on veut peindre à très grands traits la sociologie juive maghrébine de ceux qui font le choix de la France dans les années 1960, on pourrait identifier trois types. Un type « marocain », qui conserve une identité forte tout en adhérant sans réserve au modèle orthodoxe israélien qui émerge alors et sur lequel je reviendrai ; un type « algérien », pour lequel la judéité n’est somme toute qu’une variété particulière de francité ; et un type « tunisien », pour lequel la rupture avec la tradition d’origine est peut-être la plus forte, et qui va en plus forte proportion adhérer à une identité juive mondialisée, sous les espèces du mouvement Loubavitch. Rien n’est rigide, évidemment, dans cette typologie, et Aix-les-Bains comme Gateshead vont voir passer bien des bahourim algériens ou tunisiens, tout comme l’on rencontrera des Marocains chez les Loubavitch ; mais elle ne me paraît pas outrée.
Jusqu’à la fin des années 1960, on peut dire que le monde harédi israélien est finalement marginal : il existe, mais n’est pas perçu par l’ensemble du monde juif « religieux » comme un absolu et un idéal.
L’uniformisation du judaïsme sépharade sur le modèle orthodoxe ashkénaze, en France comme partout dans le monde d’ailleurs (ce qui suffit à battre en brèche cette idée d’une faillite spécifique du modèle français), survient dans un second temps, se massifiant surtout à partir des années 1980 voire 1990, et tient à un grand absent du texte de Gabriel Abensour : l’État d’Israël. Jusqu’à la fin des années 1960, on peut dire que le monde harédi israélien est finalement marginal : il existe, mais n’est pas perçu par l’ensemble du monde juif « religieux » comme un absolu et un idéal. À partir des années 1970, se met en place une série de changements qui vont le placer au centre du monde juif : la victoire de 1967 qui donne à l’État d’Israël une dimension messianique, donc religieuse ; les choix politiques de Begin, qui favorisent la massification de la société harédie, notamment en exemptant d’office de service militaire tous les bahourei yeshiva ; la massification concomitante des yéshivot, qui est corrélée à la massification des études supérieures partout dans les pays développés ; la facilité croissante, avec la démocratisation de l’avion, à voyager en Israël et à venir y étudier ; le « retour du religieux » consécutif à l’échec des grandes idéologies politiques ; et d’autres encore sans doute.
Tous ces facteurs expliquent comment un judaïsme français s’est structuré à la fin du XXe siècle sur le modèle d’une orthodoxie harédite israélienne qui est d’ailleurs, soit dit en passant, largement fantasmée. Je suis le premier à regretter qu’il n’ait pas su, à rebours des judaïsmes britannique et américain, inventer alors une orthodoxie sui generis, « à la française », alors même qu’il disposait pour cela d’une riche tradition intellectuelle, comme on l’a vu. On peut regretter notamment que les instances consistoriales aient fait le choix alors d’accompagner ce mouvement plutôt que de le modeler. Mais la solution n’aurait de toute façon pas été d’en appeler aux mânes d’un judaïsme maghrébin « souple » et « tolérant », datant de plus d’un demi-siècle et disparu, comme tout le monde d’hier, dans la tourmente de la guerre, de la décolonisation, de la mondialisation et de l’ultra-modernité. Pour le dire autrement, dans les années 1990-2000, il aurait fallu que nous nous montrions capables, non pas de renouer avec un passé, mais d’inventer un avenir. De fait, la génération de ceux nés en France s’est déjà employée, dans les vingt dernières années, à se réapproprier ce que les diverses traditions marocaines, algériennes et tunisiennes avaient à offrir de meilleur, par exemple dans l’étude minutieuse de la grammaire et de la poésie hébraïques.
Faut-il ressusciter le franco-judaïsme ?
Ceci posé, qu’il me soit encore permis de revenir, malgré la longueur du propos, sur le constat initial de Gabriel Abensour, dont je distingue à présent deux facettes : l’absence de rayonnement du judaïsme français et de ses œuvres à l’international, et la méconnaissance par les juifs français de ce riche patrimoine intellectuel.
Sur le premier point, il convient de nuancer. Si l’on élargit la focale au-delà de la littérature strictement rabbinique (encore qu’Elie Munk soit depuis longtemps traduit en anglais), il me semble que Levinas et Derrida, pour ne citer qu’eux, ne sont pas inconnus du public international, et que l’œuvre de Manitou connaît un début de reconnaissance en Israël. Pourrait-on aller plus loin ? Sans doute, mais tout est une question de rapports de force culturels : qu’il s’agisse d’œuvres juives ou non, il est beaucoup plus difficile de « vendre » des auteurs français à l’étranger que des auteurs américains ou anglais… Comment expliquer, sinon, que ni Benny Levy ni Charles Mopsik ne soient traduits en anglais ou en hébreu ?
Sur le second point, que dire ? Que les nouvelles générations sont ignorantes ? Mais n’est-ce pas vrai des nouvelles générations dans leur ensemble, juives ou non ? Ne subissent-elles pas toutes également les effets d’une déculturation générale, voulue par les pouvoirs politiques qui ne considèrent l’école que comme l’antichambre de l’entreprise ? Comment transmettre la richesse du patrimoine culturel français à des élèves auxquels on explique dans le même temps que les études servent à décrocher un métier qui rapporte le plus possible – avec, dans le cas de l’école juive, un vernis de pratique religieuse dont la fonction est avant tout identitaire ?
Il ne faudrait cependant pas croire que les responsables de l’éducation juive en France adhèrent à ce schéma délétère ; bien au contraire, lors des diverses présentations que j’ai pu faire d’Histoire juive de la France devant des directeurs d’école et des enseignants, tous déplorent le rapport consumériste des parents d’élèves et, conséquemment, de leurs enfants et tous rêvent de ressusciter un certain franco-judaïsme pétri de religiosité intelligente, d’horizons culturels larges et d’engagement citoyen. Pour autant, cet héritage des deux siècles passés, qu’il soit hexagonal ou maghrébin, n’est pas l’essentiel : c’est en regardant vers l’avenir, en définissant activement quel avenir, quelles valeurs nous voulons transmettre que nous deviendrons à notre tour les artisans de cette vie juive audacieuse que chacun appelle de ses vœux.

J’aurais également tendance à penser que la perspective de Gabriel Abensour est déformée par son point de vue géographique. Quand il nous parle de ce judaïsme français « torah-boxisé » (osons le néologisme accusateur), de qui exactement nous parle-t-il ? Où le rencontre-t-il ? Le fait est que ce judaïsme focalisé sur les minuties halakhiques, sur la recherche de la « petite bête » (littéralement), revendiquant une culture réduite aux fondamentaux, versant souvent dans la superstition, est avant tout présent sur les réseaux sociaux et dans les milieux harédis francophones en Israël. C’est essentiellement un mode de définition identitaire. Il est pourtant loin d’être exclusif, quel que soit l’espace sociogéographique que l’on considère. En Israël, même dans le monde religieux, il existe d’autres modèles, notamment du côté sioniste-religieux (qui a aussi ses travers, mais il ne s’agit pas de distribuer des bons et des mauvais points). En France, pays que je connais mieux tout simplement parce que j’y vis et que je suis familier de ses différents microcosmes, ce modèle Torah-Box est beaucoup moins dominant que l’effet loupe du cyberespace pourrait le laisser croire. Tout d’abord, il existe un très large monde juif qui, tout en étant pratiquant à divers degrés, se vit à l’écart de ce moule idéologique : c’est vrai non seulement des individus les plus progressistes, mais aussi d’un très large pan du « monde du limoud » qui en critique le simplisme. Cela n’empêche nullement les uns et les autres de profiter des services offerts par Torah-Box – horaires de shabbat, vente du hamets, que sais-je –, mais cela est loin de traduire une adhésion forte. Le judaïsme français, et singulièrement parisien, est fortement individualisé, et chacun fait un peu son marché dans l’offre de pratiques, de valeurs et de milieux, naviguant facilement – et souvent anonymement – de l’un à l’autre. Au demeurant, Torah-Box propose une diversité de contenus beaucoup plus large que la caricature à laquelle on réduit souvent le site, y compris des enseignements de haute qualité. À l’autre extrémité du spectre, Akadem est une présence forte sur la Toile. Il serait intéressant de pouvoir comparer les chiffres de fréquentation et d’engagement de l’un et l’autre site ; en attendant de disposer de tels éléments, on peut a minima arguer que le succès d’Akadem dément cette vision monolithique et déculturée du judaïsme français. En outre, il est abusif de parler d’un judaïsme français monolithique. Les réalités socio-économiques, le rapport à l’étude, à la culture générale, aux traditions locales sont sensiblement différents selon que l’on évolue à Paris, à Créteil, à Marseille, à Strasbourg, à Bordeaux, à Montpellier, à Metz ou encore à Thionville. Les besoins ne sont pas les mêmes, pas plus que les dynamiques.
Surtout, il existe une importante population de juifs pratiquants, attachés tout autant au respect de la halakha et à l’importance de l’étude de la Torah qu’aux valeurs de la modernité, à l’universalisme, à la littérature, à la philosophie et aux beaux-arts.
Certes, dans la mesure où l’idéologie harédie à l’israélienne est perçue comme dominante, les gens qui évoluent dans des milieux orthodoxes ne vont pas forcément faire étalage public de leurs désaccords de fond avec la vision du monde qu’elle propose, que ce soit sur l’aspect superstitieux des ségoulot, la vision inégalitaire de la femme, l’exaltation de l’avrekh qui n’a jamais travaillé, ou encore le refus de la culture universelle. En privé, je peux cependant témoigner que ceux qui marquent une forte distance critique avec ce modèle et avec ses diverses traductions dans l’espace communautaire français sont majoritaires, y compris chez les plus barbus d’entre nous. Je ne me berce pas non plus d’illusions : je sais bien que j’évolue moi aussi dans des milieux sociaux qui, pour être divers, n’en sont pas moins déterminés par mes affinités et mes prises de position semi-publiques ; je suis forcément amené à fréquenter plus souvent des gens qui pensent plus ou moins comme moi que ceux qui sont en désaccord radical avec mes opinions ; ceux qui vont venir me voir après une conférence, ce sont les premiers, pas les seconds. Mais je peux à tout le moins affirmer que les lignes de partage ne passent pas forcément là où on le croit. Surtout, il existe une importante population de Juifs pratiquants, attachés tout autant au respect de la halakha et à l’importance de l’étude de la Torah qu’aux valeurs de la modernité, à l’universalisme, à la littérature, à la philosophie et aux beaux-arts. Ils sont par nature moins visibles, parce qu’ils ne vivent pas cette modalité du judaïsme comme une passion identitaire, et il est vrai qu’ils peuvent parfois se sentir un peu seuls dans certaines synagogues ; pourtant, ils sont présents partout, qu’ils travaillent à leur propre compte, comme cadres dans des entreprises privées ou dans l’administration publique, à l’Éducation nationale ou dans des écoles juives, et même dans les yéshivot. Tout ce qu’il leur manque peut-être, c’est ce qu’on aurait appelé en d’autres temps une « conscience de classe ». On peut espérer que ce débat contribuera à la faire émerger.
Julien Darmon
Julien Darmon est responsable d’édition aux éditions Albin Michel ; il a notamment assuré la coordination éditoriale de l’encyclopédie Histoire juive de la France dirigée par Sylvie Anne Goldberg. Docteur de sociologie des religions à l’EHESS, il est également expert auprès de l’Alliance des civilisations de l’ONU sur les questions de dialogue interreligieux et de lutte contre l’antisémitisme. Il enseigne depuis une vingtaine d’années le Talmud et le Midrash, notamment dans le cadre de la Yéchiva des étudiants de Paris.