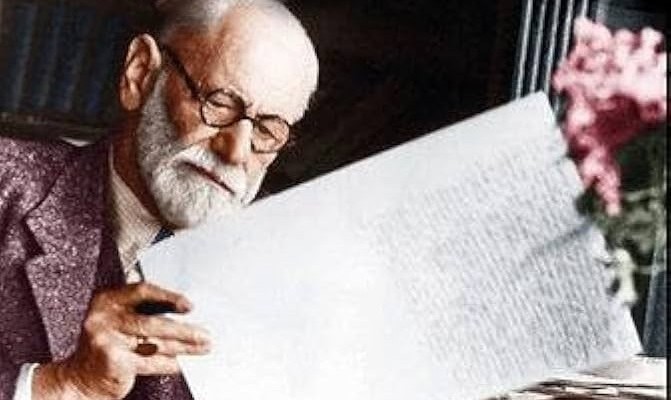Pour Gabriel Abensour, le franco-judaïsme serait oublieux de ses héritages spirituels. Déplorant l’adoption d’une ultra-orthodoxie qui rigidifie pratiques et esprits, et critiquant le manque d’audace des institutions représentatives de la communauté juive, il en appelle à renouer avec un judaïsme qui connait à la fois la valeur de l’universalisme révolutionnaire et la richesse intellectuelle de la civilisation sépharade.
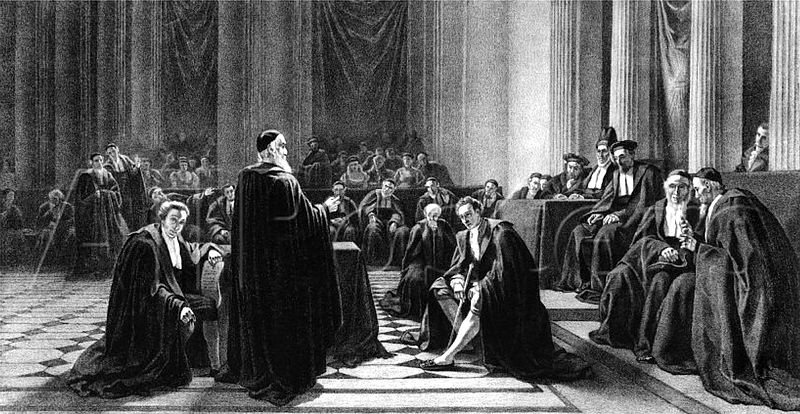
J’ai grandi à Strasbourg, au sein d’une des communautés juives les plus dynamiques du pays, dotée d’une ribambelle d’institutions, d’écoles, de synagogues et de lieux d’études. Malgré mes douze ans d’école juive, malgré ma fréquentation assidue des synagogues et des lieux d’études, j’ai quitté à dix-huit ans cette communauté, ce pays, avec le sentiment de ne rien laisser derrière moi. Il m’a fallu arriver en Israël pour découvrir non pas (uniquement) le judaïsme israélien, mais surtout ce qu’aurait pu être, ce qu’aurait dû être le judaïsme français de la fin du XXe siècle.
C’est en Israël, et en hébreu, que j’ai entendu parler pour la première fois de ce franco-judaïsme dans lequel on supposait que j’avais grandi. Un franco-judaïsme ayant vu dans la Révolution une incarnation de l’hébraïsme universel, ayant produit de nombreux érudits, rabbins et penseurs dont j’avais à peine entendu les noms en douze ans d’école juive. Qui se souvient de Joseph Salvador, Salomon Munk, Lazare Wogue et Zadoc Kahn ? Qui étudie encore leurs écrits ? Parmi les jeunes générations, même les noms des bâtisseurs du judaïsme français post-Shoah, tels qu’André Neher, Léon Ashkénazi et Emmanuel Levinas, sont bien moins connus que ceux de rabbins ultra-orthodoxes israéliens. C’est en Israël que j’ai eu la chance de rencontrer, puis de lire dans le texte Benjamin Gross. Il avait été le fondateur de l’école où j’avais passé ma jeunesse (école qui mériterait d’ailleurs de porter aujourd’hui son nom). Mais dans cette même école – de 1996 à 2006 – je n’ai jamais entendu un professeur citer son nom, encore moins enseigner l’un de ses textes.
Comme une bonne partie de mes coreligionnaires de France, mes racines n’étaient pas que françaises mais également sépharades et maghrébines. Malgré une conscience certaine des différences cultuelles et culinaires entre les ashkénazes et les sépharades, mon capital culturel symbolique demeurait toutefois assez limité. Je me souviens du jour où je découvris, sur l’étagère de la yeshiva où j’étudiais à Jérusalem, les livres du rabbin Yossef Messas (1892-1974), qui fut tour à tour grand rabbin de Tlemcen, Meknès et Haïfa. Alors que j’avais jusqu’à présent eu une conception très folklorique des sépharades, je fis brutalement la découverte d’un rabbin aux horizons intellectuels extrêmement larges, à l’esprit critique aiguisé, doté d’un esprit halakhique aussi pointu qu’audacieux. Je découvris ensuite, toujours en Israël, que le monde sépharade n’avait pas produit que des rabbins, mais également des poétes, des intellectuels, des activistes, des pionniers d’un sionisme anti-impérialiste, des maskilim et parfois des figures mêlant toutes ces qualités à la fois.

Le judaïsme français contemporain devrait trouver son origine dans ces deux courants distincts. D’un côté, un franco-judaïsme, ayant vu dans la Révolution une incarnation de l’hébraïsme universel. De l’autre côté, un judaïsme maghrébin, héritier direct de la riche civilisation sépharade. L’hybridation de ces deux courants a parfois engendré des personnalités remarquables, telles qu’Abraham Hazan, Éliane Amado-Lévy, Charles Touati, René Samuel Sirat ou Armand Abécassis. Dans un contexte moins religieux, on peut également citer des figures comme Albert Memmi, Jacques Derrida, Eliette Abécassis ou Valérie Zenatti. Mais il suffit de se pencher sur les jeunes générations pour constater que quelque chose s’est brisé dans la chaine de transmission. Ni le franco-judaïsme, ni le judaïsme sépharade ne se transmet en France, encore moins le fruit béni de leur union.
Ce qui nourrit le judaïsme français contemporain, c’est principalement un judaïsme importé d’ailleurs, tant d’un point de vue géographique avec Israël que culturellement avec l’ultra-orthodoxie d’Europe de l’Est. L’apport extérieur en lui-même n’est pas nécessairement problématique. Les différentes communautés juives ont toujours communiqué, échangé et se sont enrichies mutuellement. Cependant, la condition préalable à une intégration réussie de cet apport extérieur est une identité préexistante solidement ancrée. C’est là que le judaïsme français contemporain semble faillir. Amnésique par rapport à ses propres héritages français et sépharades, il ne détient plus que des fragments de mémoire, auxquels s’ajoutent des emprunts greffés de manière plus ou moins abrupte.
Le but de cet article est de tenter de comprendre les mécanismes qui empêchent les deux héritages du judaïsme français contemporain d’être transmis comme il se doit à la nouvelle génération. Dans cet article, je souhaiterais mettre de côté les explications conjoncturelles – l’antisémitisme, Israël ou la montée des communautarismes – au profit d’une réflexion ancrée dans les histoires modernes du franco-judaïsme et du judaïsme maghrébin, dans le but d’envisager un remède.
Un franco-judaïsme sans audace
Un constat : le franco-judaïsme des 19e et 20e siècles n’a pas d’héritiers spirituels et même sa continuité institutionnelle s’estompe d’année en année. Certes, les porte-paroles du judaïsme officiel aiment à rappeler sa mémoire. Quiconque a fréquenté les communautés juives de France, quelles que soient leurs affiliations, sait toutefois que ce judaïsme de façade ne représente plus guère même ceux qui le professent. Certains intellectuels déplorent discrètement cette situation. C’est le cas, par exemple, de Vincent Peillon et de Martine Cohen, qui regrettent à leurs manières l’agonie de ce franco-judaïsme. Quelques rares voix juives tentent de revitaliser un judaïsme à la française en cherchant à faire dialoguer pleinement une perspective juive avec les enjeux contemporains de la société. On peut citer, dans cette optique, des personnalités aussi différentes que le grand rabbin Gilles Bernheim ou le rabbin Delphine Horvilleur. Cependant, au sein de la majorité, l’ignorance prévaut. Les grands noms du judaïsme français postrévolutionnaire sont parfaitement inconnus des élèves des établissements confessionnels, tout comme de la vaste majorité des Juifs fréquentant les synagogues. L’héritage est bien là, mais désormais perdu, inconnu et inaccessible.
Pourquoi ce judaïsme a-t-il si peu de continuité ? Ma proposition, c’est que, malgré l’érudition de quelques-uns de ses membres, le franco-judaïsme a toujours adopté au niveau institutionnel une ligne conciliatrice et sans audace, ayant étouffé dans l’œuf tout mouvement de pensée un peu plus aventureux, susceptible de dépasser l’Hexagone. C’est là une constante dans l’histoire du peuple juif : seuls les auteurs, les idées et les mouvements dépassant les frontières qui les ont vus naître finissent par intégrer pleinement la mémoire juive. Or, dès l’émancipation reconfirmée par Napoléon, les juifs de France ont fait le choix d’un judaïsme centralisé et institutionnel, idéal pour ce qui relève de la représentation publique, mais asphyxiant pour les débats intellectuels trop novateurs.
Si cette voie du milieu a réussi à maintenir une certaine cohésion communautaire, il me semble qu’elle a également empêché un travail théologique et conceptuel sur la nature du judaïsme post-émancipation. Alors que de l’autre côté du Rhin se formaient des groupes de réformateurs radicaux et des groupes d’intellectuels conservateurs, en France l’essentiel de l’énergie était consacré au maintien d’une union religieuse de moins en moins stable, qu’on imaginait nécessaire à l’intégration pleine et entière des juifs à la République. Le prix de cette union de façade, me semble-t-il, a été le musellement des voix les plus audacieuses.
La proximité géographique et politique entre juifs français et juifs allemands permet à cet égard de mieux mettre en exergue les différences sur le long terme. Les mêmes débats traversaient les communautés des deux rives du Rhin au début du XIXe siècle. Au niveau structurel, à l’aube de l’émancipation, les juifs de France comme de Prusse ne pouvaient exercer leur culte que via la communauté organisée et reconnue officiellement. En France, on accepta docilement la création de ce judaïsme étatique et centralisé, qui perdurera d’ailleurs largement après la loi de 1905, marquant la fin de son hégémonie légale. En Allemagne ou en Hongrie, on lutta bien vite pour le droit d’établir des communautés indépendantes, orthodoxes, réformées ou néologues. En somme, ces luttes intestines entre des juifs de différentes tendances religieuses gardaient la trace de l’esprit du débat – de la mahloket – si cher au judaïsme traditionnel. Réformateurs et orthodoxes se lisaient les uns les autres, se menaient une lourde concurrence pour le cœur des fidèles et tentaient de surpasser sur le plan spirituel et intellectuel le mouvement adverse.

Le résultat fut un judaïsme en perpétuelle émulation, qui en un siècle arriva à produire une ribambelle de penseurs, de rabbins et d’institutions dont le rayonnement perdure bien après l’éradication de ce judaïsme par le régime nazi. L’exégèse d’un rabbin orthodoxe comme S. R. Hirsch, bien que rédigée en allemand, reste l’une des plus étudiées au sein du judaïsme contemporain. Le séminaire rabbinique orthodoxe de Berlin, le séminaire positivo-historique de Breslau ou encore la Hochschule du mouvement réformé allemand ont disparu depuis longtemps et ont pourtant posé les bases de nombreux séminaires rabbiniques à travers le monde. C’est à ces écoles que se réfèrent encore des millions de juifs s’identifiant comme orthodoxes, massortis ou réformés. Des penseurs comme Herman Cohen, Franz Rosenzweig ou Martin Buber sont régulièrement réédités en allemand, anglais ou hébreu et continuent d’alimenter la pensée juive contemporaine.
Du côté français, la conciliation entre réformateurs et conservateurs débouchait sur des compromis permanents, créant un judaïsme fade et tiède n’encourageant pas la créativité intellectuelle. À gauche, on étouffait les réclamations réformatrices en autorisant quelques maigres modifications au sein du culte, comme l’usage de l’orgue à la synagogue. À droite, on cherchait à apaiser les craintes orthodoxes en évitant toute décision trop audacieuse. Il semble que, dès cette époque, le franco-judaïsme consistorial s’était résigné à la place qu’on lui connaît aujourd’hui. Pas assez novateur pour les réformateurs, pas assez traditionnel pour les orthodoxes, il se trouvait simplement en mesure de jouer un rôle représentatif.
Et quid de la tradition sépharade ?
Les transformations de nombreux Juifs sépharades en ultra-orthodoxes calqués sur le modèle ashkénaze d’Europe de l’Est ont déjà été documentées par de nombreux sociologues israéliens. Certains, comme Yaakov Lupo, se sont même penchés sur le cas des communautés sépharades ayant immigré en France. Les sépharades des dernières décennies se sont fortement orthodoxisés, sans avoir pour autant trouvé de solution durable à leur désarroi spirituel qui perdure depuis plus d’un siècle. Ce désarroi se manifeste par des mutations religieuses permanentes, d’une décennie à l’autre. Ainsi, alors que le sionisme religieux à la manière de Manitou et le modèle Loubavitch étaient en vogue au début des années 70, ils ont rapidement été concurrencés par l’implantation d’une orthodoxie lituano-sépharade. Ces dernières années, c’est au contraire le mouvement Breslev et sa théologie hassidique parfaitement adaptée à l’esprit post-moderne de notre époque qui gagnent du terrain.
Là encore, plutôt que d’adopter un regard sociologique se focalisant uniquement sur les dernières décennies, j’aimerais proposer quelques réflexions basées sur la longue durée. Ma thèse principale est qu’inconsciemment ou non, les préjugés colonialistes européens à l’égard de l’Orient se sont rapidement enracinés au sein des populations juives ashkénazes dès le début du XIXe siècle, y compris au sein du monde ultra-orthodoxe (s’imaginant souvent à tort comme moins réceptif aux influences extérieures). L’instauration de rapports coloniaux entre ashkénazes et sépharades dès le début du XIXe siècle eut une double incidence. D’une part, cela mena à la marginalisation, voire à l’invisibilisation, de la contribution des sépharades aux développements du judaïsme au cours des derniers siècles. D’autre part, cela engendra progressivement une aliénation de leur propre culture et de leurs traditions, au point où eux-mêmes se laissèrent souvent convaincre de la vacuité de leur propre religiosité au profit du modèle orthodoxe ashkénaze.
Ainsi, dès le XIXe siècle, on note que de moins en moins de rabbins orthodoxes ashkénazes citent les écrits de leurs contemporains sépharades. Au début du XXe siècle, cet effacement est devenu effectif, et jusqu’à nos jours, il est extrêmement rare de trouver un décisionnaire ashkénaze citant l’œuvre d’un rabbin sépharade des derniers siècles. En revanche, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, les ouvrages de rabbins orthodoxes contemporains sont cités presque immédiatement après leur publication, toujours avec le plus grand respect.
Cet effacement n’est évidemment pas limité aux cercles ultra-orthodoxes. Récemment, j’ai publié une correspondance révélatrice à ce sujet entre le grand rabbin d’Oran, David Askénazi (qui sera également le dernier grand rabbin d’Algérie), et le grand rabbin de la Palestine mandataire, Abraham Isaac Kook[1]. Askénazi était un rabbin abreuvé à la fois des traditions sépharades locales et du franco-judaïsme importé en Algérie depuis la colonisation. Kook, quant à lui, est considéré comme l’un des pères spirituels du sionisme religieux, connu aussi bien pour sa vaste érudition que pour sa liberté de pensée et son ouverture d’esprit.
En 1932, Kook avait rédigé un responsum condamnant l’usage de l’orgue dans la grande synagogue d’Oran. L’interdiction en soi n’était pas surprenante pour un rabbin orthodoxe. Cependant, ce responsum a suscité la colère du jeune Askénazi, qui y voyait – à juste titre selon moi – le symptôme d’un problème bien plus systématique. Dans une lettre virulente, Askénazi dénonçait tour à tour trois points principaux, qu’il n’attribuait pas qu’à Kook en tant qu’individu, mais bien à l’ensemble du rabbinat ashkénaze. Ces trois points, me semble-t-il, dépassent largement la question initiale de l’orgue à la synagogue et dénoncent avec brio les biais coloniaux étrangers à la tradition juive et pourtant bien présents dans les rapports entre ashkénazes et sépharades.
- La négation de l’agency des rabbins sépharades. Askénazi notait que contrairement à toutes les règles de la tradition rabbinique, Kook se permettait de prendre une décision concernant une communauté étrangère sans prendre la peine de consulter ses rabbins. Cette attitude laissait clairement entendre que les rabbins locaux n’étaient pas capables de gérer leurs communautés et avaient besoin de ce que l’on appelle aujourd’hui communément un « white savior » – un rabbin ashkénaze pour les guider. Ce phénomène se produit encore de nos jours, y compris au sein du judaïsme orthodoxe français, ayant intégré l’idée (moderne) selon laquelle il existerait des « Guedolim », sorte d’autorités halakhiques transnationales. Ces guedolim sont évidemment presque toujours des rabbins israéliens ultra-orthodoxes ashkénazes, ou quelque fois des rabbins d’origine sépharade modelés à leur image. Et pourtant, de nombreux dirigeants communautaires français estiment logique que des décisions cruciales soient prises par des rabbins n’ayant jamais quitté Bné-Brak, plutôt que par des autorités locales conscientes des enjeux communautaires.
- L’universalisation du judaïsme ashkénaze. L’un des arguments centraux de Kook contre l’usage de l’orgue dans la synagogue était une excommunication célèbre déclarée par le rabbin hongrois Moshé Sofer en 1819. Askénazi soulignait à juste titre que si Sofer avait le droit d’agir comme bon lui semblait envers sa propre communauté, le simple fait qu’un rabbin ashkénaze ait banni l’orgue dans sa ville il y a plus d’un siècle ne suffisait pas à établir une règle universelle. Là encore, Askénazi ne faisait que dénoncer un biais typiquement colonial, présentant le point de vue européen comme universel, au détriment des cultures et traditions locales. Comme il le rappelait plusieurs fois à Kook, les sépharades avaient non seulement des rabbins capables de statuer pour leurs communautés, mais également des traditions herméneutiques et halakhiques n’ayant rien à envier à leurs coreligionnaires européens.
- Le mythe du déclin. Dans sa lettre, Askénazi mettait un point d’honneur à prouver la continuité spirituelle des communautés sépharades d’Afrique du Nord avec les sépharades de l’époque ibérique. On peut voir dans cette attitude une tentative de lutter contre un mythe encore bien ancré : celui du déclin des communautés sépharades après le décret d’expulsion de 1492. En réalité, la production intellectuelle, poétique, juridique et talmudique ne s’est pas arrêtée avec ce nouvel exil. Ce sont les descendants des exilés installés à Safed qui ont écrit une partie importante de ce qui constitue aujourd’hui la Kabbale. À Salonique, on a imprimé pour la première fois de nombreuses œuvres classiques, telles que le Talmud de Jérusalem, et on a rédigé des commentaires faisant toujours autorité. Au Maroc, la littérature halakhique a fleuri et a conservé une audace et une stature qui continuent de fasciner les chercheurs en droit hébraïque. À cette époque, les sépharades furent d’ailleurs les seuls à continuer l’étude de la langue hébraïque et à en faire des usages poétiques ou profanes, montrant la voie aux pionniers de l’hébreu moderne. Une fois encore, il me semble que ce mythe du déclin solidement enraciné n’est que le pendant du mythe similaire concernant les peuples d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie, offrant une justification pseudo-éthique à la colonisation.

Il faut souligner une fois encore que les rapports coloniaux entre Kook et les rabbins d’Algérie dénoncés par Askénazi n’avaient rien d’anecdotique, mais s’inscrivaient dans une logique systématique, intégrée dès la fin du XIXe siècle par les rabbins orthodoxes. On peut également citer à cet égard ce qu’écrivit en 1920 le rabbin Halpérin, qui fut le pionnier dans l’introduction d’un judaïsme orthodoxe ashkénaze au Maghreb :
« En Afrique du Nord, les Juifs sépharades ont besoin d’un soutien extérieur. Ils sont incapables de défendre eux-mêmes leur cause, leur système éducatif est au plus bas, sans ordre ni autorité… Pour qu’ils puissent penser, ils ont besoin d’Ashkénazes qui leur montreront la voie à suivre… Seul via le soutien ashkénaze ils pourront développer des capacités intellectuelles et une sensibilité susceptible d’améliorer leur condition[2]. »
L’attitude d’Halpérin n’était en rien différente de l’arrogance des envoyés de l’Alliance Israélite Universelle, avec lesquels il était pourtant en concurrence. Mais contrairement à eux, Halpérin jouissait d’un large soutien parmi les rabbins locaux, qui n’avaient absolument pas conscience du mépris qui était le sien pour leurs communautés et avaient par contre un véritable respect pour l’érudition religieuse.
Ces rapports coloniaux ont façonné la construction de deux groupes imaginaires, composés d’un côté de Juifs ashkénazes, représentants de l’érudition juive et de la religiosité authentique, et de l’autre côté de masses sépharades considérées à demi-mots comme de « bons sauvages », ignorantes et primitives mais remplies de bons sentiments, qu’on pourrait intégrer au sein du véritable judaïsme avec quelques efforts éducatifs. De fait, l’intégration n’a pas toujours été pleine et entière, les Juifs sépharades étant souvent considérés comme de « mauvais » ultra-orthodoxes par leurs pairs. Mais un siècle d’hégémonie orthodoxe ashkénaze a tout de même largement réussi à déposséder les sépharades de leur propre héritage et à les convaincre de leur dépendance envers les rabbins d’Europe de l’Est.
En France, cette intériorisation est arrivée à son summum dans les années 90, avec un rabbinat assumant désormais une ligne de soumission totale à l’ultra-orthodoxie ashkénaze. Pourtant, nombre des rabbins étaient eux-mêmes d’origine sépharade. Mais de leur sépharadité, il ne restait plus (dans le meilleur des cas) qu’un sourire charmant, un humour certain et un folklore toléré tant qu’il n’entrait pas en contradiction avec les normes ultra-orthodoxes. Les descendants des bons sauvages pouvaient garder leur joie et bonne humeur, tout en la liant au savoir qu’avaient bien voulu leur transmettre leurs frères d’Europe.
J’aimerais conclure ces propos par deux exemples anecdotiques mais révélateurs. Le premier concerne la coutume bien établie parmi les familles de l’Est du Maghreb de se réunir sous le talit paternel à la clôture de Kippour, hommes et femmes mélangés. Cette coutume a été sévèrement critiquée comme contraire à la halakha par des rabbins issus pourtant de ces mêmes communautés, mais formés dans des écoles ashkénazes. Entre les lignes, les communautés intériorisent l’idée que sur ce sujet comme pour d’autres, leurs ancêtres vivaient dans l’erreur jusqu’à ce qu’arrivent les premiers ashkénazes civilisateurs, leur montrant « le droit chemin », pour reprendre l’expression d’Halpérin.
Un deuxième exemple concerne notre conception de ce qu’est le judaïsme. Il y a quelques années, j’ai rencontré un vieux rabbin d’origine marocaine qui m’a raconté avoir étudié dans sa jeunesse avec le célèbre Rabbi David Bouzaglo, à Casablanca. Lorsque je lui ai demandé ce qu’ils étudiaient ensemble, m’attendant à une référence à l’un des traités du Talmud, sa réponse a été surprenante : le poète Nahman Byalik, le penseur sioniste laïc E’had Haam, et la Bible avec les commentaires d’Abraham Ibn Ezra, l’un des exégètes classiques les plus analytiques. Au cours de mes recherches, j’ai réalisé à plusieurs reprises à quel point la culture hébraïque moderne était enracinée au Maroc et faisait naturellement partie de ce que les élites religieuses considéraient comme faisant partie du judaïsme. Un judaïsme « traditionnel » qui conciliait sans difficulté poésie et Talmud, pensée médiévale et pensée moderne, religion et culture. Qu’enseignent aujourd’hui les orateurs les plus en vue du judaïsme français, issus pourtant de cette même tradition ? Que diffusent les sites les plus consultés ? Un judaïsme étroit, excessivement orthopraxe et infantilisant. Un judaïsme témoignant d’un déracinement brutal suivi d’une reconstruction à la hâte, avec pour contenu principal une ultra-orthodoxie mal importée d’Israël.
Conclusion
Ce texte peut se conclure par un constat paradoxal. Le judaïsme français contemporain est quantitativement le plus important d’Europe et représente la troisième plus grande communauté juive au monde, juste derrière Israël et les États-Unis. Pourtant, son apport qualitatif à l’ensemble du monde juif est quasi-inexistant. Même en le comparant à ses voisins européens, le constat est glaçant. Le judaïsme anglais, n’atteignant pas la moitié des effectifs français, a par exemple un rayonnement bien plus considérable. On peut citer le défunt Grand Rabbin Jonathan Sacks, d’envergure internationale, ainsi que Louis Jacob, influent dans les milieux non-orthodoxes, et Eliyahou Dessler, une sommité du monde ultra-orthodoxe. Sacks, Jacob et Dessler ont d’ailleurs tous trois étés traduits en français. À ma connaissance, le seul rabbin français de ces cinquante dernières années (et peut-être des cent dernières années) à avoir été traduit en anglais et en hébreu est Delphine Horvilleur. Pourquoi aucun rabbin consistorial n’a d’écho au sein du reste du monde juif ? Pourquoi aucun rabbin orthodoxe français n’est lu ou cité par ses confrères israéliens ou américains ? J’ai également mentionné précédemment l’exemple allemand, qui, même après son éradication, continue à jouir d’une aura bien plus large que son voisin français, tant sur le plan rabbinique que sur celui de la pensée juive.
Malgré ce constat acerbe, ce texte ne se veut pas l’oraison funèbre du judaïsme français. L’histoire n’est jamais écrite et les devenirs de ce judaïsme dépendent surtout des choix qui seront faits au présent. La question qui me semble la plus urgente est celle de l’héritage. De qui, de quoi, sommes-nous les héritiers ? Que voulons-nous transmettre aux générations futures ? Pour que la réponse soit pertinente, il faut oser penser au-delà de la communauté elle-même. Qu’est-ce que le judaïsme français peut-il apporter à l’ensemble du monde juif, présent et futur ? Quel legs se prépare-t-il à donner à la mémoire juive ?
Dans un aphorisme connu, largement commenté par Hannah Arendt, le poète français René Char écrivait : « Notre héritage n’est précédé d’aucun testament ». Sans testament, sans indication laissée aux générations futures sur la nature et le contenu des legs spirituels, l’héritage n’est plus que le lointain souvenir du trésor que nos ancêtres possédaient, mais dont la carte qui y mène a été perdue. Dans son livre L’Hôte de passage, l’écrivain israélien Shai Agnon proposait une métaphore véhiculant une idée similaire, mais dans un contexte plus traditionnel. Celle d’un Juif émancipé revenant au beit hamidrash, à la maison d’études de son enfance, mais découvrant qu’il a perdu la clé lui permettant l’accès aux piles de livres accumulés sur les étagères, qu’il ne voit désormais plus qu’à travers les fenêtres poussiéreuses.
Ni le franco-judaïsme ni le judaïsme maghrébin des derniers siècles ne nous ont laissé de testaments précis. Malgré tout, nous, Juifs français, avons encore les clés intellectuelles, linguistiques et culturelles qui mènent vers leurs trésors perdus. Libre à nous d’aller y fouiller, de les assembler en un trésor encore plus vaste, et d’exposer les plus beaux éléments à l’ensemble du monde juif. Pour cela, il nous incombe de nous émanciper des fardeaux de l’histoire. À nous de nous débarrasser de la lourdeur institutionnelle du franco-judaïsme, pour mieux nous emparer de son héritage universaliste. À nous de nous débarrasser des préjugés intériorisés sur une sépharadité réduite à un folklore, pour mieux redécouvrir ses nombreux atouts intellectuels et religieux. À nous, autant que possible, de faire fusionner les meilleurs éléments de ces deux univers afin de favoriser l’émergence d’un judaïsme français contemporain dont le rayonnement dépassera le temps présent.
Repousser l’échéance, c’est prendre le risque de perdre à jamais la clé qui mène à ces trésors. Et comme l’écrit Agnon : « Je médite toujours sur ces ouvrages, demeurés dans l’antique Beit Hamidrash. Ils ne représentent que les vestiges d’une richesse bien plus grande. À l’époque où je détenais les clés, je m’y plongeais et les étudiais. Désormais que la clé est perdue et que l’accès m’est fermé – qui les étudiera ? »
Gabriel Abensour
Gabriel Abensour est doctorant au département d’Histoire Juive à l’Université Hébraïque de Jérusalem et chercheur à l’Institut Shalom Hartman.