Dibbouks, golems, zombies, spectres, loups-garous et autres mazzikim, la démonologie juive a pénétré le cinéma, mais qu’a-t-elle donc à nous raconter ? Entre mémoire de la Shoah, réflexion sur le mal, le corps ou l’inconscient, voire quête d’une religiosité alternative – à l’occasion de l’exposition actuellement au mahJ : « Le Dibbouk. Fantôme du monde disparu », enquête sur l’un des apports les plus singuliers du judaïsme à l’art et aux représentations. Par David Haziza, qui vient de publier ‘Mythes juifs. Le retour du sacré‘, dans la collection Diaspora chez Calmann-Lévy.

Le 19 septembre 2015, le cinéaste Marcin Wrona se pendait dans sa chambre d’hôtel de Gdynia, en Pologne. Son film, Demon, avait été montré à Toronto et devait l’être à nouveau lors du festival qui se tient chaque année dans cette ville. Cela se passait pendant les Yamim Noraïm, les jours de pénitence allant de Rosh Hashanah à Yom Kippour, pendant lesquels s’ouvre le Livre de la vie – des vivants, mais aussi des morts. De quoi parle Demon ? D’un dibbouk, d’une hantise à laquelle le réalisateur lui-même n’aura pas survécu.
Dans Épouvante et surnaturel en littérature, Lovecraft écrivait vers 1933[1] que la mythologie juive avait considérablement enrichi les potentialités de la littérature fantastique par le thème du golem et celui du dibbouk, l’homme artificiel et animé par la magie religieuse d’une part, la possession spirituelle d’autre part. Il citait non seulement Le Golem de Meyrink, publié en 1915, mais encore la pièce yiddish d’An-Ski, Le Dibbouk, ou Entre deux mondes, créée à Vilna en 1917. Ce que Lovecraft disait de la littérature était déjà vrai du cinéma et l’est davantage encore de nos jours. Le cas de Demon – relecture de la pièce d’An-Ski et de son adaptation cinématographique par Michał Waszyński (1937) – tend à le prouver, quoiqu’il soit passé à peu près inaperçu à sa sortie. L’histoire récente de l’Europe et celle du peuple juif se jouent dans ce film d’horreur.
Le dibbouk est l’esprit d’un mort parlant par la bouche d’un vivant auquel il s’est attaché. Cette croyance existe sous des noms divers dans bien des cultures, notamment chamaniques, mais elle est étonnamment absente du christianisme, où la possession, phénomène reconnu, est liée aux démons plutôt qu’aux âmes errantes : que l’on songe aux diables de Loudun au XVIIe siècle, ou à L’Exorciste de Friedkin[2]. Le dibbouk a d’ailleurs un équivalent bénéfique, le ‘ibbour, chose qu’il serait difficile d’envisager dans les autres religions abrahamiques où la hantise, quand elle existe, est forcément maléfique. Dibbouk ou ‘ibbour, il s’agit toujours, pour la théologie mystique juive, de la « fécondation » d’une âme par une autre qui aurait besoin de cette liaison posthume pour accomplir une tâche laissée inachevée.
Dans le film de Wrona, il s’agit du retour d’une femme juive, Hannah, tuée au cours de la Shoah. Jouant les trouble-fêtes, elle vient prendre possession du corps d’un Polonais de la Diaspora, Piotr, dont on célèbre le mariage, quelque part en Pologne, pays qu’il a quitté longtemps auparavant. C’est aussi au cours de son mariage que Leah, l’héroïne du Dibbouk, est pénétrée par l’âme de Honen, son défunt bien-aimé. L’union sexuelle symbolique est donc désormais inversée en même temps que le sens, strictement juif, du drame initial, se trouve déplacé. Dans les deux cas, l’union horizontale des chairs convoque un autre lien, vertical, celui unissant les générations. « Fort comme la mort est Amour », proclame le Cantique des cantiques, poème qui structure la pièce d’An-Ski et peut-être plus encore le film de Waszyński, mais aussi celui de Wrona : l’amour présuppose la mort, qu’il est en même temps seul à même de vaincre.
Dibbouk ou ‘ibbour, il s’agit toujours, pour la théologie mystique juive, de la « fécondation » d’une âme par une autre qui aurait besoin de cette liaison posthume pour accomplir une tâche laissée inachevée.
On comprendra progressivement que la famille de la mariée de Demon, Żaneta, pourrait bien avoir la clé de l’assassinat de Hannah. Lorsque cette dernière se met à parler par la bouche de Piotr, les assistants croient entendre de l’allemand. C’est le prêtre qui identifie les mots prononcés comme yiddish. Il reviendra au dernier Juif de la ville, un « ami de la famille », d’exorciser – ou non – l’âme en peine. Il a connu Hannah et l’a sans doute aimée. Pour Marcin Wrona, la beauté et les amours de Żaneta, aussi pures soient-elles, devaient rappeler les mânes de la Juive exterminée.
Pour reprendre une idée chère à Jacques Derrida et qu’il a été amené à formuler à travers divers écrits ou même lors de sa propre apparition dans Ghost Dance, le cinéma – comme la psychanalyse qui est née en même temps que lui – devait être aux yeux de Wrona « l’art de laisser revenir les fantômes », de se laisser « ventriloquer » par les dibbouks. Oui, « l’expérience cinématographique appartient, de part en part, à la spectralité[3] », et ce retour possède une dimension éthique indubitable : à l’heure où il est devenu de bon ton de dénigrer la « repentance », le cinéma peut encore nous apprendre à écouter les plaintes des morts, car il est « un deuil magnifique, un travail du deuil magnifié. Et il est prêt à se laisser impressionner par toutes les mémoires endeuillées, c’est-à-dire par les moments tragiques ou épiques de l’histoire ».
Dès sa naissance, le cinéma fut regardé comme une nouvelle porte vers le séjour des morts, comme avaient pu l’être la peinture ou la musique, et comme l’était la photographie – mais cette fois, il sembla à beaucoup de ces premiers témoins que la mort était tout bonnement vaincue, ou qu’elle imprégnerait à tout jamais nos existences par ces traces visuelles, qu’elle y mêlerait ses spectres. Or, Derrida l’écrit encore dans Spectres de Marx, le spectre est ce qui disloque le temps, le fait « sortir de ses gonds » et provoque ainsi la responsabilité éthique, celle du survivant, du témoin, de l’héritier. Le cinéma, art des fantômes, peut jouer un tel rôle. « Venez ce soir à 10 heures chez Edith Laurin pour des nouvelles concernant vos morts. Signé : J’accuse ! » : ces mots du film d’Abel Gance (1919), qui introduisent la fabuleuse séquence des revenants, pourraient constituer l’exergue de celui de Marcin Wrona.
Miniature ou mise en abyme du cinéma même, le film de dibbouk pourrait en effet remplir un rôle semblable à ce que Derrida dit de Shoah, à savoir qu’on y voit à quel point cet art « est le simulacre absolu de la survivance absolue. Il nous raconte ce dont on ne revient pas, il nous raconte la mort. Par son propre mirage spectral, il nous désigne ce qui ne devrait pas laisser de trace ». Mais devant la caméra de Lanzmann, le survivant témoigne de ce qu’il a lui-même vécu. L’acteur qui joue le possédé, dans Demon, mime sa propre condition d’une part et celle de tout héritier, de tout survivant d’autre part : les morts vivent en nous et parmi nous.
C’est ce que Chen Shelach, un documentariste israélien, a également entrepris de raconter avec Muranów (2020). Muranów, c’est le quartier de Varsovie, sur la rive gauche de la Vistule, où, avant la guerre, se massaient deux cent mille Juifs. Une fois entouré de murs infranchissables, il allait devenir pour cette raison le Ghetto de la capitale polonaise. Entièrement détruit après l’insurrection de 1943, le Muranów de 2021 semble ne plus rien contenir de toutes les existences juives qui y ont fleuri et qu’on y a détruites. Une succession d’immeubles lugubres recouvre les allées, les parcs, les cafés, les échoppes, les synagogues et les théâtres, la vie grouillante et trépidante du siècle dernier – et le polonais a uniformément remplacé le yiddish. Pourtant, de nombreux habitants se disent aujourd’hui hantés, littéralement. Leurs maisons sont faites de briques auxquelles on a mêlé les os des morts, et l’on retrouve sans cesse des objets et des souvenirs dans leurs souterrains. Dès lors, qu’y a-t-il d’étonnant à ce que les personnages du documentaire nous parlent de « Rachel », une petite Juive dont le spectre partage sa maison, des lumières qui s’allument et s’éteignent sans raison dans ces appartements modernes, des bruits étranges et répétés qui y résonnent, du son d’un violon ou du rire d’un enfant qui se fait entendre ?
Dans Muranów, le refus de l’organiste (son église se trouve dans l’enceinte de l’ancien quartier juif) de se laisser hanter par les dibbouks, ou même d’y croire, apparaît assez clairement comme une faute. Ses propos ne sont pas antisémites, contrairement à ceux d’autres personnes filmées par Shelach, mais ils expriment une indifférence surjouée qui dit toute la vérité de la situation : il ne s’agirait pas de faire du mal aux Juifs, non… mais sans eux, la Pologne se porte tout de même mieux. Dommage que leurs spectres, eux, ne s’en aillent pas aussi !
Il y a quelque chose d’ironique dans ce « nouveau » traitement de la possession ou de la hantise juive. La croyance au pouvoir de nuisance des spectres, matérialisés (vampires) ou non (fantômes), est vieille comme l’humanité même, et elle se conjugue souvent, de façon confuse, avec la démonologie : les fées du Moyen Âge sont des âmes défuntes ou cohabitent avec de telles âmes ; de même, le vampire folklorique est souvent décrit comme un démon de son vivant même, ou un homme aux pouvoirs diaboliques. Le Juif est tout cela à la fois – un mort ou un mort-vivant, un démon, zombie, vampire et diable. Le thème vampirique moderne, littéraire et cinématographique, doit beaucoup, de son côté, aux figures, notamment visuelles, inventées par l’imagination antisémite. Pour Wrona comme pour Shelach, le Juif – la Juive en l’occurrence – est toujours spectral, plus que jamais même. Tel le vampire ou le horla de Maupassant, il hante, possède, soumet un corps, un corps de Gentil. Seulement, comme dans La danse de Gengis Cohn, ce roman drolatique de Gary où un ancien nazi est possédé par le dibbouk de l’une de ses victimes – un clown juif mort à Auschwitz –, il le fait désormais parce que l’injustice et l’horreur qu’il a subies ont fait sortir le temps de ses gonds. C’est la méchanceté ou l’indifférence des Gentils qui l’ont rappelé d’entre les morts.
Le Juif est tout cela à la fois – un mort ou un mort-vivant, un démon, zombie, vampire et diable. Le thème vampirique moderne, littéraire et cinématographique, doit beaucoup, de son côté, aux figures, notamment visuelles, inventées par l’imagination antisémite.
Un autre documentaire, The Dybbuk – A Tale of Wandering Souls, de Krzysztof Kopczyński, avait déjà traité ce sujet en 2015, quoiqu’il s’agisse cette fois d’une quête active de la part de mystiques juifs : les âmes errantes sont ici celles que vont rencontrer les pèlerins hassidiques d’Ouman, au cœur de l’ancienne Podolie (Ukraine), où est enterré Rabbi Nahman de Bratslav. Ce film explore les haines et les rancunes opposant ces deux peuples, Juifs et Ukrainiens. Il n’épargne pas les hassidim, dont les excès divers, voire le racisme, sont évoqués. Mais il montre en même temps la brutalité persistante de la haine antijuive. Dans ce contexte, une scène mérite d’être mentionnée. Un groupe de hassidim se rend dans un asile psychiatrique délabré pour y jouer de la musique. Ces mystiques « allumés » sont à la recherche des âmes en peine, dont ils pensent peut-être capter et rédimer les énergies. Leur message, ils le veulent universel : le judaïsme est la religion d’un peuple singulier, mais qui rayonne vers les autres. Dans la doctrine lourianique, dont s’inspire le hassidisme, les retours des âmes sur terre ont partie liée au processus de réparation du monde – le tiqqun ‘olam. Derrière les dibbouks, il y a une multitude d’étincelles divines, prisonnières des forces du mal et dispersées dans l’univers. Cette scène est mémorable en ce qu’elle dépeint ainsi une part invisible du cosmos d’une manière dont le cinéma seul est capable.
En suggérant qu’il y a, pour les Juifs, un devoir de se consacrer aux morts en quête de rédemption, le film de Kopczyński renoue en quelque sorte avec le thème originel du dibbouk. En effet, si Gary et Wrona ont imaginé la hantise des Gentils, si Muranów l’a décrite de façon aussi réaliste que possible, la pièce d’An-Ski comme les récits traditionnels dont elle s’inspire tendent à faire du dibbouk une affaire juive. C’est l’injustice de Sender, sa trahison, une fois devenu riche, du pacte qui le liait à son ami Nissen, qui va précipiter la catastrophe du Dibbouk : la possession de Leah, par l’âme de Honen, le fils de Nissen auquel elle était promise – son bashert. On a voulu voir dans cette pièce et dans ce film une prémonition de la Shoah. C’est ne pas se rendre compte que le monde décrit par An-Ski et Waszyński est certes à la veille de sa disparition, mais que celle-ci résulte d’abord de ses propres tensions[4]. Dans ces deux œuvres, il est question des tensions internes au peuple juif – entre rationalité et mysticisme, entre riches et pauvres, entre hommes et femmes, entre hétérosexualité et homosexualité…
Il revient aux frères Coen, dans A Serious Man (2009), d’avoir ressuscité ces aspects « internes » du mythe, faisant du dibbouk la désignation d’une autocritique juive, en l’espèce d’une critique de l’assimilation. Ce film possède une dimension surnaturelle indéniable, notamment dans son prologue en yiddish : Reb Groshkover, un homme revenu d’entre les morts – joué par le vieil acteur yiddish Fyvush Finkel – y est identifié comme « dibbouk ». Techniquement, il s’agirait plutôt d’une sorte de zombie, puisque le dibbouk est une âme attachée au corps d’un vivant, non un corps sorti de la tombe. Du Talmud[5] et des Shivh’ei haAri (XVIe siècle) jusqu’à Melnitz de Charles Lewinsky, en passant par la nouvelle « Deux cadavres s’en vont danser » d’Isaac Bashevis Singer et La nuit sur le vieux marché d’Isaac Leib Peretz, cet autre phénomène est toutefois bien connu des sources folkloriques[6], littéraires et artistiques juives, pour lesquelles il peut arriver en effet qu’un trépassé revienne dans sa chair même. Que nous dit Reb Groshkover ? Ce prologue est situé dans un temps et un lieu indécis, disloquant par avance le confort matériel et corporel, fait de pelouses bien taillées, de bronzage impeccable et de rhinoplastie, des Juifs américanisés qui seront au cœur du film. Dans A Serious Man, par ailleurs inspiré de Job, ce lépreux condamné à vivre sur un tas d’excréments mais aspirant toujours à voir Dieu « depuis [sa] chair » même[7], c’est le rappel de la chair juive, du mélange de grotesque et de sublime qui lui est propre. Le judaïsme rabbinique a fait de la croyance en la résurrection, corps et âme, un dogme. Le zombie, c’est la résurrection prématurée.
Le fantastique juif évoque en somme un questionnement identitaire, si ce n’est le retour proprement dit, la teshuvah. Dibbouks mis à part, c’est le cas dans Pi d’Aronofsky (1998), une lecture du Livre d’Ezéchiel, où un mathématicien new-yorkais, juif mais athée – et surtout schizophrène –, obsédé par la découverte d’un ordre qui régirait le chaos du nombre π, se voit contacter à la fois par des financiers peu scrupuleux et par les membres d’un groupe hassidique messianique pour lesquels son éventuelle découverte pourrait amener celle du nom secret de Dieu, et donc la fin des temps. Max Cohen est hanté par une tâche, un appel qui le dépassent absolument – et tel Ah’er, le Faust du Talmud, il se perd (ou se trouve) en voulant épuiser les mystères de la Création.
On retrouve ce questionnement dans The Vigil, de Keith Thomas (2019). Un jeune OTD (pour « off the derech », « sorti du droit chemin »), un ex-hassid donc, est appelé pour servir de shomer dans la maison d’un survivant des camps : il doit veiller sa dépouille en récitant les psaumes. Or cette maison est hantée par un mazzik[8], un démon qui était attaché au vieux Litvak depuis la Shoah et l’avait rendu fou. « Ce ne sont pas des cauchemars, ce sont des souvenirs », dit sa veuve au shomer harcelé par de terrifiantes images mentales qui lui sont comme envoyées par le défunt. L’espace d’une nuit, il devra renouer avec la pratique juive pour contrer leur néfaste pouvoir[9]. Les communautés hassidiques de Brooklyn se sont constituées après la guerre, et la mémoire de l’extermination y fut structurante, au point, selon certains « renégats », d’emprisonner les générations suivantes. Le film de Thomas s’en veut l’exorcisme et en même temps – comme tout exorcisme – la désignation et l’élucidation.
Il arrive du reste que le fantastique annonce un autre judaïsme. Un film israélien sorti en 1994, Shh’ur de Shmuel Hasfari, oppose par exemple la spiritualité des femmes marocaines, imprégnée de surnaturel (de « superstitions ») à celle de leurs époux. Dans les rites alternatifs et syncrétiques des premières se dirait le pouvoir immémorial de la mère, de la Déesse vainement refoulée – la Shekhinah. Dès Le Dibbouk, cette problématisation du religieux par le démonique est présente, puisque Honen y expérimente la sainteté du péché. Le surgissement des morts – dans le film, où il s’exhibe sous une forme expressionniste et carnavalesque, plus encore que dans la pièce – redouble la critique sociale et religieuse sous-jacente. Quant à l’exorcisme, il ne s’avère qu’en partie efficace : Honen accepte de quitter le corps de Leah pourvu que Sender dise pour lui le Kaddish, mais Leah, une fois « libérée », se sacrifie pour rejoindre dans la mort son bien-aimé. Il ne s’agit pas de nier le pouvoir du Rebbe, mais ce pouvoir, peut-être parce qu’il est corrompu par l’argent, ne peut rien face à l’amour magique des deux héros.

Le Dibbouk et Shh’ur partagent un même penchant « primitiviste », ce qui renvoie à la quête d’un « là-bas » spirituel. Gabriella Safran a montré ce que la pièce d’An-Ski devait à l’intérêt de ce dernier pour les cultures sibériennes[10]. Hassidim de Podolie et de Volhynie, matrones judéoberbères du Maroc partagent avec les populations chamanistes de l’Extrême-Orient russe une sorte de primitivité communale. Aux yeux d’An-Ski, qui était ethnographe mais aussi socialiste et révolutionnaire, cette dimension pouvait avoir un sens politique. Sender, le capitaliste est tout ce que cet ordre mystique n’est pas. Dans Shh’ur, l’ordre en question est explicitement matriarcal – et dans chacune des œuvres, ce recours au passé et à son irrationalité aurait le mérite de briser l’injustice du présent.
Si l’émergence d’un fantastique juif au cinéma possède un lien avec l’évidente cinégénie du judaïsme traditionnel, des rites juifs, elle peut aussi s’opérer sans signifiant juif apparent.
Un mot, pour finir, des apports imperceptibles du judaïsme au genre fantastique. Deux exemples suffiront. Si l’émergence d’un fantastique juif au cinéma possède un lien avec l’évidente cinégénie du judaïsme traditionnel, des rites juifs[11], elle peut aussi s’opérer sans signifiant juif apparent. Le Locataire de Polanski est à l’évidence une œuvre fantastique et juive, où un immigré polonais (qui se croit) assailli par ses voisins se prend aussi, et de ce fait même, pour une certaine Simone Choule (comme la shul, la synagogue), ou refuse qu’on ne le confonde avec elle tout en assumant inexorablement cette identité. C’est le thème du double, de la double vie, qui anime bon nombre d’histoires juives ou inspirées par le judaïsme, à commencer par la lutte nocturne de Jacob contre un personnage anonyme dans lequel la tradition rabbinique voit tantôt son ange gardien, tantôt la force protectrice des ennemis d’Israël, tantôt lui-même et tantôt le spectre de son frère et ennemi, Dieu ou le Diable. On pourrait aussi voir dans le devenir-femme de Trelkovsky une réminiscence kabbalistique : on sait que dans la Kabbale lourianique, l’âme de certains hommes diffère sexuellement de leur corps[12]. Mais Le Locataire est aussi, et pour toutes ces raisons, une fable sur l’impossibilité de l’assimilation, sur le trouble spirituel et mental que cette utopie amène forcément.

De même, le bien trop sous-estimé Wolf, de Mike Nichols, peut aussi se lire comme une allégorie de la condition juive : le Juif de la modernité est un être hybride, cachant en son sein des forces primitives et ambivalentes, vu par les antisémites comme corrompu et corrupteur, ferment d’« épidémies psychiques », comme l’écrit Meyrink dans Le Golem, de renouveaux parfois brusques que suscite son archaïsme même. Il est « génial » parce qu’il se situe par-delà bien et mal.
Mais il y a quelque chose de plus essentiel. Dans ce film, un éditeur (de New York mais pas nécessairement juif) voit ses forces créatives décuplées sous l’effet de sa lycanthropie. Or il est dit que si, dans la Genèse, la Création n’est qualifiée d’« excellemment bonne » que dans son état final, c’est parce qu’à ce stade seulement l’inclination au mal a été créée. Tout son labeur, c’est cette inclination qui va pousser l’homme à s’y adonner[13]. L’anthropologie juive est entièrement fondée sur cette intuition paradoxale et, pour ainsi dire, lycanthropique, qui semble prendre à rebours la notion augustinienne de péché originel. Ajoutons à ces considérations générales un détail que Nichols ignorait probablement : la croyance au loup-garou fut partagée pendant longtemps par les Juifs, pénétrant même la culture élitiste et littéraire des piétistes allemands des XIIe et XIIIe siècles. On trouve chez ces derniers d’étonnantes analogies entre la métamorphose lycanthropique, à la possibilité de laquelle tout le monde croyait alors, et la métamorphose angélique de certains personnages de la Bible, voire l’idée que la métamorphose de l’homme en loup découle nécessairement de sa création à l’image de Dieu : Randall, le héros de Wolf, en devenant loup-garou et en l’acceptant, acquiert non seulement des pouvoirs immenses, mais même une sorte d’immortalité.
Dans ces deux cas comme dans les exemples qui précèdent, la réflexion existentialiste est nourrie par la Bible et la tradition juive, ainsi que par les vicissitudes de l’histoire. Ce sont là autant d’exemples de l’archaïsme salvateur du Juif dans la modernité.
David Haziza
Chercheur et essayiste, David Haziza est docteur de l’université Columbia (New York). Il a enseigné l’histoire de l’Europe, la littérature française et le cinéma. Il a publié ‘Talisman sur ton cœur’ (Cerf, 2017), une exégèse du Cantique des cantiques, et ‘Le Procès de la chair’ (Grasset, 2022), un essai sur le puritanisme contemporain. Son dernier livre, ‘Mythes juifs. Le retour du sacré‘ vient de sortir dans la collection Diaspora chez Calmann-Lévy.
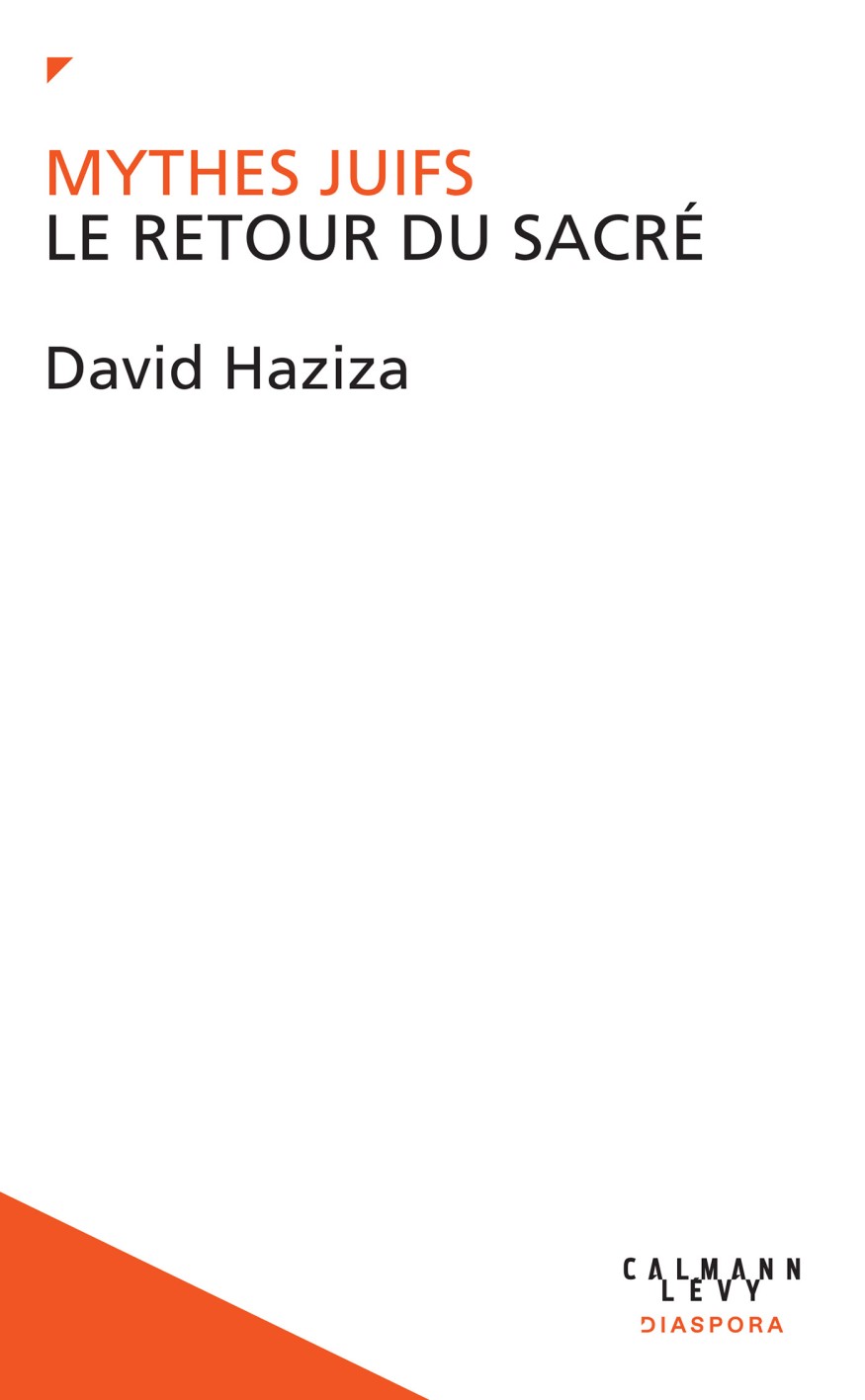
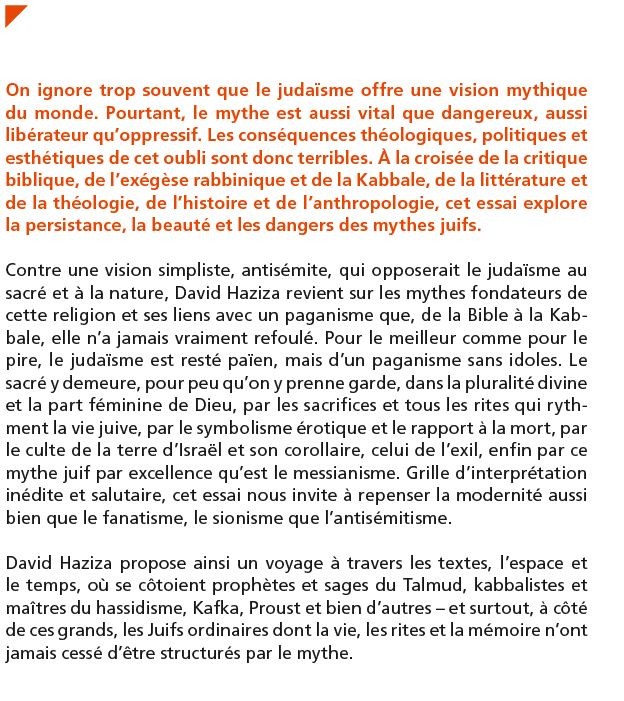
Notes
| 1 | Dans Épouvante et surnaturel en littérature. |
| 2 | Friedkin est juif mais la rhétorique de L’Exorciste est chrétienne. |
| 3 | « Le cinéma et ses fantômes », entretien réalisé par Antoine de Baecque et Thierry Jousse, Les Cahiers du Cinéma, avril 2001. |
| 4 | Voir Glenn Dynner, Men of Silk – The Hasidic Conquest of Polish Jewish Society, New York, Oxford University Press, 2006. Le sujet est au centre du roman Yoshe le fou, d’Israel Joshua Singer. |
| 5 | Voir par exemple Ketubot, 103a, où il est rapporté que Rabbi Judah HaNasi revenait chaque chabbat après sa mort, dans son corps et ses plus beaux atours. Sanhédrin, 92b, prend la parabole des ossements desséchés d’Ezéchiel littéralement, affirmant que ces morts ressuscités eurent même des descendants. Les sources plus tardives insisteraient davantage sur l’élément maléfique de telles résurrections pré-messianiques. Une histoire célèbre des Shivh’ei haAri met en scène une femme de Galilée morte vierge. Un jeune voyou, apercevant son doigt sortant de terre, lui passe un anneau de mariage par dérision. Le lendemain, elle revient réclamer son dû. |
| 6 | La scène du rêve, dans Le violon sur le toit, bien qu’elle soit présentée comme une invention de Tevyeh, appartient au même imaginaire et convoque de même une morte ressuscitée dans sa chair. |
| 7 | Job, 19 : 26. |
| 8 | Voir Pesah’im 110a. |
| 9 | Ce surgissement du surnaturel juif dans la vie moderne est l’objet d’un court-métrage français, Dibbuk, de Dayan David Oualid. Cette fois, l’exorcisme se produit en milieu séfarade, dans le XIXe arrondissement de Paris. Le démonique et le divin viennent subvertir la triste normalité d’un espace urbain à bout de souffle. Le rite s’offre comme réponse à l’obsolescence contemporaine. |
| 10 | Gabriella Safran, « Jews as Siberian Natives – Primitvism and S. An-Sky’s Dybbuk », dans Modernism/Modernity, 2006. |
| 11 | En témoigne la pléthore de réalisations récentes faites sur ce thème. Mais l’on peut songer à des films conçus il y a bien plus longtemps, qui peuvent, le cas échéant, raconter une sortie de la tradition : Das alte Gesetz, de 1923, ou le Jazz Singer de 1927. Les deux versions du Juif Süss, celle, anti-nazie, de Lothar Mendes (1934), et celle, plus célèbre de nos jours, précisément à cause de son antisémitisme, de Veit Harlan (1940), attestent également, tout fantastique mis à part, d’une sorte de fascination esthétique pour la ritualité juive. Dans le film de Harlan, cette fascination s’exhibe évidemment avec mauvaise conscience. On la retrouve dans des films aussi divers que Le Procès de Pabst (1948) ou… Les aventures de Rabbi Jacob (1973). L’exotisme du rite juif a été conjugué à l’horreur dès le Dibbouk de Waszyński, mais aussi dans les Golem de Wegener (1920) et de Duvivier (1936). On pourrait aussi mentionner un autre Golem, le film de Jean Kerchbron (1967), coécrit par Louis Pauwels et directement inspiré du roman de Meyrink. |
| 12 | https://k-larevue.com/proust-le-talmud-et-la-kabbale/ |
| 13 | Bereshit Rabbah, IX, 7. |











