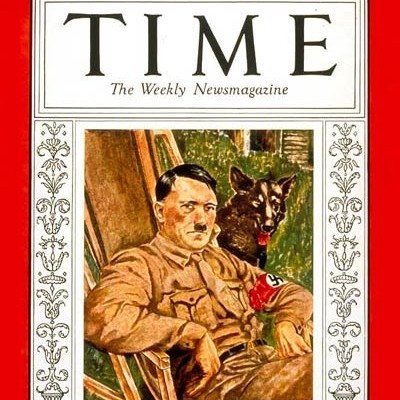La puissance corrosive du dire-vrai et la fragilité narcissique de l’autorité
Alors que l’actualité immédiate est celle de l’incursion terrestre au Liban, des opérations militaires et des assassinats ciblés, qu’il est question de l’équilibre régional voire mondial, Noémie Issan-Benchimol, dans cette lettre de Jérusalem, veut nous ramener à l’échelle plus modeste des émotions politiques et des blessures de la société israélienne, en premier lieu sur la plaie encore ouverte des otages, qui n’est pas sans dessiner une ligne de fracture profonde entre les tenants du contrat social citoyen et les tenant de la dissuasion. Prenant l’occasion d’un micro-évènement politique, elle nous propose ici une méditation sur le pouvoir et un aperçu de cette partie du peuple israélien qui s’oppose au gouvernement Netanyahou et à sa façon de faire la guerre sans préparer la paix.

Il y a deux semaines, soit une éternité en termes de temps médiatique, en Israël, parmi les trop nombreux évènements notables qui rythment un quotidien politique irrespirable, un évènement a marqué les esprits. C’était un de ces moments apparemment anodins qui sont pourtant des révélateurs. C’était un acte de parole : un homme qui parle à un autre homme ; structure banale de tout échange humain, me direz-vous. Or, nous savons bien que tous les mots n’ont pas le même poids ni la même valeur, dans cette devise aujourd’hui bien dévaluée qu’est la vérité.
Lors d’une visite à la famille endeuillée de l’otage israélien Ori Danino brutalement assassiné par le Hamas dans les tunnels de Gaza, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a, comme à son habitude, essayé de rejeter la responsabilité sur tout le monde, en contredisant ainsi performativement la nature même d’une visite faite aux endeuillés, qui est de consoler ou de tenter de consoler plutôt que de se mettre hors de cause. Mais la famille, qui était pourtant sociologiquement censée être un safe-space pour Benjamin Netanyahou puisque l’on parle d’une famille haredit séfarade de Jérusalem (et d’aucuns vont même jusqu’à affirmer que c’est pour cette raison qu’il a rendu visite à cette famille et pas à d’autres), forte de l’infini courage que peut procurer une tristesse absolue et le fait de n’avoir plus rien à perdre, s’est autorisée un moment de ce que Foucault appelait la parrhèsia, le courage de la vérité. « Vous les avez équipés d’armes. Vous les avez équipés de tunnels et de dollars… Êtes-vous venu ici pour écouter ou pour être écouté ? Parce que ce que vous avez à dire, nous l’avons entendu pendant 15 ans. »[1]
Parce que ce moment était une suspension de tellement de conventions sociales et politiques, de renversement des hiérarchies du pouvoir, j’ai voulu y revenir, à tête froide, pour essayer de l’analyser, mais aussi pour en faire l’occasion d’une réflexion plus générale sur l’autorité et la puissance subversive en contexte de dérive autoritaire, d’une simple parole de vérité qui lie un individu à une parole dans le sens le plus profond qui soit.
L’espace du deuil comme espace sacré
Certes, il existe des circonstances qui ont rendu possible ce moment de véridiction. Tout d’abord, dans sa chorégraphie : le Premier ministre est venu dans une maison privée endeuillée, et le deuil est présumé, comme la naissance et la mort, être un espace sacré, à la fois hors du monde usuel et des instrumentalisations qui caractérisent ce dernier. Les lois juives du deuil, pour peu qu’on y réfléchisse, reflètent cette idée, puisqu’à l’endeuillé est interdit tout ce qui fait les us et coutumes de la vie humaine cultivée : les salutations, la politesse, la propreté et la présentation de soi[2]. Les textes font même une analogie très profonde entre l’excommunié et l’endeuillé[3]. En tant que figure subalterne, momentanément sorti du monde, débarrassé des exigences du tact et des formalités, l’endeuillé peut aussi être celui par qui une voix de révolte et de justice s’exprime (comme dans la tragédie grecque). Or, cette voix, portée par Elhanan Danino, a fait exploser l’idée que Netanyahou cherche à entretenir, selon laquelle l’atteinte personnelle au chef serait une atteinte à l’ensemble des citoyens du pays, comme s’il n’y avait là qu’un seul corps uni : « eux c’est moi et je suis eux ». Il a bien plutôt rappelé que si la responsabilité des assassinats incombait bien au Hamas, celle de la brisure du contrat social citoyen incombait elle, et personnellement, au Premier ministre, et qu’il était donc là en tant que coupable, pas en tant qu’homme politique qui manifeste son empathie et sa proximité avec les douleurs de son peuple.
Les deux corps du roi : la paradoxale vulnérabilité narcissique du chef autoritaire
C’est que le corps de Netanyahou comme chef disparait depuis de longs mois progressivement de l’espace public et des rencontres réelles et spontanées avec le peuple au profit d’une virtualisation de ses apparitions. Messages préenregistrés, rencontres organisées et mises en scène à grand renfort de slogans faussement enjoués et de postures du corps se voulant rassurantes, refus de se confronter à la presse et au public au profit de rares interviews à la chaîne 14, qui est à Benjamin Netanyahou ce que Fox News est à Trump. En plein dans la dérive paranoïaque propre à l’homme de pouvoir qui s’y accroche comme un noyé à sa dernière bouffée d’oxygène, il s’assure d’être face à des soutiens avant de se montrer. L’élément esthétique du kitsch n’est pas non plus anodin, que ce soit les colorations ratées, les couches épaisses de maquillage, les poses en uniforme ou casque avec des soldats (ce qui est censé être interdit). Si Poutine reste le maître incontesté du style « vieil homme enflé de botox la peau tirée comme le cul d’un bébé », Netanyahou ne laisse pas sa part au chien dans ce devenir-idole/statue qui rate sa cible et opère un devenir-clown/marionnette. En bref, Netanyahou se retire petit à petit pour n’apparaître que comme spectre ou icône, et cherche à limiter les interactions non contrôlées avec le public, se sachant de plus en plus détesté. Voilà sans doute une autre raison qui a fait de l’échange avec Elhanan Danino un moment précieux : une disruption dans ces quadrillages serrés de communicants et de mises en scènes.

La parrhèsia contre la parole politique vide
Ce moment de vérité peut être décrit grâce à l’usage foucaldien du concept antique de parrhèsia, pratique verbale d’un individu libre qui noue une vérité existentielle à une parole, en dépit de certains usages, en opposition avec certaines hiérarchies[4].
Michel Foucault oppose la parrhèsia à un autre type de parole : la rhétorique politique, que nous appellerions aujourd’hui langue de bois ou bullshit politicien. La parrhèsia est aussi brute, sincère et mal dégrossie que la rhétorique est raffinée, construite et bien souvent dénuée de tout affect véritablement ressenti : « Autrement dit, la rhétorique n’implique aucun lien de l’ordre de la croyance entre celui qui parle et ce qu’il [énonce] ». L’idée de la rhétorique est de faire ressentir à l’auditoire certains sentiments, de les pousser à adopter certaines conclusions, mais aucun lien de nécessité vitale ne lie l’homme qui parle et sa parole. La langue de Netanyahou, comme celle d’un Trump, est éminemment pauvre : elle use de ce qu’on appelle les spins, et la répétition de slogans simplets, mais marquants comme « Il n’y aura rien parce qu’il n’y a rien » à propos de ses affaires judiciaires, ou « Jusqu’à la victoire totale » sur l’absence de plan réaliste de guerre et d’après-guerre à Gaza.
La langue d’Elhanan Danino, quant à elle, est une langue pétrie de franc-parler et de remontrance religieuse : une véridiction[5]. C’est aussi une forme de parole d’autorité, ce père endeuillé étant aussi rabbin, donc une autorité, pas une personne en position d’autorité. À certains moments, des accents bibliques de tokhekha[6] d’un Nathan à David se sont fait entendre : « Enfermez-vous dans une pièce et réfléchissez à la valeur juive que vous apportez — pas l’identité juive de l’État d’Israël — nous allons contrôler ici, contrôler là. Finalement, le Saint, béni soit-Il, fait tout. Aussi forts que nous fussions avant cela, à Simchat Torah, nous avons reçu une gifle comme jamais auparavant. Une gifle. Ni l’armée de l’air, ni l’infanterie [n’ont été d’aucune utilité] ». Citant également le psaume 126 : « Ne placez pas votre confiance dans les puissants, au fils de l’homme auprès duquel il n’y a pas de salut », il a rappelé le fait qui est sans doute le plus douloureux pour tout tyran narcissique : le rappel de sa condition nue de simple être humain parmi d’autres. Foucault, d’ailleurs, liait la parrhèsia à des pratiques de guide spirituel. Celui qui possède le franc-parler et la liberté est celui qui peut guider les autres. Ici, un citoyen a été un instant dans un rôle de prophète critique du pouvoir à la face du pouvoir même.
Les discours corrosifs : l’approche pragmatique de l’autorité
L’autorité est un objet que l’on a du mal à saisir. Coincée entre la persuasion et la contrainte, entre le charisme et la violence, elle est souvent l’objet d’approches essentialistes ou psychologisantes, liées à des impressions, des affects, des considérations sur l’autorité naturelle d’untel et la magie de la présence d’un autre. L’historien des religions Bruce Lincoln en propose plutôt une approche pragmatique, centrée sur les stratégies et effets produits : l’autorité est la capacité de faire en sorte que d’autres réagissent de certaines façons et ne réagissent pas d’autres façons. Utilisant une métaphore venue du droit romain, celle de l’auctoritas vendoris, à savoir la capacité de faire en sorte qu’une action de vente soit considérée comme valable en tant qu’on agit comme propriétaire, Bruce Lincoln[7] définit l’autorité comme la capacité à produire certains effets : être écouté en silence, ne pas être contredit. Mais, précisément parce qu’elle est une pragmatique et pas une essence, elle est aussi extrêmement fragile et vulnérable : un rire, un crachat, une blague peuvent en révéler la vacuité et la mettre en danger. Lincoln étudie dans son livre plusieurs de ces moments où un « discours corrosif » ébranle la marche usuelle de l’autorité, qui doit alors réagir pour se réinstaller aussi vite qu’elle a été mise en danger et exposée, comme c’est le cas de la réponse d’Ulysse au discours de Thersite contre Agamemnon dans le chant II de l’Iliade. C’est Sarah Netanyahou qui a tenté, tant bien que mal, de se mettre dans les chaussures d’Ulysse en réinstallant un pouvoir ébranlé. En disant à Elhanan Danino qu’il ne faisait que répéter ce qu’on lui disait de dire, donc qu’il était un canal instrumentalisé et pas un sujet parlant en son nom propre, elle a tenté de couper ce lien intime qui reliait avec éclat un sujet et une parole de vérité.
Les propos du Rav Elhanan Danino à Benjamin Netanyahou comptent parmi ces « discours corrosifs » qui subvertissent les performances de l’autorité. Contrairement à ce que disait Hanna Arendt sur la disparition de l’auctoritas dans la vie politique moderne, Bruce Lincoln montre que ses performances sont simplement de plus en plus couteuses et sophistiquées, et que si l’autorité doit se faire séduction (et donc se travestir), elle n’en continue pas moins d’exister dans la modernité politique telle qu’elle a toujours existé.
Cultiver l’esprit de résistance pour le présent et les temps troubles encore à venir
Je voudrais finir cette réflexion sur une ouverture plus générale liée aux pratiques collectives de résistance et à la puissance destituante des toutes petites choses qu’on fait pour la beauté du geste, pour l’honneur, pour la forme, parce que sinon on crève, parce que nous sommes des êtres de symboles et de mots, de traditions et de récits, de polyphonie et de résistance.
Ce qui caractérise une situation politique autoritaire peut souvent se résumer par la règle suivante : il existe une relation inversement proportionnelle entre le caractère ridicule de la faute et la violence étatique ou policière qui s’exerce contre elle pour la réprimer. Plus la faute est vétilleuse (porter une pancarte blanche vide de toute écriture pour une vieille dame russe au début de l’offensive russe en Ukraine), un sourire (dissident iranien avant sa pendaison), rester assis dans un parc avec une affiche d’otage du Hamas et se voir arrêté (Israël, ici et maintenant), plus elle rend visible et expose un fait nu : ce que le pouvoir réprime n’est pas tant un acte particulier que l’acte intime de résistance, la manifestation d’une indisponibilité radicale aux griffes du pouvoir, d’une liberté.
Or, plus la démocratie, formelle ou réelle, est encore importante, moins la répression peut se faire nue et brutale : elle doit a minima s’habiller de quelques formes, insidieuses, donc souvent juridiques.
Reste qu’il existe une supériorité structurelle de la créativité humaine sur tout droit fondé sur la persécution des dissidents. Alexandre Zinoniev, dans les Hauteurs Béantes, imagine la situation suivante : Soit un texte A, qui peut être qualifié d’hostile à la société (texte anti) par application d’un système de règles juridiques B. L’auteur N de A pourra être poursuivi. Mais, demande Zinoniev : « Quelle sera donc la nature d’un texte de type « N affirme que A » du point de vue de B ? Serait-ce un texte « anti » ? Parfait, mais alors, que dira-t-on du procureur lorsqu’il m’accusera au tribunal d’affirmer « N affirme que A » ? Que cet homme prononce un texte « anti » ? Non ? et pourquoi ? Où sera le critère formel qui permettra de nous distinguer ? (…) Faites-moi un code B qui contienne des lois qui permettent d’apprécier des textes comme anti, et je me fais fort, d’élaborer, à partir de n’importe quel texte anti, un texte qui ne pourra pas être jugé tel d’après B, mais qui sera de toute façon compris comme un texte d’opposant. Tout droit rigoureux est a priori une possibilité d’opposition ».

L’humour, le second degré, le métalangage, les non-dits, les antiphrases sont autant de caractéristiques du génie humain qui restent inaccessibles, bien souvent, à la répression et qui permettent, toujours, la résistance, aussi symbolique qu’elle soit.
Le cas israélien est intéressant à cet égard puisque le chef prend soin de sous-traiter et déléguer à d’autres la violence de la répression orientée contre les citoyens, à un Itamar Ben Gvir ministre de la Sécurité intérieure, à la police dont il a gangrené l’intégrité jusqu’à la moelle, mettant entre sa personne et la violence exercée plusieurs échelons, de sorte que tout le monde sache qu’il en est la source sans que jamais il ne la revendique clairement. Il convient donc que nous Israéliens, par ethos citoyen tout autant que par volonté de survivre debout et libres, cultivions et chérissions ce décalage et cette indisponibilité radicale à l’emprise du pouvoir, en créant des images et des émotions collectives, en investissant des postures et en exerçant notre corps citoyen : la marche, le sit-in, le bras levé.
Cette image d’une manifestante à pancarte « Seuls les gouvernants faibles traitent leurs citoyens en ennemis » debout entre deux policiers à chevaux qui se font face comme des lamassus assyriens est très puissante. Car rien n’effraie plus un pouvoir autoritaire qu’une phrase affutée trempée dans la douleur du vrai, ou que l’humour du désespoir qui défie l’arbitraire d’un sourire en coin ou d’une citation des sources sacrées.
Je finirai sur un souhait qui est aussi une bénédiction.
Que les menaces sécuritaires extérieures ne nous fassent jamais oublier la démocratie à chérir, la justice à poursuivre. Il faut survivre, certes. Mais il faut aussi vivre et que les autres vivent.
Que chacun et chacune d’entre nous trouve son langage de vérité comme Elhanan Danino et toute sa famille ont trouvé le leur, Amen.
Noémie Issan-Benchimol
Notes
| 1 | On trouvera ici la transcription intégrale de l’échange. |
| 2 | Le fait que ce soit aussi à l’endeuillé d’ouvrir la discussion casse la fluidité des échanges habituels. Le visiteur n’est pas censé parler en premier. |
| 3 | Voir Moshe Halbertal, “Job the Mourner” dans The Book of Job: Aesthetics, Ethics, Hermeneutics, Walter de Gruyter, 2015, pages 37-46 |
| 4 | Dans sa série de conférences « Discourse and Truth » donnée à l’Université de Californie à Berkeley en 1983, publiée plus tard sous le titre « Fearless Speech », Michel Foucault fournit une définition détaillée de la parrhèsia : « La parrhèsia est une sorte d’activité verbale où le locuteur a un rapport spécifique à la vérité par la franchise, un certain rapport à sa propre vie par le danger, un certain rapport à lui-même ou aux autres par la critique…, et un certain rapport à la loi morale par la liberté et le devoir. Plus précisément, la parrhèsia est une activité verbale dans laquelle un locuteur exprime sa relation personnelle à la vérité, et risque sa vie parce qu’il reconnaît la vérité comme un devoir d’améliorer ou d’aider les autres (ainsi que lui-même). Dans la parrhèsia, le locuteur utilise sa liberté et choisit la franchise au lieu de la persuasion, la vérité au lieu du mensonge ou du silence, le risque de mort au lieu de la vie et de la sécurité, la critique au lieu de la flatterie et le devoir moral au lieu de l’intérêt personnel et de l’apathie morale. » |
| 5 | « Parrhèsia, étymologiquement, c’est le fait de tout dire (franchise, ouverture de parole, ouverture d’esprit, ouverture de langage, liberté de parole). Les Latins traduisent en général parrhèsia par libertas. C’est l’ouverture qui fait qu’on dit, qu’on dit ce qu’on a à dire, qu’on dit ce qu’on a envie de dire, qu’on dit ce qu’on pense pouvoir dire, parce que c’est nécessaire, parce que c’est utile, parce que c’est vrai » Herméneutique du Sujet, Paris-Gallimard-Seuil, 2001, page 348 |
| 6 | Sur le concept de tokhekha dans la pensée rabbinique et ses relations possibles à la parrhèsia, voir Matthew Goldstone, The Dangerous Duty of Rebuke: Leviticus 19:17 in Early Jewish and Christian Interpretation, Brill, 2018 |
| 7 | Bruce Lincoln, Authority : Construction and Corrosion, Chicago University Press, 1994 |