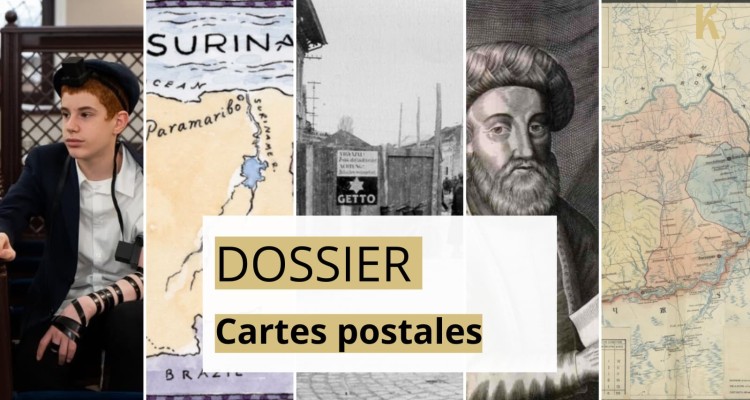Les élections italiennes qui viennent de se dérouler marquent une première. Pas seulement parce que jamais une femme n’avait accédé au poste de premier ministre en Italie ; mais surtout parce que jamais le parti à la tête de la majorité relative n’avait été une force politique héritière – plus ou moins directement – de la tradition fasciste. Dès lors, la question se pose : la consécration de Fratelli d’Italia représente-t-elle un danger pour les Juifs italiens ?

La question a été plus ou moins explicitement posée tout au long de l’été. Elle a couru de bouche en bouche dans d’interminables conciliabules, dans les foyers, dans les bars, sous les parapluies, dans d’innombrables bavardages. L’inquiétude, il faut le dire d’emblée, était là, palpable au sein d’une grande partie de la minorité juive. Parce que celle-ci participe pleinement à la vie publique du pays, cette inquiétude témoigne d’abord certainement d’une préoccupation générale quant au destin de l’Italie. C’est celle qui s’est exprimée dans la seule note officielle émise par l’Ucei (l’Union des communautés juives italiennes) après la chute du gouvernement dirigé par Mario Draghi, le 21 juillet. La note visait à dissiper la crainte des institutions que les nouvelles élections se tiennent à la veille de Rosh Ha-Shana (dimanche 25 septembre). Mais elle manifestait aussi une « inquiétude sur la situation du pays, lequel connaît une profonde crise politique venant s’ajouter aux très graves problèmes économico-financiers, sociaux et humanitaires auxquels le gouvernement et les plus hautes institutions étaient confrontés. » En bref, il y avait, et il y a toujours, la perception que les nouveaux dirigeants à venir ne seraient probablement pas plus en mesure de gérer la véritable tempête politique, économique et énergétique que l’exécutif dirigé par l’ancien Président de la banque centrale estimé dans le monde entier.
Au-delà de ces préoccupations communes pour le présent et l’avenir immédiat, il y a d’autres raisons qui agitent plus particulièrement la minorité juive. Ces raisons tiennent davantage à un passé qui n’est jamais tout à fait passé – celui des vingt années de fascisme dont le point culminant fut marqué par les lois raciales, la guerre et la Shoah – et dont les plaies ouvertes recommencent à suppurer dès que réapparaissent des images, des dates, des slogans ou des gestes « d’un autre temps ».
Slogans et images
Si le fascisme est désormais « relégué aux livres d’histoire » et n’a rien à voir avec le visage de Fratelli d’Italia, comme l’a affirmé à plusieurs reprises Giorgia Meloni – en invoquant notamment son âge (elle est née en 1977) et celui du parti (2012) – pourquoi la « signature » que représente la flamme tricolore reste-t-elle bien en vue au cœur de la symbolique de son parti ? Hommage au corps spécial des Arditi de l’armée royale italienne, selon certains plus directement à la tombe du Duce Benito Mussolini, cette flamme est une référence incontournable de la tradition politique postfasciste depuis 1947. Pendant des décennies, elle fut le symbole du Movimento Sociale Italiano (MSI), puis de son héritier, l’Alleanza Nazionale (AN), ainsi que d’une autre frange ouvertement néo-fasciste qui en fit non seulement son symbole mais aussi son nom (Movimento Sociale Fiamma Tricolore). Les nombreuses demandes adressées à Meloni pour que cette image soit retirée de la symbolique du parti – dernièrement encore, par Liliana Segre, rescapée d’Auschwitz et sénatrice à vie – sont restées lettre morte : son poids historique et électoral étant manifestement trop important ; tout comme la reprise explicite du triptyque clé de la culture fasciste – « Dieu, patrie, famille » – crié depuis la scène d’une manifestation en novembre 2019 qui a donné le coup d’envoi de l’ascension politique et populaire de la candidate : « Je suis Giorgia, je suis une mère, je suis une chrétienne » ; tout comme l’appel constant, enfin, à la défense des frontières et de l’intérêt national par les vrais « patriotes ».
Noms et gestes
Ceux qui sont prêts à croire à la bonne foi et aux assurances de Giorgia Meloni risqueraient, s’ils jetaient un coup d’œil dans les coulisses de Fratelli d’Italia, d’avoir le vertige. Une promenade virtuelle parmi les membres du parti à Milan suffit pour s’en faire une idée. Un leader – qui l’a rejoint après un long militantisme au sein du MSI puis à la direction de l’AN – et l’un de ses cadres à Milan malgré son origine sicilienne est Ignazio La Russa. Deuxième prénom : Benito. Son frère Romano, moins connu mais à la trajectoire politique similaire, a fait la une des journaux dans les derniers jours de la campagne électorale. Quelques jours avant les élections, Romano La Russa assistait à l’enterrement d’un célèbre représentant de l’extrême droite milanaise, Alberto Stabilini, et lui rendait hommage, ainsi qu’à d’autres anciens « camerata » (camarades), en levant le bras droit dans des salutations romaines répétées, au cri de « Presente ! » Pour éviter tout risque de désorienter l’électorat nostalgique, Fratelli d’Italia a donc choisi, dans une importante circonscription milanaise pour l’élection au Sénat, de présenter Mme Isabella Rauti. Un patronyme qui parle très clairement aux sympathisants d’extrême droite : son père Pino Rauti a été jeune volontaire dans la République sociale italienne (retranchement nazi-fasciste en Italie du Nord après l’armistice de 1943), puis fondateur du mouvement Ordine Nuovo, avant d’être, de 1995 à 2002, le secrétaire de Fiamma Tricolore. Un néo-fasciste pur et dur, en somme. Tout en maintenant une ligne politique nettement plus discrète, Isabella a elle-même grandi dans les cercles de l’extrême droite sociale, et il ne semble pas qu’elle n’ait jamais pris ses distances avec les idéaux de son défunt père. La circonscription dans laquelle Fratelli d’Italia l’a désignée est celle dans laquelle le Partito Democratico (PD) avait déjà choisi de présenter Emanuele Fiano, fils d’un survivant italien d’Auschwitz bien connu et ancien président de la communauté juive de Milan. Il y a un an à peine, le journal en ligne Fanpage.it avait documenté par vidéo les coulisses inquiétantes de la campagne du parti pour les élections municipales : blagues sur les Juifs et les migrants, salutations romaines, volonté de recevoir des financements occultes. Y apparaissait le rôle important d’un personnage tel que Roberto Jonghi Lavarini, le « Baron noir », déjà condamné par le passé pour avoir fait l’apologie du fascisme et dirigeant, de son propre aveu, d’un groupe de soutien et de pression sur les partis de droite comprenant des francs-maçons, d’anciens militaires, des membres des services secrets et des représentants étrangers unis par un cœur « noir ».

Dates
L’approche d’une date clé de l’histoire italienne – le centenaire de la Marche sur Rome (la descente en armes des escadrons fascistes dans la capitale qui a contraint le roi de l’époque, Victor Emmanuel III, à céder la direction du gouvernement à Benito Mussolini) – ne contribue certainement pas à dissiper les inquiétudes, rationnelles et irrationnelles. Le 28 octobre 1922 marque le début d’une ère fasciste de plus de vingt ans. Personne ne craint sérieusement que l’arrivée de Giorgia Meloni au Palazzo Chigi – presque exactement cent ans plus tard – représente une répétition de ce malheureux événement. Mais cet anniversaire, marqué par une profusion d’essais, de romans, de documentaires et de pièces de théâtre, soulève à nouveau la question de la relation non résolue entre le peuple italien, et en particulier ses classes dirigeantes, et le régime fasciste : l’ont-ils subi, en endurant toutes ses conséquences, comme le voudrait un récit dominant simpliste, ou se sont-ils bel et bien laissés séduire par celui-ci et l’ont-ils soutenu – au-delà même des contraintes évidentes imposées par un régime autoritaire ? Une question similaire se pose en ce qui concerne le choix politique du Duce de mettre en place un antisémitisme d’État à partir de 1938, avec l’adoption des lois raciales comme prémisses à la déportation massive. Les deux questions appellent une réponse délicate et complexe, et le débat sur le sujet reste ouvert chez les historiens. Mais c’est précisément à eux qu’il se limite pour l’essentiel, tandis que chez les simples citoyens et les hommes politiques un jugement hâtif prévaut qui ne coïncide pas avec celui des Juifs italiens. Outre la fragilité historico-émotionnelle liée à ce passé, un autre anniversaire approche, celui du 9 octobre, qui marquera le 40e anniversaire de l’attaque de la synagogue de Rome – fruit d’une autre époque et de dynamiques politiques étrangères, mais sur lequel des questions troublantes n’ont jamais cessé de planer quant à la possible connivence de certaines parties de l’État italien, comme on l’a déjà raconté dans K.
A la recherche d’un interlocuteur politique
Les faits et références mentionnés ci-dessus sont connus de pratiquement tout le monde. Les squelettes dans le placard de Fratelli d’Italia – symboles, slogans et membres de l’appareil dirigeant du parti qui sentent sans aucun doute le néo-fascisme – ont fait l’objet de nombreuses conversations pendant des mois. Et pourtant, à l’accueil de la victoire de Giorgia Meloni et en attendant de voir le cycle politique qu’elle ouvre, les juifs italiens sont divisés (quelle nouvelle, diront certains !).
Pour le comprendre, il convient de rappeler, brièvement, les « pérégrinations » politiques et électorales des Juifs italiens au cours du dernier siècle et demi. Entre la fin du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle, portés par la vague d’enthousiasme pour la pleine « rédemption civile » après l’enfermement historique dans les ghettos et poussés par les passions politiques de l’époque, les Juifs italiens se sont divisés pour soutenir et souvent s’engager dans toutes les grandes familles politiques : libéraux, socialistes, communistes et, plus tard, fascistes. Chacune d’entre elles répondait, pour les Juifs italiens, à titre individuel ou pour les groupes politico-culturels organisés, au besoin de voir leurs idéaux ou leurs intérêts pleinement représentés.

Après avoir subi persécution et déportation sous le fascisme, le dur réveil des Juifs italiens s’est traduit politiquement par un long rejet de toute proposition venant de la droite. D’ailleurs, d’un point de vue général, l’incarnation « pure » de la droite – le MSI – a été considérée comme insupportable et indésirable tout au long de la guerre froide, et donc soigneusement maintenue en marge du système politique par une grande partie de l’establishment et de l’électorat italiens. Dans l’immédiat après-guerre, ceux qui ont le mieux interprété le besoin de protection des Juifs italiens, et en même temps leur sympathie pour la cause du tout nouvel État d’Israël, sont principalement des socialistes, des communistes et des actionnistes (héritier de la tradition partisane laïque-libérale, le Partito d’Azione, qui se dissout dans le Parti républicain dès la fin 1946). Mais dès 1952, comme le reconstitue en détail Matteo Di Figlia dans son ouvrage Israël et la gauche en Italie [Israele a sinistra. Gli ebrei nel dibattito pubblico italiano dal 1945 a oggi, Donzelli Editore, 2012], le soutien de l’Union soviétique à la cause palestinienne a commencé à fissurer l’axe politique entre les Juifs et la gauche italienne. La rupture définitive – ou du moins le début d’une relation beaucoup plus tourmentée – devait avoir lieu en 1967, la guerre des Six Jours ayant ébranlé le modèle israélien aux yeux d’une grande partie de l’éventail politique italien, notamment le Parti Communiste Italien, mais aussi le Parti Socialiste Italien et les chrétiens-démocrates au pouvoir. À partir de cette césure historique, pour une partie du monde juif italien, la recherche d’autres options politiques s’est ouverte.
Par ailleurs, la composition démographique de la communauté juive italienne a commencé à changer à partir de ces mêmes années d’après-guerre. À la communauté historique des Juifs italiens qui avait participé pendant des siècles au destin du pays, s’est progressivement ajoutée une population croissante de réfugiés juifs originaires de divers pays où ils n’étaient plus les bienvenus : l’Égypte, l’Iran, le Liban et surtout la Libye. En raison de leur origine et de leur parcours, ces nouveaux groupes n’avaient nécessairement pas la mémoire intense des persécutions subies par les Juifs italiens, mais beaucoup plus celle des persécutions subies dans les pays islamiques.
Ainsi, au fil des années et de ces changements sociaux et géopolitiques, les Juifs italiens se sont divisés en deux groupes – ou du moins en deux tendances dominantes – qui semblent encore aujourd’hui caractériser leur situation générale : un bloc purement italien, souvent plus laïc et plus intégré, pour qui la valeur politique suprême à défendre dans l’espace public est l’antifascisme (avec comme corollaire historique la mémoire de la Shoah et la défense des droits de toutes les minorités), et un bloc d’origines plus variées, plutôt religieux, pour qui la valeur politique suprême à défendre et à promouvoir est le soutien à Israël (avec comme corollaire une préférence générale pour les politiques plus conservatrices). Il ne s’agit néanmoins pas de se figurer le paysage du judaïsme italien comme un terrain de football où s’affrontent deux équipes: il y a une osmose et des nuances, les deux « camps » valorisant également la préoccupation principale de l’autre. Mais le clivage fondamental existe et il se situe sur ces lignes directrices.
Dans les années 1970 et 1980, les seuls acteurs qui pouvaient offrir une réponse à ces Juifs italiens à la recherche d’options politiques « autres » que les trois grandes familles considérées comme anti-israéliennes étaient de petits acteurs tels que le parti républicain, le parti libéral ou les radicaux. Tout a changé à partir de 1993-94. L’effondrement du système politique de la Première République a mis en lumière le nouveau parti « plastique » de Silvio Berlusconi : moderne, optimiste, libéral, dépourvu de tout conditionnement idéologique, il est apparu à des millions d’Italiens – et à une partie non négligeable des Juifs – comme la nouveauté tant recherchée. Depuis lors et jusqu’à aujourd’hui, la bête politique créée par Berlusconi – qui défendit aussi une solide position pro-américaine et pro-israélienne pendant ses années au gouvernement – a représenté une option politique viable pour une partie des Juifs italiens. Par ailleurs, la disparition du PCI et du PSI et l’émergence à leur place d’un centre-gauche moderne, qui a adopté au fil des ans une ligne de plus en plus équilibrée sur le dossier israélo-palestinien, a permis un « retour » serein d’une bonne partie du vote juif progressiste.

Combien cela coûte de couper des ponts ?
Plus délicate et complexe est l’affaire impliquant Gianfranco Fini, le leader de l’Alleanza Nazionale, qui a été le protagoniste du tournant politique le plus significatif de la droite italienne. Ayant rejoint le camp de Berlusconi en 1993 (lorsqu’il s’est présenté à la mairie de Rome), Fini a tout misé sur la « normalisation » progressive de la droite italienne. En 1995, il a conduit le parti au fameux « tournant de Fiuggi », qui a fait basculer le vieux MSI vers la nouvelle Alleanza Nazionale, fondée – du moins théoriquement – sur le reniement du fascisme considéré comme une erreur historique. Fini a voulu orienter son parti en direction d’une droite conservatrice moderne. Les Juifs italiens sont restés prudents, peu convaincus de l’authenticité de la « conversion » – notamment parce que les contradictions et les nostalgies au sein du parti sont restées évidentes. Mais pour Fini, qui aspirait ouvertement à prendre la tête du centre-droit italien une fois le leadership de Berlusconi terminé, l’achèvement du processus de normalisation est devenu l’objectif central de son action politique. En 2001, après avoir obtenu le poste presque suprême de vice-premier ministre, il a donné une nouvelle forme à sa « conversion » en s’investissant personnellement dans la construction de nouvelles relations avec les représentants de la communauté juive (le président de l’Ucei est alors le médecin, écrivain et intellectuel de gauche Amos Luzzatto) et avec les autorités israéliennes. La clé de voûte de sa longue opération de remaniement historique et de légitimation politique fut son voyage à Jérusalem en novembre 2003. Après sa visite à Yad VaShem, Fini a prononcé une abjuration historique et « définitive » du fascisme qualifié de « mal absolu ».
Aujourd’hui comme à l’époque, ce tournant divise les juifs italiens. Il y a ceux qui y reconnaissent le point de maturité tant attendu de la droite, au point pour certains de pouvoir voter pour l’Alleanza Nazionale et même s’y engager personnellement. Il y a les autres qui estiment devoir tirer la sonnette d’alarme devant ce qu’ils envisagent comme une démarche purement « formelle » de Fini, liée à sa trajectoire politique, et que le parti ne suivrait pas vraiment.
L’actualité relative à Giorgia Meloni et à ses Fratelli d’Italia est en fin de compte, pour le meilleur ou pour le pire, enracinée dans ces mêmes convulsions de la droite post-fasciste. Pour le « pire », car lorsqu’en 2012 Meloni et d’anciens leaders de premier plan de l’Alleanza Nazionale ont fondé ce nouveau parti, il s’agissait assez explicitement de reconquérir un électorat de droite nostalgique des idéaux « patriotiques » perdu à cause d’un glissement excessif vers le centre. Les électeurs et les cadres du parti qui n’avaient jamais avalé le tournant moderniste de Fini, y compris son abjuration totale du fascisme, pouvaient trouver un foyer politique représenté au Parlement. C’est ce qui explique les mille obstacles « locaux » auxquels se heurte de manière flagrante la nouvelle normalisation recherchée par Meloni. Mais elle est néanmoins aussi inscrite, d’une certaine manière, dans la voie du « meilleur » ouverte par Fini, si l’on peut dire. Après avoir inauguré sa campagne électorale en publiant une vidéo en trois langues dans laquelle elle condamnait la suppression de la démocratie par Mussolini et les « fameuses » lois raciales, Meloni l’a close en répondant à une énième question sur sa relation avec l’héritage du fascisme par ces mots : « J’étais à l’intérieur de l’Alleanza Nazionale quand Fini l’a défini comme un « mal absolu », et et il ne me semble pas m’être dissociée [de sa position]. »

Vote de confiance
Suffit-il à la jeune future première ministre et à son parti de se prévaloir de ce bouclier politique ? La question de la « digestion » du résultat politique du dernier scrutin par les Juifs italiens se pose là en ces termes. Ainsi que les divisions qui en résultent. « Tout ce que Giorgia Meloni a réussi à faire, c’est se référer à d’autres discours de la droite italienne, proposés par Gianfranco Fini lorsqu’il était secrétaire d’Alleanza Nazionale : mais c’est Fini, responsable il y a de nombreuses années d’un autre parti, et non elle, responsable aujourd’hui de Fratelli d’Italia, qui a prononcé ces discours et a donc peut-être tenu compte de ce passé », a récemment écrit, dans Pagine Ebraiche, David Sorani, professeur d’histoire et de philosophie à Turin et ancien directeur de la revue juive de gauche HaKeillà. Il conclut que « le problème de l’ignorance fondamentale et de l’absence d’un sentiment de repentance authentique à l’égard de la réalité historique de long terme du régime fasciste et de sa signification est toujours présent aujourd’hui, car l’attitude sur cette question témoigne d’une suffisance, comme si cette dernière ne concernait pas du tout la dirigeante et son parti, dont les représentants – à commencer par elle-même – sont tous trop jeunes pour être directement responsables et semblent donc naturellement exempts du mal. Mais c’est faux, car la connivence avec les milieux pro-fascistes demeure dans certains secteurs du parti, tout comme, obstinément et « on ne sait pourquoi », le symbole de la flamme tricolore pour rappeler le sombre passé qu’il prétend avoir répudié ».
Avant les élections, Ester Mieli, journaliste et ancienne porte-parole de la communauté juive de Rome, candidate (et maintenant élue) au Sénat dans les rangs de Fratelli d’Italia, avait exprimé une opinion très différente au Corriere della Sera : « Le prochain Parlement sera élu sur les valeurs fondatrices de notre Constitution, nées de la Libération. Je fais confiance à Giorgia Meloni parce qu’elle est cohérente ». Walker Meghnagi, le président de la communauté juive de Milan, a quant à lui, bien qu’« involontairement », donné du crédit politique à Fratelli d’Italia. Il a certes refusé de participer à une conférence du parti à laquelle il était invité dans sa ville au printemps dernier, mais il a écrit, dans un message personnel aux dirigeants du parti, qu’il « [suivait] avec attention l’évolution de la droite politique italienne, qui n’a jamais manqué de se ranger du côté d’Israël en politique étrangère et qui est en première ligne pour condamner la Shoah et les horribles lois raciales ». Il ajoutait qu’il se réjouissait « de savoir que nous partageons un même amour pour la valeur de la liberté et un regard commun vers l’avenir, tout en sachant préserver les traditions et l’identité qui distinguent chaque peuple ». Publiée dans la presse, la lettre a provoqué une tempête, menant la communauté au bord de la crise politique. Meghnagi a alors revendiqué le caractère privé du message, soulignant qu’il était convaincu que « bien qu’elle fasse preuve de proximité avec l’État d’Israël et qu’elle ait progressé dans sa prise de conscience de l’histoire de la Shoah, [la droite] a encore un grand besoin de se débarrasser de ses dangereuses franges extrémistes. »
Il est évident qu’une partie de la communauté juive italienne – cette réalité à multiples facettes décrite plus haut – accorde du crédit aux propos rassurants de Giorgia Meloni et ne craint pas l’arrivée de Fratelli d’Italia au gouvernement, la considérant peut-être même comme un pas décisif vers une plus grande normalisation de la droite italienne. Les efforts prolongés déployés par Meloni pour rassurer cet électorat au cours des derniers mois peuvent être considérés comme une réussite partielle dans ce sens.
Les tirades répétées de la droite post-fasciste sur leur « réussite à l’examen d’histoire » ne sont pas près de s’arrêter, ni auprès de l’opinion publique juive, ni en général. Mais des réponses claires devront bientôt être apportées, qui portent sur la concrétisation du crédo de Fratelli d’Italia dans le contexte politique européen actuel. « Giorgia Meloni est une femme politique compétente et préparée, et je ne vois pas dans sa consécration de risque quant à la préservation des institutions démocratiques », a déclaré pour K., Daniele Nahum, conseiller municipal milanais issu du PD. Celui-ci a observé de près l’ascension de la dirigeante, en tant que président de l’Union des jeunes juifs d’Italie, dans les années où Meloni était ministre de la jeunesse. Il ajoute que « la question cruciale à laquelle elle est confrontée est plutôt de savoir comment elle pourra concilier sa posture multipliant les « garanties » vis-à-vis de l’UE et surtout des États-Unis avec sa proximité avec les idées de Viktor Orbán, des Polonais du Pis ou des Espagnols de Vox ». Sur les droits des minorités, pas seulement des Juifs, et sur le strict respect de l’État de droit, quelle ligne le prochain gouvernement Meloni choisira-t-il ? Sur ce point, des réponses claires seront bientôt apportées. Les Juifs italiens, et européens, seront les premiers à y être attentifs.
Simone Disegni
@simo_disegni