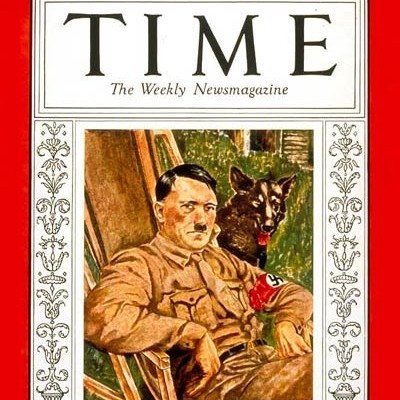« L’État d’Israël est né en tant qu’État juif. C’est la décision du peuple et la question ne porte pas sur l’identité de l’État. Il est né comme ça et il restera tel ». Cette petite phrase a été prononcée le 22 décembre 2021 par Mansour Abbas, député arabe d’un parti islamiste et ministre délégué au cabinet du Premier ministre israélien. Noémie Issan-Benchimol et Elie Beressi nous en rendent le contexte et l’analysent comme un moment qui fait césure dans l’histoire de la vie politique israélienne.

La scène, en Israël, avait quelque chose de surréaliste, voire de comique pour un œil européen : un dirigeant islamiste sur une chaise, balancé par ses militants comme si c’était sa bar-mitswa, sur fond de musique arabe, le tout dans un nuage de bannières du mouvement islamique, que d’aucuns, trompés par le fond vert et la calligraphie arabe communs à de nombreux drapeaux islamiques, ont cru être des drapeaux du Hamas. Cette célébration fêtait l’entrée des partis arabes dans le jeu gouvernemental israélien. Pour saugrenue que puisse paraître cette scène, elle saisit quelque chose de la réalité politique, sociale et religieuse de l’Israël contemporain et de tout ce qui y déjoue les lectures binaires, manichéennes, iconographiquement faciles. Les suprémacistes juifs y voient une aberration, le ver dans le fruit d’un trop plein de démocratie. Et beaucoup d’observateurs européens voient tout simplement planter leur logiciel de lecture de la situation israélo-palestinienne.
Car en Europe, la lecture idéologique surdétermine tout. Or il s’agit ici précisément d’une situation de suspension de la surdétermination idéologique permettant une politique de l’arrangement, de la composition. Il peut sembler surprenant de parler de composition et d’arrangement dans ce qui est l’une des situations géopolitiques les plus surchargées d’identités, de valeurs sacrées, d’imaginaires nationalistes exclusifs. Et pourtant, force est de constater que ces identités épaisses et multiples qui se font face dans les découpages de la situation permettent aux minorités, statistiques ou imaginaires (ainsi, les Juifs en Israël, quoiqu’en majorité tant statistique que politique, se vivent et se conçoivent comme minoritaires, en vertu de leur héritage historique comme de leur situation régionale), des jeux de recompositions transactionnelles, qui se construisent sur fond de décision de confiance, ou encore de coûts et de gains mutualisés.
Il y faut en effet le choix de la confiance assortie de garanties. Mais il y faut surtout des sacrifices symboliques, de la part de ceux qui reconnaissent et intègrent la perspective de l’autre, de ceux qui sont liés à la reconnaissance de l’existence de l’autre. Naftali Benett, premier ministre de cette coalition faite de bric et de broc, venant du camp sioniste religieux a payé et paie encore son choix de diriger une coalition qu’un islamiste pouvait faire exister, ou faire éclater, par les accusations de traîtrise à l’idéologie de son camp. Dans ce contexte, on peut dire que Mansour Abbas, lui, a fait encore plus fort.
En politique, on sait que toutes les petites phrases ne se valent guère. Il y a celles qui feront l’actualité du jour mais seront oubliées aussi vite, il y a celles qui embrasent le discours et deviennent des signalétiques démarquant les positions et les camps. Et puis il y a celles qui font l’Histoire, ou en tout cas qui en ont la potentialité, celles qui marquent le moment liminal entre un avant et un après. C’est le cas de la petite phrase prononcée le 22 décembre 2021 par Mansour Abbas.
C’est au cours d’une conversation avec un journaliste dans le cadre de la conférence Globes Israel Business qu’il a dit l’impensable, prononcé l’impossible. Ce jour-là, il a accordé ce qu’aucun responsable politique arabe ou palestinien n’avait donné avant lui.
L’homme des premières fois
Lui, le premier député arabe d’un parti islamiste à siéger dans la coalition gouvernementale et plus seulement dans l’opposition, a en effet dit ceci : « L’État d’Israël est né en tant qu’État juif. C’est la décision du peuple et la question ne porte pas sur l’identité de l’État. Il est né comme ça et il restera tel ».
Le ton avait beau être réaliste, la phrase ponctuée d’un air de regret, précisant que la campagne du parti avait été fondée sur le pragmatisme qui ne vend ni rêves ni illusions à ses électeurs, la ligne était franchie. Son interlocuteur à la conférence de Globes, Mohamed Magidli[1] a immédiatement compris qu’il avait affaire là à rien moins qu’une capitulation symbolique, et à la définition d’un nouveau cadre d’action pour la population arabe d’Israël : acceptation du cadre étatique, renonciation à la Palestine « de la Mer au Jourdain », redéfinition du groupe comme une minorité arabe au sein d’une majorité juive, et surtout abandon (momentané ?) du vocabulaire de la lutte de libération nationale au profit d’un discours sur les droits des minorités dans le cadre démocratique.
Regardons la petite phrase. Si la première partie pouvait encore passer pour une constatation ou l’énonciation d’un fait historique, il demeure que la seconde partie résonnait bien comme une prédiction sur le long terme : Israël n’est pas près de disparaître, il faut composer avec ce fait et abandonner la pensée magique. Questionné sur le fait qu’il lâchait en toute décontraction rien moins qu’une bombe, Mansour Abbas a certes répondu en réaffirmant son opposition à la Loi Etat-Nation (Hoq Ha-Lé’om), mais en maintenant le cadre israélien comme chantier d’action possible et accessible : « J’étais à une manifestation contre la loi sur l’État-nation, et je ne veux induire personne en erreur. La question est de savoir quel est le statut d’un citoyen arabe dans l’État juif d’Israël. Telle est la question. Et donc le défi maintenant n’est pas seulement pour Mansour Abbas, mais pour le public juif et le citoyen juif. Nous devons décider si nous voulons nous engager dans des campagnes qui ont une chance de réussir, et alors nous pourrons nous développer en tant que société et prospérer, et être une section de la société avec de l’influence, ou si nous voulons être dans une position isolationniste et continuer à parler de toutes ces choses pendant encore cent ans. »[2]
L’interprétation de l’énoncé a varié selon l’œil et les inclinaisons des observateurs. Tous ont été d’accord pour constater qu’un tabou avait été levé, mais les avis ont divergé quant à savoir si c’était une bonne chose ou non. Épiphanie proto-messianique pour certains sionistes religieux (« Voyez, un islamiste reconnaît l’existence, voire l’éternité d’Israël »), moment important pour l’intégration politique des Arabes en Israël pour les plus pragmatiques. Ajoutons que la petite phrase a également réussi à réunir contre elle à l’unanimité l’Organisation de Libération de la Palestine, l’Autorité Palestinienne, le Hamas, les partis Hadash, Balad, et Ta’al. Le fait est assez rare pour être souligné tant la division du camp palestinien est immense.
Ahmad Tibi, le député Ta’al, a choisi d’attaquer violemment son ancien allié : « Pour la première fois, un député arabe accepte la réalité de la Loi Etat-Nation basée sur la supériorité juive et l’infériorité palestinienne ». Le Hoq Ha-Le’om, que beaucoup d’analystes ont qualifié de loi superflue, à la portée symbolique vexatoire à l’égard des minorités non-juives d’Israël, réduit en effet le statut de la langue arabe à un « statut spécial », là où l’ancienne législation héritée de la période mandataire en faisait une langue officielle à égalité avec l’hébreu. Elle entérine Israël comme foyer national du peuple juif et prête effectivement le flanc à de nombreuses critiques. Toutefois, il semble qu’Ahmad Tibi, sans justification, la renvoie à un argumentaire suprémaciste et raciste. Le point est tout à fait contestable. Dans Liberalism and The Right to Culture, les philosophes israéliens Avishai Margalit et Moshe Halbertal ont par exemple défendu l’idée d’un droit humain à la culture – pas simplement à n’importe quelle culture, mais à la sienne propre. On peut considérer ainsi qu’il n’est pas incompatible avec les valeurs humanistes et libérales que l’État d’Israël ait une caractérisation juive (calendrier, perpétuation de la culture, droit hébraïque comme source et inspiration à la législation contemporaine). Du moment, en tout cas, qu’il remplit certains critères politiques.

Halbertal et Margalit ont proposé deux critères pour juger si un État-nation est « libéral-démocratique » plutôt que « fasciste-nationaliste ». Le premier est de déterminer si le caractère de l’État en tant qu’État-nation « nuit aux droits politiques, économiques ou culturels des minorités ». Le second est de déterminer si l’État « soutiendra et accordera le droit à l’auto-définition et à la détermination des autres groupes nationaux vivant en son sein ». Or c’est là qu’il faut s’arrêter. Car il faut bien convenir que le second critère est particulièrement difficile dans le cas israélo-palestinien. Reste toutefois que ces critères permettent de façon assez claire de fixer la distinction pertinente : celle entre un fait minoritaire inégalitaire et un fait minoritaire égalitaire.
Cette distinction est celle qui permet de mesurer la différence entre les positions qui nous occupent ici. Ahmad Tibi, en défendant une idée de démocratie non nationale (medinat kol ezrahkhea), alors même que, de façon contradictoire, il soutient par ailleurs le nationalisme palestinien, s’oppose au fondement même de la Loi État -Nation, à savoir à l’idée d’Israël comme État-Nation du peuple juif, tandis que Mansour Abbas se concentre sur l’obtention des critères d’égale dignité due aux minorités, sans toucher à cet égard au principe même qui sous-tend le Hoq Ha-Le’om.
D’autres, notamment au niveau du Hamas et de l’OLP n’ont pas eu les pudeurs d’Ahmad Tibi, certains promettant même à Mansour Abbas le destin d’un autre Abbas, allusion transparente à Mahmoud Abbas, accusé d’avoir « tout donné aux israéliens sans rien recevoir en retour ». La qualification de traître ou de vendu a clos dans tous les cas la discussion.[3]
L’héritier d’une tradition
Pourtant, ce récit de l’homme des premières fois ne doit pas effacer le contexte théologico-politique plus large qui a permis l’émergence du phénomène Mansour Abbas. Pour comprendre comment le phénomène a pu se produire, il convient de revenir aux origines du Mouvement Islamique en Israël, et surtout à la division profonde entre une branche dissidente nord, plus fondamentaliste et séparatiste (dans le sens descriptif du terme) opposée à la participation politique des Arabes au sein de l’État juif, et une branche sud, fortement influencée par la figure du Sheikh Abdullah Nimr Darwish et par le tournant démocratique et pacifiste de ce dernier[4]. En 1996, la décision juridique (fatwa) du Sheikh Abdallah Nimr Darwish, fondateur du mouvement, autorise les islamistes à participer aux élections, ce qui créa la fracture entre la branche nord et la branche sud – quoique cette fracture n’ait jamais été officiellement reconnue par les acteurs. Le parti de la Liste arabe unie (également connu sous son acronyme hébreu Ra’am), fut créé en tant qu’aile politique du mouvement islamiste de Darwish en 1996. La faction héritière de Darwish est particulièrement forte dans le Triangle[5] et dans le Negev, alors que la faction du Sheikh Ra’id Salah est particulièrement puissante en Galilée, et dans le triangle du Nord (Wadi Ara).

C’est après un passage en prison que le Sheikh Darwish, s’est investi dans le dialogue inter-religieux (avec le Rabbin Michael Melchior) et dans les initiatives de paix. Il décède cependant en 2017. Mansour Abbas, à bien des égards, est son héritier. Il ne manque pas une occasion de s’inscrire expressément dans cette lignée. Le 21 avril 2020, il a ainsi pu prononcer un discours historique sur la Shoah à la Knesset, dans lequel est évoquée sans détours la souffrance du peuple juif aux mains des nazis : « En tant qu’Arabe musulman palestinien religieux, qui a été élevé sur l’héritage du sheikh Abdallah Nimr Darwish qui a fondé le Mouvement islamique, j’ai de l’empathie pour la douleur et la souffrance au fil des ans des survivants de la Shoah et des familles des assassinés (…) Je me tiens ici pour montrer ma solidarité avec le peuple juif, ici et pour toujours. »
Consociativisme conservateur en Israël : où achoppe l’intersectionnalité des luttes
Mais il y a un autre versant à cette « normalisation intérieure » entre l’Etat juif et sa minorité arabe promue par Mansour Abbas : la convergence entre les segments conservateurs ou traditionalistes de la société israélienne contemporaine, et son corollaire. Au-delà de la codification d’une relation asymétrique, mais apaisée, entre la majorité et la minorité, il y a la mise en avant d’une certaine circulation des valeurs entre les représentants politiques de cultures très proches, qui fut explicitée par plusieurs figures importantes de l’Establishment juif traditionaliste en Israël.
Pour comprendre cette réalité, il convient cette fois de revenir à la fois sur les racines civilisationnelles profondes qui sont en jeu, et sur la conjoncture politique chaotique des dernières années de la période Netanyahou.
Historiquement, la société israélienne ne constitue pas un corps social et une communauté d’identités homogène, mais un amalgame de « tribus », pour reprendre l’expression de l’ancien président Reuven Rivlin : trois tribus majoritaires juives, les séculiers, les orthodoxes et les nationaux-religieux, et une tribu minoritaire essentiellement arabe[6]. Intérieurement, ces tribus sont subdivisées en une multitude de clans idéologiques et religieux. Les partis politiques, dans ces conditions, se font les représentants parlementaires d’intérêts renvoyant à ces différentes subdivisions. Historiquement néanmoins, la politique israélienne a fonctionné sur un modèle majoritaire où les négociations et la répartition du pouvoir se faisaient exclusivement entre les trois tribus juives, les partis arabes, en protestation contre l’hégémonie juive, refusant de participer au jeu des coalitions parlementaires.
Le fait est que cette organisation du partage du pouvoir connaît une évolution dans la conjoncture actuelle, avec une volonté croissante de la part des représentants arabes de s’intégrer au jeu politique, à quoi s’ajoute la convergence de certains segments du public juif avec une partie du public arabe sur des questions liées au conservatisme social. Cette nouvelle conjoncture ouvre la voie vers ce qu’on peut qualifier de tribalisme démocratique de concordance, ou encore de « consociativisme ». Entendons : un mode de gouvernance où les représentants des groupes minoritaires obtiennent un partage du pouvoir avec les groupes majoritaires en dépit des clivages identitaires et négocient le soutien de leur clientèle politique au gouvernement en échange de concessions faites à leurs intérêts sectoriels. Pour la première fois, on assiste au fait que de telles négociations s’opèrent à droite entre conservateurs juifs et arabes, à la fois pour des raisons circonstancielles et culturelles.
Les parallèles culturels entre le judaïsme rabbinique et l’islam sunnite jouent ici fortement, se traduisant dans des formes structurelles du pouvoir quasiment identiques. Les formes historiques politiques assumées par les deux civilisations pendant l’essentiel de leur coexistence historique, exilique pour le Judaïsme, et impériale pour l’Islam, ne doivent en effet pas faire oublier ces similarités : dans chaque cas, une communauté patriarcale[7] soumise à une loi divine définie comme « le chemin »[8] dont l’interprétation est confiée à une élite de lettrés à la fois théologiens et jurisconsultes, exclusivement masculins d’âge vénérable[9], enseignant à des disciples dans des institutions spécialisées[10], qui sont de facto les pôles organisateurs du corps social et les sièges du pouvoir. Ces pôles de pouvoir n’ont d’autre légitimité que l’estime collective portée au principal sage installé à sa tête, entraînant ce que l’on peut appeler dans le monde ultra-orthodoxe juif haredi un « féodalisme de yeshiva », la communauté étant divisées selon les allégeances personnelles aux divers rabbins et à leurs cours. Dans le mouvement islamiste israélien, la division passe le long de lignes tribales[11] rattachées à la cause de l’un des deux Sheikh, Darwish ou Salah’. Enfin il faut souligner la dimension sociale de la comparaison : les secteurs orthodoxes et bédouins en Israël, constituent des ensembles faisant face à de fortes difficultés économiques, une population pauvre mal intégrée au reste de la société et ne pouvant donc se former en véritable prolétariat.
Cette structure de pouvoir se trouve répercutée dans l’expression partisane affirmant représenter les secteurs traditionalistes de la société à la Knesset, le parlement israélien : l’action politique des représentants élus est supervisée par un conseil non-élu représentant les élites traditionnelles[12] assurant la direction extra-parlementaire de l’action politique.
C’est pourquoi, lorsque Ra’am s’est détaché du reste de la coalition hétéroclite des partis arabes (communistes, nationalistes) sur fond d’un désaccord concernant les droits des minorités LGBTQI+, sa coloration ethnique a été contrebalancée par sa dimension religieuse. D’importantes figures juives du monde orthodoxes ont considéré la branche sud du mouvement islamiste comme un allié naturel respectable pour la préservation de la société traditionnelle en Israël face aux mouvements de réformes, aux partis séculiers et au public occidentalisé qui les porte. Le Rav Hayyim Kanievsky, leader spirituel de l’orthodoxie ashkénaze, s’est ainsi prononcé en faveur de la participation des Arabes à un gouvernement de front commun contre la gauche : « il vaut mieux aller avec les représentants du public arabe qu’avec les représentants de gauche (…) Le caractère de l’État est également important pour eux et ils ne veulent pas promouvoir un melting-pot pour rendre tout le monde laïc. Ils sont également plus proches de nous en ce qui concerne l’enrôlement et les valeurs familiales ».

La conjoncture politique et l’opportunisme pragmatique de Mansour Abbas en aura décidé autrement : sa volonté de représenter le public arabe coûte que coûte l’a conduit à se rallier au bloc parlementaire anti-Netanyahu faisant accéder cette coalition mal assortie de partis de gauche, de centristes libéraux et de sionistes-religieux à la majorité nécessaire pour former un gouvernement.
C’est paradoxalement le très droitier Netanyahou qui a contribué à rendre cette participation acceptable en entamant des négociations avec Mansour Abbas. Consacré faiseur de roi, le leader de la faction islamiste était en position de dicter certaines conditions : les négociations entre délégués de segments de l’électorat afin d’imposer au public des compromis entre intérêts sectoriels généralement répartis le long de lignes ethniques ou idéologiques, en conformité avec l’un des traits permanents du système politique israélien, où, faut-il le rappeler, aucun parti n’a réellement d’assise de classe cohérente.
A la fois marginal et clé de voûte de la nouvelle coalition gouvernementale et ministre délégué aux affaires arabes, Mansour Abbas pouvait opposer son véto, motivé religieusement, aux futures avancées législatives en faveur des femmes et des LGBTQI+, s’opposer à l’intrusion de l’État dans les affaires bédouines, notamment sur la question délicate de la polygamie dans les tribus du sud. En se coupant du reste des partis arabes plus progressistes en matière de mœurs, Abbas avait suffisamment prouvé sa rigueur idéologique sur le sujet. Jusqu’ici, cela n’est toutefois pas arrivé : en s’abstenant de s’opposer à des avancées telles que l’ouverture de la PMA à de nouveaux publics minoritaires, il s’est mis en position d’obtenir du gouvernement des concessions sur le rattachement de maisons arabes construite sans permis au réseau électrique israélien ou dans le conflit foncier persistant entre le Keren Kayemet Le’Israel et les villages bédouins du Negev. Après les troubles récents, c’est sans doute ce dernier dossier sur lequel Abbas jouera son avenir politique, celui de sa personne tout autant que de son approche participative à la vie gouvernementale israélienne.
Quoiqu’il en soit, Abbas, par ses manœuvres politiques récentes, s’est inscrit dans l’histoire d’Israël, inaugurant la possibilité d’un consociativisme israélien de facto, alors qu’il n’existait jusqu’à présent que de jure.

Moderne ou anté-moderne ?
Que ce tournant ait été rendu possible par un Mansour Abbas, et non par une socialiste progressiste arabe vivant à Tel-Aviv (telle que Ibtissem Maarana, par exemple), voilà qui s’explique par tout ce que nous venons d’évoquer. D’aucuns peuvent le regretter, pointer du doigt les perdants de ces compositions transactionnelles qui mettent à nu le cœur égoïste de toute politique. On peut penser ici à cette Une restée dans les mémoires de Charlie Hebdo qui présentait les religieux des trois monothéismes abrahamiques réunis par leur misogynie et leurs idées patriarcales. Quoi qu’il en soit de cette pente et de ses risques, le paradoxe reste entier. C’est qu’il convient d’apprécier à sa juste mesure le progrès significatif que la tendance comporte, au regard de l’évolution ultérieure du régime israélien et de l’équilibre des pouvoirs entre les représentations d’intérêts sectoriels qui le caractérisent.
Noémie Issan-Benchimol et Elie Beressi
Noémie Issan-Benchimol, philosophe et doctorante en sciences religieuses et Elie Beressi, analyste politique.
Notes
| 1 | Premier journaliste arabe à être commentateur actualités générales sur une chaîne publique israélienne, la chaine 12, créateur de la radio nazaréenne A-Nas, Mohamed Magadli est également fils de Ghaleb Magadli, qui fut ministre israélien des sciences, des sports et de la culture avec le parti socialiste. |
| 2 | Source en hébreu et Source en anglais (traduction qui élude certaines expressions orales ou certains détails) |
| 3 | Source du Hamas anonyme citée par Mohamed Magadli dans cet article : « Mansour Abbas a perdu cette semaine le soutien de son peuple: pour quoi? », sur le site internet de Globes, le 24 decembre 2021 (en hébreu). |
| 4 | Voir Nachman Tal, « The Islamic Movement in Israel », The Institute For National Security Studies, Volume 2, Numéro 4, Février 2000. |
| 5 | Le Triangle est une concentration de villes et villages arabes israéliens proches de la Ligne verte, dans la plaine orientale de la région de Sharon. |
| 6 | Ghiles-Meilhac Samuel, « La société israélienne : vers la fragmentation ? », Politique étrangère, 2018/3 (Automne), p. 131-141. |
| 7 | (klal/’ummá) |
| 8 | (halakha/ sharīʿa) |
| 9 | (ḥakhamim / ʿulamā’et fuqahā) |
| 10 | (yeshivot / madāris) |
| 11 | (hamulot) |
| 12 | (Moetzes Gedeolei HaTorah / Majlis esh-Shura) |