Tous les massacres se ressemblent, quand on a sciemment décidé de se défaire de la précision analytique qui permettrait de les différencier. Mais où cet amour de la comparaison galvaudée, si courant aujourd’hui, plonge-t-il ses racines ? Stephan Malinowski s’emploie ici à repérer les filiations intellectuelles croisées et paradoxales dans lesquelles s’inscrit cette grande confusion.

À l’occasion de la remise des prix scientifiques à Ankara, le président turc Erdoğan a évoqué en décembre les « camps nazis » d’Israël et la différence entre Netanyahou et Hitler, qui résiderait uniquement dans la fortune de Netanyahou. Netanyahou, quant à lui, s’était illustré en 2015 en affirmant que c’était le Grand Mufti de Jérusalem qui avait poussé Hitler à assassiner les Juifs. À l’autre extrémité du spectre, celle de la science, l’influent historien spécialiste du génocide A. Dirk Moses a récemment déclaré lors d’une conférence à Berkeley que le but ultime du roman national allemand n’était pas cette fois-ci la déportation des « Sémites », mais, une fois transformé en culture mémorielle, l’assentiment à leur extermination massive à Gaza. Les comparaisons à grande échelle, qui traversent allègrement les siècles, les millénaires, les civilisations et les continents, en tirant par les cheveux des éléments de l’histoire du nazisme pour les faire entrer dans tous les contextes possibles, ont le vent en poupe.
À côté des champs de bataille politiques, polémiques, journalistiques et militants, le monde universitaire est lui aussi atteint par une pseudo-méthodologie qui repose essentiellement sur la réduction de la complexité et la décontextualisation. Depuis que les étudiants et les diplômés des universités d’élite du monde occidental louent le Hamas comme une organisation de libération et dénoncent Israël comme un régime d’apartheid dirigé par des colons « blancs », les médias s’efforcent également de plus en plus d’exposer à un lectorat désorienté une vision du monde influente dans le milieu universitaire, qualifiée de postcoloniale ou s’autoqualifiant ainsi. Lesdits courants, extrêmement influents bien qu’informes et vieux d’au moins cinquante ans, sont issus de sources universitaires, militantes et politiques.
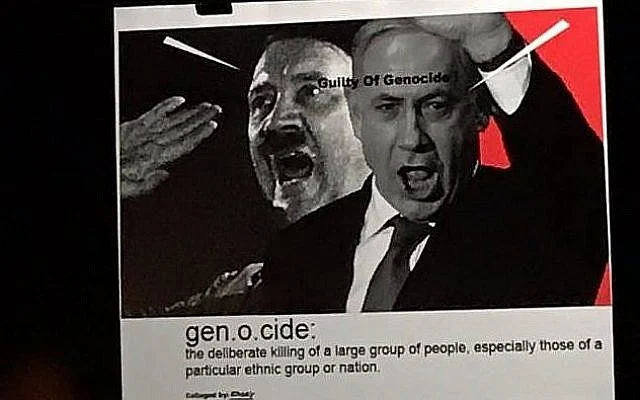
Ces deux dernières dimensions surgissent sur une scène un peu plus ancienne, qui prémunit contre le risque de considérer cette évolution comme nouvelle et qu’il semble particulièrement utile aujourd’hui d’arracher à l’oubli : dans une salle d’audience bondée au cœur de Lyon, un inhabituel quatuor d’avocats fait son apparition, dont la performance vise davantage la presse internationale venue couvrir l’événement que le banc des juges. À côté d’un avocat bolivien qui sert de figurant, un juriste algérien et un juriste congolais prononcent des plaidoiries qui viennent appuyer le charismatique protagoniste de la défense.
La Shoah serait un crime du passé, mais les crimes coloniaux s’étendraient bien au-delà, jusqu’à nos jours.
Jacques Vergès, né à la périphérie de l’empire colonial français, fils d’un médecin français et d’une mère vietnamienne, a défendu et épousé, vingt-cinq ans plus tôt, une icône de la lutte pour l’indépendance algérienne. Il a également adhéré au Parti communiste, s’est converti à l’islam, a été reçu par Mao, publié un journal anticolonialiste et défendu divers terroristes de gauche à l’échelle mondiale.
Cette « équipe d’avocats aux couleurs de l’arc-en-ciel humain », comme elle se qualifie elle-même, commente dans la salle l’assassinat de quarante-quatre orphelins juifs déportés en 1944 près de Lyon vers Auschwitz, en rappelant que, dans les camps de réfugiés palestiniens de Sabra et Chatila au Liban, sous la responsabilité de l’armée israélienne, beaucoup plus de personnes ont été assassinées en 1982. Un « Babi Yar israélien » se serait déroulé dans ces camps.
Outre les crimes contre l’humanité commis sous le régime nazi, il faudrait également mentionner les victimes de la révolte anticoloniale à Madagascar en 1947, celles de la construction du chemin de fer au Congo dans les années 1930, celles des bidonvilles de Soweto, ainsi que le million de victimes algériennes que les « nazis d’aujourd’hui » français ont tuées depuis 1954. Il n’y aurait pas de différence fondamentale entre Auschwitz et l’utilisation de bombes incendiaires. La Shoah serait un crime du passé, mais les crimes coloniaux s’étendraient bien au-delà, jusqu’à nos jours, et la notion de crime contre l’humanité en droit international ne devrait pas servir uniquement à punir les crimes nazis, mais également les crimes bien plus vastes du colonialisme européen.
Ces dernières années, la grande comparaison postcoloniale, pauvre en données empiriques mais riche en théorie, a gagné du terrain dans les milieux universitaires, politiques et médiatiques.
Cette intervention remonte à trente-huit ans, la scène se déroulant à l’été 1987. Le contexte est pour le moins surprenant. À Lyon, Vergès et son équipe internationale défendent Klaus Barbie, officier SS et chef de la Gestapo à Lyon pendant l’occupation. Le groupe de soutien de l’équipe a également de quoi étonner : la défense est financée et en partie organisée par le nazi suisse et grande figure antisémite François Genoud, un partisan du grand mufti antisémite de Jérusalem. Ce financier très actif avait auparavant été trésorier du FLN, le mouvement indépendantiste algérien.
L’avocat congolais de l’équipe, Jean-Martin Mbemba, explique devant le tribunal que Barbie a saisi sa main, la main d’un homme noir, avec ses deux mains. Le vieil officier SS Barbie aurait ainsi fait preuve de repentir, alors que le racisme reste une réalité meurtrière aux quatre coins du monde postcolonial. Maître Vergès ajoute que sa mère vietnamienne n’avait pas besoin d’étoile jaune pour être exclue, car elle était jaune de la tête aux pieds.
La mise en scène à Lyon, qui s’est déroulée parallèlement à la querelle des historiens[1], peut être considérée d’une part comme l’apogée précoce et caricatural de la vision postcoloniale du monde. D’autre part, son cocktail alimenté par des sources d’extrême gauche et d’extrême droite incarne un front transversal qui a, depuis lors, considérablement gagné en importance et en élan. L’interprétation de la Shoah comme un élément d’une chaîne millénaire de violence coloniale extrême constitue sans doute l’un des défis les plus radicaux auxquels est confrontée la recherche sur la Shoah. Cet ensemble idéologique, constitué de diverses composantes du XXe siècle, combine des fragments de traditions de gauche et de droite et associe des éléments anticolonialistes, anticapitalistes, antisémites, antisionistes et antioccidentaux, qui sont ici remixés dans un langage unique et reconnaissable.
Pour comprendre l’attrait et la force de cette interprétation, il faut d’abord se pencher sur sa profondeur historique. Depuis les années 1920, le communisme s’attaquait au caractère prétendument impérialiste du sionisme, qu’il accusait d’être dirigé par la bourgeoisie et le capital. Dans d’autres centres de gravité du globe, les leaders des mouvements anticolonialistes y ajoutaient d’autres éléments. Ainsi, fin novembre 1938, Mahatma Gandhi affirmait dans un texte antisioniste que les Juifs en Allemagne n’étaient pas moins bien traités que les Indiens en Afrique du Sud. À peu près à la même époque, des panafricanistes tels que Jomo Kenyatta, étudiant à la London School of Economics et futur premier Premier ministre du Kenya indépendant, affirmaient que le « fascisme colonial » des Britanniques ne traitait pas les peuples assujettis différemment des nazis.
La figure de pensée rendue célèbre par des intellectuels tels qu’Aimé Césaire et Frantz Fanon, selon laquelle « les nazis » n’auraient pas agi différemment de ce qu’avait fait le colonialisme européen pendant des siècles avec ses victimes, transparaît déjà ici. Mais à l’autre extrémité du spectre politique, des sources tombées dans l’oubli dans le courant des discussions actuelles méritent également d’être prises en considération. Ainsi, Ernst Nolte, vieux maître de la comparaison historique libre, s’était découvert un intérêt pour l’islam sur le tard, en 2009, et a mis en avant « l’agressivité défensive » de cette religion face à l’État colonial oppresseur que serait Israël. Les constructions de Nolte incarnaient certaines traditions de la droite, tout comme le faisaient celles des hauts dignitaires nazis en fuite qui occupaient des postes de conseillers au Caire sous le régime panarabiste du président Nasser.
Il faudra rassembler les pièces du puzzle éparpillées dans le temps et l’espace et les réorganiser afin de pouvoir comprendre correctement l’attrait du grand récit postcolonial, qui puise ses racines dans différentes sources. Il n’existe aucun lien direct entre les étudiants actuels de Harvard, Nolte, Gandhi, le Rote Fahne, Vergès, les membres de la RAF formés militairement en Jordanie et certains théoriciens postcoloniaux. Ces sources fondamentalement différentes ont toutefois en commun le moment antisioniste, le discours anticolonial et le lien largement dénué de fondement empirique entre les crimes nazis et d’autres scénarios violents.
À cela s’ajoute une diffusion pratiquement mondiale, qui ne se limite pas aux salles de cours de Harvard, Humboldt et Hofuf, mais s’étend à une partie considérable de ce qu’on appelle le Sud global. Les têtes de porc ornées de l’étoile de David, qui ont voyagé de Jakarta jusqu’à Kassel où elles ont été exposées sur une bâche en plastique à l’été 2022, ont rappelé avec force l’applicabilité mondiale et intemporelle de ces images[2]. Ensuite, le recyclage de fragments isolés de l’histoire mondiale possède une sorte de capacité à s’inscrire dans le présent que les analyses historiques partielles ne peuvent offrir. Car si les criminels nazis appartiennent à l’histoire, les phénomènes de non-simultanéité, d’oppression et de violence racistes et postcoloniales sont bien réels dans d’innombrables endroits du monde, y compris à l’heure actuelle.
Le discours postcolonial est en passe de devenir le nouveau grand récit. Comme toutes les idéologies modernes, celui-ci doit son succès aux lois de la publicité.
La posture consistant à se tenir aux côtés des « Damnés de la Terre », pour reprendre le titre de l’ouvrage emblématique de Frantz Fanon publié en 1961, n’est possible que grâce à cette capacité à s’inscrire dans le présent. Car au final, les « comparaisons » de ce type, qui ont une résonance mondiale, offrent avant tout une chose : une simplification. Les chambres à gaz d’Auschwitz, la guerre à Gaza, Dresde, la chute des Aztèques, le Vietnam, l’Algérie, la conquête espagnole, l’esclavage, l’extermination des Amérindiens, les Romains – derrière tout cela se cachaient le colonisateur blanc, l’expansion du « state power » et la quête coloniale d’une « permanent security ». Dans ce méli-mélo, le concept de colonialisme perd toute valeur analytique.
Dans un texte célèbre de 1979, le penseur français Jean-François Lyotard a annoncé la fin des grands récits et décrit ainsi la désintégration, toujours d’actualité, des systèmes et des idéologies, qui ont été remplacés par une multitude confuse de discours mineurs. Quarante ans après ce diagnostic, il apparaît clairement que le discours postcolonial est en passe de devenir le nouveau grand récit. Comme toutes les idéologies modernes, celui-ci doit son succès aux lois de la publicité. Il propose une simplification radicale, la création de nouveaux concepts et la répétition à l’infini de messages relativement simples.

Vergès, avocat anticolonialiste de la lutte antisioniste, du terrorisme de gauche et de divers génocidaires, devait défendre, dix ans après le procès Barbie, Roger Garaudy, un ex-communiste accusé de négationnisme après sa conversion à l’islam. En 1988, Vergès avait publié un pamphlet intitulé « Je défends Barbie ». Il porte la dédicace suivante : « Aux enfants martyrs de toutes les guerres : juifs, palestiniens, vietnamiens, algériens… sans oublier les soixante-six enfants allemands morts de privations dans le camp [français] de Montreuil-Bellay ».
« Tout va sombrer », prédisait Jean Améry en 1966, en référence à l’amalgame entre différents contextes historiques, « dans un sommaire ‘siècle de barbarie’ ». Ces dernières années, la grande comparaison postcoloniale, pauvre en données empiriques mais riche en théorie, a gagné du terrain dans les milieux universitaires, politiques et médiatiques. Elle fait disparaître toute précision analytique, sans laquelle il est impossible de rendre compte de manière sensée ni des ravages du colonialisme ni de ceux du régime nazi, ni des similitudes et des différences entre les deux, et encore moins du conflit au Proche-Orient. Il ne reste qu’une complainte généralisée sur tous ces morts. Là où la décontextualisation radicale s’impose, le brouillage pseudo-progressiste des frontières entre propagande politique, activisme et science ne pourra guère contribuer à élucider les scènes de violence historiques et contemporaines.
Stephan Malinowski
Stephan Malinowski est un historien allemand. Maître de conférences en Histoire européenne moderne à l’Université d’Édimbourg, ses recherches portent sur l’histoire de l’Allemagne au 20e siècle, en particulier l’histoire du Troisième Reich, et sur les sur les guerres coloniales européenne au 20e siècle.
Traduit de l’allemand par Julia Christ.
Paru dans la FAZ sous le titre en janvier 2024.
Notes
| 1 | Voir, dans K., Julia Christ, « L’Allemagne et la Shoah : une nouvelle querelle des historiens ?« |
| 2 | Voir, dans K., Julia Christ, « Documenta fifteen : promenade dans le nouveau monde de l’antisémitisme« |












