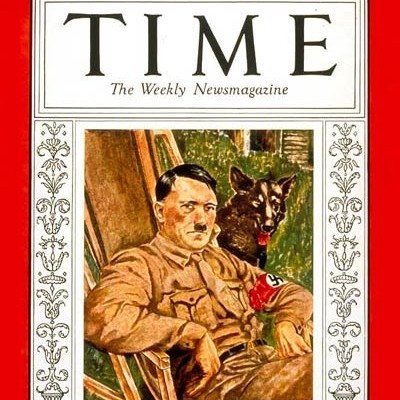À l’occasion de la commémoration des dix ans des attentats de 2015, et de la soirée organisée en commun par le CRIF et Charlie Hebdo, Bruno Karsenti interroge le sens de cette alliance sous le slogan « Nous sommes la République ». Car si les juifs ont embrassé la condition politique moderne, c’est selon une modalité critique qui emporte une certaine acception de la République.

Sur le mot de « République », en France, bien des choses se jouent. Or ce qui se joue actuellement – par une récurrence qui nous ramène au XIXe siècle finissant, quand l’antisémitisme s’installait comme parti officiel dans ce pays – a le fait juif pour point d’orgue. C’est ainsi qu’au cours des dernières élections législatives, on a vu le « Front républicain » autodéclaré se reconstituer contre une extrême droite en plein essor, dont le vieux fond antisémite reste difficile à cacher en dépit de marques d’expiation répétées et démonstratives, et abstraction faite des convictions jamais reniées de son leader historique qui vient tout juste de disparaître. Mais surtout, c’est exactement sur cet écueil que ce Front s’est lui-même fissuré, l’attitude à l’égard des juifs, appréhendés ou pas dans leur relation à Israël, témoignant de divisions tout aussi profondes que celle motivée par l’opposition à un fascisme que, par paresse ou commodité, on estime logé exclusivement à droite de l’échiquier politique.
Dès lors, faut-il s’étonner que le mot de République soit brandi par les juifs eux-mêmes, en un resserrement salutaire sur son noyau de sens, qui est de garantir aux minorités les plus exposées, non seulement l’égalité devant la loi, mais la préservation contre toute discrimination et toute persécution ? Et n’est-il pas justifié que cette reprise ait lieu à l’occasion de la commémoration des attentats de janvier 2015, lors desquels furent commis des assassinats bien ciblés – en l’occurrence, de journalistes exerçant pleinement, dans les limites de la loi, leur droit à la critique des religions dans un État républicain par définition laïque, de policiers pris comme officiers publics assurant la sécurité dans ce type d’État, et de juifs s’estimant pouvoir y jouir de la liberté, de l’égalité et de la sûreté garanties à tout un chacun ?
L’alliance du CRIF et de Charlie Hebdo dans la commémoration des attentats de janvier 2015, placée sous le signe de « Nous sommes la République », ne paraîtra incongrue qu’à ceux qui tournent le dos aux plus graves dilemmes du moment. Que puissent faire cause commune, précisément sur ce thème, l’institution représentative de la vie associative juive (sachant que les juifs, en tant que multiplicité hétérogène, ne peuvent être représentés), et un journal qui a fait de la laïcité militante son principal crédo, ne se conçoit pas seulement parce que juifs et journalistes satiriques se sont retrouvés conjoncturellement les victimes de la même volonté criminelle, en l’occurrence de l’islamisme. Le paradoxe tient à une raison enfouie dans cette conjoncture, tout à fait réelle. C’est qu’un lien existe bien entre l’histoire moderne de cette communauté particulière – où culture, appartenance et religion se mêlent inextricablement et entrent dans des compositions variables -, les juifs, et l’émancipation moderne reconduite à sa condition nécessaire, à savoir que la critique doit pouvoir, dans une société où l’émancipation prévaut, destituer toute dogmatique religieuse de sa prétention à dicter la loi commune.
Les juifs en général, prémodernes et modernes, sont ceux qui « ne sont pas Gentils », disait Lacan. Entendons simplement, ceux qui se sont refusés à la conversion au christianisme. Mais ce qui caractérise les juifs modernes, religieux ou pas, c’est d’avoir embrassé sans restriction le genre de conversion qu’emporte l’émancipation civile et politique. Ce faisant, ils n’ont pas simplement reconduit leur ancien précepte de peuple en exil – « la loi étrangère est la loi » -, mais ils ont misé sur le fait que cette loi ne leur est plus étrangère de la même manière quand elle est résolument égalitaire, parce que, par le point où elle les rend égaux à tous les autres citoyens, ils peuvent authentiquement la faire leur, et y reconnaître une nouvelle condition, préférable à celle que tout autre genre d’État leur réserve, pour l’existence et la persistance de leur peuple.
Ce qui caractérise les juifs modernes, religieux ou pas, c’est d’avoir embrassé sans restriction le genre de conversion qu’emporte l’émancipation civile et politique.
Or ils savent aussi que cela dépend du libre exercice de la critique, jusqu’à ce point où le principe de l’émancipation à l’égard de toute loi de nature religieuse – la leur comme n’importe quelle autre – éprouve sa possibilité. Lieu limite, certes, que la loi même encadre. Lieu d’où n’émane aucune injonction à se rendre, c’est-à-dire aucun motif d’adhésion à ce qui s’y dessine ou s’y dit. Lieu de la caricature possible, qui, par sa provocation, s’expose à la sanction du droit, étant entendu que le droit est laïque. Mais lieu pour cela même préservé, comme le retranchement ultime d’un ressort profond de l’émancipation.
Par leur histoire moderne, les juifs savent que la possibilité pour eux, comme pour toute minorité, d’exister librement et à égalité dans une société libre, dépend ultimement de cette condition. Ils savent que la défense de toute existence minoritaire, et donc le combat contre le racisme, la xénophobie et les discriminations de tous ordres, passent par là. Bref, ils savent que le mot de République y rejoue en permanence sa définition.
Or il y a une condition à cette condition. C’est que la République, à son tour, ne dogmatise pas. Qu’elle conçoive son élargissement comme lui étant essentiel, puisqu’en lui réside la relance d’une émancipation qui n’est définitivement acquise pour personne, et qui est même toujours menacée, pour toute minorité, dans des sociétés où la majorité court perpétuellement le risque de s’ériger en détenteur exclusif et supérieur des normes communes. Ce qui doit prévenir cette dérive, c’est encore une fois la République, mais seulement si on fait l’effort pour la comprendre d’une certaine manière : comme la forme politique ordonnée à la chose publique, res publica, cette chose commune autour de laquelle parviennent s’articuler de manière juste les actions des individus et des groupes. Actions qui ont donc leur principe de justice dans le fait d’agir en commun sur des problèmes que tous reconnaissent comme leur étant communs.
De là, il est courant aujourd’hui que l’on passe subrepticement à l’affirmation d’un moi commun. Perdant de vue la chose commune, c’est l’identité subjective grand format qui occupe le devant de la scène. De la recomposition des identités de groupes comme des propriétés figées, comme du propre déjà donné et possédé, à faire valoir plus encore qu’à défendre, les plus grands maux des sociétés démocratiques actuelles découlent directement. Si la dérive a ses versions minoritaires, elle a évidemment aussi sa version majoritaire, dans laquelle une fausse acception du mot de République est alors facilement enrôlée. En ce cas, les premières victimes du dévoiement sont les minorités elles-mêmes, pour autant qu’elles se sont engagées dans le processus d’émancipation, d’où elles tirent dans la modernité les conditions d’une existence égalitaire et libre pour leurs membres, si qualifiés par leurs appartenances puissent-ils demeurer.
Il y a une condition à cette condition. C’est que la République, à son tour, ne dogmatise pas.
À cet égard, la formule « Nous sommes la République » doit être précisée. Le « nous » qui s’énonce ici, depuis la voix à l’unisson des juifs et des journalistes, ne peut pas et ne doit pas être le « moi commun » dans lequel la France serait invitée à se reconnaître et à s’identifier. Bien plutôt, il désigne un certain point de l’espace social : celui où un aspect décisif de la chose commune comparaît, dans son urgence et avec l’impératif de sa prise en charge par tous, c’est-à-dire par la totalité sociale et politique qui, par cette action seulement, acquiert son caractère de communauté nationale.
Qu’est-ce à dire ? Avant tout que les attentats de janvier 2015, par ses victimes et par la place singulière qu’elles occupent dans les sociétés démocratiques modernes, ont figuré tragiquement le point de croisement où le sens du mot de République est appelé à se chercher aujourd’hui. On dit bien à se chercher. Car il n’est certes pas donné d’avance. La tâche ne fait ici que commencer, et rien ne serait plus dommageable qu’une rétractation, sous le poids de l’adversité dans laquelle on est pris, sur une nouvelle dogmatique tendanciellement réactionnaire.
Or pour que cette recherche ait lieu, il est clair que c’est de la question juive qu’il faut justement savoir repartir. Qu’enseigne-t-elle quant à la position du problème général de la « chose commune » et de la manière d’ordonner autour d’elle les actions des individus et des groupes, problème qui, dans l’idée de République, demeure toujours le point essentiel ? Et que prévient-elle des dérives quant à l’instanciation et l’absolutisation du « moi commun », où le républicanisme risque toujours de dégénérer en nationalisme ?
Voilà ce que l’alliance du CRIF et de Charlie Hebdo, par son caractère inattendu, voire iconoclaste, devrait être en mesure de rendre perceptible à l’opinion la plus large. Faisant de cette commémoration d’un grand traumatisme français un moment de réflexion salutaire, au bénéfice de toutes les minorités.
Bruno Karsenti