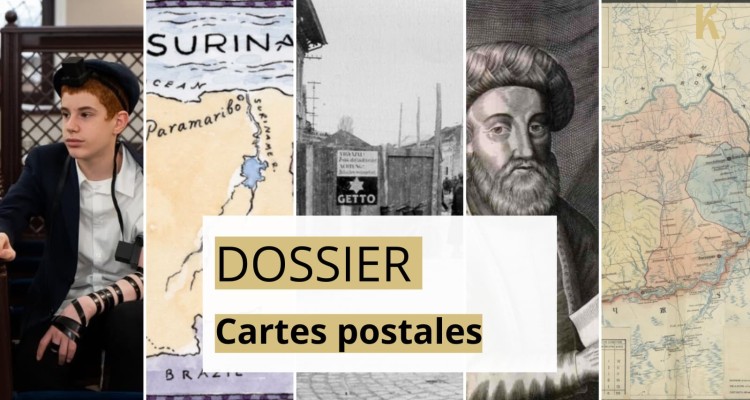Joseph Benamour s’était déjà demandé dans K. s’il restait des Juifs en Algérie ; il enquête aujourd’hui sur le besoin, si présent chez certains jeunes juifs sépharades de la deuxième ou troisième génération, d’aller au Maghreb. Pourquoi et comment pensent-ils y retrouver une part de leur histoire ? Quel rôle joue la nostalgie familiale dans ces quêtes de repères identitaires ?

C’est un moment comme je les aime. Mes parents, une de mes sœurs, des oncles et tantes sont réunis sous la soukka installée dans le jardin de la maison familiale. Nous nous retrouvons le temps d’un repas, enveloppés par la chaleureuse proximité d’une réunion sous la cabane traditionnelle. Des fruits de saison sont suspendus au plafond en canisse de la soukka, montée par ma mère, accompagnée d’une amie à moi, quelques jours plus tôt. Une khamsa – ramenée d’Algérie – est accrochée au mur, le reste est décoré de tissus bariolés en tout genre que nous ressortons chaque année avec plaisir.
Les invités passent joyeusement en revue les grands sujets familiaux. L’impression de déjà-vu d’un moment vécu tant de fois, toujours identique, toujours différent, procure une sensation rassurante. Et, comme cela arrive souvent, la conversation, doucement, se dirige vers l’Algérie, d’où la famille est originaire. Ma tante évoque ses souvenirs, vagues, d’avant ses quatre ans et le départ vers la France où toute la cellule familiale a suivi son père instituteur, en 1956, tout juste muté dans ce qui était alors appelé la métropole. Que lui reste-t-il de cette époque ? Le souvenir d’un kiosque à Aïn Beïda où, enfant, sa mère l’emmenait acheter des douceurs. Celui d’un balcon et d’un couloir dans l’appartement familial, immense, vu à travers ses yeux de petite fille. Elle décrit des impressions, des sensations. Ces réminiscences, indicibles et impalpables, forment la mémoire diffuse d’un lieu qui n’existe vraiment que pour elle.
La discussion s’anime autour d’une question. Voudrait-elle y aller ? L’Algérie n’est pas loin. Un peu plus d’une heure d’avion. Mais non, elle n’ira pas. Pourquoi y aller d’ailleurs ? « L’endroit a dû changer. Je n’y retrouverais rien de familier. Au contraire, cela risque de détruire l’image que je m’en fais. » Faire le voyage, ce serait mettre face à face le réel et le mythe. Et ça, elle ne le veut pas. Elle préfère vivre avec ses souvenirs, et ceux, réinterprétés, de la mémoire transmise.
Contrairement à elle, j’ai eu l’occasion d’aller – j’allais dire « de retourner », alors que je suis né et ai toujours vécu en France – en Algérie, comme je l’évoque d’ailleurs dans un article publié pour K. où je me demande s’il y reste encore des Juifs. Et, dès l’enfance, bercé par ces voyages, j’ai observé en moi un lien intense avec la terre d’origine de ma famille. Longtemps, j’ai eu le sentiment d’être un peu isolé parmi les Juives et les Juifs de la deuxième et troisième génération à vouloir encore et toujours aller voir l’Algérie, et plus largement, le Maghreb.
Mais ce sentiment de solitude s’estompe. Des trentenaires et quadragénaire me contactent désormais pour discuter d’un futur voyage en Algérie. Des productions culturelles, des articles, ou encore des initiatives personnelles trouvent leurs racines dans le fait d’aller sur place, au Maghreb. Des gens pour qui, contrairement à ma tante, sentir l’air et voir les lieux est devenu un désir ardent.

C’est le cas de Myriam Levain. La fondatrice du compte Instagram StayTunes fait le portrait de Juives et de Juifs tunisiens, ou d’origine tunisienne. Sa grand-mère est partie de Tunisie en 1946, à l’âge de 25 ans, sans savoir qu’elle ne pourrait pas y revenir. Myriam se penche sur cette histoire après un voyage en Tunisie avec son frère. « J’avais été en Pologne, raconte la journaliste, dont la majorité de la famille est ashkénaze. Mais jamais à Tunis. Il y a des tabous familiaux que tu respectes. » Sa famille a coupé les liens avec le pays. Seule exception, un voyage avec sa grand-mère, dans le cadre d’un séjour organisé. Mais pas question pour elle d’aller là où elle a vécu. Un peu comme elle aurait pu faire du tourisme dans n’importe quel autre pays. « Elle m’a emmené en Tunisie l’été de mes 18 ans. On est resté une demi-journée à Tunis. Une fois dans la médina [vieille ville], elle a prétexté être trop fatiguée. Nous n’avons pas été visiter son quartier. Pourtant, maintenant que je connais la géographie de Tunis, je sais que ce n’était pas du tout loin. »
Les voyages réguliers de Myriam inspirent d’autres jeunes, qui lui écrivent. « Ils me disent qu’avec le compte Instagram sur lequel je raconte mes visites, ils savent que c’est faisable. Cela rend possibles leurs projets de voyage. » Des messages de ce genre, Cléo Cohen en reçoit aussi « presque toutes les semaines ». La documentariste a notamment réalisé « Juive-arabe : comment je me suis réconciliée avec mes identités », une série pour France Culture, dans laquelle elle questionne son appartenance à la Tunisie et l’Algérie, les pays de ses grands-parents et s’interroge sur l’identité arabe des descendants de juifs nord-africains.
En Tunisie, les Juifs étaient plus de 100 000 à la veille de l’indépendance en 1956. Mais la plupart quittent le pays et se dirigent vers la France ou Israël, notamment lors de la flambée antisémite qui fait suite à la crise de Bizerte en 1961, ou encore suite aux manifestations anti-juives qui éclatent au moment de la guerre des Six jours. C’est avec ces images en tête que Cléo Cohen voyage pour la première fois en Tunisie. Elle a alors le sentiment de « faire une grosse bêtise, et l’impression de profaner un territoire sacré. » Elle est « persuadée qu’il ne reste que trois juifs dans un sous-sol. J’avais hérité d’une peur énorme par rapport à ce retour », détaille la réalisatrice. Elle est émerveillée en découvrant que l’immeuble familial tient toujours debout.
Créer une relation avec le pays d’origine
Aussi bien Cléo Cohen que Myriam Levain ont la sensation que leur présence en Tunisie a quelque chose de différent de celle des touristes et des expatriés français. Je retrouve d’ailleurs ce sentiment chez bien d’autres qui font la même expérience de retour sur les terres des parents et grands-parents. Sacha, la trentaine, s’est rendu en Algérie avec son père. À son retour il me confie, heureux : « Ça peut surprendre, mais j’ai eu l’impression de me sentir chez moi. » Cléo Cohen décrit, elle, comme une « familiarité troublante. ».
Mais tout n’est pas simple. Les voyages de Cléo Cohen heurtent sa famille. « C’est un geste de trahison. Tout le monde soupire et lève les yeux au ciel quand je dis que je vais en Tunisie. Ma grand-mère pense qu’elle va rester coincée à la douane si elle vient. Elle a peur qu’on lui demande des comptes. » Avec le temps, et à force d’y retourner, les choses se sont peu à peu normalisées : « Évoquer mes voyages en Tunisie, c’est devenu une sorte de blague récurrente pour ma famille », raconte la documentariste.
La famille paternelle de Sarah est, elle, originaire de Fès, au Maroc. Un pays qui comptait une communauté juive d’environ 265 000 membres en 1948, la plus grosse du monde arabe et musulman. La grande majorité quitte le pays pour fuir la pauvreté et les émeutes anti-juives. Une grande partie de cette communauté se trouve aujourd’hui en Israël qui a encouragé leur venue à partir des années 1950.
La jeune femme mène une réflexion sur son identité juive marocaine via des travaux de recherche, une pratique artistique ou encore une action associative. Elle est membre de Dalâla, une association qui travaille à la promotion des cultures juives d’Afrique du Nord avec des cours de langue et l’organisation d’évènements. Un jour, son père dit lui « avoir transmis ce qu’il pouvait, une enveloppe vide ». Une identité sans contenu. Elle décide alors d’aller à Fès dans le cadre d’un voyage avec des amies. Depuis, elle y est retournée une quinzaine de fois, et s’y trouve au moment où elle me confie au téléphone que « venir ici [lui] a permis de mettre du sens sur un sentiment d’altérité, d’étrangeté, qu’[elle] pouvai[t] avoir en France mais qu’[elle] ne comprenai[t] pas, explique-t-elle. J’ai grandi dans la banlieue lilloise, et on me disait c’est quoi ce nom, t’es arabe ? Je me disais : ‘‘qu’est-ce que je suis en train de trimballer avec moi, c’est quoi ce bagage ?’’ »

Grâce aux voyages, elle « raccroche [son] histoire personnelle à la grande histoire.» Cela bouleverse aussi l’image qu’elle se faisait de l’histoire de sa famille : « Ça m’a permis d’être plus reconnaissante envers mon grand-père et de transformer la colère que j’avais vis-à-vis de cette non-transmission. En allant au mellah – quartier juif au Maroc – en travaillant sur le sujet, j’ai compris une partie de la trajectoire familiale et le fait que beaucoup de Juifs vivaient dans des conditions socio-économiques désastreuses. Pour eux, quitter le Maroc c’était avoir la possibilité de s’offrir une meilleure vie. »
Réinvestir – ou réinventer ? – son identité
Pour Cléo Cohen, les générations nées en Tunisie et arrivées en France ont délaissé leur identité maghrébine. « Nos parents ont un peu mis des œillères, explique la jeune femme. Ils avaient d’autres chats à fouetter. Il fallait s’intégrer, s’extraire de leur condition d’immigrés. Mais il y a quand même eu une forme de résistance, puisque quelque chose est arrivé jusqu’à nous. »
Ce « quelque chose » laissé en héritage, la jeune génération peut se l’approprier. À quelle fin ? Cléo Cohen réinvestit une identité qu’elle estime malmenée. À l’approche de la trentaine, elle se pose « la question de ce qu’[elle] veu[t] transmettre. » La jeune femme commence à chercher, presque obsessionnellement, les traces de sa famille en Tunisie. Pour mieux comprendre ses grands-parents et son histoire.
Pour le chercheur Samuel Everett, une partie de la jeune génération a pris du recul dans le lien entretenu avec la terre d’origine. Lui qui travaille sur les populations juives d’Afrique du Nord et notamment d’Algérie à partir de 1981 s’intéresse particulièrement à la manière dont leurs descendants s’approprient l’algérianité : « Les générations nées en France sont très bien informées, elles ont beaucoup lu, elles ont une approche plus intellectualisée de leur passé. Elles ont néanmoins un rapport affectif fort au pays, car pour beaucoup, cette émotion est vécue de manière charnelle. »
Le temps de la rupture totale avec le pays d’origine a été consommé. Celui des conflits de loyauté vis-à-vis des parents, porteurs du traumatisme et de l’exil, également. Les plus jeunes peuvent donc se (re)tourner vers le Maghreb et (re)construire une nouvelle identité comme l’explique Jonas Sibony, chercheur spécialisé sur les judaïsmes du Maghreb et enseignant en judéo-arabe : « II y a un mouvement qui est assez clair chez une partie des jeunes juifs originaires du Maghreb et qui va peut-être de pair avec le fait qu’il y a une population musulmane d’Afrique du Nord importante en France. La question de la maghrébinité, elle, est vécue partout. Il y a peut-être une réidentification à un groupe d’immigrés, voire une envie d’appartenance. Ces Juifs questionnent leur place. Ils se demandent s’ils ont des problématiques et une histoire conjointe avec les autres maghrébins. La question est assez ouverte chez beaucoup de gens. »
Cette reconstruction identitaire reste l’apanage d’une minorité de Juifs et les objectifs d’un voyage au Maghreb ne sont pas les mêmes selon le milieu social auquel appartiennent les voyageurs. « Dans le monde populaire juif, qui est aujourd’hui essentiellement religieux, il y a le souvenir de la filiation du rabbin. Plus que d’aller chercher la maison et le quartier – qui est peut-être un peu plus une démarche « bobo », population dans laquelle je m’inclus – les religieux se déplacent pour des pèlerinages sur les tombes des rabbins (hiloula) »

Le pays reconnaitra-t-il les siens ?
Cléo Cohen habite désormais en Tunisie, où elle apprend la langue de ses grands-parents. « Ça m’a pris du temps de comprendre que maîtriser la langue arabe résoudrait beaucoup de mes problèmes de légitimité. Pour moi, c’est un moyen très clair de redevenir, ou de devenir avec plus d’évidence, une fille du pays. Je trouve ça hyper violent de ne pas transmettre une langue », confie la réalisatrice. C’est un processus à double sens. « Je réalise, après de nombreux voyages, que je fais ça aussi pour que la Tunisie ait conscience qu’on existe. Je veux un lien avec ce pays, mais un lien qui soit concret pas que mythologique. Je veux vivre ce lien de manière incarnée. »
Pour Myriam Levain, la Tunisie « est en demande que les Juifs viennent. Le pays renoue avec son passé juif, passé sous silence au moment de l’indépendance. » Mais selon elle, la réalité est aussi plus complexe : « Je n’arrête pas d’entendre « revenez, revenez » quand je dis que je suis juive en Tunisie. Mais les gens ne sont plus là parce que c’était devenu invivable pour les Juifs à l’époque. Il ne faut pas oublier pourquoi on est parti. Parfois il y a un fantasme sur cette vie juive. »
Jonas Sibony partage cette analyse : « une vision de paradis perdu ne peut exister que si les gens ne sont plus là. Parce que, si les gens sont encore là, la réalité des rapports humains rend nécessairement le discours plus complexe. Je crois que c’est le départ des juifs qui fait qu’aujourd’hui au Maroc et en Tunisie il y a un discours qui dit « revenez c’est extraordinaire vous nous manquez. » Ça ne veut pas dire que c’est faux, mais ce n’est pas plus vrai que l’inverse et un discours qui dirait « ne revenez pas on vous déteste ». »
Ce fantasme peut aussi prendre un tout autre visage, et se muer en tension dans les pays du Maghreb. En novembre 2022 un groupe d’une vingtaine de personnes est venu interrompre un colloque organisé par la Bibliothèque nationale de Tunisie. L’introduction de la journée a été hachée par des slogans antisémites comme « non au judaïsme » ou encore, « non au musée de l’holocauste » lancés par une quinzaine de personnes ayant fait irruption dans la salle.
La journée de recherche était dédiée aux « langues oubliées », dont le judéo-arabe qu’enseigne Jonas Sibony et sur lequel il devait intervenir ce jour-là. « Il y a une tension réelle qui se traduit notamment par des anecdotes comme celle que j’ai vécue, commente l’universitaire. La plupart des voyages, des rencontres, se passent bien. Et heureusement d’ailleurs, c’est la vie normale. Mais il y a quand même des biais historiques, politiques, identitaires qui existent. »
Sarah, elle, constate que le Maroc vit un moment d’effervescence autour des juifs, qui va au-delà des accords de normalisation diplomatique avec Israël signés en 2020. « C’est un chemin ancien. Il y a un lien qui n’a jamais été perdu. Et puis le Maroc travaille aussi à la reformulation de son récit national en se pensant comme une terre de diversité. »

En Algérie, la situation est plus compliquée. Le discours national laisse peu de place à la reconnaissance des minorités, et l’histoire juive du pays est encore mal connue localement. En Algérie, le soutien aux Palestiniens est au centre de la politique extérieure du pays. « Israël est perçu comme une force impérialiste, et n’est pas reconnu comme pays, détaille Samuel Everett. Une confusion est souvent faite entre Juif et Israélien, et par extension entre Juif et colon. » Mais ce n’est pas la seule raison qui rend plus compliqué la relation entre les juifs d’Algérie et l’Algérie. « Contrairement au Maroc et à la Tunisie, il n’y a pas de visibilité de ce qu’il reste du patrimoine juif en Algérie. Et il n’y a pas vraiment de visibilité non plus, en France, de figures juives d’Algérie. Il y a des personnalités de premier plan, mais leur part d’algérianité est souvent peu connue en dehors des communautés juives d’Afrique du Nord, contrairement, peut-être, aux Marocains et Tunisiens. », poursuit le chercheur.
Au cours de son voyage, Sacha a pris conscience que « beaucoup d’Algériens ne savent pas qu’il y a eu des juifs dans le pays, et qui ils étaient. » Il a tout de même pu se réjouir de pouvoir « aller devant ce qui reste de la synagogue à Alger. Les gens nous voient devant, sourire et prendre des photos. Je pense que ça fait du bien. » Il vit aussi son voyage comme un acte militant. De retour d’Algérie, il veut trouver une manière d’en parler publiquement. « J’ai envie d’avoir une part dans l’Algérie d’aujourd’hui. J’ai envie qu’il y ait moins de complexes par rapport à tout ça. »
L’Algérie est-elle prête à laisser « ses » Juifs avoir une place dans l’histoire moderne du pays ? Les juifs d’Algérie sont-ils des Algériens à part entière ? La diaspora juive est-elle légitime à revendiquer une algérianité, aux yeux de l’Algérie ? Rien n’est moins sûr même si les discours commencent à changer. Ces voyages font évoluer les représentations qui existent de part et d’autre de la méditerranée. Comme quand Patrick Bruel rend public son séjour en Algérie en février dernier, y compris via la télévision algérienne.
Pour ma part, aller en Algérie permet de garder vivant un lien avec ce pays. Je refuse de le voir dépérir, ou se figer, pour ne devenir qu’un lointain folklore. Mais je m’interroge sur la part de fantasme qui m’habite et j’ai conscience qu’une réappropriation de l’identité passe aussi par sa nécessaire réinvention. Et c’est peut-être là que le bât blesse avec ma tante. Nous ne parlons pas de la même chose, car nous ne sommes pas nés à la même époque et au même endroit, nos loyautés ne vont pas aux mêmes histoires et de fait, notre algérianité, revendiquée ou non, ne peut pas se construire de la même manière.
Joseph Benamour