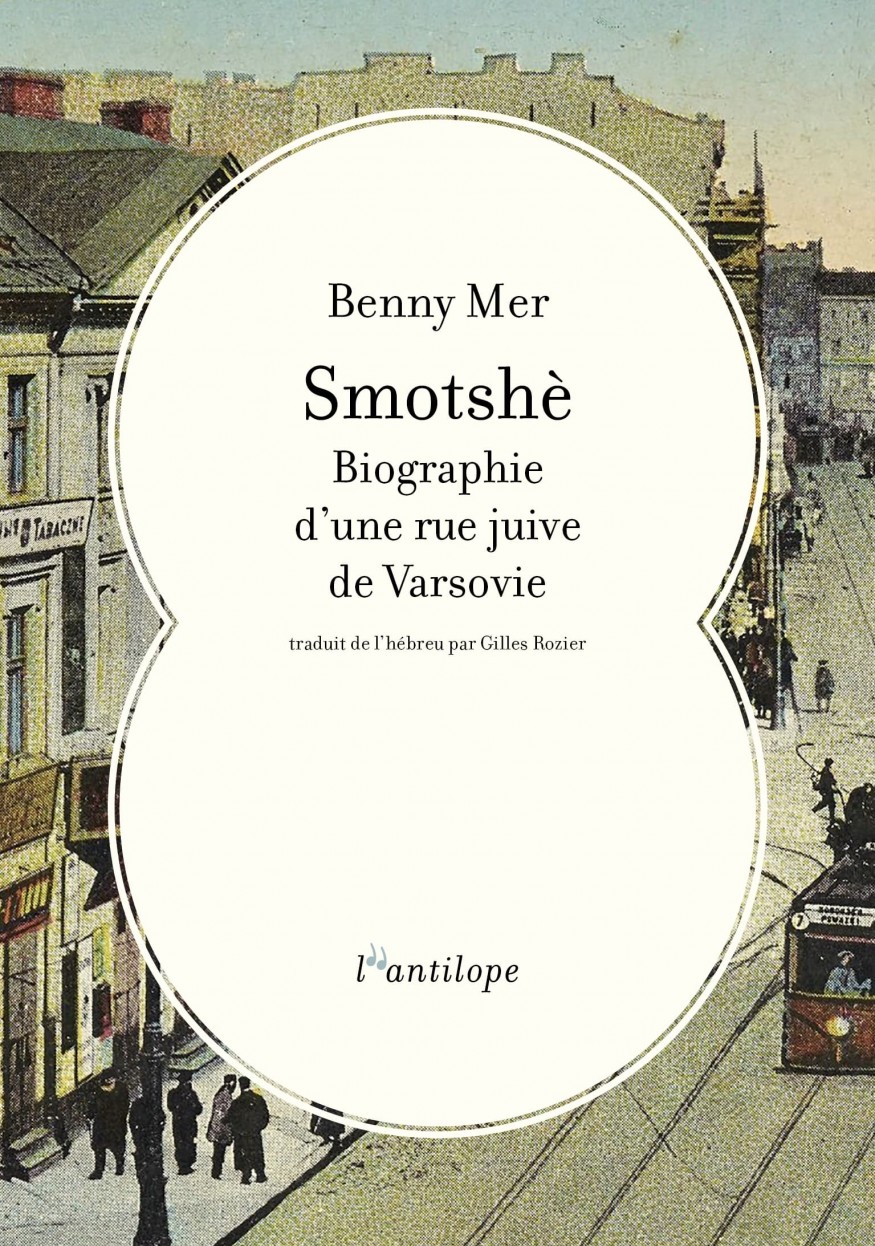Longtemps journaliste littéraire pour le quotidien israélien Haaretz, Benny Mer est un spécialiste de la culture yiddish. Il a traduit en hébreu une partie des œuvres de Sholem-Aleikhem et d’Avrom Sutzkever. Aux éditions de l’Antilope, il vient de faire paraître Smotshè – Biographie d’une rue juive de Varsovie. Une rue Smocza existe aujourd’hui, reconstruite dans l’ombre de celle d’avant-guerre ; mais la Smotshè de Benny Mer, l’une des plus pauvres de la Varsovie juive des années trente, a disparu dans les ruines du ghetto. Tel un archéologue, son biographe l’exhume en traquant toutes les traces qu’il peut récolter (dans la presse, dans la poésie et la fiction, dans les rares photographies qui demeurent, dans les témoignages que l’auteur a pu recueillir) pour donner une idée, une image, un souvenir de Smotshè qu’il aime comme on aime un fantôme qui vous fait signe. Premier chapitre du livre-enquête de Benny Mer, paru aux Editions de l’Antilope, sur ce monde disparu dont il dit qu’il s’y sent chez lui.

Avant la Seconde Guerre mondiale, la majorité des Varsoviens avait entendu parler de la rue Smotshè par des procès verbaux de police. Le quartier n’était ni beau, ni hospitalier, ni sûr. « Dans la cour du numéro 29 a éclaté une bagarre entre deux individus. Srulow Marchanow, âgé de quinze ans, a été mordu au nez. Le cannibale a pris la fuite. Mutilé, Marchanow a été transporté à l’hôpital », rapporte le Kurier Warszawski le 5 janvier 1927.
J’ai trouvé cette mention, sans surprise, dans le chapitre intitulé « Smotshè, une rue laide » du livre de Jerzy S. Majewski, Zydowski Muranów i okolice (La Muranów juive et ses environs). J’étais malgré tout heureux – bonheur visuel – de la dénicher, tant la rue Smotshè n’apparaît quasiment jamais dans la littérature polonaise de l’entre-deux-guerres. Tout au long de ma quête de cette rue, j’ai appris à apprécier chacune des références, même une mention aussi péjorative.
On n’invitait personne, ni les Polonais ni les touristes, à visiter la rue Smotshè ni aucune rue de Muranów, un des quartiers nord de Varsovie, quartier juif dans toute sa splendeur qui contrastait totalement avec les rues non juives, celles que les Juifs appelaient en yiddish yene gasn, « les autres rues ». La plupart des guides de voyage, en polonais ou dans des langues étrangères, s’arrêtaient au jardin Krasiński qui bordait le quartier. Rares étaient ceux qui osaient porter leur regard sur la magnifique synagogue de la rue Tłomackie ou s’aventurer dans les Nalewki, la rue « juive » la plus typique du quartier, débordante de vie, avec ses commerces, ses écoles, ses petites fabriques, ses rédactions de journaux et ses milliers de résidents.
Le Petit guide de Varsovie, publié en français en 1933 par une maison d’édition polonaise, décrit le quartier de la sorte : « Une partie de cette région Nalewki est surtout un quartier commercial, habité en majeure partie par des Juifs. Des rues interminables de grands blocs de maisons qui regorgent de marchandises de la cave au grenier gardent un caractère original. Les habitants de ces quartiers sont restés fidèles à la tradition, ils ont pour la plupart conservé leurs anciens costumes et leur mode de vente de marchandises très oriental. »
Smotshè, en polonais ulica Smocza (rue du Dragon), éveille une sensation désagréable. Les écrivains polonais la mentionnent comme une rue misérable, laissée à l’abandon et répugnante, dans laquelle un non-Juif, et encore moins un touriste, ne saurait s’aventurer. Pourtant, Albert Londres y atterrit en 1929 et éprouve un choc qu’il exprime dans son livre Le Juif errant est arrivé : « Immédiatement, débouchant des rues Smocza, Dzéka, Gęsia, Stawki, Miła, Pokorna, Muranowska, Pawia, Zoliborska, émergeant des caves et des couloirs souterrains, encore inexplorés des Gentils, dévalant des escaliers branlants et centenaires, bondissant des boyaux, ruelles, impasses, culs-de-sac, surgissant des cours, sortant des marchés. »
Durant la suite de ses pérégrinations, Albert Londres découvre la Terre promise – la Palestine – et se laisse séduire par le Juif nouveau, comme « réparé », autant qu’il avait trouvé repoussant le Juif ancien d’Europe orientale. Il suffit de lire cet avertissement pour s’en convaincre : « L’odeur est spécialement juive – juive orthodoxe. […] Cette odeur est un mélange d’essence d’oignon, d’essence de hareng salé et d’essence de fumée de caftan, en admettant qu’un caftan fume comme fume la robe d’un cheval en nage. »
Dans la presse hébraïque, le nom de Smotshè est également mentionné en termes péjoratifs – pauvreté, crime, ghetto – et s’y aventurer n’est pas recommandé, c’est même totalement prohibé. Dans le journal Ha-boker du 31 août 1938, A. Shteynshleyfer la décrit en des termes comparables à ceux d’Albert Londres lors de sa visite à Varsovie. « J’emprunte les rues Nalewki, Smocza, Karmelicka, Gęsia, etc. On y parle presque exclusivement yiddish. Les Juifs vêtus de longs caftans et coiffés de chapeaux noirs se pressent, courent en tous sens, à grands gestes de bras et frétillements de papillotes. […] De l’une de ses ruelles déborde une forte odeur d’oignon frit. » Et ainsi de suite…
Alors pourquoi m’intéresser à Smotshè ?
Dans les pérégrinations qui m’ont mené à cette rue, presque toutes les personnes que j’ai rencontrées m’ont posé la question. On peut les comprendre, même si je n’ai pas toujours eu la patience de le leur expliquer. Surtout que mon attirance pour cette rue m’est venue de bien ailleurs. Pourquoi m’intéresser au yiddish ? me demande-t-on en permanence. Les deux questions appellent peut-être la même réponse, car d’une certaine manière, la rue Smotshè est pour la topographie ce que le yiddish est pour les langues. Smotshè n’était pas la rue la plus importante, ni bien sûr la plus belle de Varsovie. Et pourtant, entre les deux guerres, elle constituait un véritable microcosme, en particulier de vie juive.
Il ne s’agit pas d’une remarque de pure forme. De nombreux immeubles de la rue étaient constitués de trois corps de bâtiments disposés en U. Chaque bâtiment comptait quatre ou cinq étages desservis par une grande cour, ou par plusieurs cours plus petites. La densité moyenne était d’une famille par pièce, de sorte qu’à chaque numéro vivaient près d’un millier d’individus. Dans la mesure où la rue comptait soixante-deux numéros, on peut estimer sa population à quelques dizaines de milliers, soit la population d’une petite ville israélienne. Ainsi, dans une démarche micro-historique, il est raisonnable de penser que cette rue était porteuse de la totalité du patrimoine génétique nécessaire à l’historien et à l’écrivain. Une rue pas vraiment centrale, sans réelles lettres de noblesse, pas comme les rues Grzybowska ou Twarda dans lesquelles les riches familles juives avaient élu résidence. Smotshè n’est pas non plus la rue Krochmalna, qui a accédé à la notoriété grâce à Isaac Bashevis Singer et à Janusz Korczak.
Le yiddish est un kaléidoscope qui a donné naissance à des combinaisons surprenantes, et souvent belles d’un point de vue linguistique et culturel ; il en est de même de Smotshè. Des combinaisons d’images, de scènes, d’odeurs, de sons et de voix de Polonais et de Juifs de toutes sortes : Juifs orthodoxes, bundistes, sionistes, communistes et gens ordinaires, amkho comme on dit en yiddish. C’est pourquoi cette rue ne sera pas nommée dans ce livre par son nom polonais plutôt effrayant – Smocza, la rue du Dragon – mais de la façon dont on a l’habitude de la nommer en yiddish : Smotshè. Comme souvent, la voyelle finale en polonais est devenue un è en yiddish. En outre, le mot a acquis une certaine douceur, comme s’il s’agissait d’un diminutif, d’un surnom affectueux.
L’écrivain yiddish Leyb Malakh (1894-1936), qui avait quitté Smotshè pour Paris vingt ans plus tôt, revint visiter son pays natal durant les années 1930 : « Ici demeurent des luftmentshs, des doux rêveurs, des hommes de peine, des ouvriers et des petits artisans. Dans ces rues, l’obscurité est si épaisse. Même par temps clair, même sous le soleil, là, tout est mélancolique, lugubre […] partout, des immondices. […] On vit sur un lit et sous la table. »
« Les visiteurs, touristes et journalistes, décrivirent le “ghetto” juif comme un nid de pauvreté. Mais ce n’était que partiellement vrai », écrit l’historien Yankev Shatski dans son ouvrage sur l’histoire des Juifs de Varsovie. Les premières sensations d’un visiteur – surtout dans une rue telle que Smotshè – peuvent être trompeuses. De tels lieux nécessitent une observation plus longue ; il convient tout d’abord de s’habituer à la foule et aux odeurs, il faut y vivre pour découvrir la richesse que recèle la misère et la lumière contenue dans toute cette noirceur. Ce n’est qu’alors que l’on peut en distinguer la singularité. Il n’en va pas de Smotshè comme de ses voisines, Stawki, Gęsia, Ostrowska ou Miła.
Dans notre esprit, à nous autres Israéliens, toutes ces rues n’en font qu’une, comme un goulet d’étranglement au carrefour de la vie diasporique et de la misère. Le photographe américain Roman Vishniac, qui effectua un reportage dans le yiddishland d’Europe orientale en 1935, nous a légué un riche témoignage de la vie juive « à la toute dernière minute ». Mais comme Albert Londres, il ne fit pas la différence entre les paysans des Carpates et les socialistes de Łodz, entre un talmud torah de Munkács et une école primaire moderne de Varsovie. Il n’y a qu’une place pour le yiddishland dans notre mémoire. Chaque rue porte un nom, y compris une rue qui a sombré dans les entrailles de la terre, et pas seulement de manière métaphorique. Dans le livre de photos que Roman Vishniac a consacré aux enfants, par exemple, il est impossible de savoir dans quelle rue ont été photographiées les petites filles au regard curieux qui apparaissent sur la couverture, ni aucun des autres enfants figurant à l’intérieur. Roman Vishniac n’a rien mentionné au dos de ses photos. J’ai résisté à la tentation de les utiliser, puisque rien n’indiquait qu’ils avaient un lien avec cette rue en particulier. On ne peut apprécier les spécificités de la rue Smotshè qu’en s’en approchant de très près. De fait, une rue de Varsovie porte encore le nom de Smocza aujourd’hui, son tracé est même presque identique à celui d’avant la Seconde Guerre mondiale, mais dans la nouvelle Smocza, rien n’est comme avant 1945, ni les immeubles, ni les résidents.
Pour faire revivre cette rue, j’ai décidé d’appeler à la rescousse ceux qui l’ont bien connue : des journalistes, des écrivains, et aussi des enfants qui ont cavalé dans les cours de ses immeubles et qui, à l’heure de la rédaction de ce livre, auraient déjà plus de quatre-vingt-dix ans. Par exemple, Moyshè Zonshayn (1906-1960), un écrivain très varsovien, parle de Smotshè dans son livre Yidish Varshe (La Varsovie juive) : « La rue Smotshè ne comptait aucun résident de marque. Il fut un temps où les “gens bien” l’évitaient à tout prix et refusaient d’y habiter. Ce n’était pas de sa faute. Elle souffrait de la proximité d’autres rues, comme Ostrowska, Stawki, qui avaient une très mauvaise réputation. La rue Smotshè était la rue des Juifs les plus pauvres. »
Smotshè a quelque chose de la rue Neve She’anan à Tel-Aviv, dans le quartier de la gare routière, celle où se regroupent de nombreux immigrés originaires du Soudan et d’Érythrée. Cette comparaison un peu grossière permet néanmoins de percevoir le sentiment d’étrangeté éprouvé par les Polonais à l’égard de cette zone juive de Varsovie. De même, les Juifs des autres quartiers de Tel-Aviv considèrent celui de Neve She’anan comme une enclave étrangère, parfois inquiétante, un bout d’Afrique, pas seulement de par son apparence mais également du fait des bruits et des odeurs. De nombreux Polonais voyaient ainsi Smotshè comme un territoire perdu. S’il m’a été difficile de trouver de la documentation concernant Smotshè dans les archives polonaises, on peut imaginer qu’un jour, un chercheur d’origine soudanaise ou érythréenne éprouvera la même difficulté à en trouver dans les archives municipales de Tel-Aviv ou à la Bibliothèque nationale d’Israël, concernant la population africaine qui aura vécu là durant de longues années. La chronologie qu’il trouvera dans la presse israélienne concernera principalement des faits divers. Mais pour l’enfant qui aura grandi dans ce quartier, Neve She’anan aura été un monde en soi, pour le meilleur et pour le pire.
Je ne vis pas à Neve She’anan, de même que l’écrivain Sholem-Aleikhem – sans vouloir une seconde me comparer à lui – n’a jamais vécu parmi les petits bonshommes de Kasrilevkè auxquels il a consacré son œuvre. Après avoir traduit en hébreu certains de ses écrits, et d’autres grands textes yiddish comme ceux d’Avrom Sutzkever, je rentre à la maison, parmi les petites gens au milieu desquels je me sens bien.

Un jour, quand j’étais petit, j’ai accompagné grand-mère Feyge chez la femme de rabbi Halberstam. Cette petite dame habitait une vieille maison de plain pied, délabrée, aux confins de Bnei-Brak, derrière la rue Rabi Akiva. Bien qu’elle fût plus jeune que ma grand-mère, elle me semblait plus âgée. Tout comme ma grand-mère, elle parlait yiddish, et tout comme elle, elle avait les yeux bleus. Elle était pauvre et vivait d’expédients mais elle me demanda d’aller lui chercher une boîte rangée au-dessus de l’armoire en bois sombre de la chambre. Quand je la lui ai apportée, elle en a sorti un trésor qui éveilla en moi émerveillement et convoitise : une coiffe décorée de pierres précieuses. Plus tard, j’apprendrais que ça s’appelait en yiddish un shterntikhl (une coiffe décorée de perles). Les femmes juives aisées en portaient pour agrémenter leur visage. Mais cet accessoire était tombé en désuétude et, dans les années 1980, cette parure était devenue une curiosité. J’ignore comment la femme de rabbi Halberstam avait pu préserver ce trésor au cours de ses nombreuses et éprouvantes pérégrinations, mais je me souviens qu’elle s’en était coiffée, et elle avait même évoqué les prestigieuses têtes rabbiniques qu’elle avait ornées. Puis elle avait demandé à ma grand-mère de quels prestigieux rabbins elle descendait. « D’aucun », avait répondu ma grand-mère d’une voix étranglée, « mais mes parents étaient des erlekhe yidn, des Juifs droits. »
Je ne raconte pas cette histoire par provocation. Le nom d’Halberstam a refait surface des années plus tard dans le livre The Lost World: Polish Jews, un album photographique publié en 2015 par le Centre historique juif de Varsovie. Voilà que ce livre présentait une photographie de rabbi Sinaï Halberstam, le rabbi de Żmigród. Dans le cadre de mes recherches, je m’efforce d’être minutieux. Alors pour vérifier j’ai pris un livre que m’avait offert rabbi Halberstam lors d’une autre visite, Arye Shaag (Un lion rugissait). Et sur la page de titre j’ai lu que Arié Leybush Halberstam n’était autre que « le fils de notre maître Sinaï, président du tribunal rabbinique de Żmigród ». Certains trouvent un intérêt aux personnalités telles que les rabbis de la maison Halberstam. Personnellement, je souhaite continuer à me préoccuper de personnes anonymes dénuées de tout lignage.
*
Et pourquoi donc Smotshè entre les deux guerres, et notamment durant les années 1930 ?
Au milieu des années 1930, Varsovie était, avec 375 000 âmes, la deuxième communauté juive de diaspora après New York. Les Juifs y représentaient presque le tiers de la population de la ville. À ce moment-là, l’activité culturelle et politique des Juifs de Pologne était bouillonnante. Pourtant la situation économique et sociale de la majorité des Juifs se trouvait affectée par l’accession au pouvoir de partis nationalistes, suite à la mort du maréchal Józef Piłsudski en 1935. Le nombre d’actes antisémites grimpa. Plus tôt déjà, l’administration avait commencé à lourdement taxer les sources de subsistance des Juifs, principalement sur le commerce et l’artisanat. Dans le domaine éducatif, les universités polonaises réduisirent la possibilité donnée aux Juifs de suivre un cursus académique. De 21,5 % en 1925, la proportion des étudiants juifs tomba à 8,2 % en 1938-39. Cet état de fait induisit, entre autres, un renforcement des mouvements politiques et des associations. De nombreux Juifs rejoignirent alors un parti : les partis religieux Agudat Israel et Mizrahi, le Bund socialiste, le Parti communiste, l’un des partis sionistes ou d’autres.
Cette détresse se lit sans équivoque dans l’ouvrage Alilot ne’urim (Récits de jeunes), une anthologie de textes autobiographiques rédigés en yiddish, en polonais et en hébreu, par des jeunes gens et des jeunes filles juives en Pologne entre 1932 et 1939. Il s’agit d’une source primaire rare, qui décrit cette grande période durant laquelle la métamorphose du judaïsme polonais – près de trois millions et demi d’âmes – atteint un pic. Presque tous les jeunes vécurent cette métamorphose dans leur chair et les rédacteurs de ces textes autobiographiques expriment la sensation d’avoir goûté au fruit de l’arbre de la Connaissance. Ils se confrontent aux douleurs d’une prise de conscience. Cette génération de la Pologne indépendante fut la première à avoir accès à l’enseignement obligatoire dans des écoles d’État. Cela est particulièrement vrai pour les filles (presque toutes les filles de familles juives orthodoxes ont été scolarisées dans des écoles publiques et ont reçu une éducation juive dans une école complémentaire, une école du réseau religieux Beit Ya’akov). De ce fait, il leur était difficile de se confronter à la frontière entre la vie familiale et le monde extérieur. « Pourquoi devrais-je me laisser étrangler par des règles restrictives alors que tout en moi me porte vers un horizon sans limites ? », se demande Esther.
Durant cette période, des dizaines de journaux juifs en yiddish, en polonais, mais aussi en hébreu, parurent en Pologne, et des milliers de livres furent publiés, principalement en yiddish. Rien qu’à Varsovie, au moins cinq théâtres yiddish (dont un rue Smotshè) fonctionnaient régulièrement et il existait des institutions religieuses de diverses tendances. « Smotshè débordait de foi », écrit le journaliste Mordkhe Tsanin. Il poursuit : « Malgré toute l’injustice dont elle était victime, Smotshè savait se réjouir. Le soir, une masse de spectateurs accourait au théâtre juif de Smotshè comme si y pénétrer était une promesse de liberté et d’allégresse. Dans ces rues étroites et populeuses, de la rue Leszno à Muranów et à la rue Stawki, de la rue Smotshè aux rues Nowiniarska et Freta, il y avait des centaines d’associations et de bibliothèques, de maisons d’étude et de shtiblekh, de théâtres et de cinémas, de salles de lecture et de rédactions de journaux, un monde de spiritualité juive, un monde avide de connaissance et de liberté, autant d’aspirations sans bornes. »

C’est sur cette vie si diverse que je me propose d’écrire, une vie sur laquelle bientôt l’Anéantissement se déchaînera. Je préfère ne pas y porter le regard directement, l’observer plutôt de manière indirecte : avant et après l’Anéantissement. Et surtout avant. Ce que je décris, et ce que j’essaie vraiment de faire, c’est de reconstituer la vie qui fut vécue ici, rue Smotshè. Et de ce lieu particulier, Smotshè, on pourra sans doute tirer des enseignements plus généraux sur la Varsovie de l’entre-deux-guerres, mais les similitudes d’une rue à l’autre n’apparaîtront qu’après avoir pris conscience de la spécificité de Smotshè. Bien qu’au cours de mes recherches et de l’écriture de ce livre, je n’aie cessé de m’identifier davantage à « ma » rue, je n’ai pas l’intention de tresser des lauriers à Smotshè au détriment des autres rues. Cette rue a été tant oubliée que je serais comblé si je parvenais à la restituer dans toute sa vitalité, celle des bons et des mauvais jours. Et s’il est possible d’en tirer des enseignements pour le présent et le futur, ce sera une belle récompense. J’aimerais faire entendre le récit de Smotshè, de la même façon que j’aimerais entendre le récit de n’importe quelle autre communauté ou rue, à Bagdad ou à Djerba.
Peut-être faut-il aborder mes motivations personnelles. Les années 1930 sont une limite temporelle à laquelle j’ai encore un accès direct à l’heure où j’écris ce livre, car les souvenirs de mes proches remontent à cette époque. Et notamment Betsalel, mon père, né en Pologne en 1932. Il n’est pas natif de Varsovie, mais de Pułtusk, une bourgade proche de la capitale et différente en tous points. (Pułtusk et Smotshè se sont pourtant rencontrées au moins une fois : selon un fait divers publié dans le quotidien Undzer eksprès du 4 mars 1930, une jeune fille blonde de dix-huit ans a été retrouvée à Pułtusk. Elle semblait avoir perdu la raison. Sa sœur, Khanè-Feyge, habitait rue Smotshè à Varsovie.) Même si mon père n’est jamais allé à Varsovie dans son enfance, cette recherche est cependant une tentative, tardive de ma part, de comprendre à travers l’identification et les connaissances que, finalement, nous ne sommes pas si différents les uns des autres. Pas seulement mon père et moi, mais aussi nous et eux.
Le nom de Smotshè est mentionné des centaines, voire des milliers de fois, dans la presse de l’époque et dans la littérature, principalement en yiddish, et un peu également en polonais et en hébreu. En général, les informations qui concernent Smotshè n’apparaissent pas dans les premières pages (celles-ci sont réservées aux « grandes » actualités en provenance du monde), elles se trouvent plutôt dans les dernières pages et surtout dans la rubrique consacrée aux nouvelles locales. Chaque mention de la rue est une minuscule histoire, et j’ai essayé d’amalgamer toutes ces histoires pour en faire un seul grand récit : la biographie d’une rue. En chemin, j’ai également trouvé quelques photographies – en nombre bien plus restreint que les comptes rendus et les anecdotes – et même un court métrage. Certaines photos figurent dans l’ouvrage, ainsi que le plan aidant à la visite. Du fait du peu de documentation – de nombreux fonds d’archives ont été touchés par la destruction de Varsovie pendant la guerre, des documents importants ont disparu – la presse reste la source essentielle, comme le confirme Jerzy Majewski dans son introduction au livre La Muranow juive et ses alentours. La plupart de mes sources proviennent de la presse yiddish, à la fois du fait que le yiddish était la langue principale des habitants de Smotshè, et parce que Smotshè n’intéressait pas les lecteurs polonais, hormis quelques comptes rendus concernant des événements sortant de l’ordinaire comme les crimes. Mais pour ma part, je compte en restituer le quotidien, l’ordinaire.
Grâce au site Historical Jewish Press – outil précieux pour toute recherche historique concernant les Juifs – la presse de Varsovie est à présent facilement accessible. Dans ces journaux, j’ai pu opérer une recherche systématique sur Smotshè. J’ai ainsi déniché des occurrences nouvelles et surprenantes (du fait de leur grand nombre, je ne citerai pas les articles en notes de bas de page, mais à l’intérieur du texte en précisant le nom du journal et la date). La consultation de milliers de livres en yiddish de la bibliothèque digitale du Yiddish Book Center m’a permis d’approfondir mes recherches tout en restant devant mon ordinateur, et la recherche avancée sur Google Books m’a aidé à trouver de nombreuses mentions de la rue. Certains journaux ne sont pas encore accessibles sur Internet ou alors la recherche thématique n’est pas encore possible. Lors de mes recherches, cette accessibilité m’a manqué pour le Naye folkstsaytung, un quotidien bundiste, et les journaux du monde juif orthodoxe. Quand j’ai commencé à rédiger cet ouvrage, il était déjà trop tard pour espérer pouvoir rencontrer tous les habitants de la rue encore vivants. Cependant, les possibilités qu’offre le monde digital m’ont aidé à restituer la rue par les mots. Il y a des raisons d’espérer que, dans l’avenir, de nouveaux moyens permettront d’ajouter d’autres couches anciennes.
Du fait du peu de sources et de témoignages concernant les femmes de cette rue, je n’ai sans doute pas pu décrire leur univers de façon exacte. Hormis quelques rares mentions qui leur sont consacrées, la presse et la littérature se sont en général focalisées, comme on le sait, sur le masculin. Un jour peut-être trouvera-t-on le moyen de restituer cet élément manquant de la rue ou des éléments qui concernent d’autres minorités. Ce n’est donc pas moi qui terminerai ce travail.
Outre des extraits tirés de la presse et des textes littéraires, ce livre contient des documents trouvés dans les archives conservées en Israël et en Pologne, ainsi que des témoignages écrits et oraux, fruits de rencontres avec d’anciens habitants de Smotshè ou avec leurs descendants. Je me suis abstenu de me fonder sur mon imaginaire. Malgré le cadre temporel fixé – Smotshè entre les deux guerres mondiales – j’ai choisi de raconter l’histoire de cette rue comme une visite guidée. Elle part du 1 rue Smotshè, à l’angle de la rue Nowolipie, et va jusqu’au 62 rue Smotshè, à l’angle de la rue Stawki. J’y ferai fonction de guide touristique et j’utiliserai tout naturellement la première personne. C’est pour moi la meilleure manière de faire connaissance avec la rue et l’histoire de ses habitants, pas à pas, comme une cueillette où les personnages défilent sous nos yeux au gré de la promenade. Néanmoins, l’ouvrage comprend trois chapitres atypiques (outre ce chapitre d’introduction). Ce sont des chapitres thématiques qui n’ont pas pu s’intégrer dans le fil de l’agencement des immeubles de la rue : ils concernent les enfants et l’enseignement, les relations entre Juifs et Polonais, et enfin les écrivains de Smotshè.
*
Il me reste à dévoiler quelle a été ma clé d’entrée dans cette rue, à savoir la première fois que j’ai entendu son nom, Smotshè. C’était dans un vers du poème « Mayn shvester Khayè » (« Ma sœur Haya »), de Binem Heller, qui décrit Smotshè-gas mit di krume trep (rue Smotshè aux marches cabossées). Chava Alberstein a mis ce poème en musique et l’a enregistré avec les Klezmatics dans l’album The Well (Le puits), sorti en 1998. Il me semble qu’avant d’avoir écouté cet enregistrement, j’ai vu Chava Alberstein l’interpréter lors de l’inauguration de la synagogue de la rue Oranienburg à Berlin, retransmise sur Arte par une fraîche soirée d’été. Je reviendrai dans le dernier chapitre sur ce poème et sur son auteur. Pour l’heure, je confesserai juste que mes pas m’ont amené à pénétrer rue Smotshè pour la même raison que Binem Heller a continué à écrire en yiddish dans la yidish medinè (l’État juif) : il ne parvenait pas à l’oublier.
Khayè, ma sœur aux yeux verts,
Khayè, ma sœur aux tresses noires,
Khayè, cette sœur qui m’a élevé
Rue Smotshè, dans la maison aux marches cabossées.
Maman quittait la maison tôt matin,
Quand le jour pâlissait à peine.
Elle partait à la boutique pour gagner
Quelques misérables groschen.
Et Khayè restait avec ses petits frères,
Elle les nourrissait, les gardait,
Elle leur chantait les beaux airs
Que l’on chante le soir aux enfants fatigués.
Khayè, ma sœur aux yeux verts,
Khayè, ma sœur aux tresses noires,
Khayè, cette sœur qui m’a élevé
N’avait guère plus de dix ans.
Elle nettoyait, cuisinait, nous donnait à manger,
Elle coiffait nos petites têtes,
Mais elle oubliait de jouer avec nous,
Khayè, ma sœur aux tresses noires.
Khayè, ma sœur aux yeux verts,
Un Allemand l’a fait brûler à Treblinka.
Et moi, je suis dans l’État juif,
Le tout dernier à l’avoir connue.
C’est pour elle que j’écris mes poèmes en yiddish
Dans les jours terrifiants de notre temps.
Elle, de Dieu la fille unique,
Au ciel, elle siège à sa droite.
Ce poème est pour moi un peu comme la petite annonce de recherche de Dora Bruder, une jeune fille juive qui a quitté sa cachette dans un couvent parisien en décembre 1941 sans laisser de trace. Cette petite annonce a retenu l’attention de Patrick Modiano.
Comme Dora Bruder, le livre de Patrick Modiano dans lequel il tente de suivre sa trace, Smotshè est la recherche mélancolique de la rue perdue. Quelques années après Patrick Modiano, l’écrivain américain Daniel Mendelsohn écrit Les Disparus, une tentative de ramener à la mémoire six êtres parmi six millions : le frère de son grand-père, son épouse et leurs quatre filles.

Bien sûr, il y a l’injonction faite aux morts de se faire oublier, alors Smotshè est une tentative désespérée de lutter contre cette injonction. Car la plupart des habitants de cette rue ne sont pas morts de mort naturelle. Nombre d’entre eux trouvèrent la mort dans le ghetto de Varsovie ou à Treblinka, et ne figurent même pas parmi les « daf-ed », les feuilles de témoignage, déposées à Yad Vashem, le musée israélien dédié à la mémoire de la Shoah. Ils n’ont pas non plus eu un Binem Heller pour se souvenir d’eux. Partir à la recherche de ces disparus, c’est ce que j’ai essayé de faire.
Benny Mer
Traduit de l’hébreu par Gilles Rozier