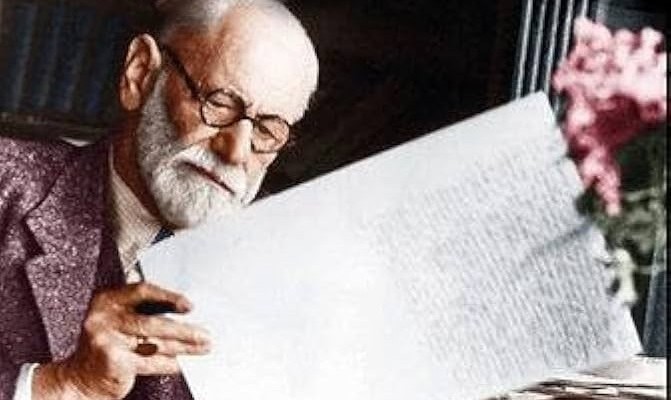La sortie dans les salles françaises du Procès Goldman a questionné la rédaction de K. Quelle trace a laissé le militant dans la conscience juive française, notamment de gauche ? Et quelle trace n’a-t-il pas laissée dans la gauche, après sa disparition ? Il nous a semblé évident de nous tourner vers le philosophe Gérard Bensussan, qui après avoir vu le film de Cédric Kahn nous a confié ce texte dans lequel il décompose la figure de Pierre Goldman, pris dans sa condition juive, juif « imaginaire », paria finalement parvenu.

Le procès Goldman, de Cédric Kahn, est un film sobre, presque sans chair vivante, sans effet de manche, si je puis dire : en un mot intègre. Cette intégrité de fond, soit ce désir de réduction de « l’affaire » au seul « procès », de l’épaisseur de l’événement à sa réfraction dans les quatre murs du prétoire, trouve son expression formelle, épurée, dans une image taillée au carré. La caméra y enferme les visages, les corps et les paroles dans l’étroitesse d’un quadrilatère fixe. Ce choix technique ne souffre pas d’exception : pas de reconstitution, pas de retour en arrière, pas d’extériorité, rien que la Cour d’assises d’Amiens, ses murs, ses protagonistes et leurs mots contendants comme des armes. On suffoque comme les jurés, on manque d’air, de lumière – immergé dans le clair-obscur un peu glauque, verdâtre, du tribunal, sans hors-champ, soumis au rythme accéléré des plaidoiries acérées et entrechoquées, des témoignages sans cohérence et des rages de Pierre Goldman. Je ne fais que décrire un cadre, je n’ai aucune compétence avérée de critique cinématographique. Je voudrais cependant évoquer, proustiennement, ce dans quoi le film de Cédric Kahn m’a plongé, l’immensité océanique des souvenirs et des impressions, des images et des traces, sans négliger la possibilité qu’y logent de toutes parts, travestissements et déformations. J’ai relu Souvenirs obscurs d’un juif polonais né en France, jamais rouvert depuis 1975.
La mémoire involontaire est erratique et oublieuse. Je ne me souviens pas vraiment du procès, je me souviens en revanche, comme si c’était hier, de l’annonce de l’assassinat de Pierre Goldman par un commando d’extrême droite, alors que j’étais en pleine conférence de rédaction d’une revue depuis longtemps défunte, Dialectiques. Nous fûmes tous sidérés. Goldman était une figure marquante dans toute l’extrême gauche et ses mouvances élargies, pas toujours estimée, admirée sans doute, fascinante aussi – mais que son « aventurisme », pour reprendre une de ces catégories accusatoires que le marxisme-léninisme avait forgées pour d’autres procès, autrement expéditifs, vouait à l’enrayement « petit-bourgeois » et aux dérives individuelles où, « objectivement », l’ennemi de classe trouverait sa pâture contre-révolutionnaire. J’ai la mémoire précise de ce que la parole de Pierre Goldman, dans Souvenirs obscurs, et sa présence publique, auratique, l’élucidation intellectuelle par lui-même de ses faits et méfaits, avaient provoqué chez de nombreux militants. Il faudrait, longuement, se replacer dans ces années où « le fond de l’air » était « rouge », comme disait le titre d’un autre film, de Chris Marker.
L’engagement révolutionnaire dans le mouvement communiste ou ses succédanés trotskiste et maoïste tenait lieu, pour beaucoup de jeunes juifs de cette époque, d’identité de substitution, affirmée sans reste et avec un brin de provocation. Le militantisme d’extrême gauche nous dépouillait, et nous le voulions délibérément, de toute identité juive qu’il eût été alors incongru de seulement nommer. En nous en émancipant, il nous rendait égaux à tous, frères de tous les opprimés, prolétaires de tous les pays, Arabes, Noirs, Vietnamiens. Je crois n’avoir jamais seulement prononcé le nom de « juif » pendant tout ce temps, dans tous les débats, les confrontations politiques incessantes et virulentes, y compris sur les Palestiniens. Pas plus qu’on ne l’invoqua jamais devant moi. La chose était sue, les patronymes l’attestaient, mais n’avait pas droit de cité. Ce qui n’empêchait pas ces « juifs non-juifs » que nous étions d’éprouver un sentiment de mitzva, de devoir accompli et d’exercice de la justice, au cours des affrontements physiques avec les groupuscules d’extrême droite. Cette judéité tue, tacite, innommable, ce misérable « petit recoin de mon cœur » comme dit Rosa Luxemburg, ne pouvait trouver place dans le grand élan internationaliste de solidarité avec tous les opprimés. Aucun privilège ne pouvait y être accordé aux juifs, surtout pas – c’eût été à nos propres yeux suspect. Ce silence partagé et inavoué, comme un secret marrane, ou de polichinelle, pouvait à l’occasion provoquer de l’embarras. Je me souviens d’une sorte de honte parfois ressentie, comme si dissimuler sans vraiment dissimuler revenait à simuler, ou à enfouir. L’effacement volontaire du judaïsme, tenu pour inessentiel et inimportant, l’obscur consentement à ce qui pointait pourtant autour de nous comme antisémitisme, latent et pensé comme résiduel et négligeable, ou bien patent et suscitant perplexité et anxiété, laissèrent quelques plaies invisibles. En tout état de cause, militants juifs révolutionnaires, nous pensions fermement que, comme le signifia un jour Trotski à Lénine, la vérité de notre engagement ne pouvait être juive, puisqu’universelle et mondialisée. Elle passait au mieux par la déconstruction, au sens strict, de notre judaïsme, au pire par son refoulement, sous peine de dériver vers un nationalisme juif de très mauvais aloi. À l’inverse de la juste maxime d’Hannah Arendt, lorsque nous étions attaqués en tant que juifs, nous répondions non en tant que juifs, mais en tant que révolutionnaires, citoyens du monde ou internationalistes.

Je rappelle tout ceci, une atmosphère, un climat d’époque, si différent d’aujourd’hui, pour mieux restituer quelque chose de l’effet de choc produit par le cas Goldman, son cri, les mots qu’il choisit en les inscrivant dans un certain héritage, juif, comme la levée d’une sorte de schize. Un militant révolutionnaire, engagé dans les maquis d’Amérique latine, solidaire des « peaux noires » de ses amis et de ses amours caribéens, capable de faire usage d’armes à feu contre l’État bourgeois, un militant si proche de nos rêves, pouvait donc prononcer le mot « juif » sans s’écorcher la bouche. La force de son verbe enracinait donc son combat, notre combat, dans la mémoire des juifs de l’affiche rouge, de la MOI, de Rayman qui ressemblait à Rimbaud, des combattants du ghetto de Varsovie, à l’égal des innombrables peuples de la grande cohorte anti-impérialiste. Dans Souvenirs obscurs, Goldman avoue même sa secrète admiration d’Israël, pour avoir su mettre en pratique l’idée révolutionnaire de « peuple en armes ».
Avec le recul, et ce qu’il peut révéler d’effroyable (notre complète indifférence d’alors à la question de sa culpabilité ou de son innocence dans l’assassinat des pharmaciennes du boulevard Richard Lenoir est terrible !), on se dit que Goldman ne fut rien qu’un « juif imaginaire », au sens de Finkielkraut, trop tard venu, condamné à une « vie par procuration » (c’est le titre d’une chanson de son frère Jean-Jacques). L’idée, et la pratique, d’une transitivité simple entre le combat des juifs résistants et antinazis et la lutte antiraciste et anticapitaliste des années 60 et 70 est une fiction d’époque, une quête de gloire nourrie de références continues à la Résistance. Ce topos n’a pas disparu. Il aura frayé le chemin aux ravages familiers qu’on connaît bien aujourd’hui, en particulier à la désastreuse équivalence entre dictature et démocratie, rapportées l’une et l’autre à des formes différentielles de la domination de classe. Dans Souvenirs obscurs, Goldman ridiculise à raison le vieux mot d’ordre soixante-huitard « CRS = SS » sans apercevoir la contradiction dans laquelle il se place en affirmant par ailleurs que la police est structurellement, systémiquement, raciste, police d’État au service de la classe dominante, police bourgeoise.
La polarité paria/parvenu, telle qu’Arendt la mobilise pour comprendre la situation historique des juifs d’Europe, paraît particulièrement appropriée à la saisie de ce que nous dit aujourd’hui de ces années gauchistes la figure de Pierre Goldman. La notion descriptive de paria désigne la caste des intouchables, la plus basse dans la hiérarchie traditionnelle de la société indienne. Max Weber assigne les parias intouchables au statut de « peuple-hôte » vivant parmi un peuple plus ou moins étranger dont ils seraient séparés rituellement et socialement. En comparant le statut des Juifs à celui des intouchables, Weber puis Arendt plus encore lorsqu’elle en emprunte l’usage soulignent que la situation des juifs en Europe fut et continue d’être inique, malgré les droits civiques, malgré l’Émancipation, malgré l’égalité juridique. Dans l’analyse de la condition juive moderne, la notion de peuple-paria semble faire pièce aux dilemmes théoriques de l’assimilation, du sionisme, de l’engagement communiste, ou encore de l’adhésion aux valeurs républicaines comme on dit aujourd’hui. Tout se passe, ou se passerait, comme si les juifs, poussés dans leurs retranchements, n’avaient de choix ultime qu’entre le statut de paria, soumis et dominé ou bien au contraire « conscient », s’assumant comme tel, dit Arendt ; et celui de parvenu, de Hofjude, du Juif riche s’entremettant auprès des puissants en faveur de ses frères paria en tâchant de les gagner à leur cause. Lorsqu’il récuse son avocat, Goldman explique qu’il le considère comme un ignominieux « juif de salon », comparable à tous les juifs de cour qui l’ont précédé. Il s’affirme ainsi et se vit, lui, comme paria conscient, comme un juif authentique, pour reprendre une caractérisation sartrienne, contrairement à la plupart des jeunes juifs gauchistes de l’époque, plus ou moins honteux d’une particularité qui risquait de les encapsuler dans l’identité acosmique d’un groupe fermé, coupé des grandes luttes révolutionnaires du monde.
Paria, juif imaginaire, juif (in)authentique, on pourrait ajouter à cet empilement de déterminations la dissimilation selon Rosenzweig. Goldman a toujours affirmé son refus de toute assimilation à la France, à la Pologne, à Israël, à toute nation quelle qu’elle fût, il a toujours brandi son « étrangèreté » radicale. La dissimilation rosenzweigienne est attachée à la dissidence absolue d’un judaïsme pensé comme extra-historique, extra-étatique, extra-occidental, hors temps et hors lieu. La dissimilation goldmanienne est, elle, délibérément associée à une « tradition moderne » (J.L. Nancy), révolutionnaire, occidentale, elle s’inscrit dans une marginalité qui a son histoire et ses lettres de noblesse, ses hérauts et ses quarts d’heure de gloire. C’est cette dissimilation assimilée qui fait de Pierre Goldman un juif « imaginaire », un paria finalement parvenu. Dans Souvenirs obscurs, lorsqu’il évoque son gangstérisme, ses braquages, sa vie de truand, il y discerne en profondeur quelque chose d’inauthentique, un « jeu disloqué où je brisais le centre de ma nature » écrit-il.
L’une des fortes qualités du film de Cédric Kahn est de montrer comment l’exercice de la justice « disloque » institutionnellement non seulement la « nature » d’un accusé mais aussi « la vérité » – tous les films de prétoire pourraient s’appeler comme celui de H.G. Clouzot. La recherche de la vérité, de « la vérité des faits » dit Goldman, se heurte sans cesse à des obstacles et des limites, du temps, perdu et retrouvé, de la mémoire infidèle. Cette représentation d’une vérité disloquée met aussi en scène, dans Le procès Goldman, des figures, le paria et le parvenu, le dissimilé et l’assimilé, Goldman et Kiejman, mais aussi, autrement, Pierre et Jean-Jacques, des destins croisés, semblables et dissemblables, des voies incertaines. Les juifs français sont aujourd’hui parties intégrantes de la nation et de la République, mais par un biais plutôt inattendu, l’islamisme français, ils peuvent s’entendre dire « retourne à Tel Aviv » ! J’ai lu quelque part qu’en clamant que « juifs » et « nègres », c’est « pareil », Goldman anticipait ce qu’on appelle l’intersectionnalité des luttes. Peut-être, mais ladite intersectionnalité, si elle a pignon sur rue, est aujourd’hui judenrein. Les juifs n’en sont pas partie prenante, ils en sont au contraire, pour l’extrême gauche contemporaine, les empêcheurs. Qui, parmi ses représentants, pourrait aujourd’hui défiler sous un slogan comme « nous sommes tous des juifs… » ?
Un peu comme la symbiose judéo-allemande fut, au dire de Scholem, une histoire d’amour à sens unique, la symbiose judéo-révolutionnaire que voulut incarner Pierre Goldman les armes à la main aura mal fini, comme les histoires d’amour en général selon la chanson.
Gérard Bensussan
Philosophe, professeur émérite à l’Université de Strasbourg, Gérard Bensussan a travaillé sur la philosophie classique allemande et la philosophie juive. Il a publié une vingtaine d’ouvrage dont ‘Le temps messianique. Temps historique et temps vécu’ (Vrin, 2001), ‘Dans la forme du monde : Sur Franz Rosenzweig’ (Hermann, 2009) et dernièrement ‘L’Écriture de l’involontaire. Philosophie de Proust’ (Classique Garnie, 2020). Son dernier livre : ‘La transaction. Penser autrement la démocratie’ PUF, 2023