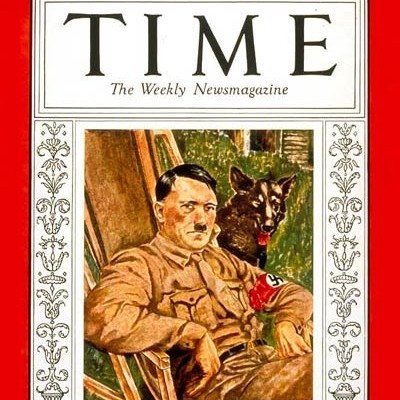Qu’est-ce qui explique la capacité de l’antisionisme à agréger les luttes au nom de l’émancipation, et qu’Israël soit devenu le «mauvais objet » de la critique s’énonçant depuis l’université ? Dans un texte mesuré et éclairant, Bruno Karsenti interroge pas à pas la grammaire des mobilisations étudiantes pour dégager une perspective sur les reconfigurations politiques qui s’annoncent. Dans cette grammaire deux notions sont opposées comme irréconciliables : la nation et le peuple, deux notions dont la signification et les liens sont perdus de vue. C’est ainsi qu’une critique à la dérive se met en place. Et, sans que les étudiants le sachent nécessairement, c’est alors la vieille ‘question juive’ qui trouve une nouvelle formulation, autour de l’impensable persistance du peuple juif dans la nation moderne.

Dans les États où nous vivons, l’université est le lieu où peut se former et s’exprimer, à distance des pouvoirs religieux, politiques et économiques, la pensée critique, celle susceptible de fonder et d’articuler les protestations contre les injustices. Sur le long cours, elle est née comme le desserrement d’un étau, en commençant par l’étau politico-religieux de l’État et de l’Église, et à l’abri des puissances du marché. Une poche de réflexion sur la réalité – sur les lois, sur les faits, et plus généralement sur le cours du monde – s’est constituée de cette manière. Progressivement, elle s’est avérée essentielle au fonctionnement de toute démocratie digne de ce nom.
Il y a là un acquis qui nous est vital. Toute atteinte à la démocratie se signale par le fait que ce lieu est menacé et réinvesti par les pouvoirs institués, qu’on cherche à brider la connaissance et la réflexion qui s’y déploient. C’est immanquablement ce qui arrive dans les États autoritaires (religieux ou pas). Différents moyens sont dans ce cas utilisés, notamment la réduction de la liberté académique des enseignants, ou encore la répression des mobilisations étudiantes, exercice de leur liberté d’expression. L’expression étudiante n’a certes rien à voir avec la liberté académique. Cependant, dans la mesure où les étudiants font partie intégrante de la communauté universitaire, de l’academia, l’opinion qu’elle traduit est plus qu’une simple opinion. Les connaissances que les étudiants sont supposés acquérir, leur participation à la discussion argumentée qui est la règle dans cette communauté, font qu’on doit par principe les créditer d’une haute conscience critique, c’est-à-dire d’une perception et d’une compréhension relativement élevées des questions de justice. Car celles-ci, dans cet espace où ils font leurs études et reçoivent un enseignement, sont examinées rationnellement, hors de toute ingérence et en toute liberté d’esprit.
Les luttes écologiques, celles pour les femmes contre les discriminations raciales, les violences policières ou les politiques néolibérales, font pâle figure en comparaison de la lutte antisioniste. Aucune autre cause n’était parvenue à provoquer un tel élan dans le foyer démocratique de la critique que porte la jeunesse étudiante
Antisionisme
Les mobilisations étudiantes qui se déroulent en ce moment sont un signe de cette vitalité et de cette liberté. Elles doivent être entendues et évaluées au regard de ce qu’elles sont supposées être : l’expression critique nécessaire à ce que nos sociétés existent et fonctionnent démocratiquement. Or ce qu’on voit, c’est qu’elles ont trouvé leur centre de gravité et le proclament. Elles s’ordonnent autour de l’antisionisme, thème qui parvient à les faire converger et leur donne une surprenante vigueur. Parfois s’y agrègent des enseignants, parfois pas. Parfois d’autres types d’acteurs, extra-universitaires, s’y associent, avec les risques d’influence subreptice, de parasitage, de captation et de détournement qui s’ensuivent. Seule une ethnographie précise pourra établir la genèse, la composition, le mode de construction et d’organisation de ces mouvements. Et seul le temps permettra de juger de l’importance du phénomène.
Mais dans l’attente de ces données, un point est d’ores et déjà remarquable : les luttes écologiques, celles pour les femmes et les minorités sexuelles, ou encore celles contre les discriminations raciales, les violences policières ou les politiques néolibérales, font pâle figure en comparaison de la lutte antisioniste. Aucune autre cause, au fil des occasions qui n’ont pourtant pas manqué dans le passé récent, n’était parvenue à provoquer un tel élan dans le foyer démocratique de la critique que porte la jeunesse étudiante. Que la gauche radicale, à un moment où il lui faut trouver un nouveau souffle, y voit une étincelle à laquelle s’accrocher n’a rien de surprenant. Crier à l’instrumentalisation est sans doute vrai, mais a en définitive peu d’intérêt. Une tendance sociale s’exprime, et les politiques soit la suivent soit la dénoncent, soit l’attisent et cherchent à se l’approprier, soit la condamnent et en font un épouvantail ; c’est tout ce qu’il y a à relever. Le jeu de la politique est ainsi fait.
Plus intéressant, mais aussi plus compliqué, est de se demander en quoi cette tendance consiste. Son fondement objectif est le drame saillant du moment : la guerre menée par Israël à Gaza, lourde en pertes civiles du côté palestinien. La lutte étudiante est motivée par les souffrances de ce peuple, dont elle considère que les gouvernements occidentaux sont complices, sinon par le soutien actif qu’ils apportent à l’action militaire israélienne, du moins par le caractère seulement verbal des critiques qu’ils se contentent de lui adresser. Ces critiques ne s’accompagnent selon les protestataires d’aucune action réelle. Or c’est l’action qui est à l’ordre du jour, et pas les vaines paroles et les discussions soupçonnées d’être dilatoires dans l’urgence où l’on se trouve.
Le cadrage adopté par les mobilisations est on ne peut plus clair : Israël est un État colonial, raciste et génocidaire, dont les victimes sont un peuple opprimé, affamé, démuni et en résistance.
Cette action requiert évidemment un cadrage stable de la situation dans laquelle elle intervient. Il n’y a pas à s’étonner non plus que dans le moment aigu de la mobilisation, ce cadrage soit érigé en amont et placé hors de discussion. Celui adopté par les mobilisations est on ne peut plus clair : Israël est un État colonial, raciste et génocidaire, dont la victime est un peuple opprimé, affamé, démuni et en résistance. Le mouvement a des « piliers », et il débouche sur des « revendications ». Aux deux pôles, son antisionisme s’affiche. C’est là toute sa force : assuré dans sa position, sûr de la qualification des faits, il vise une fin déterminée et la juge accessible. On peut bien rappeler le mouvement à la nécessité d’une analyse historique, sociologique et politique pondérée, tenter de le reconduire à la vocation réflexive et savante du lieu depuis lequel il parle, rien n’y fait. Car pour lui, l’heure est à l’expression de ce qu’on porte en soi en tant que conviction critique. Les discussions qu’il organise ne visent qu’à étayer et afficher cette conviction. Le mouvement veut en finir avec Israël, État dont l’existence repose sur l’injustice la plus grande, à savoir la plus à même aujourd’hui de susciter l’indignation.
Par-là s’explique aussi le rapport que le mouvement entretient avec la guerre. Révélateur de l’injustice constitutive du sionisme, la guerre indique pour lui tout aussi clairement la voie à prendre pour abolir cette injustice. Certes, le cessez-le-feu immédiat est réclamé à Gaza. Mais il l’est comme une étape dans la guerre à laquelle il s’agit de participer par les moyens dont on dispose, à distance de la zone de feu : le boycott d’Israël, prélude à son annihilation. Par cet acte, on estime être à coup sûr aux côtés des Palestiniens, lutter avec eux contre leur ennemi. Non pas en exigeant qu’Israël change de parti au pouvoir et modifie sa politique, mais qu’il disparaisse en tant qu’État juif, en tant qu’État sioniste, vivant comme tel de l’oppression d’un peuple.
Les deux pôles du clivage
Le conflit idéologique actuel dans le monde occidental tel qu’il s’exprime dans ce lieu de science et de réflexion qu’est l’université – car il en va autrement dans d’autres lieux, comme par exemple l’arène politique – n’est pas, on le voit, entre pro-israéliens et propalestiniens. Il est entre tous ceux qui considèrent qu’il y a un État d’Israël dont la destruction n’est pas envisageable, et ceux qui considèrent qu’il y a un État d’Israël dont la destruction est le point de convergence et d’exhaussement de toutes les luttes.
Faut-il alors penser que le clivage est entre sionistes et antisionistes ? Certes, mais encore faut-il s’entendre sur les mots. Car ce qu’on voit, c’est que tous ceux qui considèrent que la destruction de l’État d’Israël n’est pas envisageable ne sont pas nécessairement sionistes, au sens où ils se caractériseraient par leur adhésion à cette idéologie nationale née au XIXème siècle qui s’est réalisée avec la création de l’État d’Israël. Ils peuvent l’envisager avec sympathie ou antipathie, le point est ailleurs : précisément dans l’élément de la réalisation de ce courant idéologique. Disons qu’ils partent du constat qu’un processus de nationalisation guidé par le sionisme a abouti à la formation d’une entité stato-nationale appelée « Israël » qui fait partie de l’ordre mondial, ordre à l’intérieur duquel on raisonne pour traiter des conflits. Que ces conflits engagent des prétentions nationales concurrentes en quête d’État fait évidemment partie des coordonnées du problème. C’est ainsi qu’est intégrée la cause palestinienne : on acte son existence en tant que cause nationale, tendue comme telle vers l’acquisition d’un État. Les modes d’intégration de cet élément peuvent varier, et c’est cette variation qui décide des différentes positions en présence : elles peuvent être pro-israéliennes ou propalestiniennes. Et elles peuvent en cela s’affronter durement. Elles restent néanmoins dans la même problématique et usent d’une grammaire commune.
Les « sionistes » auxquels on s’oppose dans les universités, ce sont tous ceux qui prononcent le nom « Israël ». Ce qui, évidemment, comprend beaucoup de monde.
Or dans l’autre camp, qui a son épicentre à l’université, on raisonne tout autrement : on s’oppose à la réalisation sioniste. On est antisioniste en ce qu’on s’attaque au sionisme tel qu’il s’est effectivement réalisé, c’est-à-dire à l’idéologie sioniste en tant qu’elle fonde et maintient dans l’existence un certain État. L’argument est antisioniste, au sens d’anti-israélien.
La nuance vaut d’être relevée. Lorsque ce camp s’exprime dans l’aire occidentale, il se conforme à l’usage d’une grande partie du monde arabo-musulman et parle d’ « entité sioniste », c’est-à-dire qu’il se refuse à prononcer le nom que cet État s’est donné et qui a été enregistré par la communauté internationale. Pourtant, le refus se connote ici d’un sens qui lui est propre. Il s’agit de refuser que le sionisme accède à sa réalisation sous la forme d’un État-nation. C’est cette forme qui est rejetée, en tant qu’elle a été visée et réalisée par ce mouvement national juif qu’est le sionisme. Processus auquel est imputée l’injustice la plus grande, celle qui consiste à porter atteinte aux droits des Palestiniens. À la différence de ce qui se passe pour le monde arabo-musulman, le refus n’est pas essentiellement adressé à la communauté internationale, mais aux juifs, auxquels il est signifié que le sionisme ne doit pas se réaliser, parce que ce peuple n’aurait pas dû se nationaliser sous cette forme et accéder sur cette voie à leur nom d’État. Les droits du peuple palestinien, hier comme aujourd’hui, l’interdisent. Bref, les Occidentaux antisionistes frappent d’interdiction le sionisme tel qu’il s’est réalisé, et c’est pour cela qu’ils bannissent le nom d’Israël de leur discours. Par extension, ils l’interdisent à quiconque adopte ce point de vue, qu’il soit juif ou non-juif. Les « sionistes » auxquels on s’oppose dans les universités, ce sont tous ceux qui prononcent le nom « Israël ». Ce qui, évidemment, comprend beaucoup de monde.
Les deux camps qu’on vient de décrire, celui qui interprète la situation comme un conflit entre deux affirmations nationales de nature différente dont il s’agit d’évaluer les légitimités respectives mises à l’épreuve dans la guerre et ses crimes éventuels, et celui qui prend le parti d’un peuple contre un État-nation dont l’existence est reconduite à la violence qu’il lui inflige, imprègne à coup sûr les sociétés démocratiques occidentales dans leur ensemble. On peut le voir cheminer et se reproduire, sous un style plus ou moins prononcé, dans de nombreux espaces. En Europe comme outre-Atlantique, c’est toutefois dans la sphère universitaire qu’il connaît son expression la plus spectaculaire. Tandis que partout ailleurs on est plutôt porté à lire le conflit selon la première grammaire, où s’affrontent des propalestiniens et des pro-israéliens, la sphère universitaire donne toute sa place à la seconde, celle entre les « sionistes », au sens large de ceux qui disent « Israël », et les antisionistes qui s’opposent à la réalité qui porte ce nom et à tous ceux qui le prononcent.
C’est là-dessus qu’il convient de s’interroger : sur l’hégémonie, à l’œuvre dans l’université, à laquelle prétend cette seconde grammaire. Alors que la première est beaucoup plus commune, alors qu’elle est majoritairement en usage chez les gouvernants et dans l’opinion publique, il en va tout autrement dans l’université, lieu de la réflexion sociale et politique censément la plus poussée, celle qui s’éclaire le plus directement de l’analyse scientifique des faits, et est en droit de prétendre orienter la meilleure politique possible.
Peuple contra nation
Le véritable problème n’est pas de savoir pourquoi l’antisionisme a son principal terreau dans le monde universitaire, et de s’alarmer qu’il y soit dominant. Il n’est d’ailleurs pas vrai qu’il en soit ainsi. À l’université, que ce soit chez les étudiants, les personnels administratifs ou les enseignants, les positions varient beaucoup, et la tendance propre aux mobilisations antisionistes, si démonstrative soit-elle, n’enclenche pas de mouvements de masse, ni au sein du microcosme ni au-delà. Par ailleurs, hors de cet espace, d’autres foyers, religieux et politiques, nourrissent l’antisionisme très directement. C’est ce qui fait que l’antisionisme se signale aujourd’hui comme un courant politique transnational de grande ampleur, actif dans le monde entier. Dans le monde non-occidental, il est fréquent qu’il traduise l’opinion majoritaire et galvanise les foules. Rien de tel ici.
Pour les mobilisations antisionistes, il n’en va pas d’un conflit entre deux processus de nationalisation différents, ni de l’imputation des responsabilités dans l’inachèvement de l’un et la situation d’inégalité qui en découle. Le peuple palestinien emporte l’adhésion en tant qu’il est un peuple, et non pas une nation en devenir, appelée à s’organiser socialement et politiquement pour donner naissance à un État.
Ce qui est en revanche significatif, c’est que nos universités détiennent le privilège de fabriquer et de faire rayonner une lecture singulière du conflit : lecture qui remonte jusqu’à l’existence d’Israël, et impose de se positionner pour ou contre. Mais surtout : lecture qui secondarise l’alternative entre pro-israéliens et propalestiniens, en faisant de la prononciation du nom « Israël » l’enjeu vraiment décisif, celui qui fait tomber d’un côté ou de l’autre du clivage fondamental, où la question de la justice est touchée en son centre névralgique. Insistons : où elle l’est de façon plus aiguë et plus manifeste que lorsqu’il est question de n’importe quel autre fait de domination avérée et de faute commise par un acteur quelconque.
Comment expliquer un phénomène aussi étrange ? Comment rendre compte de l’attirance de la critique universitaire, non simplement pour le conflit du Proche-Orient, mais pour cette formulation et cette compréhension singulières de ce conflit ? Qu’est-ce qui rend une partie de cette communauté aussi prompte à se saisir de ce conflit pour exprimer son exigence de justice la plus pressante, et pour cela à le définir précisément de cette manière, comme un conflit entre un peuple à défendre et un État à abolir ?
Les Palestiniens sont un peuple. C’est là ce que personne – hormis les extrémistes sionistes qui ne remplissent pas les conditions minimales de participation à la discussion – ne conteste. Ils le sont au même titre que les juifs le sont. Mais dans le conflit, les juifs comparaissent sous un nom qui est un nom d’État. Ils figurent comme « les Israéliens », les membres de l’État d’Israël, appartenant à la nation israélienne, qui inclut d’ailleurs des juifs et des non-juifs, parmi lesquels des Palestiniens. Dans le même temps, cette nation n’en est pas moins le produit d’une dynamique de nationalisation qui a un caractère juif : le sionisme, justement. Et c’est le sionisme réalisé qui coïncide avec la création d’un État qui n’est pas – comme a le tort de l’énoncer la loi de 2018 promue par Netanyahou – « l’État-nation du peuple juif », mais l’État créé par un peuple qui s’est nationalisé sur le mode moderne, et qui en se nationalisant sur le mode moderne, a donné naissance à une société nationale plurielle et démocratique, comprenant une majorité juive et des minorités non-juives, c’est-à-dire plusieurs peuples.
Quant aux Palestiniens, peuple sans État, ils sont engagés de longue date dans un processus de nationalisation moderne analogue, amorcé à la fin de l’Empire ottoman, qui, pour des raisons à la fois internes et externes, n’a pas abouti jusqu’à présent à la même réalisation. Actuellement, dans une guerre que l’un de ses mouvements politico-religieux a déclenchée, ce peuple est gravement atteint et subit des pertes civiles dont il est juste de s’indigner et auxquelles il est juste d’essayer de parer.
On exige, par forçage juridique assumé, le qualificatif de génocidaire, mot-fétiche auquel on tient plus que tout, parce qu’il dit en toutes lettres exactement de ce qu’on veut dire : à savoir qu’un État tue un peuple.
Mais décrire les choses ainsi, on le voit, c’est de toute façon s’engager dans la première grammaire, la plus commune, et non pas celle dont l’hégémonie cherche à s’établir dans l’université. Pour les mobilisations antisionistes, c’est très insuffisant, puisqu’il n’en va pas d’un conflit entre deux processus de nationalisation différents, adverses et désynchronisés, ni de l’imputation des responsabilités dans l’inachèvement de l’un et la situation d’inégalité qui en découle. Ici, le peuple palestinien emporte l’adhésion en tant qu’il est un peuple, et non pas une nation en devenir, appelée à s’organiser socialement et politiquement pour donner naissance à un État. Il est saisi à partir de la légitimité de principe que lui confère son autochtonie. L’appartenance à la terre, son ancrage dans son milieu de vie et sa pure présence à lui-même suffisent à le qualifier – tout comme c’est le statut d’entité stato-nationale affectée d’artificialité et de volonté de puissance qui suffit à discréditer Israël, c’est-à-dire à faire tomber son nom.
Raciste, colonial, génocidaire, le sionisme l’est dans cette vision par sa seule réalisation. Il l’est du fait même qu’il s’est réalisé. La mise hors discussion du cadrage initial vient de là. On ne discute pas du caractère colonial et raciste d’Israël. Surtout, on exige, par forçage juridique assumé, le qualificatif de génocidaire, mot-fétiche auquel on tient plus que tout, parce qu’il dit en toutes lettres exactement de ce qu’on veut dire : à savoir qu’un État tue un peuple. L’existence d’Israël implique l’amas de traits négatifs qui culminent dans le génocide. Elle l’implique originairement, à l’encontre des Palestiniens comme peuple plutôt que comme nation.
La critique en suspens
On ne le relève pas assez : les mobilisations actuelles sont très différentes des luttes nationales qui ont accompagné la décolonisation dans les années 60 et 70. L’ère dans laquelle on est entré depuis les années 90, si elle nous met à coup sûr à distance de l’après-Seconde Guerre mondiale et de la conscience post-Shoah qui en était issue, nous éloigne aussi de l’époque des luttes de libération anticoloniales et anti-impérialistes. Les concepts d’autodétermination et d’autonomie nationale n’y dessinent pas un axe central, et si un motif tiers-mondiste semble bien se rejouer dans ce qui se passe aujourd’hui, c’est avec une connotation toute particulière. Si bien que les références historiques auxquelles le mouvement veut se raccrocher et dont il cherche à tirer une certaine aura (le Vietnam, l’Algérie…) rendent pour finir un son creux.
C’est qu’aujourd’hui, la cible principale de la critique vient se loger au cœur des processus de nationalisation. Ce qu’on en arrive à contester, c’est que ces processus puissent être par eux-mêmes des vecteurs assurés d’émancipation pour les individus et pour les peuples.
L’inflexion, soulignons-le, n’a rien de pathologique en soi. Elle est née d’une conscience et d’un savoir critiques plus aiguisés qui ont été soutenus et élaborés à l’université. C’est par surcroît de lucidité, c’est-à-dire par une attention plus poussée aux problèmes d’intégration des minorités de toute sorte au sein des États-nations, ou encore à l’accroissement des interdépendances entre ces États, avec les dommages transnationaux qu’elles provoquent (migratoires, sanitaires, environnementaux…), que l’on a éprouvé la nécessité de revenir sur soi de cette manière. On l’a fait en revisitant le passé – et donc en produisant une nouvelle historiographie – et en scrutant plus intensément le présent – sur les voies conjuguées du droit, de l’économie, de la sociologie et de l’anthropologie, sciences sociales dont les méthodes ont dû profondément se transformer à partir du moment où les cadres étatiques et nationaux, reconduits à leurs contradictions, sont apparus précisément comme ce qui devait être réévalué et réexaminé.
A mesure qu’on se faisait plus autocritique et attentif aux impensés coupables de la politique occidentale passée et présente, on peinait à rejoindre ce qui, ailleurs, reprenait l’aspect, en plusieurs foyers qui s’étaient allumés et nourris mutuellement, de processus de nationalisation de type démocratique.
Mais l’effort requis par de telles avancées a son revers. Car il s’accompagne du doute jeté sur la portée émancipatrice de ce qui se présente comme des luttes expressément nationales. Si la grammaire de base de la nationalisation est remise sur le métier, alors la conséquence est inévitable. Les phénomènes associés à la constitution des peuples en nations, ce mouvement constitutif de la modernité où il en va de l’acquisition des droits démocratiques, ne sont plus tenus pour acquis, mais questionnés dans leurs fondements. Ce retour sur soi est juste et nécessaire, sans quoi c’est l’expérience moderne elle-même qui cesse de se poursuivre et qui se nie elle-même. Mais l’incertitude et l’indétermination qui pèsent sur le nouveau cadre à reconstruire, au-delà de celui dont on scrute et identifie les limites, minent forcément la critique. Celle-ci court alors le risque de se perdre dans la simple dénonciation de ces limites, du moins tant qu’elle ne se double pas d’un autre effort qui consiste à redessiner les appartenances collectives et les formes de solidarité nouvelles, plus complexes et plus larges, où puissent être reçues, traitées et résolues les attentes de justice qui se font jour.
Au cours de la décennie passée, on a pu voir un signe de cette difficulté dans la façon dont la conscience politique occidentale a réagi aux Printemps arabes, et à leur pic tragique que fut l’échec de la révolution syrienne. Au premier chef, il y eut bien entendu la tiédeur, pour ne pas dire plus, des États occidentaux et de leurs représentants, les compromissions des responsables politiques qui renvoyaient aux agendas et aux intérêts géopolitiques en présence. Mais ce qu’on doit relever, c’est le faible engagement de la conscience critique à cet égard, et le faible écho qu’elle donna aux mouvements d’émancipation qui se produisaient. Comme si elle ne trouvait pas là assez de résonances avec ses propres tendances pour s’engager massivement et articuler avec netteté sa protestation. Comme si, à mesure qu’on se faisait plus autocritique et attentif aux impensés coupables de la politique occidentale passée et présente, on peinait à rejoindre ce qui, ailleurs, reprenait l’aspect, en plusieurs foyers qui s’étaient allumés et nourris mutuellement, de processus de nationalisation de type démocratique.
Il n’y pas de hasard à ce que les massacres en Syrie – dont certains ont d’ailleurs décimé des Palestiniens en grand nombre – n’aient jamais déclenché dans nos contrées une mobilisation universitaire comparable à celle qu’on constate en ce moment. On dira qu’on n’attendait pas du régime syrien le même respect des droits que de la part d’une démocratie apparentée à la nôtre comme l’est Israël, et qu’il est naturel que l’indignation soit au plus haut lorsqu’un reflet de soi se laisse lire dans l’action dont on s’indigne. Mais si la question est bien de savoir de quel mouvement d’émancipation nous nous sentons solidaires, l’argument ne vaut rien. Car le critère doit résider dans ce pour quoi on lutte, sans autre considération. Dans le présent, l’indignation que suscite la souffrance des Palestiniens est à la mesure de l’écho qu’elle rencontre dans certaines des inclinations les plus puissantes de la conscience critique occidentale. Or on voit bien de quoi il s’agit : à travers la lutte des Palestiniens, résonne au premier chef l’identité bafouée d’un peuple, le fait qu’il soit dépossédé de lui-même et de sa terre par un autre peuple, qui est devenu quant à lui occupant et oppresseur précisément en se faisant nation et en acquérant dans la foulée l’État qui lui correspond. Bref, dans l’esprit des protestataires, cela s’est produit à travers ce mouvement national coupable qu’est le sionisme, parvenu au stade de sa réalisation.
Les sionistes, ce sont au fond tous ceux qui raisonnent en termes nationaux dans l’effort qu’ils font pour traiter du conflit, au moment où il est devenu éminemment problématique de le faire, et où aucun cadrage de substitution n’est fourni par la réflexion. C’est ainsi que le sionisme est devenu le mauvais objet de la critique en perte de repères.
En dénonçant l’État d’Israël comme colonial, en affiliant le sionisme au colonialisme de type impérial porté au XIXème siècle par les puissances européennes, puis relayé par l’impérialisme américain au siècle suivant, c’est ce raisonnement qui se met en place. Quand on y regarde de près, ses faiblesses et ses courts-circuits apparaissent vite. Il ne fonctionne qu’à effacer systématiquement tous les éléments qui exceptent le sionisme réel du schéma dans lequel on veut le faire rentrer, à savoir tous ceux qui le rattachent justement à un mouvement de libération nationale – celui d’un peuple dispersé entre Orient et Occident, attaché lui aussi à cette terre de Palestine où sa présence ne s’était jamais éteinte au fil des siècles, et dont le mouvement de retour fut alimenté par des vagues successives, non pas d’exploiteurs coloniaux en quête de profit, mais de réfugiés en quête d’abri, en provenance d’Europe d’abord, puis, dans les années 50, des pays arabes qui avaient expulsé leurs juifs (flux dont il n’est pratiquement jamais question dans le discours critique) .
Mais ces considérations ne sont d’aucun poids dans la grammaire antisioniste universitaire. Par une pathologie qui affecte la réflexion censément la plus poussée, il arrive que certains acteurs de cette institution optent pour le dogmatisme le plus obstiné et pour la défiguration. C’est que l’image de ce qu’ils désirent voir est dans ce cas trop imposante et trop attirante pour qu’ils puissent y résister.
Récemment, sur le mur d’un hall central de l’université de Berkeley, on pouvait lire ce drôle de message : « All sionists are nazionists ». Sous l’assimilation sans surprise des juifs aux nazis, trope antisémite des plus classiques, on déchiffre un autre mot : les « nazionists » ne sont-ils pas plutôt des « nationists », tous autant qu’ils sont ? C’est bien le cas pour les acteurs de la mobilisation. Les sionistes, ce sont au fond tous ceux qui raisonnent en termes nationaux dans l’effort qu’ils font pour traiter du conflit, au moment où il est devenu éminemment problématique de le faire, et où aucun cadrage de substitution n’est fourni par la réflexion. C’est ainsi que le sionisme est devenu le mauvais objet de la critique en perte de repères, incapable de se politiser autrement qu’en empilant sur une même cible tous les traits de ce qu’elle considère haïssable. Qu’il en aille surtout de morale dans ce négativisme abstrait, et nullement de politique, il arrive que la mobilisation l’avoue et s’en glorifie. Elle croit se parer ainsi d’un surplus de légitimité. Mais en vérité, elle ne fait qu’attester de la gravité de la crise dont elle est le symptôme. Crise qui consiste en une politisation échouée, doublée du refus fier de soi de vouloir encore connaître. Crise du savoir et de la politique, inséparablement, où l’université donne les signes, non de sa destruction sous les coups de pouvoirs extérieurs qui la menaceraient, mais de son autodestruction.
Peuple juif
Toute mobilisation réussie est mue par des affects antithétiques. Aimer et haïr, s’enthousiasmer et souffrir, rire et pleurer font partie du tableau. Ce qui importe, c’est moins de voir de quel côté penche la balance que d’analyser la façon dont ces affects s’agencent, de sonder leurs mixtes et de comprendre de quoi ils sont faits. Ce qui, là encore, ne peut se faire sérieusement que par une enquête de sociologie compréhensive, intérieure au mouvement. Enquête d’autant plus ardue que ses sites potentiels sont multiples et hétérogènes, distribués sur plusieurs pays et continents, marqués de différences quant à la composition des populations étudiantes et aux types d’institution concernés.
Ce qu’on peut dire toutefois dès à présent, c’est que la motivation est puissante partout, du moment qu’elle arrive à se focaliser sur les termes qu’on a vus : d’un côté un peuple en quête pour lui-même d’une justice qui lui a toujours été refusée, de l’autre un État-nation fondé intégralement sur le déni de cette justice. D’un côté les « Palestiniens », de l’autre les « sionistes ». Entre les deux, la guerre continuelle, mais dont le mouvement protestataire pressent qu’elle est entrée depuis le 7 octobre dans la phase de son dénouement. L’enjeu est de déterminer qui l’emportera finalement sur le territoire qui s’étend « de la rivière à la mer ». Là encore, le slogan en dit long, puisqu’il a le double avantage de ne tenir compte que de frontières naturelles, et non pas stato-nationales, et d’avaliser la congruence parfaite entre un peuple et sa terre, seul fait auquel on adhère sans réserve pour se justifier du camp qu’on a choisi.
Le mauvais objet remplit en cela sa fonction : il suscite l’imagination de ce que le monde pourrait être si par bonheur Israël n’existait plus. Tous les maux du moment sont traduisibles en un seul : le sionisme.
Les sionistes attirent vers eux tous les feux de la critique. Positivement, cela signifie que tous les vœux de résolution des injustices que l’on ressent intensément, sans toutefois jamais parvenir à discerner la forme sociale et politique d’existence dans laquelle une telle résolution pourrait bien se produire, trouvent dans cette situation concrète et déterminée un espoir d’exaucement. D’où le prodigieux effet de synthèse de la lutte qui prend pour cible l’« entité sioniste .» Ici, le geste devient possible, mais en passant par une négation simple et claire, accessible. Du moment que disparaît Israël – cet obstacle fait d’un peuple nationalisé et d’un État consistant –, l’horizon se dégage. Le mauvais objet remplit en cela sa fonction : il suscite l’imagination de ce que le monde pourrait être si par bonheur il n’existait plus. Tous les maux du moment, entendons tous ceux auxquels on veut vraiment, sincèrement et anxieusement, mettre un terme, parce qu’ils entachent les politiques stato-nationales ressaisies dans leur histoire comme dans leur principe, sont traduisibles en un seul : le sionisme.
Quant à la définition exacte de ces maux et à la manière dont on les appréhende, elles varient suivant les sites. D’une rive à l’autre de l’Atlantique, les groupes engagés, leurs rapports à l’État et à la nation n’étant pas les mêmes, les problématiques n’ont pas le même contenu. Sur le gradient de l’intensité, les États-Unis paraissent à l’avant-garde ; ils sont talonnés par des pays d’Europe comme la Suisse et la Belgique ; la France, quant à elle, fait plutôt figure d’élève appliqué. Ses plus gros efforts de suivisme, elle les fait dans ses institutions de prestige. Partout, cependant, la toile de fond et les termes du lexique sont stables. Ce qu’on fustige à travers le sionisme, c’est le colonialisme et le racisme, mais aussi l’extractivisme et le productivisme, et jusqu’à la domination masculine et aux violences sexuelles. L’essentiel n’est pas qu’un lien avec l’idéologie sioniste puisse dans chaque cas être attesté – les contorsions virent évidemment à l’absurde – mais seulement que l’on perçoive ce que l’antisionisme a de conditionnant en première instance. Et de fait, on comprend dans quelle mesure la critique désorientée est fondée à y voir son point de blocage le plus retranché : une émancipation nationale réalisée, qui laisse effectivement subsister une injustice criante à l’égard d’un peuple bien identifiable.
Pour ce qui est de la gamme des émotions, les mêmes notes reviennent aussi. Il y a d’abord la souffrance partagée avec les victimes palestiniennes, civiles et militaires indistinctement, tandis que les victimes civiles juives sont effacées et que leur seule évocation est prise comme une offense faite à la lutte. Et il y a une joie simple et pure à la vue des barrières brisées et des échappées rendues possibles des tueurs et des violeurs qui furent libres d’agir durant les longues heures du 7 octobre. Enfin, il y a le soulagement d’être enfin arrivé à formuler, avec l’antisionisme, ce qui restait informulable. Le moment procure visiblement aux manifestants la respiration qu’ils espéraient depuis longtemps, écrasés comme ils l’étaient par le poids d’une tâche critique à laquelle tous les instruments manquent. Au bout du compte, ces sentiments culminent dans l’enthousiasme ressenti à la perspective d’en finir avec Israël. C’est leur geste politique, leur passage à l’action. C’est leur but le plus cher.
En finir avec Israël et avec le sionisme, mais certes pas avec les juifs, tiennent-ils toutefois à préciser. C’est le point sur lequel la haine est sommée de s’arrêter, par un autocontrôle d’autant plus scrupuleux que les accusations d’antisémitisme sont fréquentes, notamment après les actes du 7 octobre et le soutien, assorti de réserves et de regrets chez les plus prudents, qui leur a été apporté. « Procès d’intention », c’est la réponse invariablement donnée à ces accusations, lors des moments de dérapages, qu’il s’agisse de mots qui échappent, de coups qui partent, d’insultes qui fusent, ou encore de comparaisons si grossières qu’elles laissent facilement transparaître l’atteinte aux juifs qui les motive en réalité – « Nazionist » en est un précipité, mais on ne cesse d’en voir de plus subtils et de plus pernicieux à travers les alertes au génocide décrété en cours.
Les mobilisations comptent dans leur rang des étudiants juifs autoproclamés. Ils y occupent une place d’honneur pour autant qu’ils adhèrent à l’antisionisme, affichent leur solidarité absolue avec les Palestiniens, excluent que le 7 octobre ait comporté la moindre dimension antisémite, et œuvrent au travail crucial de discrimination entre l’être-juif et l’être-israélien…
Soyons juste : « Mort aux juifs » n’est pas un slogan bienvenu dans l’antisionisme occidental, alors qu’il l’est couramment et sans fausse pudeur dans sa version non-occidentale. Dans la protestation antisioniste de type universitaire, sa violence est même proscrite. Les sionistes sont les ennemis désignés et caractérisés, pas les juifs. Aux sionistes, il s’agit de faire la guerre – le boycott universitaire est, répétons-le, la participation préconisée à la conduite de la guerre « par d’autres moyens ». Mais la guerre n’est pas faite aux juifs. C’est qu’entre des peuples, entre de purs peuples, il ne peut pas y avoir de guerre.
Précisément, qu’en est-il du peuple juif dans l’argumentaire antisioniste universitaire ? Il est clair qu’il ne peut en être question comme il est question du peuple palestinien. Entre les deux, la différence des temps joue d’abord : victime actuelle, le peuple palestinien l’est par l’action présente de l’État qui, estime-t-on, se pare de la souffrance passée du peuple juif pour se justifier. Cette souffrance passée, les protestataires ne la nient pas – le négationnisme n’a pas sa place dans le mouvement. S’ils consentent à voir aujourd’hui de l’antisémitisme, c’est sur le mode résiduel. Il n’est pas assez significatif pour dire que le peuple juif est une victime actuelle au sens où l’est le peuple palestinien. Cela étant, en tant que peuple, le peuple juif n’est pas moins pur que n’importe quel autre. Toute identité de peuple est respectable du point de vue de la critique universitaire, et toute détermination ethnoculturelle, distinguée des dynamiques de nationalisation qui font l’histoire tragique de la politique moderne, est positivement perçue et valorisée.
Les mobilisations comptent ainsi dans leur rang des étudiants juifs autoproclamés. Ils y occupent une place d’honneur pour autant qu’ils adhèrent à l’antisionisme, affichent leur solidarité absolue avec les Palestiniens, excluent que le 7 octobre ait comporté la moindre dimension antisémite, et œuvrent au travail crucial de discrimination entre l’être-juif et l’être-israélien, entre éthique authentiquement juive – Levinas, tronqué de tout ce qu’il a pu dire sur Israël, n’est pas une référence malvenue – et idéologie sioniste. C’est là leur contribution propre, et elle est très appréciable : elle aide à reconstruire de l’intérieur la corruption idéologique princeps, le sionisme, traqué sous tous ses aspects. Elle montre que le peuple juif, pas plus qu’aucun autre peuple, n’est spontanément orienté dans le sens de l’intégration inégalitaire, dominatrice et discriminatoire qui, juge-t-on, est inéluctable dès que s’impose le moule de l’État-nation.
C’est aussi pourquoi, comme toute autre minorité, ce peuple subit parfois les conséquences négatives de la construction stato-nationale accomplie par d’autres peuples. Celles-ci culminent dans le racisme, dont l’antisémitisme n’est alors, dans cette vision, qu’une sous-spécification. Mais la distinction entre racisme et antisémitisme n’a dans ce cas pas lieu d’être, et la mettre en avant est frappé d’interdiction par la critique universitaire antisioniste. Il n’y a là, pense-t-on, rien de très dommageable, dans la mesure où toute plainte émanant de ses victimes est en droit recevable, sous condition que les actes dénoncés ne soient pas confondus avec l’expression de l’antisionisme, et puissent être reversés à des tendances réactionnaires résurgentes, réprouvées sans hésitation. De ce point de vue, l’antisémitisme, traité comme sous-espèce du racisme, ne peut qu’être de droite (ou le signe d’une malheureuse rechute à droite par des sujets de gauche égarés). Affirmer le contraire et s’obstiner à distinguer constituent une dérogation inacceptable à la convergence des luttes qu’assure en ce moment la lutte pour le peuple palestinien.
Mais alors, quoi qu’on en veuille, une asymétrie demeure : les juifs, pour autant qu’ils disent qu’il y a de l’antisémitisme distinct du racisme, sont suspects de faire dangereusement défection à ce à quoi la mobilisation tient le plus. Soulignons : ils le sont cette fois en tant que membres de leur peuple, et pas en tant que soutiens putatifs de la formation d’un État-nation qui se qualifie de juif, c’est-à-dire en tant qu’ils seraient sionistes ou crypto-sionistes.
Que disent exactement les juifs quand ils disent qu’il y a de l’antisémitisme qui les cible et qu’il connaît aujourd’hui, dans le monde occidental post-1945, une amplification inouïe ? Et qu’y a-t-il dans ces propos de particulièrement inassimilable par le discours critique qui trouve son point d’orgue dans les mobilisations universitaires ?
Que disent-ils dans ce cas ? Ils réclament que l’on considère qu’il y a de l’antisémitisme, et que ce phénomène traduit une pathologie particulière des sociétés modernes, occidentales et non-occidentales, justiciable d’un traitement propre. Ils en décèlent différentes versions, dont l’une, particulièrement meurtrière, s’est réalisée le 7 octobre dans les actes du Hamas ; et dont d’autres, de violence moindre mais tout aussi manifeste, se sont ravivées dans les réactions suscitées en Occident par le 7 octobre. Ils affirment que nous sommes en train de vivre un grand moment antisémite, d’ampleur inconnue depuis la Seconde Guerre mondiale.
Ces juifs-là, ces membres-là du peuple juif, font état de ce qu’ils voient. Il faut donc poser la question la plus gênante : que disent exactement les juifs quand ils disent qu’il y a de l’antisémitisme qui les cible, que celui-ci ne se confond pas avec le racisme frappant d’autres minorités, et qu’il connaît aujourd’hui, dans le monde occidental post-1945, une amplification inouïe ? Et qu’y a-t-il dans ces propos de particulièrement inassimilable par le discours critique qui trouve son point d’orgue dans les mobilisations universitaires ?
L’antisémitisme en nous
L’antisémitisme moderne est un mal d’origine européenne. Il est inséparable de la formation des États-nations modernes. Son activateur est paradoxal : il ne relève pas du procès pour séparation intenté aux juifs par l’antijudaïsme traditionnel et motivé théologiquement, mais de l’intégration, supposée corruptrice pour le corps national, de cette minorité particulière, du moment que les États s’engageaient à émanciper ses membres, c’est-à-dire à leur accorder les droits civils et politiques de tous. Sans doute l’ancien antijudaïsme s’est-il prolongé dans l’antisémitisme moderne : il lui a communiqué des schèmes qu’il pouvait réinvestir, dont certains revêtaient déjà un caractère raciste, comme les « statuts de la pureté de sang » de l’Espagne du XVème siècle. Mais l’évolution n’en était pas moins nette : les corps nationaux, précisément en s’égalisant intérieurement, faisaient émerger une inquiétude et une haine tournée sur un élément qui leur était intégré. De son côté, la condition des juifs s’améliorait, cette amélioration sécrétant dans le même temps un genre de discrimination et de persécution sociales renouvelé dans ses motivations et ses modes d’action. La racialisation, celle qui les concernait en propre, fut à cet égard une fonction de l’antisémitisme social, et non pas l’inverse. La « race juive » fut la construction destinée à configurer le mal social que cherchait à combattre l’antisémitisme, à savoir le peuple juif qui, nationalisé dans les États non-juifs, en devient le corrupteur intérieur éminent. Bref, sous la race se tenait le peuple, qui était la vraie cible.
Avec les juifs, ce qu’une partie de la nation moderne hait, c’est une dimension d’elle-même. Ce sont les porteurs éminents du mouvement par lequel elle s’est constituée, le « cas d’école » sur lequel elle a éprouvé la promesse qui l’animait.
Cette tendance antisémite fut puissante et irrépressible, dès les débuts du XIXème siècle jusqu’au nazisme. Elle puisa aussi bien à droite qu’à gauche. Étant donné qu’elle avait pour vecteur le nationalisme, lorsque le thème de la nation bascula de la gauche à la droite dans le dernier tiers du XIXème, l’antisémitisme suivit le mouvement, mais sans perdre son ancrage à l’autre pôle. De même, il prit la voie du racisme. Il consonnait d’autant mieux avec ce grand mouvement qui avait sa source parallèle dans les conquêtes coloniales, qu’il en faisait ressortir une fonctionnalité essentielle : celle de freiner la mobilité sociale, l’égalisation et l’émancipation déclenchées par les États eux-mêmes, à l’aide de fixations naturalisantes sur lesquelles fonder des hiérarchies et des exclusions. Racisme et antisémitisme furent à partir de là inséparables, et des traits de structure les unissent effectivement. Leur distinction n’en subsiste pas moins, quant à la minorité haïe et quant à la manière dont on la hait.
Car avec les juifs, ce qu’une partie de la nation moderne hait, c’est une dimension d’elle-même. Ce sont les porteurs éminents du mouvement par lequel elle s’est constituée, le « cas d’école » sur lequel elle a éprouvé la promesse qui l’animait. Émanciper et intégrer les juifs, pour les nations modernes, ce fut en effet s’intégrer vraiment : quitter le plan théologique prémoderne où prévalait la séparation, réaliser en acte le changement d’époque. Les juifs voulurent ce baptême laïc, ils endossèrent eux aussi la promesse moderne. Ils dirent : « Nous pouvons être modernes en tant que juifs, comme vous l’êtes en tant que chrétiens ou laïcs ; plus encore, nous pouvons l’être en tant que juifs laïcs, porteurs seulement d’une certaine identité ethnoculturelle, au sein de la nation ». Or si l’antisémitisme est la sécrétion nécessaire et inévitable de ce mouvement, c’est que la promesse ne dit pas tout. Hitler en tira la conséquence la plus radicale : il fit la promesse inverse, celle d’une Allemagne et d’une Europe sans juifs. Il la déclara bien plus tenable que l’autre, ce qui se vérifia en grande partie.
L’Europe post-Shoah comprit peu à peu ce qui s’était produit : elle en tira quant à elle le combat contre l’antisémitisme, comme un combat conjoint à l’antiracisme, mais distinct de lui cependant, en ce qu’on percevait, confusément ou lucidement, qu’il touchait à un rapport à soi. On comprit que l’antisémitisme était en nous, qu’il faisait partie de nous, non simplement comme une inclusion incomplète, un déni des droits pour ce qu’on décrète encore inintégrable, et qu’on discrimine, exclut et persécute pour cette raison – comme c’est le cas dans le racisme -, mais comme une complétude retournée sur elle-même, une intégration qui requiert de détruire le mal qu’elle sent poindre en elle, adhérent à son accomplissement.
Le peuple juif est ainsi venu figurer au point où la nationalisation se critique elle-même précisément comme émancipatrice et intégratrice. Elle se ressaisit sous l’aspect, au sens littéral, de son ambivalence. Le mot ambivalence, ici, revêt un sens tout à fait technique – et pas celui un peu flottant qui fleurit dans tant de discours aujourd’hui. Une ambivalence n’est pas exactement d’une contradiction. Freud en a donné la meilleure définition : une ambivalence, disait-il à propos du rapport des fils au père, est le point où le négatif et le positif coïncident exactement, et se renversent l’un dans l’autre de telle sorte qu’il est impossible de faire abstraction d’un côté quand c’est l’autre qui comparaît. Ainsi en va-t-il des juifs, pour l’Europe et en Europe, consciemment et pas inconsciemment, depuis 1945 : ils sont ceux à l’égard desquels on sait avoir été, et toujours risquer d’être, ambivalents, en tant précisément qu’on est modernes. Comme les victimes du racisme, ils sont les objets d’une haine qui renait à mesure que les avancées sociales et politiques se font sentir. Mais à la différence du racisme, la haine tient à ce qu’il y a de plus positif dans cette avancée : l’intégration nationale réussie. Non pas parce qu’ils, les juifs, l’auraient réussie, mais parce que nous tous l’avons réussie à travers eux, qui font partie de nous.
On comprit que l’antisémitisme était en nous, qu’il faisait partie de nous, car le peuple juif est venu figurer au point où la nationalisation se critique elle-même précisément comme émancipatrice et intégratrice.
On conçoit dans ces conditions que la réflexion spécifique sur l’antisémitisme soit l’une des tâches fondamentales de la critique immanente des processus de nationalisation. Elle est corrélée à la réflexion sur le racisme, et cependant distincte d’elle par les problèmes spécifiques qu’elle pose. La critique universitaire ne peut s’en abstenir, et elle est en faute dès lors qu’elle cesse de distinguer, tire argument de la corrélation pour réduire les deux réalités à une seule. C’est exactement ce qui se produit dans les mobilisations universitaires antisionistes. Il faut donc insister : d’où vient ce besoin de ne pas distinguer, si la critique immanente des processus de nationalisation se situe dans le sillage de la conscience post-Shoah, tout autant et avec la même nécessité que dans celui de la critique postcoloniale, celle autour de laquelle gravitent les mobilisations ?
Les explications en termes de stratégie des groupes sont insuffisantes et superficielles. Tout comme les discours qui se contentent de décrire une concurrence des mémoires, selon laquelle celle en quête de reconnaissance verrait dans celle créditée d’une reconnaissance officielle supérieure (et antérieure) une captation indue – un monopole juif. Ce n’est pas que de tels phénomènes n’existent pas, avec les fantasmes et les relents antisémites qu’ils induisent. Au contraire, ils émaillent l’opinion, et l’opinion savante se contente bien souvent de s’en faire l’écho. C’est le cas encore de la critique en vigueur dans les mobilisations. Pour autant, on aurait tort d’en rester à ces discours de surface. Car ils ne permettent pas de rejoindre le ressort véritable de la situation – une situation où le combat contre l’antisémitisme est globalement assumé, où son rejet est majoritaire dans l’opinion, y compris du côté de la critique universitaire. Une situation où aucune mémoire n’est niée, et où cependant l’antisémitisme dans ce qu’il a de spécifique est précisément ce qui ne doit pas être vu.
Persistance
Ce ressort tient à la façon dont les juifs persistent dans les États-nations, et à la façon dont ces États persistent eux-mêmes au travers des défis qui sont aujourd’hui les leurs pour faire droit aux nouvelles attentes de justice.
Que veut dire persister ? Pour les juifs, l’impératif a pris des sens différents au cours du temps. Leur expérience moderne s’est singularisée en ce que la persistance propre – la vie en Galout, leur condition d’exil – s’est composée positivement avec la persistance d’un certain genre d’État d’accueil, l’État-nation moderne de type démocratique. Cette composition a pris différents visages, où l’un ou l’autre versant du phénomène était plus ou moins accentué. Sous ses versions variables, elle prévalut au travers de tous les écueils. La conjonction des persistances fut scellée par l’acceptation juive du baptême de la nationalisation moderne, sur fond de refus confirmé du baptême chrétien. De même, ces compositions ont dépendu des États-nations concernés, de leur niveau de démocratisation, et la place qu’ils aménageaient aux juifs dans le mouvement par lequel ils les nationalisaient. Un élément les minait cependant toutes : l’antisémitisme fomenté dans ces États, qui a culminé en Europe dans la Shoah. La composition s’est alors reprise avec les deux coordonnées nouvelles qu’on a soulignées : combat contre l’antisémitisme, et sionisme réalisé sous la forme d’un État.
Ce que cette histoire a de plus remarquable s’agissant de l’Europe et des États qu’elle réunit après 1945, c’est qu’elle reprend la double persistance et ne l’abolit pas. L’Europe n’a pas sombré et les juifs n’ont pas disparu. Sous les deux conditions nouvelles assumées, la dynamique de composition se relance où persistance des juifs et approfondissement de la nationalisation ont partie liée. À la différence de la sphère universitaire, c’est ce que la sphère politique a globalement réaffirmé, à de rares exceptions près, à l’échelle de toute l’Europe comme aux États-Unis, après le pogrom du 7 octobre.
Persister, pour les juifs, a pu signifier se nationaliser, sans que l’irréductibilité du peuple à la nation n’en ait été effacée. Ils sont le peuple distinct de la nation, et non pas contre-national. Peuple versus nation, et pas peuple contra nation.
Pour la critique universitaire égarée, par contre, décrochée des processus de nationalisation et des transformations qu’ils impliquent – celles, en premier lieu, de respect mieux garanti des droits des minorités – il y a là une affirmation proprement insupportable. La persistance des juifs en tant que peuple, intriquée comme elle l’est dans la persistance des États-nations sur une ligne émancipatrice et intégratrice continue, voilà précisément ce qu’il faut s’acharner à nier. Elle n’y voit pas simplement une anomalie, mais le déni de son opération constitutive : ne plus appartenir à la trajectoire condamnée, et pour cela objecter depuis l’identité de peuple, idéalement purifiée, à la nationalisation comme telle. Or les juifs, précisément, sont restés un peuple dans les nations. Ils le sont restés en leur appartenant et en endossant leur dynamique émancipatrice. Ils le sont restés par-delà les discriminations et les persécutions, jusqu’à la destruction et au-delà de la destruction. Persister, pour eux a pu signifier se nationaliser, sans que l’irréductibilité du peuple à la nation n’en ait été effacée. Ils sont le peuple distinct de la nation, et non pas contre-national. Peuple versus nation, et pas peuple contra nation. C’est ainsi qu’ils persistent encore aujourd’hui même, en Diaspora et en Israël. Ce qui les rend doublement haïssables, ici et là-bas.
En Diaspora, l’identité de peuple se maintient sous le signe de la persistance à se dire « juifs », non pas simplement comme des individus repliés chacun sur soi, mais comme les membres d’un collectif dont l’existence est dotée de sens (peu importe comment ce sens est décliné et compris par chacun). Si le peuple juif persiste, c’est alors comme minorité. En Israël, la même opération a lieu, avec cette différence que le peuple se maintient dans une nation où il est majoritaire. Mais comme il ne perd pas pour autant son identité minoritaire de peuple – il reste disséminé dans les nations, et n’a pas vocation à cesser de l’être, la montée en Israël n’étant qu’une option ouverte, et pas la condition sine qua non pour réaliser l’être juif – l’écart entre peuple et nation subsiste. On a cité précédemment la faute commise par la loi fondamentale de 2018 dite « loi État-nation du peuple juif ». Tandis qu’il est tout à fait admissible de considérer que la France est l’État-nation du peuple français, l’Allemagne l’État-nation du peuple allemand, et même la Belgique l’État-nation du peuple belge (si pluriel soit-il culturellement), il ne l’est pas pour Israël. L’union se fait dans le peuple, et se suffit à elle-même. L’union nationale se produit selon un autre principe que celui du peuple. Telle est la singularité d’un peuple structurellement minoritaire, qui s’est lancé dans ce processus juif de nationalisation qu’est le sionisme, et en a tiré ce curieux État pluraliste et démocratique fait pour accueillir les juifs, si et pour autant qu’ils le veulent, et sans prétendre par-là effectuer leur unité. Il s’est fait instrument de la persistance des juifs, partout où ils se trouvent. Car partout ils persistent comme peuple – dans tous les États-nations où ils sont intégrés, y compris dans celui qu’ils se sont fabriqué pour eux-mêmes sans s’y fondre.
Cette jeunesse se dit antisioniste, et pas antisémite. Elle est pourtant antisémite, au sens où elle hait ce que les juifs incarnent ici et maintenant, à l’échelle mondiale, en se distribuant en minorités intégrées, que ce soit dans les États-nations non-juifs ou dans l’État des juifs.
À l’heure où la critique s’est focalisée sur les oppressions et les dominations reconduites ou engendrées par les processus de nationalisation qui sont à leur principe, un tel phénomène de persistance est devenu ce qu’il y a de plus difficile à considérer. Car il faut alors que les identités collectives minoritaires soient ramenées à l’idée de ce qui les fait minoritaires d’une majorité, c’est-à-dire les obligent à se ressaisir comme les parties différenciées d’une même société globale, la nation, à la construction de laquelle leur différence, à sa manière, participe. Mais pour arriver à saisir ce point, encore faut-il que la critique ne s’égare pas dans la négation abstraite et infinie de la forme stato-nationale. Lorsqu’elle s’égare, l’obligation à voir ce qu’elle ne veut pas voir et qu’elle est toujours plus en incapacité de voir, tourne à l’obsession. Cette obsession a pour nom l’antisionisme de type universitaire. Il est antisémite, au sens où il se fonde sur l’exaspération face à la persistance des juifs, en Occident et en Israël, deux espaces dont il comprend confusément la corrélation. À tort, ou pour se voiler la face, il l’interprète comme une extension coloniale et impériale. Mais ce qui est en vérité visé, ce sont les deux piliers agencés pour que la persistance des juifs soit assurée après la Shoah.
L’ancien et le nouveau dans l’antisémitisme
La dénonciation de l’antisémitisme en tant que tel, et donc de la manière singulière et paradoxale dont les juifs figurent dans la problématique moderne de l’intégration, ne doivent pas comparaître pour cette frange de la pensée critique de l’université qu’exprime la jeunesse actuellement mobilisée pour les Palestiniens. Cette jeunesse se dit antisioniste, et pas antisémite. Elle est pourtant antisémite, au sens où elle hait ce que les juifs incarnent ici et maintenant, à l’échelle mondiale, en se distribuant en minorités intégrées, que ce soit dans les États-nations non-juifs ou dans l’État des juifs. Entendons : intégrés et persistants, participant en tant que juifs à la poursuite du projet moderne qui est celui de la transformation, depuis le point de vue interne comme externe, des processus de nationalisation.
L’antisémitisme de cette jeunesse doit cependant être bien cerné pour finir. Il n’est pas celui qui est encore monnaie courante dans maints espaces sociaux, l’antisémitisme pour cause d’intégration corruptrice. L’antisémitisme est une réalité composite, éminemment instable, faite de strates historiques distinctes réagissant les unes sur les autres. Comme l’inconscient selon Freud, et à l’image de la ville de Rome par laquelle il le représentait, ces strates coexistent et échangent certaines de leurs propriétés. De même que l’antijudaïsme à connotation théologique de type traditionnel reste partiellement efficace, de même le fait de considérer que les juifs sont les corps parasitaires dont il faut se débarrasser – représentation dont il est évidemment faux de penser que la droite en aurait l’exclusive – fait toujours sentir son poids et trouve toujours dans différents groupes sociaux des porteurs zélés. Récemment, la pandémie en a encore montré l’actualité, et les théories du complot le réactivent sans cesse. D’un autre côté, l’islam politique, dans sa version non-occidentale comme dans sa traduction en Occident, selon un dosage variable d’arguments théologiques et d’arguments modernes, alimente aujourd’hui l’antisémitisme dans ces deux formes majeures, séparatrice et intégrative. Il leur fournit de nouveaux thèmes, de nouveaux éléments au regard des héritages passés. Cependant, si un antisémitisme original existe, même sous-tendu comme il l’est indéniablement par l’islamisme, ce n’est pas l’islamisme qui le rend nouveau quant à sa forme.
C’est à l’université que la vraie nouveauté s’atteste et se fait la plus perceptible, comme l’indice d’un autre régime que celui connu jusqu’à présent. Il y a là une différence de nature sur laquelle il faut insister (ce qu’interdisent de faire les catégories mal formées, comme celles d’islamo-gauchisme ou de wokisme). Son moteur est politique, et inséparable de l’échec de la politisation censée se former par les pratiques réflexives et critiques à l’œuvre dans les universités. Le fait qu’elle reste en vérité à l’état d’épiphénomène – nul engouement social généralisé n’en procède encore, ni ici ni aux États-Unis, et l’antisémitisme de masse est réservé actuellement au monde non-occidental – ne doit pas empêcher d’en souligner le côté avant-gardiste. Car c’est à l’université que revient l’étrange privilège de développer un antisémitisme qui n’est axé ni sur la séparation, ni sur l’intégration, mais sur la persistance.
Du juif dont on escompte qu’il est encore vivant, du juif dont on espère qu’il vive, il faut se débarrasser. Car la persistance juive est insupportable aux consciences critiques désormais perdues.
Cet antisémitisme, notons-le, ne fait pas que passer par l’antisionisme. Celui-ci en est la clef, en tant que le sionisme, mouvement national juif réalisé, non simplement assure la persistance du peuple, mais cristallise le peuple persistant. Littéralement, sans l’inclure, il le représente aux yeux des États du monde entier. Et cependant, si l’antisionisme est la clef de l’antisémitisme occidental pour cause de persistance, cette clef semble enfouie dans l’esprit des acteurs. Les mobilisations étudiantes, acharnées à effacer toute trace du succès de l’articulation entre un peuple persistant dans son être de peuple, et la nation qu’il intègre et qui l’intègre, sont porteuses de ce motif antisémite, mais elles le sont dans la dénégation.
De fait, on peut accréditer pour finir sur ce point leur sincérité. Ce motif, elles ne sont pas en mesure de le discerner, puisqu’elles sont persuadées d’avoir suffisamment témoigné de leur amour des juifs en leur accordant le statut de peuple à l’égal de tous les autres, dans un monde où tous les peuples souffrent, et certains plus que d’autres – et où il importe de toujours savoir remonter à l’amour des vivants comme tels, « pleurables » à égalité. Pourtant, le motif n’en chemine pas moins dans leurs pensées, leurs paroles et leurs gestes, bien chargé de sa dose de haine, comme lorsqu’un portrait d’enfant juif enlevé par le Hamas est rageusement déchiré. C’est là le genre de geste, typique des mobilisations de campus, où la vérité de l’intention affleure. Du juif dont on escompte qu’il est encore vivant, du juif dont on espère qu’il vive, il faut se débarrasser. Car la persistance juive est insupportable aux consciences critiques désormais perdues. Elle l’est là-bas, comme attestation d’un peuple persistant dans sa propre nationalisation, en laquelle il ne se dissout pas. Elle l’est ici comme preuve que, au stade élevé de l’autocritique de l’après-Shoah, l’intégration nationale, en Europe et dans le monde, peut encore se poursuivre dans sa visée émancipatrice.
On le voit, l’antisémitisme qui vient cible toujours les juifs, mais il les cible autrement que ce n’était le cas dans les autres affluents du même fleuve ancien. Il accueille favorablement le fait qu’on les tue, à condition de ne plus voir qu’on les tue comme juifs. Et il fait d’Israël le condensé de ce qu’il faudrait ne plus voir pour aller de l’avant, sans la moindre idée de la destination à atteindre. Du fleuve à la mer, donc, mais sans aucun horizon en vue.
Bruno Karsenti