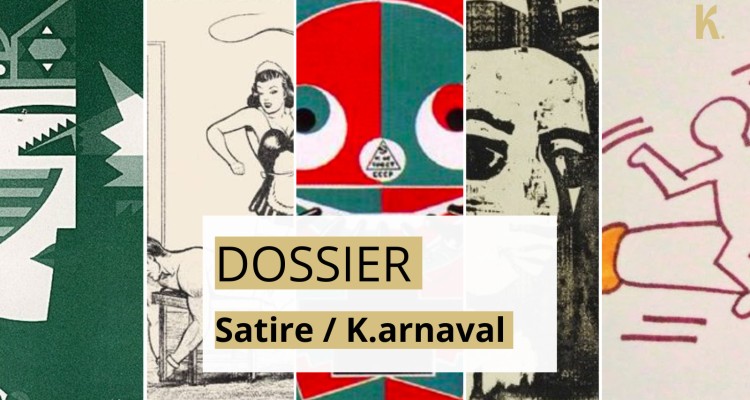(une autofiction)

Paris, 2022 ; Dessert
Assise à l’autre bout de la table, elle observe celui qu’elle avait considéré comme son meilleur ami pendant leur jeunesse, les années de prépa, puis la fac, avant qu’elle ne parte aux États-Unis. Elle scrute avec minutie ses moindres gestes, ses tics de langage, ses regards intenses et provocateurs, comme s’ils pouvaient lui révéler une explication de leur dissension amicale. Elle se souvient du temps idyllique de leur correspondance mi-intellectuelle, mi-adolescents attardés, ces années d’hypokhâgne et de khâgne où ils s’échangeaient presque quotidiennement des lettres qui parlaient de Nietzsche, de Duras, de tragédies classiques, des présocratiques, de Lautréamont, parfois même de Kant et du transcendantal. Elle l’admirait, lui qui en plus de son humour plein d’esprit, écrivait avec toute la culture d’une famille d’intellectuels de gauche, des anthropologues et des sociologues, contre qui il avait promulgué une guerre des disciplines en choisissant la philosophie, les lettres, puis finalement la linguistique. Et lui, qu’admirait-il en elle alors, se demande-t-elle aujourd’hui avec plus d’acuité ? Car désormais, il n’aime plus ce qu’elle écrit. La discordance entre eux, latente depuis ses années américaines, est devenue manifeste lorsque, l’année précédente, elle a publié dans une « revue juive » – comme il l’avait affirmé sur le ton du reproche – son texte « Mamie-louche » sur sa grand-mère et sa judéité marrane. Une ligne de faille s’est depuis lors creusée, séparant progressivement deux êtres qui croyaient en l’éternité de leur danse ensemble.
Ses dix convives ne remarquent pas son absence dans la conversation depuis quelques temps, l’heure est avancée et elle aimerait que ce dîner s’achève. Elle interrompt alors le vacarme des discussions politiques, cette atmosphère tantôt joyeuse, tantôt nerveuse émanant de ses dîners du samedi soir.
« – Qui reprend du dessert ? Ou alors un carré de chocolat ?
– Oh là, tu vas nous tuer avec tout ce sucre !
– Ça va, remballe ton discours écolo toi.
– Écolo ? Je ne parle pas de la planète mais de mon indice glycémique !
– Et moi de mon tour de taille !
– Bon, qui est motivé pour aller courir demain ?
– Mais attends, tu as mis du sucre ou du sirop d’agave dans ton gâteau ? Tu sais, c’est fantastique l’agave, j’ai découvert récemment…
– Au fait, vous avez entendu cette histoire de pénurie de sucre en Tunisie, il paraît que…
– Oh ça ne leur fera pas de mal de moins manger de saloperies sucrées !
– À nous non plus d’ailleurs…
– Alors là stop, si le médecin s’y met… on ne t’invitera plus, hein. Le mois dernier tu nous as plombés avec ton speech sur les cellules cancéreuses, j’en ai pas dormi du weekend !
– Moi, perso, demain je fais un jeûne, pas intermittent, une vraie diète, toute la journée.
– Écoutez, je vais vous détendre, vous connaissez cette blague juive que la collègue de notre chère hôte lui avait racontée la veille de Kippour ?
– Laquelle ?
– Moi je ne la connais pas, déballe, mais sois concis, il est tard.
– Y en a eu beaucoup… ressers-moi du vin plutôt, tiens.
– Ok, ok, celle sur la randonnée, ça ne vous dit rien ?
Four Europeans go hiking together and get terribly lost. First they run out of food, then of water :
‘I’m so thirsty’, says the Englishman. ‘I must have tea!’
‘I’m so thirsty’, says the Frenchman. ‘I must have wine!’
‘I’m so thirsty’, says the German. ‘I must have beer!’
‘I’m so thirsty’, says the Jew. ‘I must have diabetes!’[1]
Rires ; pas tous. Elle, elle s’en souvient bien sûr, mais elle sourit à peine. Probablement parce qu’entendre cette histoire de la bouche d’un ami goy n’est pas aussi drôle que venant de sa vieille collègue juive. Peut-être parce que, selon l’assemblée, la plaisanterie devient raillerie, c’est Desproges qui le dit. Ou bien, parce que, tel le juif d’une fameuse blague yiddish, « elle l’a déjà entendue, et elle peut la raconter mieux ». En observant sa tablée, elle attend de voir qui, ce soir, cette blague va-t-elle réveiller, qui, de l’antisémite mondain, du philosémite de dîner, de l’âme offusquée de circonstance.
« – En tout cas, il était excellent ton cake.
– Il était casher j’espère !
– Arrête d’ironiser, vous allez encore vous embrouiller.
– Il était hallal bio, ça te va ? Allez ne commence pas à la chercher.
– Oh c’est bon, c’était une joke, on ne peut plus rire ! Je suis comme le juif de ta blague au milieu des Européens, prêts à me dévorer ! »
Elle ne rit pas. A-t-elle perdu son sens de l’humour ? Peut-on perdre son humour, quand celui-ci devient sarcasme ? Elle ne répond rien. Elle sait exactement sur quelle pente l’ami d’avant veut l’emmener, depuis son « tu veux nous tuer » jusqu’au gâteau « casher » et au « je suis comme le juif ». Elle ne se demande même plus si son silence est légitime, si sa langue nouée est le symptôme d’un malaise plus général. Non, elle se martèle qu’elle n’est pas le juif hypocondriaque, elle n’est pas paranoïaque ; le juif malade, c’est précisément ce que lui voudrait. Ils ne comprennent pas la blague de la même manière. Elle aimerait lui siffler que son humour s’écorche à cause de son insistance, que si un stéréotype peut faire rire c’est parce qu’on ne s’y attarde pas. Mais ce soir, comme depuis plusieurs mois, peut-être même des années, lui, le blagueur, a rompu avec la brièveté, il s’englue dans la boue du ressentiment. Lui, le linguiste pourtant le plus brillant de sa promotion, qui pourrait passer des heures à expliquer le mécanisme de déplacement de l’anxiété dans cette blague juive, des nuits à disserter sur le double sens du verbe ‘avoir’, posséder ou être atteint de…, il ne discerne plus les subtilités, il ne perçoit pas que si elle est le juif de cette plaisanterie, c’est par son anticipation du désastre. Or c’est précisément cela qu’il lui refuse, de tout son inconscient il campe contre : elle-n’a-pas-le-droit-de-se-soucier-des-juifs. Non, elle ne peut pas se préoccuper des juifs : quand on porte un nom arabe, le camp est déjà défini avant soi, et lui, l’Ami Neutre, ni juif ni arabe, se pose en Garant des Frontières. Lui le « pacifiste », qui a toujours voté à gauche, qui défend les peuples opprimés, aujourd’hui les peuples sans Etats, surtout un, lui qui est habité par cette charité chrétienne d’employer une femme de ménage syrienne, mais que son inconscient bien consciencieux a empêché de recruter un jeune docteur d’origine algérienne dans son laboratoire de recherche, bref, lui qui ce soir se dit « comme le juif au milieu des Européens », par son imposture belliqueuse renverse d’une claque dans la figure l’histoire et leur amitié, la confiance qu’elle avait placée en lui de la complexité identités minoritaires.
Elle pense à ses enfants qui dorment dans la chambre au fond du couloir, dans la paisible ignorance de la guerre qui se joue à l’autre bout de l’appartement. Elle aimerait se réfugier dans leur cabane, la tente tipi remplie de jouets qui trône dans le coin de leur pièce. « J’ai essayé cet anxiolytique, c’est très léger, tu vois encore les problèmes, mais ça t’atteint moins, ça glisse sur toi », elle se souvient de ce conseil d’une amie sur qui la chimie avait fait des miracles. Au milieu de sa révolte intérieure, à ce dîner du cake « casher », elle espère un instant cette magie, « les choses glissent sur toi ». Mais, en réalité, cette pensée vient attiser sa colère, car, se dit-elle, ce vieil ami qu’elle ne supporte plus cherche à la rendre malade, il veut la pathologiser, alors qu’il est celui qui a un problème. C’est bien lui qui est devenu rageux lorsqu’elle s’est mise, elle, la fille un peu juive, pas vraiment, au nom arabe, à s’inquiéter pour les juifs, à défendre les juifs dans son discours, ses prises de position. C’est lui qui n’a pas supporté qu’une « arabe » retisse une ascendance maternelle juive à moitié assumée et brouille les frontières. Tout son système immunitaire s’est affolé quand il a diagnostiqué qu’elle s’enjuivait, par ses lectures, ses fréquentations, ses centres d’intérêt. Au fond de lui, ça tremble de peur, d’envie, de haine, de désir à l’idée que cette fille au nom arabe, à l’histoire familiale complexe qu’il croyait maîtriser depuis son sommet français, puisse un jour lui servir du « gâteau casher » – fantasme cauchemardesque de l’émiettement de son contrôle, une part de poison qu’elle lui servirait en lui chuchotant, aguicheuse, la pire avanie qu’il puisse entendre d’elle : « je suis juive si je le veux, je suis arabe quand je le veux, tu n’y peux rien ». Alors que depuis leur rencontre, pendant les classes préparatoires, leur amitié scellée dans les épreuves traversées, leurs rires, leurs sourires, leurs pleurs, il a doucement, patiemment, alimenté un rêve érotique inavouable, la prendre et la retourner contre un mur, la baiser de toute sa force d’homme, en lui murmurant, suave dans son cou, qu’il trouve les orientales séduisantes et sybarites.
Au moment de se dire au revoir, dans l’entrée, manteau à la main, il jette un œil à l’étagère de livres derrière elle, et d’un ton provocateur : « Tiens, tu as gardé Orientalism ? Je suis content qu’Edward Saïd ait encore une place chez toi. » Puis, immédiatement, en confession : « Franchement, je ne comprends pas pourquoi tu te mets, toute seule, des bâtons dans les roues ». Miettes d’un mets empoisonné, ces phrases piquantes perpétuent l’onde de choc qui se diffuse fatalement entre les deux amis. Effarée, plus écœurée que jamais, elle tente impulsivement d’en saturer l’épicentre : « je te donne une part du restant de gâteau, pour ton petit déjeuner ? »
Cambridge, Massachusetts, 2016 ; Plat
A peine entrée dans le salon si élégant du Harvard Faculty Club, elle cherche son compagnon des yeux, comme pour se fixer un horizon. Fatiguée, elle avait rechigné à l’accompagner à cette soirée, mais avait finalement accepté non seulement pour le soutenir dans son rôle de nouveau professeur, mais aussi parce qu’elle avait tout de même un délicieux souvenir de ce lieu où elle avait été invitée deux ou trois fois par sa directrice de thèse pendant son doctorat. Un coup d’œil à la canopée formée par les plateaux des serveurs lui indique qu’elle n’est pas trop en retard, l’apéritif est encore servi, le plat l’attendra. Elle voit son amoureux traverser le fond de la salle, pris dans une discussion avec un collègue. Elle repense à sa proposition de randonnée sauvage en Alaska, toujours des projets extrêmes qui ne l’enchantent guère. Comme s’il avait besoin de radicalité pour s’éprouver en amour. Dormir à la belle étoile, elle était d’accord, mais se réveiller face à un grizzli, comme il était arrivé à des amis, non merci. Elle s’élance pour rejoindre celui qu’elle aime malgré leurs discordances vacancières, mais percute légèrement un autre homme, s’excuse. « No problem ! Hi, how are you, hmm… what’s your name ? » Il cherche son nom sur l’étiquette soigneusement collée sur sa veste mais cachée par son rabat. Elle, elle a immédiatement reconnu le visage de cet illustre professeur de droit. L’homme d’une soixantaine d’années était aussi fameux pour son ardent engagement républicain que pour son intelligence éloquente, et elle avait un souvenir vif de sa diatribe politique contre les démocrates lors de l’élection présidentielle. Ces deux caractéristiques en faisaient à ses yeux un personnage à la fois inamical et intrigant. Elle hésita donc un instant à lui montrer son nom, mais y fut bien obligée, étant donné le contexte de ce dîner-cocktail à son alma-mater. La réaction fut immédiate, et – de manière inattendue – très chaleureuse : « Oh I had a dear friend with the same last name ! A fervent Maronite, a righteous patriot, and a supporter of Israel ». Elle tempère l’enthousiasme en faisant remarquer le caractère commun de ce nom de famille libanais chrétien, tout en appréciant la finesse de cet Américain pouvant distinguer la confession religieuse des noms arabes. Car, avec ce nom arabe à particule, combien de fois l’avait-on prise pour une musulmane, étudiants et collègues confondus, voire pour une experte de l’Islam –identity politics oblige, aux États-Unis – elle qui ne connaissait presque rien de cette religion et qui se débattait avec l’héritage hargneux d’une famille paternelle maronite divisée et déchirée par la guerre civile.
L’échange se prolonge. Le professeur lui raconte, in a nutshell, American-style, son histoire familiale d’immigration ashkénaze, Roumanie, Pologne, Russie. Et poursuit avec quelques remarques sur son séjour de jeunesse en Israël, les guerres, et celle où il veut en venir, le Liban. Elle redoute les mots qu’il va énoncer. Parler de cette guerre est une marche sur un champ de mines, même si le cocktail sous la magnifique verrière du Faculty Club lui donne des allures de prairie sans danger.
« We did some good job together in 1982. ».
Glas. Voilà, peste-t-elle intérieurement, le bât blesse. Ces fichues associations du nom, ces loyautés immondes, ces carnages sans noms mais avec complices, ce gouffre dans lequel elle ne veut pas regarder. L’imagination est plus forte, le grizzli la regarde devant sa tente de campeurs.
Il ne dit pas « the Phalanges » ; il prononce, dans une remarquable sonorité arabe, « Kataeb party », « Hizb al-Kataeb ». Il connaît bien l’arabe, prétend-il, la langue, les hommes. Il parle d’amitié et de proximité, des années 1970, de visions partagées. Cite Max Weber, en politique il n’y a que des mauvaises solutions, du pire au moins pire. Évoque le tragique, la réalité est toujours frustrante. Ponctue certaines phrases par « alas ». Il ne distingue pas les civils et les combattants, il raisonne en termes d’équilibre démographique.
Il ne nomme pas Sabra et Chatila, il évoque les « dirty camps ».
Grizzli. Elle ne voit que lui. Elle est blême. L’histoire est un vertige.
Son petit-ami l’a rejointe, il se tient légèrement derrière elle, écoute. Sans le voir, mais le connaissant bien, elle sent la colère s’approcher de lui et progressivement l’assaillir. Une invasion de chaleur sur son flanc droit. Elle pense au grizzli, espère qu’un refroidissement arctique le traverse. Aucun dérapage n’est autorisé pour un jeune professeur nouvellement appointé.
Mais le vieux professeur continue ; il ignore que cet homme qui s’est joint à eux et qui pourrait être son fils, combat toutes les nuits les fantômes de ses années dans Tsahal, et que, tous les jours, il se confronte à l’image du déserteur. Il ne peut savoir que ce bel Israélien, sous ses airs d’intellectuel européen détaché, souffre d’un persistant syndrome post-traumatique.
Autres guerres, autres générations, mêmes territoires.
Surtout, il ne peut deviner que le père de ce jeune professeur n’était pas qu’un des milliers de manifestants de La Paix Maintenant le 25 septembre 1982, mais que, magistrat, il a œuvré à la mise en place de la commission Kahane.
« Kahane ». Le mot, lâché par le jeune homme, explose comme une bombe. Elle se fige, le grizzli a disparu, ou bien elle ne le voit plus car elle est déjà dans sa gueule, se dit-elle ; elle se concentre sur l’homme qu’elle aime, comme si l’effort mental pouvait assurer une contenance stable à la discussion, comme si son attention pouvait délimiter la conversation dans un contour cordial. Néanmoins la profusion des signifiants lancés par son compagnon lui signale que c’est une illusion, la casse peut devenir illimitée. Elle attrape alors sa main, espère lui communiquer un peu de cette tendresse si nécessaire et dont ils ont fait leur maison. Cependant elle sent que le volcan entre en éruption.
Aux dessus d’eux, le nuage incendiaire recouvre l’ombre d’un nom, celui de « Bachir Gemayel », point de rupture fissurant les familles libanaises chrétiennes, la sienne à elle en particulier. L’image fractale du jeune président s’impose à elle, fantôme liminal des guerres intestines. Des souvenirs d’archives se télescopent dans son esprit, des photos d’albums familiaux, les mots flottant issus de son dernier discours avant son assassinat, son poing levé, pierre fracturant le réel de sa détermination. Abstraite de la conversation entre son compagnon fulminant et le professeur placide, elle revisite une géographie commune, la superposition des lieux de Gemayel et sa propre famille, le collège Notre-Dame de Jamhour, l’université Saint-Joseph, l’Université du Texas, et, fatalement, les locaux de la permanence du parti Kataeb dans le quartier d’Achrafieh à Beyrouth.
Elle pense à ses deux oncles, campant de chaque côté de la brèche toujours ouverte. D’un côté, le Phalangiste, le benjamin des frères, de l’autre l’aîné, militaire haut placé et soutenu par le Parti Populaire Syrien du chrétien Antoine Saadeh, et proche du parti Baath. Une tragédie familiale banale : le jeune, à l’extrême droite maronite, aux côtés de ceux qui sont entrés dans les camps, qui ont tué, violé, démembré, éventré, piétiné ; le plus âgé, Général aux idéaux égalitaires et laïcs, emprisonné pour son coup d’État loupé, qui combattait du côté de ceux qui défendaient les camps. Entre eux, le silence, impitoyable loi des abîmes criminels, du gouffre où les haines se déchaînent, « Palestiniens », « Israéliens », « Chrétiens », « Musulmans », « Sunnites », « Chiites » – termes ramifiables d’une équation avec divisions à géométrie variable. La fourche politique est inexorablement un drame familial, parce qu’au pays du Cèdre, où le pouvoir est une propriété privée, la violence a tout mangé, jusqu’aux ronces.
La sentence qui sauve ce qu’il reste des meubles arrive enfin : le plat est servi, les professeurs sont invités à aller prendre place à table dans la grande salle.
« Well, it was nice to meet you both. Bon appetite, as you say in French! », conclut le professeur de droit.
Elle n’a plus faim, il a la nausée.
Il est minuit passé, ils n’arrivent pas à dormir, chien de fusil à droite, chien de fusil à gauche, s’enlacent de toutes manières possibles.
« You know what would make me really happy ? », murmure-t-elle.
« What ? »
« To hike in Alaska ».
Ils rient de connivence.
« Let’s go see the grizzlies then ».
Ils s’embrassent, en espérant rêver, cette nuit, de paysages non-humains.
Beyrouth-Tel Aviv, 2021 ; Entrée
Elle voit un numéro +972 s’afficher sur son écran. Rejette immédiatement l’appel. Elle est folle ma sœur, se dit-elle. Elle lui écrit un texto par WhatsApp.
N’appelle pas sur la ligne
tu veux que je finisse à Roumieh[2] ?!
Tu es parano !
Certes, elle sait que dans ce nid d’espions on a mieux à faire que de surveiller une Française venue rendre visite à sa famille, mais les phrases de ce Général qu’elle avait entendu, alors adolescente, se sont durablement incrustées dans son esprit : « Le Liban est officiellement en guerre contre Israël, et la loi libanaise interdit tout contact avec l’État hébreu et ses citoyens ». Elle pense aussi au réalisateur Ziad Doueïri, et à certains autres, amis ou personnalités, qui ont été jugés au regard de l’article 285 du code pénal « interdisant toute visite en territoire ennemi, sans autorisation préalable ». Et puis la loi de boycottage d’Israël datant de 1955 qui condamne toute personne physique ou morale d’entrer en contact avec des Israéliens, ou quiconque résidant en Israël. Petite satisfaction compensatoire, elle se remémore comme un réflexe tous ses amis et amants israéliens, franco-israéliens, israélo-américains, -argentins et autres, et elle se dit que l’histoire des États a toujours un temps de retard par rapport à ce que tissent les individus, que certains États sont un squelette de dinosaure dont la cavité cérébrale est hantée par le même écho depuis des décennies.
Comment ça va, t’es bien arrivée ?
Oui, je suis déjà au mariage,
j’ai pas eu une minute avant pour t’appeler, désolée.
On vient de finir l’entrée,
Il y a une pause,
J’en profitais pour t’appeler.
Ça a été l’entrée, sur le territoire… ?
Non comme toujours mise de côté,
sept heures d’interrogatoire,
des questions à te faire tourner en bourrique,
un petit con en particulier qui faisait du zèle
Pff insupportable
c’est dégradant, et tu perds une journée !
Elle pense à sa mamie-louche, à celle dont le nom est effacé deux fois par les patronymes, à la lignée généalogique qu’elle avait laborieusement reconstituée, et ce grand-cousin de mamie-louche, un des fondateurs architectes de Tel Aviv.
Comment va la famille ?
Très mal, comme le pays.
On est au-delà de la catastrophe.
Tout s’est effondré, plus rien ne marche.
Quelle calamité…
Elle ferme ses paupières, tente un instant d’imaginer ce pays qui avait été surnommé la Suisse du Moyen Orient pour conjurer ce qui se présente désormais sous ses yeux, des hommes et des femmes tirant sur les banques par désespoir, des enfants qui meurent de faim, des malades qui succombent dans les hôpitaux dépourvus de courant continu d’électricité, des bébés qui manquent de lait et de couches.
Tous les binationaux sont partis.
Et les expats qui viennent claquer leurs dollars
dans les bars et boîtes de nuit,
cet inaltérable sens de la fête, c’est indécent.
Et résilient, ça fait du tourisme. Mais quel désastre…
Vous avez apporté les valises à donner ?
Oui, oui.
Bon tu diras mazel tov de ma part
à ta copine et son mari, ok ?
Il sont bien installés, ça va ?
Oui je leur dirai.
Ça va mais ils ont galéré à trouver un logement,
la vie est hyper chère ici.
Y a même des gens qui louent des tentes sur des toits d’immeubles pour plus de 5000 shekels !!
Ne me parle pas de tentes, tu verrais ici,
les réfugiés sont presque plus nombreux que les locaux…
Bon, ils sont en train de chanter le siman tov,
je vais y retourner.
Tu fais attention à toi, hein ?
Pensive, elle regarde l’horizon. Depuis le balcon de l’appartement, dans le quartier de Gemmayzeh, non loin de la place des Martyrs, elle voit la somptueuse et immense mosquée Al Amine, à côté de laquelle la vieille cathédrale maronite de Saint Georges paraît désormais minuscule. Un peu plus loin, rue Wadi Abou Jmiel, elle devine la synagogue Maghen Abraham, magnifique depuis sa restauration, mais toujours inaccessible, barricadée, dans ce quartier gouvernemental, dans ce pays où il n’y a plus de juifs. La beauté des pierres juxtaposées des trois cultes ne cache pas la violence qui rôde depuis des siècles, la brutalité du vivre-ensemble des hommes qui ne savent pas vivre ensemble. Camps, contre-camps. La songerie brouille la vision, le paysage devient une tâche faite de l’assemblage de milliers de petits carrés et triangles. Des tentes, des camps, d’autres tentes, d’autres camps, à n’en plus finir, de Beyrouth à Tel Aviv.