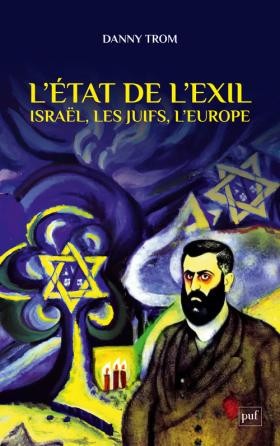Mais qu’est-ce que l’État d’Israël ? Le livre de Danny Trom L’État de l’exil propose une réponse à cette question d’apparence simple : l’État d’Israël n’est pas, ne peut pas être, le simple État-nation du peuple juif. Israël est un État « pour les Juifs » qui, procédant de l’expérience politique des Juifs d’Europe, demeure inscrit dans la configuration exilique des Juifs, hors de laquelle son fondement-même viendrait à disparaître.

L’État-nation est un projet que chaque peuple réalise pour soi, même s’il est voulu pour tous. L’invitation à le réaliser, formulée en Europe à l’ère des nationalités, s’est généralisée. Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est désormais universel, tel un principe incontestable. Les juifs ont-ils été invités comme les autres peuples à se réaliser dans un État-nation ? Cette question, formulée de l’intérieur de la modernité politique européenne, résonne immédiatement mais étrangement dans la tradition juive, prémoderne, qui scénarise une tension entre assignation à l’exception et volonté récurrente d’y échapper. Le syntagme « juif » et la galout, l’exil, surgissent ensemble. Ils s’entre-appartiennent. Les juifs – Israël en exil, séparé des nations – forment un peuple dispersé et dominé, condition d’exception acceptée mais dont la fin est attendue. Et dans le récit biblique – le commentaire traditionnel y insiste – le royaume d’Israël procède d’une réclamation du peuple qui demande avec insistance un roi au prophète Samuel afin d’être, rapporte le récit biblique, « une nation comme toutes les autres nations ». La mise en exception d’Israël, souvent rapportée à la parole du prophète Isaïe « Vous serez la lumière des nations », y est donc ambivalente, assumée ou revendiquée et parfois rejetée, tel un fardeau injustifié.
Cette dialectique de la mise en exception et de la normalisation, encastrée dans la tradition, prend toujours une coloration politique : à la demande transgressive du peuple d’avoir un roi pour mener ses guerres, Samuel le prophète s’indigne et Dieu rappelle à cette occasion que lui seul est le roi d’Israël. Et si Dieu est le roi d’Israël, aucun espace ne s’ouvre pour désigner cette sphère d’activité que les Grecs nomment « politique ». Si Israël a Dieu pour roi, toute velléité d’autonomie est vaine. Il s’ensuit que la langue hébraïque n’a forgé aucun terme pour rendre la notion de politique ; l’hébreu moderne la transposera simplement par politika. Le premier dictionnaire de la langue hébraïque moderne publié en 1901 par Éliézer Ben-Yehouda proposa de traduire « démocratie » par amonouth – le gouvernement de la multitude, de tous – mais le terme grec hébraïsé demokratia s’imposa. Malgré les efforts, la langue hébraïque, même dans sa forme modernisée, demeura rétive à la langue politique européenne héritée des Grecs. Et pourtant, l’État d’Israël naquit.
Qui, aujourd’hui, en contexte moderne, valorise la révolte juive contre la mise en exception d’Israël endosse souvent le credo sioniste de la nécessité du retour des juifs, jadis nation antique, sur la scène de la Weltgeschichte [histoire universelle] de laquelle elle s’était retirée. L’exil est le nom de ce retrait ; la fin de l’exil équivaut à un retour. Cette proposition, au moment où elle fut énoncée, à la fin du XIXe siècle, était extravagante. Prise dans le sens du mouvement des nationalités qui anime l’Europe depuis le Printemps des peuples, les juifs n’ont jamais ambitionné de disposer d’eux-mêmes. Ils étaient, traditionnellement, à la disposition de Dieu, leur roi, et avec l’exil, livrés par Dieu aux « nations », mis à la disposition des souverains territoriaux auxquels ils sont soumis, auxquels ils appartiennent parfois telle une propriété et devant lesquels ils défèrent toujours, tout en se ménageant autant que possible une autonomie interne – autonomie qui avait pour condition un statut séparé des sociétés chrétiennes dans lesquelles ils étaient immergés.
L’émancipation des juifs en Europe fut alors un mouvement de normalisation au bout duquel les juifs, peuple-invité (Gastvolk) dans les nations européennes, selon l’expression de Max Weber, acquéraient le statut de citoyens de leurs États. Le sionisme, quant à lui, trouve son principe actif dans la volonté de normaliser le cas des juifs en Europe, qu’ils soient émancipés ou pas, en les assemblant sur un territoire et en les étatisant. La proposition sioniste tenait à ce simple constat, imprévu : en Europe, même là où la modernité politique a pleinement livré ses effets, il y a persécution malgré l’émancipation. Alors, puisque les juifs sont toujours soupçonnés de former une nation dans les nations, ils formeront, une nation parmi les nations. Avec le sionisme politique, on passa donc de la normalisation nationale à la normalisation internationale des juifs. On passa de la nationalisation des juifs dans les États européens à la nationalisation des juifs d’Europe dans un État nouveau qui leur serait spécialement dédié.
L’État d’Israël, en première approximation, réalise cette dernière ambition. Il normalise doublement la condition juive, puisque les juifs y deviennent non seulement citoyens, mais citoyens de leur État, perspective que la tradition juive excluait en repoussant ce genre d’accomplissement à l’ère messianique, à « la fin des temps », donc indéfiniment. Le sionisme politique permutait donc les termes de l’analyse traditionnelle de la condition juive : l’exception ancestrale devint, en contexte moderne, une anomalie. L’anomalie est une requalification de l’exception juive. Cette dernière procède de l’élection d’Israël, d’une dérogation heureuse et légitime de la norme pour avoir été choisi par Dieu (am nivkhar) d’entre les nations, tandis que l’anomalie en est une déviation malencontreuse et illégitime. Traditionnellement, l’exil est une condition d’aliénation, de dépossession, acceptée car imposée par Dieu, tandis que sa levée, elle aussi, est dépendante de la volonté divine. Le sionisme politique transforma alors l’exil en une condition de domination desquels les juifs se libéreront de leur propre initiative ; l’exil ne résultait désormais d’aucune intention divine mais d’une trajectoire historique malencontreusement tordue qu’il convenait de rectifier. La doctrine sioniste inversait donc la valence de l’exception.
[…]
Avec la création de l’État d’Israël, les juifs, peuple disséminé, sans assise territoriale, se poseraient enfin sur un sol et se doteraient d’un État pour se propulser sur la scène internationale. Cette appréhension présuppose d’une part que le principe révolutionnaire du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, qui s’impose unanimement tout au long du XIXe siècle malgré les résistances des puissances réactionnaires, exige cette mise à jour moderne, et d’autre part, que les juifs forment un peuple à vocation nationale, un collectif désireux et apte à s’autogouverner en se dotant d’un État. Dernier risorgimento d’Europe, l’État d’Israël serait aussi l’assemblement territorial des morceaux éparpillés d’Israël, des communautés juives, sous l’autorité d’un État. Il serait alors une déclinaison juive de la forme politique moderne appelée État-nation. Jamais, avant la publication de Der Judenstaat de Theodor Herzl en 1896, une telle possibilité n’avait été énoncée avec autant de netteté, à condition que Herzl l’eût formulée effectivement ainsi, ce dont, on le verra, il est permis de douter.
Herzl postule qu’il existe un sujet politique qui s’ignore nommé « les juifs ». Cette affirmation, aussi élémentaire puisse-t-elle sembler, était audacieuse : jamais, à l’ouest de l’Europe, depuis l’ère de l’émancipation, elle ne fut énoncée ainsi. Scandaleuse, elle revenait à nier que le processus de nationalisation des juifs en Europe était irréversible. Der Judenstaat de Herzl échafaude le moyen de confectionner un État pour les juifs, mais cette intention procède entièrement du constat de l’échec de leur émancipation pourtant acquise à l’ouest de l’Europe depuis au moins un siècle :
« Partout nous avons sincèrement tenté de nous fondre dans les communautés nationales dans lesquelles nous vivons, cherchant simplement à préserver la foi dans nos pères. Cela ne nous est pas permis. En vain avons-nous été de loyaux patriotes, parfois extraordinairement loyaux ; en vain avons-nous effectué les mêmes sacrifices de nos vies et de nos propriétés que nos concitoyens ; en vain avons-nous contribué à la gloire de nos pays natals, à travers les arts et la science, et leur prospérité par l’échange et le commerce. »
Aussi, Der Judenstaat se lit comme une lettre de dépit à l’égard de l’Europe moderne ; et comme une lettre d’intention de divorcer promptement de l’Europe. Or un divorce bien mené implique que la partie qui abandonne la résidence familiale trouve, dans la foulée, un autre domicile. Une résidence alternative étant indispensable, Herzl, tel un technicien, s’attelle à penser la construction d’un État « pour les juifs », mais sans porter la moindre attention à la substance du collectif qui le posséderait – ce qui en fait un entrepreneur national d’un genre très particulier. Dans le langage de la science politique d’aujourd’hui, on dira que Herzl pose les bases du state-building sans nation-building. Il veut l’État pour un peuple réputé inerte, alors que la formation d’une nation suppose que le peuple soit actif, doté d’une volonté. L’entrepreneur étatique Herzl veut l’État pour le peuple, en l’absence de volonté populaire. Il s’ensuit que Der Judenstaat ne se traduit pas par « État juif » mais « État des juifs » , mieux encore « État pour les juifs » – un État qui leur est destiné et un État qu’ils recevront.
[…]
Si donc avec la naissance de l’État d’Israël le cas juif se moule dans la forme stato-nationale, il est effectivement normalisé. Mais l’on perçoit dès à présent qu’il ne s’y moule pas, ou inconfortablement, ou partiellement, en sorte qu’il demeure anormal. « Normalisation » était effectivement le maître mot du mouvement sioniste dont l’État d’Israël apparaît, rétrospectivement, comme le produit fini ou semi-fini. Beaucoup d’énergie a été consacrée à appuyer la thèse d’après laquelle l’État d’Israël est un État « comme tous les autres », un État-nation à tous égards . […] Mais l’aspiration à la normalité se heurte, on y insistera, à la réalité de l’État d’Israël, à la réalité de sa vie politique saturée d’anomalies, petites et grandes. La plus grande d’entre elles est de taille : elle réside dans l’incapacité d’assumer la qualification, somme toute banale, de l’État d’Israël comme étant « l’État‐nation du peuple juif », cela jusqu’aujourd’hui. Si le syntagme État‐juif suscite un trouble que l’on peine à dissiper, c’est que le trait d’union qui sépare et relie « État » et « juif » y prend une acception minimaliste, celui de la simple détention d’un objet : l’État d’Israël n’est pas l’État‐juif, il est l’État possédé par Israël. Cette déflation du concept d’État national suscite, on le verra, un malaise qui touche au cœur de l’identité politique de l’État d’Israël. En retour, ce malaise appelle une exploration de la teneur du trait d’union qui sépare et lie « État » et « nation » en Europe. Il nous indique que l’État‐nation demeure un syntagme sécable. Il nous rappelle que la formation stato‐nationale est une performance et une épreuve, que l’histoire de cette forme est parsemée d’échecs, sans que l’on soit en mesure d’identifier précisément ses conditions de félicité.
On admettra alors une proposition générale relative à l’État d’Israël. L’échec de sa normalisation doit être éclairé à la lumière d’une cause structurelle. Ce qui apparaît comme un effet de la conjoncture et semble devoir être rapporté aux circonstances chaotiques de la naissance de cet État doit être ressaisi à travers un schème structurel qui génère une ambivalence à l’égard de la forme étatique elle‐même, y compris dans le mouvement sioniste réputé œuvrer à l’édification d’un État pour les juifs. L’incapacité de s’auto-définir, nœud névralgique de la culture politique de l’État d’Israël, tient à cette hésitation structurelle. La perplexité à l’égard de l’État est un héritage du processus moderne de politisation des juifs en Europe. Elle doit être corrélée au dispositif qui génère un rapport contrarié à la souveraineté comme bien politique, rapport qui distille continûment une ambivalence à l’égard de l’« État pour soi » entendu comme État pour soi‐même, pour une « nation juive » – contrariété profondément ancrée dans l’imaginaire de l’exil qui imprégna le mode d’existence des communautés juives avant et par‐delà l’avènement de la modernité politique.
Aussi, personne ne s’aventurait à décrire l’État d’Israël comme un Phœnix antique renaissant de ses cendres. Même si quelques éléments de la symbolique antique sont accolés à cet État, les courants sionistes significatifs impliqués dans sa promotion et sa construction ne visaient pas une telle résurrection. Certes, sa réputation de nouvelle Sparte se forge à l’occasion des multiples conflits qui l’impliquent, mais cette face guerrière ne le caractérise pas en propre, elle tient à la difficile insertion de l’État d’Israël dans son environnement ; sa face athénienne, démocratique, apparaît quant à elle comme un héritage direct de l’Europe. Sous ces angles, l’État d’Israël ne se singularise donc nullement. Ni l’héritage de Jérusalem ni celui d’Athènes ne permettent de le localiser. Mais alors, à quoi tient cette particularité ? Elle émane d’un autre sédiment, constitué par l’expérience des juifs d’Europe sur laquelle le sionisme s’est formulé et édifié.