Dialogue entre Ivan Segré & Gérard Bensussan
Comment comprendre l’apparition d’un usage politique de la tradition juive au sein d’une certaine gauche radicale ? Cet usage est-il paradoxal, idéologiquement surdéterminé, ou procède-t-il d’un intérêt réel pour certaines sources religieuses, susceptibles de ressusciter un messianisme révolutionnaire ? Avishag Zafrani a posé la question aux philosophes Ivan Segré et Gérard Bensussan, tous les deux fins connaisseurs de la tradition juive autant que de celle de la gauche révolutionnaire.

Nous saisissons l’occasion de la parution d’un article consacré à la revue Tikkun, dont la « matrice doctrinale » repose sur une interprétation radicale et révolutionnaire de la kabbale lourianique, pour interroger la légitimité de cet usage politique de la tradition juive ; et in fine pour questionner la pertinence de la transposition séculière d’un ésotérisme conditionné par la recherche d’une signification de l’exil, dans des contextes politiques différents, où c’est le renversement du capitalisme qui est en ligne de mire. Quel sens revêt l’usage de ces éléments juifs, à l’extrême-gauche ? Notamment quand cette dernière est traversée par l’antisionisme, tandis que le sionisme a été nourri par le renouvellement d’une spiritualité juive engagée dans la refonte d’un socialisme utopique/prophétique (par exemple chez Martin Buber, et Scholem, en dépit des différences entre les deux penseurs), axé sur l’émancipation, l’autonomie et la réinvention de la communauté politique ? La pratique révolutionnaire peut-elle théoriser le messianisme juif, sans l’extraire de ses conditions particulières d’existence, et donc sans le déformer ? Il faut ainsi être vigilant à la violence que contient une entreprise révolutionnaire, et voir dans quelle mesure l’usage des éléments juifs ésotériques pourrait orienter une perspective apocalyptique de l’histoire. A cet égard, dans les mouvements révolutionnaires, y-a-t-il une veille de l’effondrement du monde, lui-même signe d’un monde agonistique, mauvais, à détruire ? Tandis que le judaïsme ne saurait renoncer à l’idée que la création est bonne, sans se renier. Soulignés successivement par Charles Mopsik et Moshe Idel, ces éléments nihilistes sont étrangers aux textes juifs[1]. Ainsi pour interroger et discuter des usages de l’ésotérisme juif par une pensée révolutionnaire, nous avons réuni les philosophes Gérard Bensussan et Ivan Segré, tous deux spécialistes – par des cheminements différents – de ces sujets. – Avishag Zafrani
Avishag Zafrani : La sécularisation d’éléments de la tradition juive, prophétisme ou messianisme, a-t-elle été un élément fondamental de l’émergence d’un socialisme qui se pensait comme émancipation, fin des aliénations, et restauration du monde ?
Ivan Segré : Il est très difficile de répondre à cette question s’il s’agit d’apprécier la part de la tradition juive, en termes de causalité historique, dans l’émergence du socialisme au XIXe et XXe siècle. Certains souligneront la prégnance du phénomène « judéo-bolchevique », d’autres, à l’inverse, mettront l’accent sur les rouages « juifs » du capitalisme international, notamment financier. Dès lors que « les juifs sont partout », chacun peut voir midi à sa porte. En revanche, ce qui me paraît sûr, c’est que dans l’histoire des idées, la tradition juive est bel et bien un « élément fondamental » de la pensée et de la pratique de l’émancipation humaine. Il est clair en effet que si la philosophie, entendue au sens d’une spéculation instruite par le raisonnement mathématique, provient d’une matrice grecque, en revanche la critique systématique de l’aliénation et l’idée que l’émancipation humaine, à la fois métaphysique et sociale, est l’axe principal de la spéculation existentielle, cela provient selon moi d’une antique matrice juive, qu’on peut du reste résumer en deux mots : « sortie d’Égypte ».
Gérard Bensussan : J’ai longtemps pensé moi aussi qu’une certaine tradition juive sécularisée, ou au moins que des séquences narratives, des aggadoth[2], un « esprit » juif au sens le plus vague du terme, irriguaient les grands courants émancipateurs de l’histoire du mouvement ouvrier révolutionnaire, des socialismes et des communismes. Ceci me paraît aujourd’hui plutôt relever d’une sorte d’indécidable. Il n’est pas tout à fait impossible de se tenir à cette hypothèse, mais en son sens « faible », comme on a pu parler d’une épistémologie « faible », c’est-à-dire dans l’esprit du beau vers racinien d’Athalie : « Je vois que l’injustice en secret vous irrite / que vous avez encore le cœur israélite. ». Proust évoquait « le goût du sacrilège » des Juifs, Habermas leur esprit de transgression. Tout ceci est remarquable. Mais l’absence de toute causalité déterminable entre ces phénomènes me paraît interdire qu’on puisse parler d’« élément fondamental » à propos du judaïsme et de sa tradition dans l’histoire des grandes émancipations du XXe siècle, ou de quelque chose qui permettrait d’y voir une ressource de pensée et d’action. Qu’une certaine filiation prophétique, et même une certaine lignée rabbinique dans le cas de Marx lui-même – puisque la question a aussi été posée en ces termes et dans ce cadre – puisse marquer effectivement, de façon attestable, les social-démocraties européennes de la fin du XIXe siècle ou le Komintern et autres Internationales au XXe siècle, est très difficile à établir. Ou alors à titre périphérique, selon la statistique par exemple puisqu’il est vrai que beaucoup de Juifs ont participé aux courants révolutionnaires les plus divers, beaucoup ont été à l’origine de la constitution des partis communistes. Tout ceci est à la fois effectif, vrai et réel, et vague, constatable a posteriori. Comment passer des textes prophétiques ou du messianisme juif à la politique communiste au sens large ? De l’irritation profonde devant l’injustice, du « cœur israélite », au léninisme, au trotskysme, au stalinisme, à l’anarchisme ? Tout ceci reste indéterminable de façon consistante. Je parlais d’indécidable : à chacun ensuite de décider, d’investiguer, de suivre telle ou telle piste, telle hypothèse.
A.Z. : Qu’en est-il précisément de Marx lui-même, à qui l’on attribue un messianisme dit “sécularisé” ?
G.B. : La vieille question de savoir si le marxisme n’aurait pas au fond constitué un mode de sécularisation du messianisme juif, de son eschatologie, a pu être tranchée par l’affirmative et parfois défendue de façon convaincante. Elle ne me paraît plus guère tenable, même si elle contient à coup sûr des « éléments » de vérité, difficiles à circonscrire vraiment. Le rapport a en outre été grevé par un antijudaïsme circulant tous azimuts dans les mouvements socialistes. Lorsque Hess est surnommé « le rabbin communiste », ce n’est jamais en très bonne part. Marx est à la fois un Juif allemand très arrogant pour les Bauer, Proudhon, Bakounine et autres adversaires au sein de l’Association internationale des travailleurs, et pouvant lui-même à l’occasion passer pour un Allemand antisémite. Ces chassés-croisés brouillent encore la question, indémêlable en fin de compte.

A.Z. : Il apparaît dès lors, qu’à l’instar de Scholem et Benjamin dans leur correspondance, il faut se mettre d’accord sur ce qu’est la tradition juive. Scholem disait rechercher intensément une « essence du judaïsme », ce qui va le mener vers l’étude de l’ésotérisme juif. Mais il reprochait explicitement à Benjamin d’avoir trouvé une rédemption dans le communisme, tandis que dans le judaïsme, comme chez le kabbaliste moderne que serait Kafka, la rédemption ne saurait être anticipée. Le succès de la pensée révolutionnaire benjaminienne dans les milieux de l’extrême gauche des années 1990 et 2000 est-il l’expression de cette distorsion de la tradition juive, messianique ?
I.S. : Il ne me semble guère possible d’identifier chez Benjamin une « distorsion » du judaïsme, du moins s’il s’agit de l’opposer à une « essence » du judaïsme qu’aurait su approcher Scholem, ou encore Kafka. Plus radicalement, puisque toute « distorsion » suppose en effet de se mettre d’accord sur ce que serait la rectitude en la matière, soit une représentation non déformée du judaïsme, on se retrouve confrontée à la question de l’orthodoxie. Et bien entendu, l’orthodoxie juive elle-même est le résultat de « distorsions » successives au cours des siècles.
Prenons un exemple particulièrement fondamental : la codification systématique du Talmud entreprise par Maïmonide au XIIe siècle. Au départ, elle fut vertement critiquée, et pour cause : le Talmud est dialectique de A à Z, « dialectique » en ce sens que la loi y est exposée de manière contradictoire. Or la codification repose précisément sur une « distorsion » du Talmud (au sens notamment médical d’une partie du corps qui se tourne ou se contracte d’un seul côté), puisqu’une exposition dorénavant unilatérale de la loi succède à une exposition initialement contradictoire. Il n’empêche que le processus de codification est devenu, au cours du second millénaire de l’ère commune, l’un des piliers, sinon le pilier de l’orthodoxie juive. Un second exemple : Rabbi Salomon ben Aderet (1235-1310), dit Rachbah, l’une des grandes autorités rabbiniques du judaïsme médiéval, a bataillé à la fois, sur le versant rationaliste, contre l’engouement pour la philosophie qu’a suscité le Guide des égarés de Maïmonide, et, sur le versant ésotérique, contre le radicalisme cabalistique d’Abraham Aboulafia, n’hésitant pas à recourir, pour ce faire, à l’excommunication. Dans une même veine, le Gaon de Vilna (1720-1797), au XVIIIe siècle, a fustigé la ferveur populaire suscitée par le Hassidisme. Enfin, au sein même de l’œuvre du Gaon de Vilna, le fait est que l’orthodoxie juive privilégie aujourd’hui ses annotations légales sur la Codification plutôt que ses commentaires d’inspiration cabalistique sur le livre des Proverbes ou le Cantique des cantiques. Où est « l’essence » du judaïsme ? C’est une question par définition ouverte, à moins de recourir à une autorité centralisée calquée sur l’Église romaine. La question n’est donc pas d’opposer une « distorsion » à une « essence », elle est plutôt de discerner entre des approches fécondes et d’autres moins fécondes, voire stériles. Reste tout de même qu’il peut être parfaitement légitime, au sujet de l’exégèse d’un texte, de considérer que telle lecture est rigoureuse et intelligente tandis que telle autre est naïve, inepte, voire tordue. Et quant à se mettre d’accord sur ce qu’est la tradition juive, je crois qu’on pourrait la définir comme une pensée-pratique fondée, d’une manière ou d’une autre, sur le noyau indiscutablement essentiel de cette tradition, à savoir la Bible hébraïque et le Talmud, la loi dite « écrite » et la loi dite « orale ».
A.Z. : Qu’en est-il dès lors du messianisme plus moderne, celui de Walter Benjamin notamment ?
I.S. : Il me semble que le messianisme benjaminien a été historiquement tout aussi fécond que celui de Scholem, sinon davantage. Et quant à la question du rapport entre le messianisme juif et la politique d’émancipation, ma position à ce sujet, pour la résumer en deux mots, est celle de Levinas qui affirme d’une part, dans « La laïcité et la pensée d’Israël » : « Aucun espoir de salut individuel (…) ne se peut, ne se pense en dehors de l’accomplissement social » – et qui rappelle d’autre part, dans « Judaïsme et révolution » : « La cause juive n’est pas uniquement une cause sociale ». Pourrait-on en conclure que la position de Levinas est un dépassement, au sens de l’allemand Aufhebung, de la dispute entre Benjamin et Scholem ? C’est là évidemment un clin d’œil que j’adresse à Gérard Bensussan.
G.B. : Je suis entièrement d’accord avec Ivan Segré sur le point de la distorsion. La distorsion n’est pas un vilain défaut. S’approprier une tradition de l’extérieur passe par des forçages, des séquençages, des déformations et des torsions inévitables, ou alors on tombe dans cette sottise
qui voit et dénonce partout d’illégitimes « appropriations culturelles ». En tout cas ce n’est pas sous cet aspect que la question du rapport « judaïsme » / « révolution », ou « tradition juive » / « gauche révolutionnaire », peut être tranchée, ce n’est pas en raison d’une infidélité de celle-ci à celui-là. La réception et la faveur de Benjamin à l’extrême-gauche, que vous évoquez en passant, Avishag Zafrani, est plutôt énigmatique, au fond, en tout cas du point de vue théorique. Dans son Journal de travail, Brecht discernait plutôt dans cette pensée, et alors qu’il éprouvait une certaine sympathie pour Benjamin, un « mysticisme », voire une fâcheuse tendance au « fascisme juif », je le cite ! La question de ce rapport judaïsme/révolution, pour ramasser génériquement les termes d’une relation beaucoup plus ramifiée, est une question de fond, de substance. Est-il sensé de mettre en rapport des corpus, des massifs de pensée, comme, d’une part, la tradition juive, c’est-à-dire la Torah écrite, la Torah orale mise par écrit, les midrachim, la Kabbale, les océaniques commentaires rabbiniques, et d’autre part ce qui forme une autre tradition, mais une vraie tradition, depuis Marx, voire depuis Babeuf, jusqu’aux extrêmes-gauches contemporaines – textes contre textes, pratiques contre pratiques. Je ne sais pas. Je vois bien des affinités électives, j’ai jadis écrit là-dessus, de possibles rapprochements de « cœur ». Mais peut-on aller plus loin que le simple niveau de la description ?

Je reviens sur deux points. D’abord la codification du Talmud dans le Michneh Torah ainsi que l’usage que fit Maïmonide de la philosophie aristotélicienne : cette « distorsion » a donné lieu à de très violentes controverses internes au judaïsme, dont les historiens racontent qu’elles se sont poursuivies sans réduction d’intensité, alors même que les communautés étaient persécutées et expulsées. Ensuite la question, philosophiquement ancienne, mais toujours nouvelle, de l’essence. Je n’ai pas le temps d’y revenir dans la longue durée de l’histoire du concept. Je dirai qu’il y a, peut-être, une façon non substantielle, non essentialisante, de faire usage de cette notion. Disons qu’elle permet de nommer tout ce qui décolle de ce que j’appelais tout à l’heure le niveau descriptif. Au-delà de la description et de l’affinité formelle, « l’essence », c’est-à-dire, au sens lâche, dissociatif, que je propose, pourrait désigner une certaine configuration instable, certainement pas dialectique, sans relève intra-textuelle, puisque les paroles des Sages sont toutes « également paroles de Dieu ». L’ensemble juxtaposé et contraposé des positions tenues par les Sages du Talmud forme une tradition et une « essence », une essence-silhouette, je dirais ; pas une ousia, ni un Wesen. La mahloqet[3], pas l’Aufhebung. Et j’espère que c’est ce que nous sommes en train de faire.
A.Z. : La pensée de Levinas vous semble-t-elle constituer un dépassement de cette opposition, à l’instar d’Ivan Segré ?
G.B. : Je reprendrais ici le développement d’Ivan Segré point par point : je ne pense pas que Levinas ait jamais eu pour souci foncier de statuer sur le rapport que nous sommes en train de tenter de circonscrire, malgré certains propos de circonstance, et d’époque, sur le marxisme en particulier. Son questionnement, le pathos qui est le sien dans sa façon de faire de la philosophie, la puissance de son énonciation en grec de choses complètement ignorées par le grec – tout ceci forme une interrogation « éthique », quelque chose de si original, à condition de bien s’entendre sur les mots, bien sûr, que la « chose » est parfaitement introuvable dans la tradition marxiste, comme dans la tradition de l’ontologique grec ou du théologico-politique. Là encore, on peut toujours suivre le fil d’un « rapport », avec profit peut-être, à condition de ne pas en imputer la consistance et l’épaisseur à Levinas lui-même. Il me semble que nos deux points de vue sur ce rapport judaïsme/révolution sont assez sensiblement divergents, mais pas tout à fait exclusifs…
A.Z. : Pouvez-vous revenir précisément sur le lien qui unit le judaïsme au thème de la révolution, ou de ses éléments (comme l’émancipation) ? Est-il dragué par le thème du messianisme par exemple, est-il le fruit plus contingent de la condition historique juive ?
G.B. : Je discerne une possible différence entre deux manières d’approcher la question qui fait l’enjeu de cette discussion depuis le début. Ou bien on distingue dans le judaïsme un noyau aggloméré autour du messianisme qui pourrait être repris dans les pensées et les pratiques révolutionnaires qui traversent les deux derniers siècles au point d’en former un « élément fondamental ». Ou bien on s’interroge sur le statut de cette « reprise » sans nier quelques ressemblances dans les physionomies ni même certaines affinités « électives ».
Les révolutionnaires eux-mêmes, je le note – et je les mets tous abusivement dans un même sac ici, pour des raisons de commodité d’exposition, les révolutionnaires, donc, n’ont guère été sensibles à la possibilité d’un transfert de ce genre, à part quelques allusions formelles à tel ou tel prophète, mais beaucoup plus encore à la figure de Jésus comme prophète des prophètes. C’est surtout du côté juif qu’on a été attentif à cette proximité. Et je ne la nie pas, « la veuve, l’orphelin et l’étranger » – car « vous fûtes étrangers au pays d’Égypte » ; le jubilé, l’affranchissement social, la tsedaka, ses modalités, la libération de l’esclavage, évidemment le messianisme. Je m’interroge simplement sur le statut de cette proximité, son statut théorique, politique, épistémologique, sans avoir d’ailleurs de position bien arrêtée – tout ce que je sais, c’est que trop d’hypothèques grèvent ce « rapport » pour pouvoir en autoriser vraiment la pensée rigoureuse.
A.Z. : Est-ce qu’il n’y a pas, en tout cas, une particularité juive à relever ?
G.B. : On peut remarquer que les deux autres monothéismes (sans parler d’autres religions que je ne connais pas et dont je ne peux dire un traître mot !) revendiquent également des virtualités subversives susceptibles de faire éclater les cadres sociaux, les ordres établis. L’islam est présenté comme la religion des pauvres, avec un certain succès aujourd’hui. Les théologies de la libération en Amérique latine, voire le Che comme quasi-réincarnation de Jésus, en sont le pendant du côté du christianisme. Je dis les choses très grossièrement, j’en suis navré. J’essaie seulement de faire état de quelques doutes sur notre « rapport », en son universalité incluant en elle le particulier, comme dirait Hegel. Y a-t-il une spécificité telle dans le judaïsme, je veux dire quant à ce qui nous intéresse ici, la relation aux grands mouvements d’émancipation, que nous pourrions déduire qu’il en constitue un élément fondamental, ce qui impliquerait la détermination d’une certaine causalité, même « faible » ?
Sur le messianisme juif – qui représente certainement le cœur de ce mouvement de transfert possible via la sécularisation, on peut dire que c’est essentiellement par le truchement de sa lecture et de sa reprise chrétienne qu’il en est venu à représenter le vecteur d’un « progressisme », d’une vection linéaire et ascendante des mouvements de l’histoire, de son sens. On est très loin de ce qu’on peut lire, par exemple, dans le Traité Sanhédrin, sur les modalités de la venue du Messie, imprévisibilité, surprise vaguement menaçante, arrivée fortuite, présence et imprésence. J’ai écrit en son temps que le messianisme juif ne pouvait pas être considéré comme la matrice des ontologies de l’histoire, de Vico à Hegel, mais bien plutôt comme des modèles réduits, de forte intensité, des pensées de l’événement.
S’il y a une particularité juive dans ce rapport à la « révolution », elle tient sans doute à l’histoire européenne des Juifs, c’est-à-dire à leur histoire mondiale ou d’emblée mondialisée. Les Juifs sont quasiment depuis le début impliqués-désimpliqués dans l’histoire de l’Europe. Ce sont de drôles d’Européens, plus et moins que la moyenne des Européens. Ils ont donc eu à connaître, à participer depuis leur excentration aux mouvements de fond de toute cette histoire, tout en en étant les tiers exclus, les dissidents, comme une marge qui rayonnerait jusqu’au « centre ». Ce qui, peut-être, leur a conféré ce « regard sociologique » dont parle Habermas, propice aux engagements aux côtés de toutes les contestations du centre dominant.
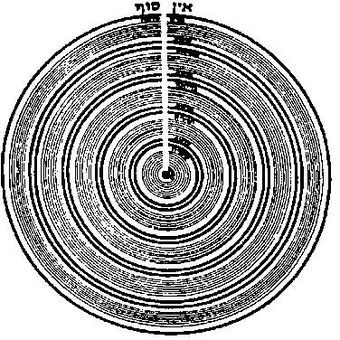
I.S. : Il me semble qu’il convient de distinguer plusieurs choses : il y a d’une part la question de savoir si la tradition juive, et plus particulièrement messianique, a joué un rôle quelconque dans l’émergence de mouvements révolutionnaires au XIXe et XXe siècle, et comme nous l’avons dit c’est un problème complexe et difficile à démêler ; il y a d’autre part la question des significations éthiques et politiques que véhicule la tradition juive, indépendamment de la manière dont ces significations ont pu, ou pas, inspirer tel ou tel mouvement historique ; et il y a enfin la question de savoir comment, à la lumière des enseignements de la tradition juive, apprécier tel ou tel mouvement historique, philosophique ou politique.
Prenons un exemple : la Bible est un texte politique, au moins en ce sens que l’éthique de la relation humaine y nourrit une critique redoutable du pouvoir d’État, critique qui me paraît pertinente bien au-delà du paradigme, aujourd’hui un peu daté, de la royauté. Et à ce sujet, le plus important, me semble-t-il, n’est pas de mesurer l’influence historique que cette critique a pu avoir sur tel ou tel mouvement révolutionnaire, l’important est d’apprécier sa pertinence conceptuelle. La remarque vaut aussi bien pour la manière dont l’antique tradition juive s’est élaborée contre l’impérialisme néo-assyrien, babylonien, grec ou romain.
Plus généralement, je crois que la Bible et le Talmud traitent de ce que j’appellerai, pour aller vite, des invariants anthropologiques, d’où la fécondité transhistorique, et intempestive, des enseignements de cet antique corpus fondateur. A partir de là, il y a évidemment matière à discussion sur ces différents plans : quelle lecture fait-on de tel écrit biblique ou talmudique ? Quels enseignements en tire-t-on ? Comment apprécie-t-on, à la lumière de ces enseignements, tel ou tel mouvement ou doctrine qui se réclame, ou non, de la tradition juive ? Et enfin, peut-on déceler une influence de la tradition juive dans tel ou tel phénomène historique, politique, philosophique ou religieux ? Par exemple, est-ce que la valorisation islamique de l’impératif de justice sociale a des origines juives ? On sait que, dans le Coran, le motif de la destruction des idoles emprunte au midrash rabbinique relatif à Abraham. Il n’est donc pas impossible que l’impératif de justice sociale, si cher aux prophètes bibliques, ait fécondé, historiquement, l’inspiration coranique.
Et pour compliquer encore la chose, et revenir d’un autre biais à votre première question, il y a aussi les distorsions qui ont été infligées aux enseignements de la Bible et qui ont eu des incidences historiques et philosophiques. Par exemple, interpréter la loi donnée au Sinaï comme la fondation d’un État des hébreux, ainsi que Hobbes et Spinoza l’ont fait à la suite d’une longue tradition chrétienne, c’est, à mes yeux, se méprendre complètement sur le déroulement du récit biblique, puisque la fondation de l’État, à proprement parler, intervient lorsque les Hébreux demandent à Samuel d’établir une royauté, « comme les nations », précisément. Il y a donc ici une distorsion multipliée au carré, si je puis dire : l’établissement d’une royauté est une distorsion de l’idéal prophétique porté par Samuel à la suite du livre des Juges, et la lecture de Hobbes et Spinoza radicalise cette distorsion, ou la multiplie au carré, en interprétant la loi mosaïque sur le modèle d’un contrat social.
A.Z. : La question, plus générale, qui est soulevée ici concerne le passage du théologique au politique, en particulier par une pensée révolutionnaire supposée revitaliser une praxis politique. Ceci demeure, comme vous le soulignez, à plusieurs égards, énigmatique. A nouveau donc, pourquoi ? La pensée révolutionnaire a-t-elle besoin du religieux, du transcendant ? Sans doute devons-nous ici déterminer depuis l’intérieur de la tradition juive, s’il y a une légitimité du passage du théologique au politique, ou si au contraire la religion veut se protéger du politique. Je fais aussi allusion aux thèses sur le concept d’histoire de Benjamin, dans lesquelles le messianisme est en quelque sorte mis entre parenthèses, au profit du souvenir – le messianisme, et l’anticipation de l’avenir qu’il suppose, étant pour Benjamin à suspendre sous peine de jeter un sort à cet avenir. N’y-a-t-il pas un écart, une prudence insérée entre le théologique et le politique ici ?
G.B. : Je souscris sans peine aux distinctions proposées par Ivan Segré à propos de la « tradition juive » et de ses significations intrinsèques, extrinsèques et normatives. Elles sont judicieuses et c’est exactement cela, penser en distinguant/spécifiant/déterminant, que j’ai essayé d’introduire dans notre discussion comme son préalable de méthode. Et d’ailleurs, moyennant ces indispensables précisions, on peut mieux entendre, il me semble, la question du « rapport » – qui n’est pas un rapport, entre judaïsme et révolution, je laisse tomber les guillemets car désormais la chose est claire. Il y a en effet, à même les grands textes de la tradition juive, en gros Torah écrite plus Talmud, des séquences, disons comme ça, des séquences notamment prophétiques de critique implacable des pouvoirs et de la domination. Et il faut en effet les considérer dans leur efficience intrinsèque, avant de tenter de mesurer leurs effets de dilution dans l’islam, le christianisme, les pensées révolutionnaires, voire les pensées juives du politique, si tant est qu’on puisse les circonscrire en tant que telles. Ici, se pose la question du sionisme – dont on peut considérer qu’elle forme une figure exemplaire, interne au judaïsme, de ce que vous déterminez comme « passage » du théologique au politique. Au fond, le sionisme constitue l’aggiornamento juif de la vieille question dite « théologico-politique » telle qu’elle s’est posée au XVIIe siècle, dans le contexte de guerres civiles et de guerres de religion terriblement meurtrières. Hobbes et Spinoza s’interrogent sur la souveraineté dans ce contexte : qu’est-ce qui en constitue le fondement ? à qui la souveraineté en dernière instance, à l’Église, à l’État ? et un État peut-il survivre, s’il est « assujetti à deux maîtres » comme dit Hobbes, dont l’un ferait sécession d’avec l’autre ?
Ces questions sont censées avoir été résolues par la philosophie politique classique du XVIIe siècle, les Lumières et la Révolution française au XVIIIe, puis les revendications sociales du XIXe. Elles ne le sont guère. On n’en a pas fini avec le complexe théologico-politique, Schmitt l’a montré, à sa façon, et en dépit d’un certain simplisme.
A.Z. : Comment, dans cette perspective, le sionisme prolonge-t-il cette problématique ?
G.B. : Ces questions sont en effet au cœur du sionisme comme normalisation de la revendication adressée par le peuple à Samuel (8,5), de la constitution de l’État d’Israël puis de son statut démocratique. En Israël, elles relèvent d’une jurisprudence quotidienne, d’une interrogation sans terme. La bévue que signale Ivan Segré quant à la lecture politique classique, surtout chez Spinoza, de la Loi des Hébreux comme inaugurant le règne d’une théocratie, est devenue au XXIe siècle réalité politique, théologico-politique. Ce n’est pas la première fois qu’une erreur théorique est sanctionnée par sa réalisation historique. Je songe ici d’ailleurs bien davantage aux régimes politiques se réclamant de l’Islam politique qu’à l’État d’Israël, les uns et l’autre étant substantiellement différents. Le complexe théologico-politique continue d’habiter spectralement les démocraties elles-mêmes, malgré leur émancipation effective d’avec le religieux, dont on dira à l’occasion, et pour marquer une incompréhension naïve, qu’il fait « retour ». Les démocraties, en effet, se croient définitivement préservées du « religieux » et de son poids, persuadées d’être définitivement « laïques », comme dans le positivisme comtien où le théologique n’est qu’un « âge » qui précède l’état métaphysique et l’état scientifique.
Le sionisme, lui, en tant qu’il pose aussi la question de la souveraineté nationale-étatique et, en creux ou par contraste, celle du statut de la Loi religieuse, brasse et redistribue tous les thèmes attenant au théologico-politique. Il oblige à tenir compte d’une donnée de base dont il est lui-même l’obligé : la création de l’État d’Israël est un événement intra-historique, il ne signifie pas la fin messianique de l’exil, l’avènement de l’ère messianique en son universalité, et moins encore la rédemption des Juifs, la rédemption des hommes, de tous les hommes. Athènes est désormais dans Jérusalem, voilà le dilemme que signifie le théologico-politique juif, si je puis dire, le sionisme. Le sionisme est d’ailleurs lui-même exposé à la bifurcation du religieux et du politique, de l’autorité de la Loi et de l’autorité de l’État, des Lumières et de l’orthodoxie. La question des « deux maîtres » traverse le sionisme de part en part et l’expose évidemment à bien des périls, dès lors que « la république se divise contre elle-même », pour reprendre encore les mots de Hobbes. Comme son nom l’indique, le théologico-politique n’annule pas le théologique, lequel continue son chemin sous la domination de l’autorité laïque des institutions politiques. Comment ? Telle est la question qui se pose dans les démocraties libérales – et le sionisme l’exhausse comme telle. Comme le prévoyait non sans malveillance le Traité théologico-politique, le sionisme ne laisse comme alternative à soi que l’assimilation, encore que la voie de la « dissimilation » (Rosenzweig) la batte en brèche, sans l’annuler. La dissimilation est peut-être aujourd’hui la voie royale de l’assimilation, en transformant celle-ci du dedans. Situation complexe – liée certainement à l’ambivalence de toutes les critiques juives de Spinoza, de sa « trahison », comme critiques modernes de la modernité, je pense notamment à Hermann Cohen.
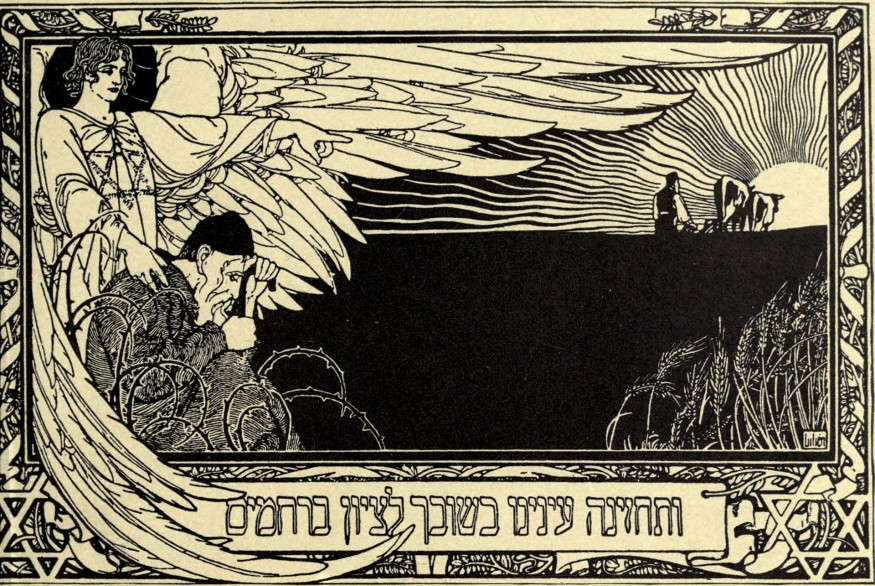
I.S. : Si je comprends bien, vous nous interrogez, Avishag Zafrani, sur la manière dont la tradition juive conçoit le rapport du « théologique » (ou du « religieux ») au « politique ». Eh bien, à s’en tenir aux textes fondateurs, ce rapport est déterminé, dans la Bible, par un jeu de relations triangulaires entre le prêtre, le roi (qui succède au juge), et le prophète. Puis, après l’exil et la destruction du temple, de fait, la royauté est abolie, la prophétie s’interrompt, tandis que les prêtres n’officient plus, si bien que la configuration est dorénavant la suivante : il y a d’une part le rabbin, celui qui enseigne la loi mosaïque et qui juge les cas qui lui sont soumis, et d’autre part celui que le Talmud appelle le « rech galouta », le chef politique de telle communauté en exil. Or, si le « rech galouta », pour chaque communauté, est en quelque sorte le rejeton d’une souveraineté politique déchue, en revanche le rabbin n’est pas le rejeton d’une prêtrise déchue avec la destruction du temple, il est l’héritier du juge et du prophète. En ce sens, dans la tradition juive, la question « théologico-politique » est donc rendue caduque depuis au moins l’occupation romaine de la Judée. Je veux dire par là que, depuis deux mille ans, c’est une question fondamentalement non juive, ou plus exactement chrétienne pour une part, islamique pour une autre. Car dans le judaïsme, la question posée depuis l’exil et la destruction du temple est celle-ci : comment les juifs peuvent-ils continuer à se soustraire à l’emprise religieuse, idéologique, culturelle, sociale, etc. des souverainetés théologico-politiques sous lesquelles ils vivent ? Et comme vous le savez, jusqu’à « l’émancipation des juifs », la principale réponse à cette question a été la pensée-pratique du mosaïsme. Et on situe traditionnellement l’origine de cette configuration politique et existentielle lorsque Rabbi Yohanan ben Zakaï, au Ier siècle de l’ère commune, cède d’une main à l’occupant romain la souveraineté politique sur la Judée, tandis que de l’autre main il fonde l’école talmudique de Yabné.
A.Z. : Comment le processus d’émancipation des juifs émerge-t-il dans ce cheminement ?
I.S. : Dix-huit siècles plus tard, intervient en effet ce qu’on appelle « l’émancipation des juifs », processus qui combine des avancées et des régressions – parfois abyssales – depuis la Révolution Française jusqu’à la seconde Guerre Mondiale. C’est dans cette nouvelle configuration historique qu’à la fin du XIXe siècle prend racine le sionisme, lequel comporte au départ deux tendances principales, l’une étant partisane d’une émancipation à la fois nationale et sociale, dans le sillage des mouvements révolutionnaires (anarchistes, socialistes, communistes), l’autre étant partisane d’une émancipation principalement ou exclusivement nationale. On peut dire grosso modo que la première a dominé le sionisme jusqu’à la fin des années 1970 et qu’avec la fin de la séquence socialisante et l’avènement d’une hégémonie dite « néolibérale », c’est la seconde qui l’emporte, si bien qu’aujourd’hui le sionisme présente un visage à la fois néolibéral et nationaliste ou identitaire. Et c’est donc une configuration localisée d’un processus mondial. Mais sa dimension locale n’en garde pas moins certains particularismes, notamment pour ce qui touche au « religieux ». En effet, les forces politiques et sociales dites « religieuses », en Israël, sont principalement divisées en deux camps : il y a d’une part l’orthodoxie religieuse, qui prétend poursuivre, au sein de l’État d’Israël, le modus vivendi qui avait lieu en exil, et d’autre part le nationalisme religieux, jusque-là minoritaire, qui en revanche considère que la création de l’État d’Israël est un retour à la configuration biblique par-delà le Talmud et sa Codification. Mais ces forces ne sont pas statiques. Les choses évoluent sous nos yeux. Il est clair, par exemple, que l’orthodoxie religieuse tend politiquement à rejoindre le bloc nationaliste. Mais c’est à mon sens une évolution contingente, principalement due au fait que la gauche israélienne s’est refondée, depuis l’avènement du néolibéralisme et l’échec de Camp David, sur une axiomatique anti-religieuse. Car ce qui préoccupe essentiellement l’orthodoxie religieuse, c’est de maintenir son autonomie culturelle et sociale et non de conquérir l’État. En revanche, l’objectif du nationalisme religieux, c’est bien la conquête de l’État. Il y a donc en résumé un sionisme laïc qui aspire à construire une démocratie parlementaire similaire au modèle euro-américain, mais dont le substrat national serait juif plutôt que français ou espagnol ; il y a une orthodoxie religieuse a-sioniste, qui aspire à poursuivre un mode de vie fondé sur la pensée-pratique du mosaïsme tel qu’interprétée au Moyen-Âge par les acteurs de la Codification ; et il y a enfin un sionisme religieux convaincu qu’avec la création de l’État d’Israël la royauté davidique est possiblement de retour, sans qu’on sache vraiment bien, du reste, comment ses partisans entendent traduire politiquement le récit biblique.
Si je reviens maintenant à la problématique occidentale du théologico-politique, il apparaît donc que le sionisme laïc est la configuration juive, au sens national du terme, de l’affranchissement du politique au regard du théologique, mais d’un versant théologique qui est donc chrétien : dès lors que l’État, en Occident, s’est affranchi de l’Église, les juifs ont pu s’émanciper politiquement au sein de l’Occident, et pour une autre part, avec la création de l’État d’Israël, ils ont pu s’affranchir nationalement. Et comme on sait, la raison d’être, sinon la nécessité de cet affranchissement national prend sa source dans le fait qu’un antisémitisme nationaliste, voire racial, a succédé, en Europe, à l’antijudaïsme religieux, ou encore que l’antijudaïsme religieux s’est métamorphosé en antisémitisme.
Je m’efforce d’exposer synthétiquement certains éléments fondamentaux d’une longue histoire. Mais la manière de les articuler reste bien sûr ouverte. J’observe ainsi que Danny Trom, dans un récent ouvrage, Persévérance du fait juif, analyse tout cela de manière originale en soutenant, en gros, que la création de l’État d’Israël n’est pas tant un produit de la modernité occidentale que la forme contemporaine d’une conception juive de l’État dont la source se trouverait dans le Midrash, notamment relatif au livre d’Esther. A le suivre, en effet, la fonction de l’État, en exil, y est conçue comme celle d’un « gardien » chargé d’assurer la survie des juifs, toujours menacée par les pulsions meurtrières d’une « populace » dont le ressentiment antijuif traverserait les âges et les lieux. L’État d’Israël étant un État « refuge », il aurait pris le relai une fois que cette fonction n’était plus assumée par l’État non juif. Je suis critique sur la manière dont Danny Trom situe la pulsion antijuive dans la « populace » et non dans l’État lui-même, alors qu’il me semble qu’historiquement et conceptuellement cette pulsion est composée de ces deux versants, puisque l’antijudaïsme est aussi une manière de réunir, dans la haine des juifs, la classe dominante et la classe dominée. Mais la force de sa thèse est néanmoins de montrer en quoi l’État d’Israël prolonge une configuration essentiellement exilique de l’existence juive. Et paradoxalement, c’est donc une thèse qui éclaire profondément le point de vue de l’orthodoxie juive. On peut donc dire que le livre de Danny Trom traite de la question précisément « théologico-politique », mais saisie dans sa stricte configuration juive.
Deuxième partie la semaine prochaine
Propos recueillis par Avishag Zafrani
Gérard Bensussan est philosophe, professeur émérite à l’Université de Strasbourg. Il a enseigné dans le monde entier et il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages dont le récent « Miroirs dans la nuit. Lumières de Hegel » (Cerf, 2022). Il publiera au printemps 2023 « La transaction. Démocratie et philosophie » (PUF).
Ivan Segré est philosophe ; ses travaux portent sur le judaïsme et la philosophie classique et contemporaine; il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages dont « Judaïsme et révolution » (La Fabrique, 2014), « Les Pingouins de l’universel. Antijudaïsme, antisémitisme, antisionisme » (Lignes, 2017) et « La Souveraineté adamique. Une mystique révolutionnaire » (Amsterdam, 2022). Depuis 2015, il collabore régulièrement au site d’information alternatif LundiMatin.
Notes
| 1 | Voir la critique de l’usage de la gnose de G. Scholem par Charles Mopsik, « Observation sur l’oeuvre de Gershom Scholem par Charles Mopsik et Eric Smilevitch » in Pardès, vol. 1, 1985, p. 6-31. http://www.charles-mopsik.com/Texte08.html. En amont, Hans Jonas a montré l’antinomie du nihilisme gnostique et du judaïsme, notamment à partir de l’antisémitisme métaphysique de la gnose antique. |
| 2 | Enseignements non législatifs de la tradition juive, comprenant récits, allégories, histoires, recueillis notamment dans le Talmud |
| 3 | Ousia est un terme d’origine grecque signifiant la substance ou l’essence d’une chose ; Wesen en est la traduction allemande, et renvoie à une tradition ontologique, de la science de l’être, tandis que le Mahloqet est un terme hébraïque traduit par “débat” ou discussion contradictoire. L’Aufhebung est le mouvement de dépassement, issu du verbe aufheben allemand, propre notamment à la dialectique hégélienne. |












