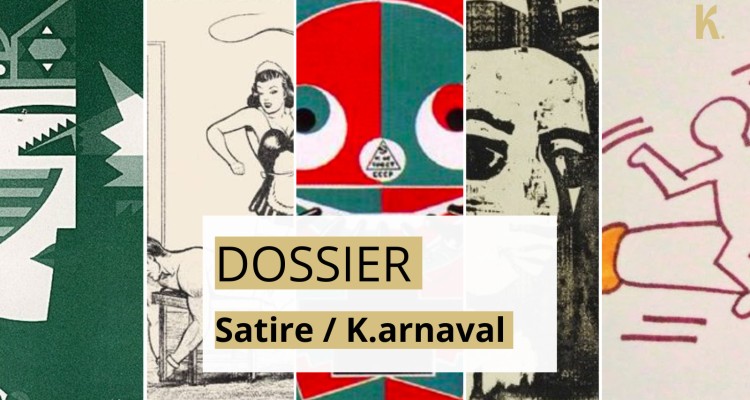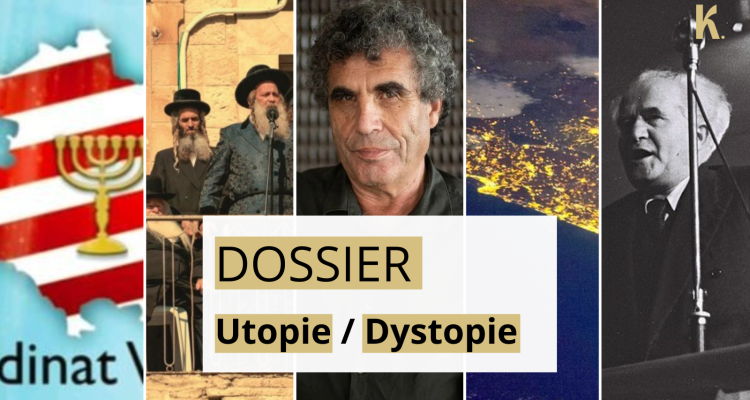Où le rabbin Hillel et le pharmacien Zalman Amsterdamskii ont une idée de génie, avant que l’invasion russe ne gâche leur projet…

Malgré les protestations d’Itsik, tous les vendredis, en se défaisant de la vapeur et des soucis quotidiens dans le vestiaire, ses protecteurs continuaient de tramer des plans pour obtenir une réponse à la question : le pauvre Rothschild, était-il de la même souche que ces seigneurs étrangers ?
— Je crois qu’il m’est venu en tête une bonne idée, dit Zalman Amsterdamskii, qui, couvert d’un drap blanc, ressemblait à un fantôme dans la nuit.
— Si vous avez une bonne idée en tête, reb Zalman, il serait péché de la garder enfermée plus longtemps… Après tout, les idées aussi peuvent manquer d’air et mourir.
— Itsik n’a besoin d’aller nulle part, déclara Zalman Amsterdamskii avec la voix d’un joueur qui vient de recevoir une carte maîtresse. Nous allons envoyer une lettre à Paris.
— Une lettre ? À Paris ?
— Nous allons nous asseoir et écrire noir sur blanc. Mais pas à votre ami Meishe-Yankl, au baron Rothschild lui-même. Lui dire voilà, dans tel et tel petit lieu en Lituanie, vit avec son père gravement malade un jeune homme formidable… préposé aux bains… D’ailleurs, nous n’écrirons pas qu’il est préposé aux bains. Qu’ont-ils à savoir ce qu’il fait ? L’important est qu’il soit lui aussi un Rothschild.
— Une lettre ? À Paris ? le rabbin Hillel passa ses mains dans sa somptueuse barbe, essayant de surmonter son sincère désarroi en effleurant ses fils blancs.
— À Paris, à Paris. Et nous allons sans détour demander au baron si la vénérable famille Rothschild n’aurait pas des parents dans la lointaine Lituanie…
— Nous pouvons, bien sûr, écrire une lettre… dit le rabbin Hillel. Mais comment arrivera-t-elle à destination, si nous ne savons pas où ces Rothschild habitent, ni dans quelle rue ni dans quel immeuble ?
— Ne vous inquiétez pas. Elle arrivera. C’est notre facteur qui ignore où se trouve l’allée des Fleurs du petit lieu : là-bas, les messagers connaissent tout sur le bout des doigts. Vous pouvez arrêter n’importe quel passant et lui demander où habite le baron Rothschild, il vous répondra aussitôt, le rassura Zalman Amsterdamskii.
— Mais pourrions-nous attendre la réponse ? Nous n’avons plus dix-sept ans tous les deux…
— Nous attendrons. Même les morts attendent le Messie, rabbi.
Peut-être que le rabbin Hillel et Zalman Amsterdamskii se seraient véritablement assis dans un endroit tranquille et auraient écrit sur du papier à entête une lettre à Paris, mais la mort d’Avigdor, le père du pauvre Rothschild, réduisit à néant toutes leurs bonnes intentions.
Il n’y eut pas un seul Juif capable de se déplacer qui ne soit venu faire ses adieux au vieux préposé aux bains et l’accompagner dans sa dernière demeure. Lorsque son corps léger, presque aérien, recouvert d’un drap blanc acheté à cet effet fut sorti de la maison sur des planches en bois, le rabbin Hillel se mit à pleurer, et les larmes, de grosses larmes bien mûres, trempèrent sa barbe épaisse.
— Ne pleurez pas, rabbi, dit le pauvre Rothschild. Mon père rêvait de mourir.
— Que dis-tu, que dis-tu… murmura-t-il. Qui donc rêve de mourir, Itsik ?
Le pauvre Rothschild se tut, se mordilla les lèvres, avala l’amertume qui lui brûlait la gorge et l’empêchait de respirer et parvint à articuler : — Celui qui ne veut plus vivre. Celui qui sait de manière certaine que c’est le seul rêve qui, à coup sûr, peut encore se réaliser. Peu importe quand.
Dans l’air du cimetière flottait une odeur âpre de pin funéraire. Des essaims de bourdons intrépides, hébétés par le soleil de juin, voletaient au-dessus des pierres tombales immobiles et leur bourdonnement incessant se mêlait à la prière du deuil que récitait en chantonnant le rabbin Hillel, bégayant de compassion.
— Amen ! répétaient les habitués des bains après chaque bénédiction.
En contrebas, au-dessous de la côte, coulait, mesurée comme une paysanne, la rivière-nourricière, dans laquelle pendant plus de quarante ans Avigdor avait puisé de l’eau, et son doux clapotement d’adieux se confondait avec le bruissement de l’argile qui s’égrenait dans la fosse béante. Du haut d’un pin broussailleux, un corbeau, depuis longtemps habitué aux prières et aux larmes, observait de son regard d’aigle le monticule fraîchement formé. Zalman Amsterdamskii le menaça de sa canne à pommeau en os, mais l’oiseau sur la branche se contenta de croasser de mécontentement en fixant le pharmacien de son regard mystérieux qui n’augurait rien de bon.
L’été n’augurait vraiment rien qui vaille. Une armée étrangère s’était établie en Lituanie, dont les unités s’installèrent dans les accueillants bois et bosquets qui ceinturaient le petit lieu. Le guichet de la gare ferroviaire s’était mis à vendre uniquement des billets pour les trains locaux, à destination de Kaunas ou Šiauliai, et le bureau de poste avait cessé d’envoyer le courrier à Paris et à Londres et ne recevait plus que les lettres pour Riga et Minsk, Leningrad et Moscou. Le président lituanien – auprès duquel le fameux invité, le baron de Rothschild, s’apprêtait soi-disant à racheter le petit lieu avec tous les Juifs qui y habitaient –, avait apparemment décidé de ne pas attendre l’offre avantageuse du banquier et s’était enfui à l’étranger en abandonnant tous ses biens.
À la synagogue, le nombre de fidèles avait sensiblement diminué, et la pharmacie était désormais fréquentée par des épouses de commandants russes, qui achetaient, auprès d’un Zalman Amsterdamskii tombé dans une mélancolie noire, non seulement des poudres et des pilules mais aussi des parfums et des pommades, du shampoing et de la teinture pour les cheveux. L’accablement avait aussi marqué de son sceau le visage de l’inébranlable rabbin Hillel, qui caressait de plus en plus souvent sa barbe, comme si dans son épaisseur se cachaient des réponses à toutes les questions qui le tourmentaient.
Le rabbin Hillel et Zalman Amsterdamskii venaient toujours aux bains le vendredi, mais, convaincus de la vanité de leurs efforts, ne harcelaient plus le pauvre Rothschild avec des propos sur sa parenté avec des riches qui lui étaient inconnus et qui, s’ils le souhaitaient, pouvaient faire le bonheur de n’importe quel Juif. Préoccupés par leur propre avenir, ils étaient toujours en train de chuchoter quelque chose dans le vestiaire, puis, en poussant de longs soupirs et sans que la vapeur ait pu chasser l’inquiétude de leurs âmes, repartaient chez eux en silence.
Seul Itsik n’était pas affecté par les changements survenus avec l’arrivée de l’Armée rouge en Lituanie. Il descendait toujours chercher de l’eau à la rivière, coupait du bois, tressait des balais, chauffait les bains le vendredi et ne se tracassait plus à propos de sa parenté avec les riches étrangers. Ses rêves de bains, tapissés de marbre et chauffés non pas au bois mais à l’électricité, et de poignées de mains royales étaient, eux aussi, partis en fumée…
— Par les temps qui courent, il vaut mieux ne pas parler de parents riches, dit le rabbin Hillel comme pour se justifier de son inaction lorsque, le trentième jour après la mort du père du Pauvre Rothschild, il rencontra Itsik au cimetière. Les Russes n’aiment pas les riches, et les Rothschild… enfin, ceux qui vivent à Paris et à Londres, n’aiment pas les Russes, puisque les Russes confisquent aux riches toutes les richesses qu’ils ont acquises. Alors, Itsik, pour le moment, tâche d’oublier leurs noms et leurs grades et ne parle sous aucun prétexte de ta parenté avec eux à des inconnus. Tu m’as compris ?
— Qu’y a-t-il à comprendre ? répondit Itsik. Tout est déjà très clair. J’ai toujours su tenir ma langue. Et pour ce qui est de parents – seulement, rabbi, ne vous riez pas de moi –, je me suis dit que même sans ces Rothschild de Paris et de Londres, des parents, j’en avais déjà plein.
Le rabbin Hillel n’aimait pas qu’on plaisantât avec lui au cimetière, il ne prêta donc aucune attention à la facétie d’Itsik. Le garçon a lâché une sottise. Ça peut arriver à n’importe qui. Au petit lieu, tout le monde savait qu’Itsik ne pouvait se vanter que d’une seule parente – sa pauvre et mesquine tante Feiga.
— Les arbres et les oiseaux dans le ciel sont mes parents, la rivière, et même Haya le chat sont mes parents, proféra Itsik. Personne ne pourra me les enlever. Personne. N’est-ce pas ? Ni les Russes, ni les Lituaniens, ni les Français. Cette parenté, le Seigneur me l’a donnée lui-même, et ce jusqu’à ma tombe.
— Toi, Itzik, tu n’es pas aussi naïf qu’il n’y paraît à première vue, s’émerveilla le rabbin Hillel. Ses yeux se mirent à briller, ses narines se dilatèrent et sa main plongea dans la jungle de sa barbe pour pêcher une quelconque louange pour le préposé aux bains. — Tu es bon non pour couper du bois, mais pour faire jaillir par la pensée des étincelles de la Torah.
— Merci, rabbi. Vous avez toujours été bon envers moi.
— Qui donc remercie non pas pour la soupe et la viande mais pour le bol vide ? Nous n’avons strictement rien fait pour toi. Nous t’avons taquiné seulement. Le rabbin Hillel se pencha, ramassa une pierre orpheline et la déposa sur la tombe du vieil Avigdor. C’est dommage que les autorités aient supprimé la ligne Kaunas-Paris, et notre espoir avec. Mais ne t’inquiète pas, l’espoir vit plus longtemps que n’importe quel pouvoir.
Le pauvre Rothschild n’avait aucune raison d’être inquiet. Il n’avait jamais compté sur quoi que ce soit, bien qu’il ne jugeât pas Zalman Amsterdamskii et le rabbin Hillel pour avoir cru à un miracle qui n’était pas destiné à s’accomplir. Itsik avait vécu jusqu’alors sans parents, il vivra de même, avec la miséricorde de Dieu, le reste des années que le ciel lui avait accordées.
Les changements de pouvoir l’intéressaient peu. Les gens vont aux bains sous n’importe quel gouvernement, il ne mourra donc pas de faim. Le rabbin Hillel n’aura pas à demander pour lui l’aumône à l’entrée de la synagogue. Dieu soit loué, Itsik gagne plutôt bien sa vie, il n’en est pas à manquer de pain. Sous les Soviets, les amateurs de vapeur chaude étaient même plus nombreux – tous les mardis, les commandants russes amenaient leurs soldats aux bains. Le vestiaire débordait de tuniques militaires et croulait sous des bottes en bâche. Alignées en rang par échelon, les bottes et les portianki[1] exhalaient une odeur piquante de victoire, laquelle ressemblait davantage à une promenade dominicale. Zalman Amsterdamskii jurait que les Russes avaient pris toute la Lituanie en une seule nuit sans aucun coup de feu.
Parmi les vainqueurs, il y avait un officier juif de Biélorussie – le Pauvre Rothschild le comprit tout de suite en l’apercevant nu. Un jeune gaillard au nez en trompette, aux yeux noirs de jais et aux cheveux bouclés tout aussi sombres.
— Comment tu t’appelles ? demanda-t-il au préposé aux bains en un yiddish mutilé mais compréhensible.
— Itsik.
— Igor donc, comme on dit chez nous, à la soviétique. Et le nom de famille ?
— Rothschild.
— Moi, c’est Arkadii… Shulman, je veux dire, Shkolnikov. Il coiffa ses boucles humides et demanda avec un sourire fraternel : Et ta banque, où est-ce qu’elle est, Igor Rothschild ? À Paris ou à Londres ? Où est-ce que tu la touches, ta rente ? Il sourit à nouveau, découvrant des dents blanches comme du sucre raffiné. Tu as quel âge ?
— Quoi ? le dévisagea le Pauvre Rothschild.
— Quel âge tu as, je te demande.
— Vingt ans.
— Tu seras bientôt soldat. À ton âge, j’étais déjà en deuxième année d’école d’infanterie à Ryazan.
— Je ne veux pas être soldat, dit soudainement Itsik.
— Que tu le veuilles ou non, tu seras appelé quand même. On ne se soustrait pas au service militaire en Union Soviétique. C’est un devoir sacré pour tout citoyen. Peut-être serviras-tu la Patrie non loin de la maison, quelque part chez moi, en Biélorussie, ou alors tu peux être envoyé en Extrême-Orient, près de la frontière chinoise. Quoi qu’il en soit, tu seras dans tous les journaux soviétiques, on montrera à coup sûr des reportages sur toi dans tous les pays de l’Union. Je n’ai aucun doute là-dessus. Ce n’est pas de la rigolade, le premier Rothschild à l’Armée Rouge ! Shulman éclata de rire et se mit à chausser lentement ses bottes militaires.
— Mais, ne pourrait-on pas servir la Patrie ici, aux bains ? demanda Itsik avec une innocente malice.
— Tu es un farceur, qui plus est, Rothschild…
— Je suis qui ?
— Un plaisantin, dit Shulman en russe.
Mais le Pauvre Rothschild ne comprenait pas le russe. Quand le rabbin Hillel et Zalman Amsterdamskii viendront le vendredi, il leur demandera, à ces hommes érudits, ce que « plaisantin » veut dire et ils vont sûrement lui traduire ce mot incompréhensible, car tous les deux sont venus au monde encore sous le tsar et devaient connaître ne serait-ce qu’un peu les lettres russes dans leur jeunesse.
À suivre
Gregory Kanovitch
Traduction originale du russe par Elena Guritanu
Notes
| 1 | [NdT] : En russe, carrés de tissus utilisés par les soldats pour protéger leurs pieds. |