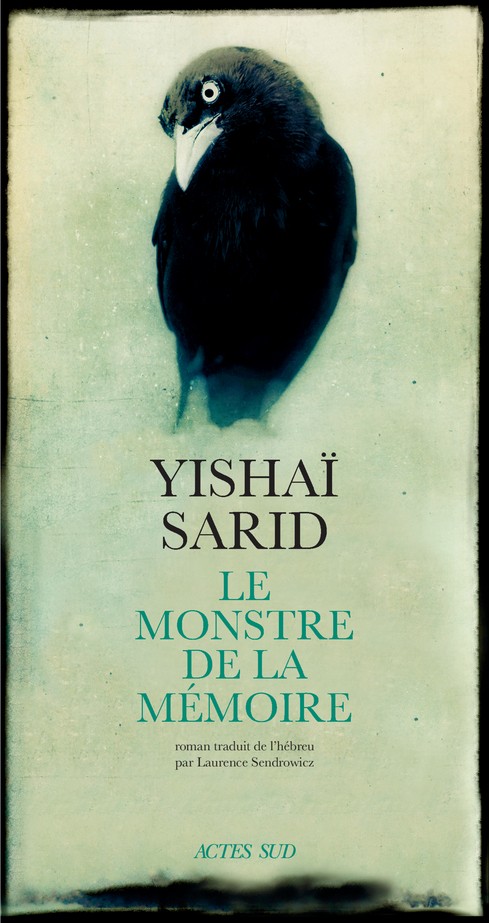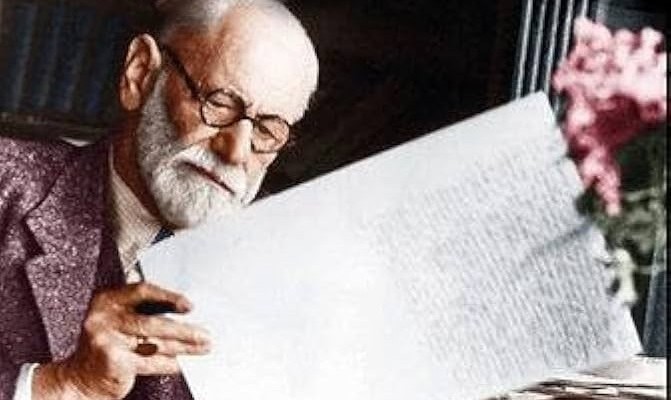Paru il y a un an, Le Monstre de la Mémoire (Actes Sud) est le quatrième livre de Yishaï Sarid, après deux romans policiers[1]et un roman d’anticipation dystopique. Dans ce dernier, Le troisième temple, il imaginait Tel-Aviv et Haïfa détruites, le projet de reconstruction du temple de Jérusalem et Israël devenir un royaume théocratique. Le Monstre de la Mémoire est un récit tout aussi provocateur et dérangeant qui questionne la relation des Israéliens à la mémoire de la Shoah et à l’Europe. Entretien.

« Cher monsieur, vous trouverez ci-après le récit de ce qui s’est récemment passé là-bas… »
Le « monsieur », destinataire de la lettre qui commence ainsi, est le directeur de Yad Vashem ; celui qui l’a rédigée un jeune historien israélien, spécialiste de la Shoah[2]. « Là-bas », c’est pour ce dernier l’Europe obsessionnellement pensée comme lieu du crime, à la fois si loin et si proche de l’État juif, sa province originaire maléfique. Quant au « récit de ce qui s’est récemment passé », il a pour but d’expliquer l’effondrement progressif du rédacteur de la lettre – laquelle compose l’intégralité du Monstre de la Mémoire. Car la mémoire de la Shoah, pour l’historien – d’abord devenu guide à Yad Vashem, puis envoyé par l’institution sur les sites d’extermination en Pologne pour accompagner des groupes de lycéens faisant leur « voyage de la mémoire » – est en effet un monstre qui le dévore. Elle n’est pas seulement un résultat, une somme d’informations et de détails qu’il possède ; mais une puissance délétère, une force de hantise qui le ronge et s’installe en lui pour le posséder. A-t-il « conscience des répercussions [d’un tel travail] sur son mental », des « dangers psychiques » auxquels il est exposé ? demande-t-il au directeur de Yad Vashem, qu’il se représente comme « le représentant officiel de la mémoire » et la plus grande autorité en charge du culte. « Je suis le réceptacle de cette histoire » le prévient-il « et celle-ci sera à jamais perdue si les fissures qui me gagnent viennent à s’élargir au point de me briser. »
Ces fissures, elles le gagnent d’abord parce que cette histoire et la mémoire qui l’envahit le séparent d’autrui et l’isolent. Il est accablé par ces élèves qu’il guide en Pologne. Par ces représentants du gouvernement israélien qui instrumentalisent les lieux. Par ces entrepreneurs d’une startup de Tel-Aviv qui lui proposent de les aider à concevoir un jeu vidéo sur Auschwitz… Sa tâche est de « faire comprendre l’ampleur de cette énormité nommée Shoah ». Mais combien sont-ils à en être véritablement capables ? Il rapporte qu’on apprécie ses connaissances, mais qu’on remarque chez lui un « zeste de froideur », un manque d’empathie envers les destinataires des connaissances qu’il transmet. On lui reproche de ne pas transmettre assez d’espoir. « C’est bon, nous comprenons, ça nous suffit » lui dit un homme dans un groupe qu’il accompagne à Birkenau, « nous n’avons pas besoin de voir davantage d’horreurs pour comprendre. C’est assez. Inutile d’en rajouter. Et ne vous inquiétez pas, vous serez intégralement payé. »
Ce qui le mine, c’est le spectacle du mémoriel (tourisme, utilisation politique, pathos surjoué, proclamation stéréotypée du sempiternel devoir de mémoire …), tous les discours qui visent en somme à digérer l’énormité, à ne pas se laisser saisir par l’ampleur de l’événement. Il ne cesse de repérer ceux qui restent intacts. Jusqu’au déraillement ultime, face à face avec un réalisateur allemand qui l’a engagé comme guide pour préparer un film de plus sur les camps. Et lui inflige la violence de trop.
*
Comment l’idée du Monstre de la Mémoire vous est-elle venue ? S’agissait-il d’abord de faire une critique du rapport de la politique et de la culture israélienne à la mémoire de Shoah ?
Yishaï Sarid : Je suis né avec la Shoah, mon patronyme et son histoire en témoignent : « Sarid ». À l’origine, le nom de famille de mon grand-père et de ses ancêtres – originaires d’une région qui était autrefois en Ukraine et se trouve aujourd’hui en Pologne – était « Schneider ». En 1945, mon grand-père, qui était professeur, s’est retrouvé dans des camps de transit pour dispenser des enseignements à de jeunes enfants rescapés de la Shoah avant qu’ils ne fassent leur aliya et partent vers la Palestine. C’est là qu’il a annoncé à mon père, alors âgé de cinq ou six ans que notre nom de famille deviendrait désormais « Sarid », ce qui signifie « rescapé » ou « survivant ». Toute la famille avait été exterminée en Europe durant la Shoah. Dans la Bible, « Sarid » signifie « celui qui reste ». Pour revenir à votre question, je pense qu’il n’y a pas d’Israéliens pour qui la Shoah ne soit pas un élément du quotidien, je dirais même pour qui elle n’est pas son élément le plus fondamental. Et cela tout à la fois sur le plan général et sur le plan personnel. La Shoah influence la vie politique et celle de chaque individu, au quotidien.
Dans votre récit, cette influence apparaît comme mortifère : le narrateur subit un effondrement psychique lié à son statut même d’historien de la Shoah.
Pendant des années, j’ai lu tout ce sur quoi je pouvais mettre la main concernant l’histoire de la Shoah : les livres d’histoire, les récits des survivants et les témoignages. En tant qu’écrivain, j’ai senti que je devenais obsessionnel, je m’intéressais aux plus petits détails. Je voulais absolument savoir tout ce qui s’était passé et comment. Quels étaient les moyens de mise à mort ? Quels étaient les airs joués par les orchestres qui accompagnaient les gens dans les camps ? Je voulais tout savoir. Et puis cette obsession a commencé à m’effrayer. Je me suis détaché de cette histoire et j’ai arrêté de m’intéresser à la question pendant assez longtemps. Mais en vérité, au-delà des apparences, cette obsession ne m’avait pas du tout quitté. J’ai décidé de faire de cette obsession-même le sujet d’un livre. Écrire sur la Shoah est une entreprise énorme et je savais dès le départ que je ne voulais pas inventer un récit sur cet évènement. Il y a six millions de récits sur la réalité de ce qui s’est passé et on n’a pas besoin de moi pour en ajouter un de plus. Je voulais écrire sur la façon dont chacun d’entre nous peut se mesurer à cette question. Je me suis alors rendu en Pologne. Lorsque je suis arrivé à l’aéroport de Varsovie, j’ai loué une voiture et j’ai passé deux semaines à visiter chacun des camps d’extermination du territoire polonais. Ce sont des lieux horribles. Quand je suis rentré de mon séjour, ma femme m’a dit que j’avais été touché, que je n’étais plus le même. J’ai alors compris quel devait être le cadre de mon livre : ce voyage quasi obligatoire sur les lieux de l’extermination, que fait chaque jeune Israélien, à la fin de ses études. Et ma mission : l’écrire du point de vue de mes sentiments concernant ce que j’avais éprouvé dans ces lieux.
Vous avez employé le mot « détail ». C’est un mot qui revient fréquemment dans le récit. Votre personnage est lui-même obsédé par les détails. Son expérience est en somme la version hyperbolique, catastrophique et pathologique de celle que vous avez connue ?
Le personnage principal, c’est moi et ce n’est pas moi à la fois. C’est toujours le cas ! Ce que la prose ou le roman permet, à la différence d’un article de journal ou scientifique, c’est de parcourir vos pensées les plus dégueulasses, les plus politiquement incorrectes. En lisant le texte, on se dirait par exemple qu’il est aussi exact que j’ai failli devenir diplomate. Et pourtant, dans le roman, ce n’est pas moi.
Mais au-delà de ces précisions anecdotiques, vous avez en commun la manière avec laquelle le personnage devient obsessionnel, traversé d’une question lancinante qui lui vrille le cerveau : comment rendre compte de l’ampleur et de la portée de cet évènement ? Il a le sentiment que ceux qui veulent vraiment saisir ce qui a eu lieu sont peu nombreux. Il se sent seul face à ces jeunes étudiants israéliens qu’il accompagne en Pologne et il dit plusieurs fois qu’il ne les aime pas.
Quasiment tous les lycées israéliens envoient leurs élèves faire ce voyage en Europe qui est quasiment devenu un pèlerinage initiatique. Il est extrêmement difficile pour des jeunes de cet âge-là de faire face à cette horreur. J’en ai été témoin : la plus grande crainte des professeurs qui les entourent, c’est que ces élèves leur fassent honte. Les professeurs ont peur que les élèves quittent l’hôtel, la nuit, pour aller dans les boites de nuit et se saouler. Ils ont peur qu’ils fassent honte à l’histoire du peuple juif. Je le sais de première main puisqu’en 1983, je faisais partie d’un des premiers voyages de ce type. Un garçon de 18 ans a d’autres choses dans la tête que l’histoire de la Shoah, il pense aux filles… Il y a une sorte d’incompréhension et d’effroi qui germent dans la rencontre entre les aspirations de ces jeunes et la Shoah.

J’ai un peu honte de ce que je vais confier maintenant : dans le premier camp d’Auschwitz I, il y a ce mur devant lequel on fusillait directement certains des juifs qui arrivaient. En 1983, le groupe auquel je participais y est arrivé et on a chanté la Hatikvah, l’hymne national israélien. L’épouse de notre guide avait une voix très haut perchée, une voix un peu ridicule. Nous avons chanté l’hymne national et sa voix est partie dans les cintres. Tous les lycéens étaient par terre, en train de rigoler. Une telle situation, au-delà du cocasse, était la marque qu’il était très difficile de se mesurer à ce que nous découvrions, qui nous était insurmontable.
Quoique autrement, cela reste aussi insurmontable pour le narrateur de votre récit…
Le narrateur qui est un accompagnateur se trouve face à des gamins de 17 ou 18 ans pour qui il est difficile de comprendre des événements trop complexes. Il écrit qu’il ne parvient pas à les aimer parce qu’il y a une trop grande distance entre eux et lui. Et quand il essaie de trouver un moyen de se relier à ces jeunes, il se met d’abord à entendre les voix de ceux qui ont été assassinés là et à voir leurs visages. Il essaie de trouver ce lien, ce lien humain, avec ses élèves notamment, mais à chaque fois, il se trouve repris par le récit de la mise à mort qu’il ne parvient en effet pas à surmonter. Lorsqu’il visite un des camps d’extermination et que passe à côté de lui une lycéenne, il ressent le besoin irrépressible de toucher ses cheveux longs et brillants pour toucher quelque chose de jeune et de vivant. La jeune fille se retourne outrée et lui dit : « Mais qu’est-ce que tu fais ? ».
Le narrateur déclare être lui-même contaminé par un virus de la mémoire. Vous diriez qu’il souffre d’une véritable maladie de la mémoire ?
Dire que c’est pathologique, cela me paraît évident, parce qu’il s’agit ici d’un traumatisme qui n’a jamais été traité et qui n’a jamais été guéri. Nous sommes tous victimes, atteints par ce traumatisme. Je pense qu’il y a des rituels qui n’ont pas lieu d’être, comme, par exemple, chanter la Hatikvah en agitant le drapeau israélien en sortant des camps. Je pense aussi à ces images du survol des camps d’extermination par des équipages de l’armée de l’air israélienne. C’est une façon de vouloir mettre un happy end. Mais je ne peux pas non plus dire « laissons tomber tout cela ». Comment pourrais-je le dire ? Le livre s’intitule Le Monstre de la Mémoire, parce qu’il s’agit de rendre compte d’une mémoire qui est en mouvement et non pas de quelque chose de statique. La mémoire fonctionne par des biais bizarres. Si vous me posiez la question de savoir s’il est possible de faire tout cela autrement, je répondrais qu’on ne peut pas véritablement se guérir ou sortir de cette impasse. La plaie reste ouverte, du moins chez moi, ouverte dans mon cœur. C’est de cette plaie que vient mon écriture. Le narrateur pense constamment à l’affront fait à la mémoire des assassinés, qui sont présentés dans la dernière étape de leur vie, au moment où les nazis leur volent leur humanité. On ne parle pas de ces gens quand ils étaient vivants, de leurs maisons, de leurs métiers, de leurs amours et de leurs amitiés. Rien de tout cela. On ne parle que du moment où ils vont être anéantis. Mon personnage est quelqu’un de sensible et, au-delà de sa sensibilité, il est blessé. Est-il possible pour lui de continuer ainsi, jour après jour, de vivre ce genre de vie ? Il se sent investi d’un devoir qui pèse très lourdement sur ses épaules. Il rédige un rapport adressé au président de Yad Vashem sur son expérience de spécialiste de la Shoah envoyé en Europe de l’est pour accompagner des lycéens lors de leurs voyages de la mémoire. Il est comme un soldat qui fait son débriefing à l’organisme étatique israélien qui est responsable du maintien de la mémoire. Au début de son expérience, il suit pas à pas le programme prescrit par cette institution. Il est comme un soldat envoyé en mission mais, dans ce cas précis, c’est un soldat qui est isolé, unique et il est seul à l’accomplir. Il veut bien faire, il veut être un émissaire de confiance jusqu’au moment où cela se brise en lui. Il ne peut plus être à la hauteur de ce qu’il essaie de faire.
On remarque tout de même qu’il n’est pas d’accord avec la mission qu’on lui donne. Plusieurs fois, il remet en question ce que vous appelez « la demande d’espoir » qu’il est chargé de satisfaire. C’est d’ailleurs le principal reproche qui lui est régulièrement fait : il ne transmet pas assez « d’espoir ». Il est le soldat d’une mission dont les modalités ne lui conviennent pas du tout.
Au début, il réussit assez bien. C’est après que les choses commencent à dérailler… Mais je voudrais répondre en reprenant le chemin de mon expérience personnelle. Au retour de ce voyage que j’ai fait en 1983, telle fut ma conclusion : « nous devons être forts ». J’ai ensuite fait mon service militaire et j’ai poursuivi mon engagement dans l’armée pendant 6 ans. Cette décision fut, en grande partie, le résultat de l’expérience que j’avais vécue durant ce voyage de quinze jours. Il m’a donné une leçon utile et importante, comme pour tous les juifs. Mais plus tard, on mûrit un peu, on devient un peu plus intelligent et on se pose la question : est-ce là le seul enseignement que l’on tire de la Shoah ? Est-ce que c’est l’unique leçon que l’on va transmettre aux jeunes ? C’est cette question qui poursuit le personnage dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle. « Nous devons être forts. » Est-ce tout ce qu’il y a à transmettre ?
Avez-vous, ne serait-ce qu’une fois, pris l’avion en pleine nuit avec ces adolescents, avez-vous roulé en car avec eux pendant sept ou huit heures, vous êtes-vous déjà évertué à leur expliquer et leur réexpliquer ce qui s’était passé ici et là, dans les forêts, les ghettos, les camps, avez-vous essayé de pénétrer derrière leurs visages, dans leurs pensées happées par les clignotements des téléphones portables, avez-vous tenté de rendre perceptible la mort, des nombres et des noms, les avez-vous vus vous suivre enveloppés de drapeaux d’Israël, chanter l’Ha Tikva devant les fours crématoires, réciter le kaddish sur le tapis de cendres, allumer des bougies en souvenir des enfants jetés dans les fosses, exécuter toutes sortes de rituels de leur cru et, bien sûr, s’efforcer de verser quelques larmes ? Je me suis demandé bien des fois si vous aviez expérimenté tout cela.
Il y a cette « plaie » dont vous avez parlé mais il y a aussi l’indignation, qui donne à votre récit une charge violemment critique, voire satirique. Votre personnage est dégoûté par l’instrumentalisation politique de ces voyages mémoriels sur les lieux de la Shoah, comme lorsqu’il voit un homme politique israélien qu’il accompagne à Belzec se faire photographier devant un monument aux morts.
Quand j’ai écrit Le montre de la mémoire, il ne s’agissait pas pour moi d’en faire un texte de critique politique. La critique, dans ce livre, fait partie intégrante des processus psychologiques du narrateur. Il dénonce les buts quasi-militaristes qui se déploient durant ces visites, les différents objectifs qu’elles cherchent à atteindre. Il y a aussi un autre aspect, qui n’est pas à l’ordre du jour aujourd’hui, qui est ce sentiment de vengeance qu’il ressent à l’encontre des Allemands.
La question de l’Allemagne hante le récit et votre personnage. Celui-ci répète souvent, aux lycéens comme aux attachés militaires qu’il accompagne en Pologne : « Pourquoi avez-vous tant de mal à haïr les Allemands ? C’est cette question qui m’intéresse ».
Il existe une histoire d’amour entre Israël et l’Allemagne et entre les Israéliens et les Allemands. J’ai des amis israéliens qui me téléphonent et me disent « Viens cet été, en famille, on va aller en Forêt noire. ». Je leur réponds « Écoutez les gars, cela ne va pas être possible. Peut-être l’an prochain… »
Le livre est ambigu, problématique non pas à l’égard de la haine ressentie pour les Allemands Nazis de l’époque, mais à l’égard de ceux qui sont nos contemporains. Le livre se termine par un face à face violent avec un Allemand.
J’ai participé à une réunion d’intellectuels et d’écrivains israéliens et allemands à Jérusalem. Le sujet de la rencontre n’avait rien à voir avec la Shoah. Mais au bout de quelques instants, les Allemands en sont arrivés à parler de l’histoire de la Seconde Guerre Mondiale et de la Shoah. Ils ont commencé à raconter les histoires qu’ils avaient entendues de la bouche de leurs grands-parents ou de leurs parents, de leur pensée et de leur réflexion au sujet de la Shoah. Nous en avons discuté avec eux. Au fur et à mesure, je me sentais de plus en plus mal à l’aise. Ça a duré deux jours au terme desquels il y avait un petit symposium de conclusion. Je leur ai dit : « Je n’ai rien contre vous personnellement, vous êtes des gens charmants mais franchement, on n’est pas du même côté ». Il ne s’agit pas d’une histoire commune dont nous pouvons faire des débats entre nous. C’est ce qui arrive à mon narrateur qui vers la fin du roman accompagne un réalisateur de cinéma allemand sur les lieux de l’extermination et qui agit comme s’ils étaient tous les deux en train de vivre une expérience commune… C’est de là que vient ce motif sur l’Allemagne et les Allemands dans le livre.
Le livre tend vers le récit du déraillement final du personnage. Ce qui le fait s’effondrer, c’est la manière insupportable dont, d’après lui, ce réalisateur allemand qu’il accompagne le regarde : comme un Juif. Il se sent observé par une espèce de bête obsédée par une mémoire qui ne le concerne pas, en tout cas pas de la même manière que lui.
Encore aujourd’hui, nous devons faire face à l’antisémitisme. Israël est peut-être le lieu où l’on en est le plus préservé. Les vieux stéréotypes antisémites, qui remontent à très loin, reviennent à la surface. Ils ont motivé la création du sionisme. Le but était de créer un Juif qui n’aie plus rien à voir, ni de près ni de loin, avec les stéréotypes du juif tels que véhiculés par l’antisémitisme. À l’image de l’être faible, lâche, veule, pas sportif du tout, l’idéal sioniste oppose un Juif grand, fort, agriculteur, avec des mains fortes et caleuses. Je me souviens que lorsque j’étais gamin, on allait rendre visite à des membres de notre famille qui vivaient dans un kibboutz (je parle d’un kibboutz de l’âge d’or des fermes collectives). Au bord de la piscine, les enfants étaient de jolis petits gaillards : ils étaient grands, beaux, forts. Et moi, j’étais un gamin des villes, pas tellement bien bâti, bronzé ou sportif – en plus j’étais binoclard. La vision que nous avons de nous-mêmes à travers le regard antisémite est quelque chose qui perdure jusqu’à aujourd’hui. Ne jamais être faible. On l’entend sans cesse de la bouche de personnalités politiques israéliennes. Cela signifie qu’il ne faut pas avoir trop de sentiments de culpabilité, ne pas être trop moralisateur et ne pas être trop intellectuel. Pour moi, cela revient à proposer de ne pas être trop juif. Et cela vient des gens qui sont prétendument les « plus juifs », les plus religieux…

Mais de quelle « histoire d’amour entre Israel et l’Allemagne » parliez-vous plus haut ?
Il nous reste tout de même un rapport problématique à l’Europe. Les Israéliens s’identifient à l’Europe. On n’a pas trouvé une place convenable dans notre petit quartier… Les Israéliens voyagent beaucoup en Europe et les Israéliens aiment beaucoup l’Allemagne, sa culture, la propreté, les blondes. Il y a quelques années, je me promenais à Tel Aviv et, pas très loin de mon appartement, j’ai vu qu’ont été organisées des kermesses pour l’Oktoberfest. Dans un des bars, je voyais des Israéliennes déguisées en Bavaroises… Ceux qui se rendent aujourd’hui en Israël trouveront, à l’aéroport Ben Gourion, un petit fast food avec de la nourriture bavaroise. On a la nostalgie de l’Europe. Plus que cela ! Quand les Israéliens observent les migration vers l’Europe, beaucoup d’entre eux sont en colère contre ces émigrés venus des pays arabes et de l’Afrique car ils détériorent cette belle Europe blanche qu’ils aiment. Ils oublient un petit peu que nous sommes, nous, « les nègres de l’Europe ». Vous comprenez bien que je ne suis pas en train de dire qu’il faut partir en guerre, nous venger des Allemands, je ne suis pas dans cet esprit-là. Mais cette colère, ce besoin de vengeance ou de revanche, ne s’évanouit pas. Il se redirige vers un autre endroit et vers qui ? Vers les Arabes, par exemple. Je pense que si nous arrivons à un accord de paix avec les Palestiniens, cela nous prendra beaucoup plus de temps pour pacifier nos relations avec eux que cela nous en a pris pour pacifier nos relations avec les Allemands.
Vous notez une nostalgie européenne de la part d’Israéliens aujourd’hui. C’est votre cas ?
Je ne peux pas être pris en exemple. Moi, je me promène à Berlin et j’ai la nausée. 99% des Israéliens vont sans problème à Berlin pour faire du shopping, aller dans les bars et boîtes de nuit. C’est moi qui suis de travers, c’est moi le problématique. Pour moi, la plaie en Europe reste ouverte.
Mais est-ce que vous vous sentez encore un peu européen ?
Je n’ai jamais été européen mais il n’y a aucun doute que je suis d’origine européenne. Mes parents sont venus d’Europe de l’Est. Ma grand-mère maternelle est née à Lvov, aujourd’hui Lviv, en Ukraine. Elle a fait son alyah en 1935, à l’âge de 19 ans. Elle est montée seule en Palestine. Elle avait une enseignante non-juive au lycée, qui avait de l’affection pour elle. Elle lui a dit « Écoute, les juifs n’ont pas d’avenir en Europe. J’ai entendu dire qu’il y avait un coin appelé Palestine. Peut-être qu’il y aurait là-bas quelque chose à construire et que ça serait un bon endroit pour les Juifs. Vas-y ». Et lorsqu’elle a pris le bateau à Trieste, elle a vu la mer pour la première fois de sa vie. Il y a quelques années, je suis allé à Trieste pour un évènement littéraire et j’ai vu le port. Cela m’a beaucoup ému. Elle est arrivée au pays, elle a suivi un enseignement dans une école d’infirmière, elle a rencontré mon grand-père, ils se sont mariés. Ses parents, sa sœur ont été assassinés à Lvov pendant la Shoah. C’était une femme exceptionnelle mais extraordinairement triste. Après la chute du Rideau de fer, on lui a demandé si elle voulait retourner à Lvov pour voir la maison de ses parents. Elle a dit « Absolument pas, je n’ai là-bas que des mauvais souvenirs ». Dire que je n’ai pas de lien avec l’Europe, ça serait erroné. J’ai un lien historique ou culturel avec l’Europe. Il y a une civilisation juive qui a duré un millénaire en Europe, je ne fais pas l’impasse là-dessus. Voici ma réponse.