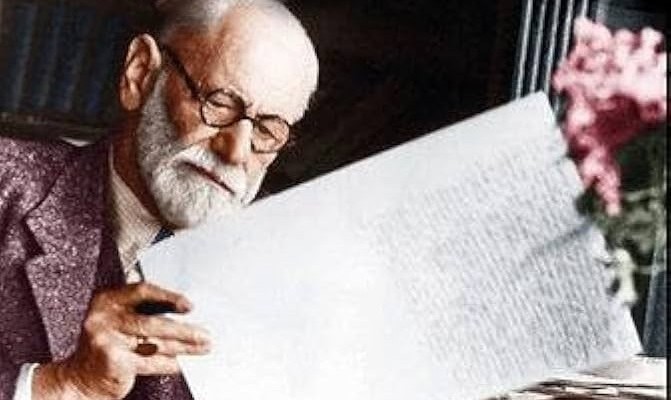Les mélomanes et discophiles actuels ressentent-ils une gêne en écoutant les enregistrements des grands interprètes ayant joué, entre 1933 et 1945, sans états d’âme, pour les dirigeants nazis ? C’est le cas de Philippe Olivier, historien de la musique, spécialiste d’opéra – et notamment de Wagner –, pour qui cette question n’est pas anodine et qui s’interroge sur son propre rapport à ce patrimoine musical.

Je suis historien de la musique. Je suis né en 1952. Les noms d’interprètes exceptionnels comme celui du chef d’orchestre Wilhelm Furtwängler (1886-1954) ou du pianiste Wilhelm Kempff (1895-1991) ne sont pas seulement synonymes, pour moi, d’émerveillement artistique — sans oublier, parmi d’autres encore, celui d’Elisabeth Schwarzkopf (1915-2006), surnommée « la diva nazie » par le New York Times. Ils restent liés, de près, à un passé terrifiant. Quand je les écoute, je n’entends pas seulement l’excellence de leurs interprétations, mais aussi le contexte historique et politique dans lequel elles ont eu lieu. D’autres mélomanes ne partagent pas mon embarras. Ils se divisent en deux grandes catégories. On trouve d’abord, des auditeurs se réclamant d’une neutralité telle qu’ils se disent adeptes de la séparation totale entre l’art et la politique. Il existe aussi des mélomanes tourmentés par l’histoire de l’Europe au XXème siècle qui refusent absolument de se régaler, par exemple, des symphonies de Beethoven dirigées par le Dr Furtwängler, afin de ne pas avoir à tenir compte du contexte de l’Allemagne sous Hitler. Je voudrais revenir ici, de manière personnelle, sur mon propre rapport d’auditeur à ce patrimoine musical, où le génie artistique s’entremêle aux plus sordides compromissions.
Furtwängler, Kempf, Schwarzkopf : trois cas typiques
Wilhelm Furtwängler est un cas typique de cette tension. Pur produit de l’establishment culturel bourgeois en position de puissance sous le règne de Guillaume II, il fut en effet rapidement considéré comme l’emblème par excellence de l’art musical allemand. On le tient encore aujourd’hui comme l’un des plus grands chefs d’orchestre de tous les temps. On le vit présider simultanément aux destinées de l’Orchestre philharmonique de Berlin et à celles du Gewandhaus de Leipzig, envisager de prendre les commandes de l’Orchestre philharmonique de Vienne et triompher au Festival de Bayreuth, vitrine lyrique du régime hitlérien. Furtwängler, un homme particulièrement vaniteux, manqua d’être pulvérisé par Goebbels en raison de sa considération pour des compositeurs « dégénérés », comme Arnold Schönberg (1874-1951) et Paul Hindemith (1895-1963). Mais il les retira de son répertoire et se mit à faire profil bas. Une pareille attitude était – pour lui – d’autant plus nécessaire qu’il affirmait ne pas pouvoir vivre hors de l’Allemagne. Devenu une icône du IIIème Reich, Furtwängler renvoya en 1934 sa secrétaire et déléguée artistique, la fameuse Fräulein Dr. Berta Geismar (1892-1949), parce qu’elle était juive. Pourtant, cette femme à la fois brillante et fort ambitieuse témoigna à la décharge de Furtwängler au moment des procès de dénazification de 1947.
Ayant joué plus d’une fois sous la baguette de Furtwängler, le pianiste Wilhelm Kempff – considéré comme ayant enregistré une des grandes versions de référence de l’intégrale des sonates de Beethoven – était le fruit d’une éducation luthérienne vouée à la défense des « valeurs » militaires prussiennes et de la grandeur – vécue comme universelle – de la musique allemande. On le vit, durant la Première Guerre mondiale, jouer près des lignes de front pour les soldats de l’armée impériale. Après les événements sinistres de la fin janvier 1933, Kempff devint un ambassadeur-pianiste du nouveau pouvoir. Il effectua des tournées de propagande ; il se produisit dans les contrées sous le joug de l’occupation nazie. La paix revenue, Kempff triompha dans la France des années cinquante à quatre-vingt-dix, se déguisant alors en agneau de la réconciliation de notre pays avec sa voisine germanique. Ce qui ne l’empêcha pas, lors du Festival estival de Bayreuth après la guerre, de retrouver des personnalités comme des artistes continuant à utiliser la formule codée unser seliger Adolf, soit « notre bienheureux Adolf »…
Troisième cas typique, après Furtwängler et Kempf : la cantatrice Elisabeth Schwarzkopf, elle adhéra au parti national-socialiste par carriérisme et en devint la détentrice de la carte n° 7. 548. 960. Protégée par Richard Strauss, lui-même président de la Chambre de musique du Reich, elle donna des concerts pour les membres des divisions SS cantonnés sur divers terrains d’opérations militaires et aurait chanté – selon une rumeur persistante n’ayant pas pu être vérifiée jusqu’à présent – devant les officiers de camps d’extermination. Alors que, dans les années 1960, la Schwarzkopf devenait une gloire du chant comparable à la Callas, un silence général se manifesta quant à son adhésion sans états d’âme aux théories hitlériennes. Le refoulement, la dénégation du passé, une part d’antisémitisme résiduel aussi, étaient sans doute à l’œuvre ici et là. L’un des seuls pays développés où la Schwarzkopf ne se produisit jamais fut, d’ailleurs, Israël. Là, on savait parfaitement à quoi s’en tenir au sujet de son passé. Devenue une pédagogue réputée du chant, elle usait d’une technique d’enseignement pour le moins autoritaire. Elle déclara plus d’une fois à des élèves pourtant très douées qu’elles auraient tout intérêt à se marier et à devenir mères de famille au lieu de rêver d’une carrière de cantatrice. Le terrorisme psychologique ne lui fit jamais peur.
Je fus confronté, en 1987, à la violence, restée intacte, d’Elisabeth Schwarzkopf lorsque je lui rendis visite dans sa villa de Zumikon, située aux environs de Zürich. Alors âgée de soixante-douze ans, elle tint des propos qui m’ont littéralement abasourdi. Il était impossible, à ses yeux, que sa consœur espagnole Teresa Berganza (1933-2022) excellât dans Mozart parce qu’elle n’était pas issue du monde germanique. Sa détestation s’abattait aussi sur la cantatrice américaine Teresa Stich-Randall (1927-2007) qui avait commis le « sacrilège » d’interpréter des œuvres de compositeurs allemands et autrichiens. Elisabeth Schwarzkopf se garda bien d’aborder le cas des quelques chanteurs afro-américains qui s’étaient produits à Berlin ou à Salzbourg avant l’arrivée d’Hitler au pouvoir. Pour la légendaire soprano, le monde libre de l’après-guerre courait à sa perte parce que les valeurs démocratiques y étaient répandues et parce que la diversité représentait à ses yeux un danger majeur. Je suis sorti de cet entretien en état de sidération manifeste. Il m’avait confronté à une femme cynique, avide de pouvoir et d’une rare méchanceté, image transmise par des collègues auxquels elle avait fait souffrir mille maux tandis que le Troisième Reich s’imaginait pouvoir durer mille ans. Je m’attendais à rencontrer une figure d’envergure mondiale. Je vis une vieille dame formulant des opinions qui attestaient de son appartenance indéracinable à une Weltanschauung fasciste. Lors de ce genre de rencontre, une question ne vous lâche plus, peut-être naïve : comment peut-on chanter An Sylva ou Gretchen am Spinnrade [Marguerite au rouet], comme tous les lieder de Schubert, avec la douceur et la subtilité requises tout en nourrissant un tel ressentiment politique.
Bayreuth Über Alles
En janvier 2022, la Ville de Berlin annonça qu’une commission d’historiens conseillerait au maire de celle-ci le changement de nom d’une centaine de rues. Il était fait référence à des personnalités connues pour leur antisémitisme ou pour leur soutien aux théories nazies. Richard Wagner et Richard Strauss étaient au nombre de ces personnalités. Richard Strauss, couvert d’honneurs sous le IIIème Reich, composa l’hymne des Jeux olympiques de 1936. À l’heure où il se vit contraint d’héberger, dans sa somptueuse villa de Haute-Bavière, des réfugiés des villes bombardées par les Alliés, il se plaignit avec aigreur de se voir ainsi confronté à des personnes qu’il considérait comme trop liées aux milieux populaires. Mais Strauss ne se vanta jamais du fait que sa belle-fille fut juive. Comme le dit Simon Ghraichy ( 1985), la rock star du piano classique français dont j’ai sollicité l’avis sur ces questions, « des tabous puissants sont toujours à l’œuvre. On n’aime pas beaucoup parler des compositeurs et des interprètes ayant associé leur image aux ravages des dictatures. Mais, au lieu de s’en prendre à eux, on devrait tenir compte de deux données psychologiques fondamentales. D’un côté, nombre d’artistes sont prêts à toutes les compromissions pour survivre en tant qu’artistes. De l’autre, la fragilité de leur statut aura créé des situations des plus étranges. L’être humain est ainsi fait. »[1]
Je n’ai pour ma part, devant ces thèmes, pas le moindre affect. Après des décennies d’étude de pareils sujets, je considère que le peuple allemand n’a pas droit au pardon pour les horreurs commises avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Affirmer qu’il ignorait tout de la Shoah tient de l’imposture révisionniste. Il existe toujours dans le public du Festival de Bayreuth une part minime – peut-être 1% – d’individus partageant les obsessions hitlériennes. Ainsi que l’écrivait après-guerre Klaus Mann (1906-1948) à propos de ses compatriotes : « Comme ils ne peuvent plus faire étalage de leurs […] chars, ils ont recours à Bach et à Beethoven[2]. » La vérité de Bayreuth sous Hitler ? Sa synagogue ne fut pas incendiée durant la nuit de Cristal de 1938, parce qu’elle était mitoyenne du théâtre baroque de la Margravine. Mais les Juifs de Bayreuth furent déportés à partir de 1942. La ville de Franconie se proclama judenfrei. Auparavant, la direction du Festspielhaus avait congédié les chanteurs, danseurs et instrumentistes juifs se produisant dans son cadre. Plusieurs d’entre eux furent assassinés à Auschwitz — où d’ailleurs des orchestres de déportés jouaient. Les officiers du camp se régalaient en écoutant l’un de leurs captifs, le Grec Estrongo Nachama (1918-2000), futur hazan des communautés de Berlin-Ouest et de Berlin-Est.
Pour ce qui est des enregistrements réalisés entre 1933 et 1944 à Bayreuth, il est bien sûr impossible – à leur écoute – de faire abstraction de la situation d’alors. On peut se gargariser en écoutant le Dr Wilhelm Furtwängler, emblème de la pleutrerie devant Hitler, au pupitre des Maîtres-Chanteurs de Nuremberg donnés au festival de 1943. Mais on doit s’informer des circonstances de l’exécution de cet ouvrage. Les Maîtres-Chanteurs furent la seule œuvre donnée cette année-là à Bayreuth, en raison de l’effort total de guerre. Ses seize représentations se virent exclusivement destinées aux « invités personnels du Führer », à savoir des soldats, des infirmières, des travailleurs de l’armement et des citoyens « méritants ». L’auditeur de l’enregistrement dirigé par Furtwängler ne peut pas s’en rendre compte, mais il devrait le savoir et ne pas l’oublier en l’écoutant. Il devrait imaginer une salle garnie d’uniformes vert-de-gris tandis que les svastikas flottaient partout aux alentours du bâtiment et que les Jeunesses hitlériennes aidaient au service d’accueil des spectateurs. Une certaine proportion de ceux-ci déclarera, après 1945, avoir été définitivement dégoûtée de Wagner tant l’enrégimentement organisé au festival suscitait une nausée qu’on gardait alors secrète.
Toscanini, lui, déserta Bayreuth. Le légendaire chef d’orchestre italien, annoncé pour le festival de 1933, fut remplacé par Richard Strauss au pupitre de Parsifal. L’Italien s’était fâché avec les descendants de Richard Wagner en raison de leur glissement complaisant vers les thèses d’Hitler. Toscanini fut une des rares vedettes de la musique classique d’envergure mondiale à prendre fait et cause pour les Juifs persécutés. Il se rendit en Palestine mandataire où il conduisit, en décembre 1936, le concert inaugural du futur Orchestre philharmonique d’Israël. La Seconde Guerre mondiale terminée, le projet de résurrection du Festival de Bayreuth, grâce à un tandem directorial constitué d’Arturo Toscanini et de Thomas Mann, échoua. On ne voulait pas – en dépit de l’occupation de la Bavière par l’US Army – valoriser deux vétérans du combat contre le nazisme…
Réécriture nazie de l’histoire de la musique allemande
La vie sous le nazisme était inondée de musique, mais quand avaient lieu des retransmissions radiophoniques de concerts, fondements de nombre de disques futurs, les œuvres de Mahler, de Schönberg, d’Offenbach, de Mendelssohn-Bartholdy et de nombre d’autres en étaient exclues. Ces compositeurs juifs ou d’origine juive étaient interdits d’exécution, de publication, et de diffusion[3]. Apparut alors une école de « musicologues » nazis ou inféodés au NSDAP, affirmant sans vergogne que Mendelssohn – petit fils de Moses et cas le plus problématique à réévaluer par les nazis compte tenu de l’importance de sa place dans la constellation de la musique romantique allemande – devait être considéré comme une figure allogène à la culture allemande. Il avait pourtant ressuscité, en 1829, la Passion selon saint Matthieu de Bach, maître absolu dont les penseurs hitlériens se feraient plus tard les porte-drapeaux zélés. « Dire qu’il a fallu un petit Juif comme moi pour leur rappeler la grandeur de leur musique ! » aurait pu leur répondre – par anticipation – Félix Mendelssohn-Bartholdy lorsqu’il a prononcé cette phrase, peut-être apocryphe.
La minutie allemande s’était également préoccupée, entre 1933 et 1945, du contenu de nombreuses partitions. Prenons un exemple, celui du Concerto pour violon en ré majeur opus 61 de Beethoven. On en avait retiré les cadences écrites par le virtuose juif Fritz Kreisler (1875-1962) pour les remplacer par celles d’Ottmar Gerster (1897-1969), compositeur protégé par Hitler[4]. Aujourd’hui encore, les cadences signées Gerster figurent sur plusieurs enregistrements récents de l’opus 61 de Beethoven. L’immense majorité des discophiles s’en délecte. Elle ignore le contexte dans lequel Gerster a été incité à écrire ces cadences, à savoir sur l’ordre des autorités de l’Allemagne nazie. Je n’arrive pas, pour ma part, à l’oublier. De même, je ne peux pas oublier que la traduction allemande du livret des opéras de Mozart – réalisée par le grand chef d’orchestre Hermann Levi (1839-1900) – avait été remplacée par une autre traduction en raison du judaïsme de son signataire. On enleva également toutes les références à des personnages ou à des situations présentes au long de la Torah dans les célèbres oratorios de Händel. Ainsi, le titre de Judas Macabée devint : Un héros de notre peuple.
Cette éradication ne concerne pas que la musique classique, mais aussi le jazz. L‘année dernière, je découvre, comme souvent dans les rues de Berlin, des livres mis gracieusement à la disposition des curieux. J’y jette un œil, par déformation professionnelle. Je retire deux ouvrages d’un carton. La pêche est bonne. L’un des deux livres idéalise la vie dans les Sudètes, objet des Accords de Munich en 1938. Il représente aussi les membres du groupe Jazzband Saxonia, alors que la pratique du jazz est interdite par le nazisme et que ses disques sont détruits en public par des fascistes zélés[5].
Une postérité qui, sur fond d’oubli, ne se dément pas.
J’ai évoqué les cas de Furtwängler, Kempf et Schwartzkopf. Ils sont emblématiques, et pas seulement des compromissions des musiciens allemands. En France, on sait le parcours à tout le moins problématique d’Alfred Cortot (1877-1962) – pianiste français qui forma des dizaines d’interprètes au cours de sa carrière de grand pédagogue –conseillant le Maréchal Pétain afin d’éliminer les « éléments indésirables de la profession musicale », se produisant devant des parterres d’officiers de la Wehrmacht, se déplaçant dans l’Allemagne nazie en pleine guerre pour y donner des concerts. Alfred Cortot jouera ici et là, en juin et en juillet 1942, tandis que se préparera la rafle du Vel’ d’Hiv’. L’homme qui avait fondé, en 1919, l’École normale de musique pour que les interprètes français échappent à l’influence de l’enseignement musical supérieur allemand était désormais l’un des convives assidus d’Otto Abetz (1903-1958), ambassadeur du IIIème Reich auprès du gouvernement de Vichy. Quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Cortot se faisait encore remarquer par son manque de discernement. Il s’étonna vivement, en 1947, d’être interpellé et conspué, au Théâtre des Champs-Élysées, par des auditeurs lui reprochant ses liens avec l’Allemagne nazie. S’ensuivirent une bagarre et l’intervention de la police.
J’aime me souvenir que, contrairement à Cortot, quelques pédagogues non juifs ne voulurent pas, en pleine tourmente, cesser d’enseigner à des élèves juifs traqués. Jules Boucherit (1877-1962), professeur au Conservatoire de Paris, cacha dans une villa de Seine-et-Marne plusieurs futurs violonistes virtuoses. Ivry Gitlis (1922-2020) était parmi eux. Boucherit, reconnu plus tard Juste parmi les Nations, ne craindra jamais de donner ses leçons, une activité de plus en plus risquée « en raison des pressions exercées par les autorités occupantes, de l’adoption de nouvelles mesures antijuives par le gouvernement de Vichy et surtout de l’intensification des rafles policières »[6]. Au même moment, la grande pianiste Clara Haskil (1895-1960) se trouve réfugiée aux environs de Marseille, dans la demeure de la Comtesse Lily Pastré (1891-1974). Il en fut de même pour Lazare Lévy (1882-1964), le maître de la virtuose lisztienne France Clidat (1932-2012), obligé de se dissimuler près de Montpellier. Philippe, le fils de Lazare Lévy, fut un héros de la Résistance. Torturé par Alois Brunner (1912-2001), il mourut en 1944 à Auschwitz.
Des confrères allemands de Cortot, les pianistes Walter Gieseking (1895-1956) et Wilhelm Backhaus (1884-1969), ont également eu un comportement opportuniste. Le premier d’entre eux apprécie la compagnie d’Hitler. Il est nommé, en 1938, sénateur du Reich pour la culture. Backhaus se produit en France occupée, durant les tournées de l’Orchestre philharmonique de Berlin, même si le concert programmé à Marseille se voit perturbé par des protestations venues du public. Gieseking et Backhaus demeurent des pianistes géniaux, de référence et célébrés, tout comme Kempf. Après-guerre, il s’agit pour eux de faire oublier leur attitude passée, mais les réflexes peuvent demeurer… Kempf reprochera en public, au milieu des années 1960, à l’une de ses élèves françaises d’avoir épousé un Juif. Cette attitude ne l’empêcha pas, à la même époque, d’être reçu dans l’Ordre des Arts et Lettres par André Malraux au terme de l’un de ses récitals Salle Pleyel. D’autre part, le pianiste Pierre Reach (né en1948) apprit de la pédagogue roumaine Ludmila Popisteanu que « Kempff avait exigé à Bucarest, dans la salle de l’Athénée, où il était venu jouer en 1942 des sonates de Beethoven, que les Juifs sortent de celle-ci pour pouvoir commencer son concert »[7]. Leur éventuelle présence aurait souillé – selon Kempff et ses amis – la mise en lévitation de l’auditoire. L’évocation d’un pareil épisode mit plus tard dans une colère folle le grand chef d’orchestre Otto Klemperer (1885-1971), chassé de l’Allemagne nazie dès le printemps 1933, parce que juif.
Aussi impliqués furent-ils sur un plan idéologique, Gieseking, Backhaus et Kempff sont néanmoins restés dans l’histoire de l’interprétation comme des artistes dotés d’une puissance artistique de très haute envergure. On peut donc les rapprocher d’un Furtwängler et d’une Elisabeth Schwarzkopf. Cependant, ils n’atteignirent pas le sommet d’iniquité et d’engagement nazi d’Elly Ney (1882-1968), surnommée « la grand-mère pianiste du IIIe Reich ».
Elly Ney, cette spécialiste de Beethoven – dont il existe toujours des enregistrements – ne fréquentait jamais les hôtels où séjournaient des Juifs. Elle refusa de se produire dans la ville slovène de Maribor parce que, en plein XVIe siècle, plusieurs familles catholiques de celle-ci « demandèrent à se convertir au judaïsme. Titulaire de l’Épingle d’honneur en or du NSDAP[8], Elly Ney s’enrichit beaucoup sous le IIIe Reich. L’Allemagne occupée par les Alliés, elle continua à donner des concerts jusqu’au crépuscule de sa vie. Ses auditeurs ne songeaient pas que la SS torturait les opposants, les homosexuels et les Juifs, pendant que ses doigts filaient sur l’ivoire. Ils préféraient voir en Elly Ney la vestale de l’art du clavier germanique d’alors. En tout cas, la postérité discographique n’a pas retenu son nom. Une reconnaissance unanime ne lui a pas été accordée. Il y a deux raisons à cette situation. D’une part, la communication publicitaire d’Elly Ney a été étroitement confondue avec la propagande nazie. D’autre part, ses interprétations de Beethoven suscitent aujourd’hui des commentaires dont l’énoncé n’a rien de serein. Elles sonnent de manière fort agressive, se garnissent de fortissimos quasiment belliqueux et transforment le parler sonore viennois en un langage comportant une certaine violence. L’exemple de ces interprétations tendrait à suggérer qu’il exista une « couleur » nazie dans l’exécution des œuvres laissées par les grands compositeurs allemands.
L’expert Günter Haußwald (1908-1974) célébrait alors un art « préservé de mauvaises influences »[9]. On peut placer face à la figure inquiétante d’une Elly Ney, celle du malheureux Karlrobert Kreiten (1916-1943), un élève de Claudio Arrau (1903-1991). Artiste prometteur, Kreiten était un opposant au nazisme. Il fut dénoncé à la Gestapo par une cantatrice, arrêté, condamné à mort et exécuté alors qu’il n’avait pas trente ans. Si, dans l’Allemagne actuelle, Kreiten est presque totalement oublié, les compromissions de Wilhelm Kempff avec le régime nazi ne doivent pas y être trop exposées lors de manifestations publiques.
Avons-nous le droit – c’est bien ainsi que je me pose la question, en termes de droit – de nous délecter sans arrière-pensées à l’audition de virtuoses ayant servi la cause de la prétendue « supériorité » allemande et de son programme génocidaire ? Que penser des enregistrements de l’Orchestre philharmonique de Berlin dont les violonistes, les altistes et les violoncellistes jouaient des instruments spoliés à leurs propriétaires juifs, instruments remis lors d’une cérémonie pendant laquelle ces musiciens prêtaient serment de les faire retentir à la gloire de la musique « aryenne » ? Qui se souvient que les pianos Bechstein, utilisés pour nombre d’enregistrements sous le nazisme, étaient produits par une manufacture dont l’actionnaire majoritaire, Helene Bechstein (1876-1951), considérait Hitler comme son fils adoptif ?[10] Source de plaisir et d’émotion, le disque est un outil à la fois documentaire et restrictif. Il est restrictif parce qu’il occulte une partie de la réalité, connue seulement des acteurs comme des témoins de divers événements et des experts.
Je me souviens de l’ambiance glaciale qui s’abattit sur l’auditoire rassemblé à l’Académie des Arts de Berlin quand, en décembre 2008, je fis mémoire de la considération dévotieuse dont Kempff jouissait auprès des hiérarques nazis. Le débat dont j’étais l’un des orateurs se tenait dans le cadre d’une vaste exposition consacrée à ce pianiste, décidément transformé en figure immaculée. Se trouvait, parmi le public, l’une des filles de Wilhelm Kempff. Elle affirma que son géniteur n’avait pas la gloire post mortem qu’il méritait – selon elle, bien sûr. On tombe, ici, dans des cloaques.
Il est selon moi impossible de se délecter – en connaissance de cause – des interprétations d’œuvres qui, aussi admirables soient-elles, ont vu le jour dans un contexte abject. Le même contexte se trouvait en contradiction complète avec le contenu expressif, humaniste des œuvres en question. Dans un pays comme la France où la musique est vue comme un mode d’expression relevant du simple divertissement, les connaissances en histoire de la musique sont faibles. L’information des notices publiées notamment – dans notre langue – par Wikipédia s’avère limitée quand on aborde les relations entretenues par des musiciens éminents avec le nazisme. N’y figure pas ce qui pourrait ternir leur image post mortem. À l’inverse, la version allemande de Wikipédia est généralement loquace. Préfet du chant[11], Thomas Tacquet-Fabre observe que « pour les interprètes d’aujourd’hui, l’un des problèmes est celui de l’ignorance. Quand j’ai commencé à écouter des anthologies de Wilhelm Kempff ou d’Elisabeth Schwarzkopf, je ne savais rien de leurs relations avec le régime nazi. On a besoin de renseignements sur les actes passés de ces artistes. On n’en trouve pas quand on écoute leurs playlists. Nos formateurs, au Conservatoire de Paris ou ailleurs, ne sont pas des historiens. Leur mode de pensée est musical, technique, pas historique. Il s’avère nécessaire de procéder à des initiatives personnelles. J’ai fait nombre de découvertes en lisant des ouvrages d’histoire, dont ceux du chef d’orchestre Amaury du Closel »[12]. Né en 1956, Amaury du Closel est un pionnier en la matière. Il se déplace dans toute l’Europe, avec son ensemble Voix étouffées, pour diriger des œuvres de compositeurs victimes de l’hitlérisme.
Du Closel pallie, de cette manière, les faiblesses du système d’enseignement supérieur de la musique. On n’y parle jamais de la période nazie si on étudie les œuvres de Paul Hindemith ou de Kurt Weill (1900-1950), pourtant victimes des oukases de Goebbels et de ses serviteurs. On n’y explique quasiment pas pourquoi les enregistrements de Fritzi Massari (1882-1969), reine de l’opérette à Berlin et à Vienne, sont devenus presque impossibles à trouver. Juive convertie au protestantisme, elle réussit à s’enfuir outre-Atlantique en 1939. Les professeurs de musique de chambre ne parlent pas non plus d’Anita Lasker-Wallfisch, une violoncelliste co-fondatrice de l’English Chamber Orchestra. Elle fut membre de l’orchestre des femmes détenues à Auschwitz. Son fils Raphaël également violoncelliste, mène une brillante carrière internationale de soliste.
Épilogue : Hans Schnoor, historien de la musique sous le nazisme et après-guerre
Le second livre abandonné et que j’ai récupéré début 2022 dans le quartier berlinois de Weißensee est l’œuvre de Hans Schnoor (1893-1976). Il s’agit d’un substantiel guide de présentation – paru en 1955 – des partitions données à l’opéra, dans les salles vouées à l’opérette et au concert[13]. Docteur en musicologie, son auteur enseigna au Conservatoire de Dresde. Inscrit au Parti national-socialiste neuf mois avant l’arrivée d’Hitler au pouvoir, Schnoor exerça – comme d’autres – une influence néfaste sur le goût musical du public allemand par ses professions de foi. L’un de ses livres, vendu à 120.000 exemplaires, contient la déclaration suivante : « La nouvelle Allemagne spirituelle comporte […] le peuple et le Führer, la patrie, le sang et le sol [Blut und Boden], la race, le mythe, l’histoire des héros. […] Ces pensées portent en elles la vieille nostalgie métaphysique de l’idéalisation artistique de ses valeurs les plus élevées de regard sur le monde[14]. » Antisémite militant, Schnoor affirmait que la vie musicale européenne de son temps était contrôlée par les Juifs.
Durant le conflit mondial, Schnoor soutint les opérations militaires nazies en écrivant – en 1943 et 1944 – dans le bimensuel Musik im Krieg [Musique en Guerre]. Rédigée par des spécialistes alors sous les drapeaux, la publication était un catalogue d’opinions monstrueuses. Pourtant, une fois la paix revenue, ses auteurs ne furent guère inquiétés. Ils firent autorité à l’heure du miracle économique allemand. L’incorrigible Schnoor – qui témoigne d’une forme de continuité entre ce qui s’écrivait sous le nazisme et après la guerre – continua à rédiger des textes aux sous-entendus de très mauvais goût. Un article consacré à Giacomo Meyerbeer (1791-1864) suggère ainsi que sommeillait chez ce compositeur une nature « de manager : l’art comme commerce et le commerce comme art »[15]. En 1956, un scandale important éclata dans les journaux spécialisés allemands. Il fut suscité par Schnoor, s’en prenant à la fois – dans un article – au chef d’orchestre Hermann Scherchen (1891-1966) et au compositeur Arnold Schönberg. Schnoor accusait Scherchen d’avoir fait voisiner, au cours d’un concert, l’ouverture d’Egmont de Beethoven avec le monodrame Un Survivant de Varsovie, signé Schönberg. Il qualifia cette partition d’« œuvre dégoûtante qui doit ressembler à une insulte pour tout Allemand digne de ce nom »[16]. Datant de 1947, le monodrame raconte les persécutions vécues dans un camp de concentration nazi par un survivant du ghetto de Varsovie. Elle se termine sur le Chema, Israël. Si ce chef-d’œuvre est postérieur à la chute du régime nazi, les interprètes au service de celui-ci ne le donnèrent jamais dans l’immédiat après-guerre. Il fut cependant valorisé et enregistré par Pierre Boulez (1925-2016). Pour revenir à Schnoor, il avait aussi – dans son guide de 1955 – commenté Moïse et Aaron de Schönberg. Il y suggérait, avec une malhonnêteté intellectuelle complète, que le compositeur n’avait pas achevé l’ouvrage parce qu’il aurait été d’une ampleur trop vaste pour ses moyens[17].
La paix revenue, Schnoor et ses amis accablèrent de reproches les quelques émigrés des années 1933 à 1939 rentrés en Allemagne après 1945. Otto Klemperer était de ceux-là. Schnoor l’accusa de se produire à nouveau outre-Rhin et souhaitait que des représailles violentes s’abattent sur lui : « Il y aura un soulèvement – pas un soulèvement des masses, mais un soulèvement des meilleurs d’entre nous[18]. » De pareils propos indiquent que les scories du nazisme se trouvaient encore à l’œuvre. Comme le disque constitue l’une des formes de la mémoire, tout mélomane actuel ne peut faire l’impasse sur un pareil sujet. L’enregistrement sonore appartient à l’histoire, pas seulement à l’histoire de l’interprétation musicale.
Philippe Olivier
Docteur en histoire et musicologue, Philippe Olivier est spécialiste de la vie musicale allemande entre 1933 et 1945, et sous la République Démocratique Allemande. Il a publié une trentaine de livres, tant en France qu’à l’étranger. Il est invité pour des conférences à l’Académie des Arts et à l’Opéra d’État de Berlin, au Festival de Bayreuth, aux Universités de Genève, de Ljubljana, de Londres, de Tel-Aviv, de Vienne et de Vilnius.
Notes
| 1 | Entretien téléphonique avec Simon Ghraichy, 4 février 2022. |
| 2 | Klaus Mann : Contre la barbarie – 1925-1948, Phébus, Paris, 2009, p. 284. |
| 3 | Voir Amaury du Closel : Les Voix étouffées du IIIe Reich – Entartete Musik, Actes Sud, Arles, 2005. Lire également Amaury du Closel et Philippe Olivier (dir.) : Déracinements – Exil et Déportation des Musiciens Juifs sous le Troisième Reich, Hermann, Paris, 2009. |
| 4 | Gerster deviendra, par pur opportunisme, après la Seconde Guerre mondiale un notable de la profession en Allemagne de l’Est. Voir Philippe Olivier : La vie musicale en République Démocratique Allemande (1949-1990), Droz, Genève, 2022, pp. 94-95. |
| 5 | Des Sudètes était aussi originaire le pianiste juif Rudolf Serkin (1903-1991). Devenu entretemps un mythe, Serkin a été sauvé d’une mort probable par l’émigration aux États-Unis. On ne saurait, bien sûr, le classer parmi les pianistes soumis de manière délibérée aux hitlériens. Pourtant, il fut – information stupéfiante ! – courtisé, en 1933, par Hermann Göring en personne. |
| 6 | Claude Singer : Vichy, l’Université et les Juifs, Les Belles Lettres, Paris, 1992, p. 284. |
| 7 | Communication de Pierre Reach – par courrier électronique – à l’auteur, en date du 4 novembre 2021. Disciple d’Yvonne Lefébure (1898-1986), Pierre Reach est un virtuose français issu d’une famille d’Europe centrale ayant compté Gustav Mahler parmi les siens. Pierre Reach a notamment réalisé un enregistrement transcendant des Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach. Il excelle aussi dans Beethoven, dont il prépare une intégrale des sonates pour piano. |
| 8 | Le NSDAP est l’acronyme du Parti national-socialiste. |
| 9 | Günter Haußwald : Die deutsche Oper, Hermann Schaffstein Verlag, Cologne, 1941, p. 59. |
| 10 | Helene Bechstein offrit un cabriolet Mercedes à Hitler; il fit cadeau à son admiratrice du manuscrit autographe de Mein Kampf. |
| 11 | Un préfet du chant est un pianiste spécialisé faisant étudier leurs rôles à des chanteurs d’opéra. |
| 12 | Entretien téléphonique avec Thomas Tacquet-Fabre, 3 février 2022. |
| 13 | Hans Schnoor: Oper, Operette, Konzert- Ein praktisches Nachschlagbuch für Theater- und Konzertbesucher, für Rundfunkhörer, Fernsehteilnehmer und Schallplattenfreunde, Bertelsmann, Gütersloh, 1955. |
| 14 | Hans Schnoor : Oratorien und weltliche Chorwerke, Breitkopf & Härtel, Leipzig, 1939. |
| 15 | Hans Schnoor: Oper, Operette, Konzert- Ein praktisches Nachschlagbuch für Theater- und Konzertbesucher, für Rundfunkhörer, Fernsehteilnehmer und Schallplattenfreunde, Bertelsmann, Gütersloh, 1955, pp. 302-303. |
| 16 | De pareilles affirmations furent publiées par le Westfallenblatt, un quotidien régional paraissant depuis 1946 en Westphalie. Il était contrôlé par Carl-Wilhelm Busse (1914-2001), apparemment un proche de Schnoor. |
| 17 | Hans Schnoor : op. cit., p. 392. |
| 18 | Hans Schnoor : Wir und der Funk [Nous et la Radio], in Westfalenblatt, 29 octobre 1955. |