Vilna, Wilno, Vilnus. Yerushalayim de Lita. Ville-songe, inondée par la lumière de la Grande Synagogue. Ville rêvée, aux matins parfumés de brioche à la cannelle. Ville-chimère, aux forêts empêtrées d’effroi. Dans un texte inédit en français, Grigory Kanovich — l’écrivain lituanien, mort le 20 janvier dernier, à 94 ans, en Israël — évoque sa Jérusalem de Lituanie, ville devenue fantôme.

Il me semble avoir rêvé d’elle dans mon berceau – longtemps avant de l’avoir vue, éveillé, pour la première fois, longtemps avant qu’en 1945 elle ne me prenne dans ses bras ensanglantés et noircis par la fumée de la guerre, longtemps avant que ne grandisse en son sein le monticule d’une tombe, dont l’argile a maculé mes joies et teinté pour toujours mes peines d’un jaune vénéneux, car c’est en dessous qu’a trouvé (l-a-t-elle trouvé ?) le repos éternel ma mère, que sa mémoire soit bénie !
J’ai visité, dans ma vie plus si courte, de nombreuses villes – New-York et Paris, Toronto et Genève, Londres et Turin, Prague et Varsovie, mais aucune d’entre elles, majestueuses, uniques, convoitées, n’a habité mes rêves.
Je ne rêvais que d’elle, la seule ville au monde.
Je rêvais de ses rues et ruelles, étroites comme des fils, sur lesquels séchait depuis des siècles du linge juif, passé au bleu des espoirs inassouvis, audacieux et altiers comme le sont les nuages au matin, celui des rêves tombés en pluie sur les âmes frêles des filles et garçons des quartiers aux noms mélodieux de rois et de reines : Judith et Ruth, Solomon et David.
Je rêvais de ses toits en tuiles, sur lesquels les chats se promenaient comme des anges, et les anges comme des chats.
Je rêvais de ses pavés, dont chaque dalle était comme un éclat des tables de Moïse.
Je rêvais de ses synagogues et de ses marchés – du murmure de la prière, ardente, presque passionnelle, dont les saccades s’entremêlaient dans mes songes la nuit à des cris frénétiques :
̶ Kugel ! Heyse beygelekh ! Frishe fish ![1]
Les cris résonnaient aussi graves et pénétrants que des psaumes, et les commerçants ressemblaient aux prophètes d’antan – leurs chevelures argentées flottaient au vent, leurs yeux brillaient d’un feu surhumain ; la babka[2] aux pommes de terre sentait non pas la cendre noire des poêles qui fumaient quelque part rue Zavalynaïa ou Novogrudska, Myasnitskaïa ou Rudnitskaïa, mais les autels dispersés aux sommets des monts de Judée.
Dans mon enfance, qui est elle-même devenue un songe, mes rêves de cette ville merveilleuse et inaccessible étaient hantés par les interminables et accablantes histoires de ma parentèle – mes grand‑mère et grand-père, oncles et tantes, qui n’avaient jamais quitté le périmètre de notre petit lieu mais en savaient sur le monde autant que le Seigneur lui-même si ce n’est davantage – par les racontars de nos innombrables voisins, bavards à souhait et prompts à l’affabulation (fables dont mes compatriotes brodaient quotidiennement la toile grise de l’existence), par ceux des pèlerins affamés, égarés dans nos contrées au bord de la Vilia et qui payaient généreusement le gîte et le couvert avec toute sorte de mayses[3].
Leurs récits indolents, leurs longues histoires qui s’étiraient jusqu’à l’aube enflammaient l’imagination comme une Haggadah de Pâques. Mon Dieu, quelle ivresse il y avait dans ces magnifiques, dans ces inoubliables mensonges, dans ces prodigieuses et bienfaisantes demi-vérités ! Elles donnaient le vertige, la maison débordait de soupirs et d’exclamations douces-amères, qui mêlaient tristesse et euphorie, passions et espoirs sibyllins.
̶ Oh ! s’exclamait ma tante Hava en essuyant discrètement une larme.
La vieille fille, aussi, rêvait d’elle. Peut-être plus souvent que moi. Elle lui apparaissait sous la forme d’une immense houppa[4] étendue dans une vaste prairie verdoyante, sous laquelle, toute de blanc vêtue, elle se tenait, étourdie de bonheur, aux côtés de son promis. Là-bas, dans cette ville extraordinaire, même la dernière des laiderons trouvait un mari. Là-bas, chaque jour et chaque heure que Dieu fait, de jeunes mariés échangeaient des alliances en or.
Pour ma tante Hava, Wilno elle-même était un anneau d’or perdu dans l’Univers.
̶ Eh ! soupirait d’aise, comme au sortir de la banya[5], mon oncle Leyser, lorsque son nom était prononcé.
À lui aussi, elle lui apparaissait en songe. Oncle Leyser rêvait qu’il était élu starosta[6] de la Grande Synagogue, qu’il portait une kippa brodée de perles, sous laquelle sa tête brillait dans le crépuscule comme une étoile au firmament. Leyser souhaitait être enterré auprès du Gaon Rabbi Eliyahu, le juste parmi les justes et sage parmi les sages.
̶ A-a-a-ah ! marmonnait avec délice le boulanger Rakhmiel, né dans cette ville merveilleuse mais amené nourrisson en la Lituanie païenne.
Lui, il avait d’autres rêves au four – il n’avait rien à faire des kippas brodées de perles ; il pouvait être enterré auprès de n’importe qui : une tombe n’est pas un lit conjugal ; mais à chaque fois qu’il était question de Wilno, il se voyait en propriétaire de la pâtisserie en face de la Grande Synagogue, où il vendait du matin au soir des brioches aux raisons secs et à la cannelle qui sentaient bon le paradis. Le Tout-Puissant lui-même s’y rendait après la prière du matin pour en goûter.
De ces contes, envahis par l’exagération comme une terre en friche par des fleurs sauvages, de ces histoires qui tantôt vous accablaient tantôt vous plongeaient dans une euphorie qui frisait la déraison, de ces soupirs et de ces exclamations, de ces demi-mots et sous-entendus naissait quelque chose qui n’existait sous aucun des toits du petit lieu, et que l’on ne pouvait voir à travers aucune fenêtre, fût-elle encadrée d’or. En ressortait l’image de la ville des villes, de l’îlot juif dans un océan bouillonnant d’étrangeté et de haine, capitale de la piété et de la sagesse juives. De ces contes, tel un navire brillant de tous ces feux, émergeait la ville de nos rêves.
C’était un navire fabuleux, qui flottait en même temps sur l’eau, sur terre et dans les airs. Comme dans un port, il entrait dans chaque maison, dans chaque hutte. Ses cales, toujours ouvertes à tous, étaient pleines de joyaux et de trésors – prenez, emplissez-en vos poches et vos âmes, riches et pauvres, sages et idiots, heureux et malheureux. Dans mes oreilles emplies du sable des souvenirs, résonne encore le long sifflement de ses sirènes, et il ne se taira probablement pas jusqu’à ma dernière heure. Il réveille les vivants et les morts.
Cent trente kilomètres séparaient ce rêve de la réalité.
Qu’est-ce une telle distance à l’ère des vols supersoniques et des puissantes Mitsubishi ? Mais alors… ! En ces temps-là, le voyage de notre petit lieu jusqu’à Wilno semblait aussi lointain que la Grande Ourse. L’inaccessible accroît la nostalgie et l’amour. Comme disait ma grand-mère, paix à son âme, la raffinade est plus sucrée en esprit que dans la bouche : en bouche elle fond, en pensée – jamais.
Dans l’esprit de ceux que l’on appelait, depuis des siècles, des litvaks, Wilno ne fondait jamais.
Je me souviens de mon grand-père, le cordonnier Shimon Dudak, qui roulait ses petits yeux, étroits comme des trous de serrure sur la porte d’une grange, et, relevant ses sourcils broussailleux vers son crâne chauve et lisse comme une toile cirée, s’exclamait :
̶ Seigneur ! Quels cordonniers ils ont là-bas ! C’est le Tout-Puissant lui-même qui fabrique leurs poinçons !
Je me souviens du tailleur Gedalie Bankvecher qui, caressant sa noble moustache et prenant appui sur sa jambe droite raccourcie, se vantait ouvertement :
̶ J’ai appris à coudre à Wilno. Des tailleurs comme là-bas, le monde n’en a jamais vu ! Ils vous redressent un bossu !
Je me souviens du fou du petit lieu, Motele, affable, toujours vêtu de blanc comme enveloppé d’un linceul, qui disait :
̶ Quelle ville ! Ils sont tous fous là-bas ! Tous ! et il claquait sa langue en signe d’accord avec lui-même.
Ma grand-mère, surnommée la fiancée de Dieu à cause de sa piété, qui tendait vers elle de toutes ses forces, murmurait son nom comme on murmure le nom de son bien-aimé et se préparait si ce n’est à une vraie rencontre avec elle au moins à un bref rendez-vous – elle monterait au deuxième étage de la Grande Synagogue, marmonnerait une prière, et le Seigneur l’entendrait, pardonnerait tous ses péchés, balaierait son vieil âge comme on souffle sur une bougie et lui rendrait sa jeunesse. Mais son rêve n’était pas destiné à s’accomplir. Comme n’étaient pas destinés à s’accomplir les rêves de ses congénères et compatriotes, modestes ouvriers à qui la chance souriait peu – poissonniers, accoucheuses, tailleurs et cordonniers, selliers et menuisiers, commerçants et forgerons, ayant fait le tour entier de la terre par la volonté du Tout-Puissant, ou celle du Diable.
Je ne peux dire à ma grand-mère, la fiancée de Dieu, la vérité sur la Grande Synagogue. Je ne peux la dire à aucun des plus de deux cent mille Juifs morts pendant le Seconde Guerre mondiale en Lituanie, – ni au nourrisson jeté vivant dans la fosse, ni au vieil homme murmurant dans ou sous le feu le Shema Yisrael appris par cœur depuis l’enfance ! Les morts, comme les vivants, ne croient pas en une vérité qui ne leur laisse aucun espoir. Comment ça, il n’y a plus de Grande Synagogue ? Qui a dit qu’il n’en restait plus une trace ? Le Messie viendra, et nous, les morts, nous levant de nos tombes, serons les premiers à nous dépêcher d’y aller prier… ! Elle, ma grand-mère, longtemps avant le massacre inouï, la monstrueuse faucheuse qui ne laissa dans les petits lieux de Lituanie pas un seul bourgeon, pas une seule pousse, pas une seule brindille sur l’Arbre d’Israël, elle ne laissait pas une poussière retomber sur ses songes, sur son rêve, sur sa ville bien-aimée. Elle brillait pour elle de tout l’éclat de son éblouissante beauté.
Avant la guerre, une seule personne de notre petit lieu avait eu l’honneur de la visiter – le balagula[7] Peisakh-Tzimes, un parent éloigné de mon grand-père.
A son retour de Wilno, ma grand-mère lui demanda :
̶ Bon, alors ? Qu’est-ce que tu en dis ?
Elle attendait de lui des mots qu’elle n’avait jamais entendus auparavant, des mots qui, en son âme tourmentée et enveloppée d’impénétrables nuages, ferait soudain fleurir un arc-en-ciel ; mais le balagula Peisakh, connaissant le tempérament de la vielle femme, tournait autour du pot, reniflait longuement en remuant la carotte rouge de son nez et se balançait d’un pied sur l’autre comme s’il se tenait non pas sur des planches en bois mais sur un radeau en pleine tempête :
̶ Une ville comme une autre. Du vacarme, de la cohue, de la boue… Des Juifs à chaque pas. Et des balagulas autant que de chiens errants.
̶ Et c’est tout ? demanda la vielle femme horrifiée.
̶ C’est tout, marmonna Peisakh avec franchise.
̶ Et la Grande Synagogue ? Et la tombe du Gaon ? Et… et… et… Tous les sons qui vivaient en elle s’étaient soudain dissipés, envolés, évanouis.
Grand-mère toussota, essayant de faire sortir de sa gorge quelque chose comme de l’étonnement ou du mépris envers Peisakh. Confus, celui-ci se mit à cligner de ses yeux de taille différente telles deux pièces de monnaie de valeur inégale et lui lança sur un ton conciliant :
̶ Tu ne me crois pas ? Va voir toi-même… ! Je peux t’emmener avec moi après Yom Kippour.
Mais là, ma grand-mère se fâcha pour de bon :
̶ Pas question ! rétorqua-t-elle.
Elle ira avec qui l’on veut, mais pas avec lui. Ni après Yom Kippour, ni à Hanoucca, jamais. Elle préférerait encore y aller à pied, seule, sans compagnon de voyage, plutôt que de s’asseoir dans sa carriole miteuse qui empestait la pisse et les peaux de bêtes.
Avec n’importe qui, mais pas avec Peisakh, pas avec ce rustre, ce glouton et ivrogne qui en dehors des tavernes, des chevaux et des routes boueuses ne voyait jamais rien ! Rien-de-rien !
Je lui suis reconnaissant pour sa colère et sa rancune – elle a sauvé mes rêves de l’avilissement, et empêché que les cales du navire, qui flottait dans nos eaux paisibles avec sa cargaison de joyaux et ses innombrables trésors, ne soient définitivement obstruées. Grâce à elle, jusqu’à ce fatidique vingt-deux juin 1941, mon enfance avait été inondée de lumière, celle de la foi et du sacré qui filtrait des fenêtres de la Grande Synagogue ; grâce à elle, mon enfance avait continué de sentir non pas la vérité des cochers, vulgaire et nauséabonde comme l’urine de cheval et les peaux de bêtes, mais l’encens des contes, qui élevaient l’âme et la transportaient vers d’autres rivages, beaux et inaccessibles ; grâce à elle, j’avais un talisman, sûr et invisible, qui me protégeait du mal et du désespoir.
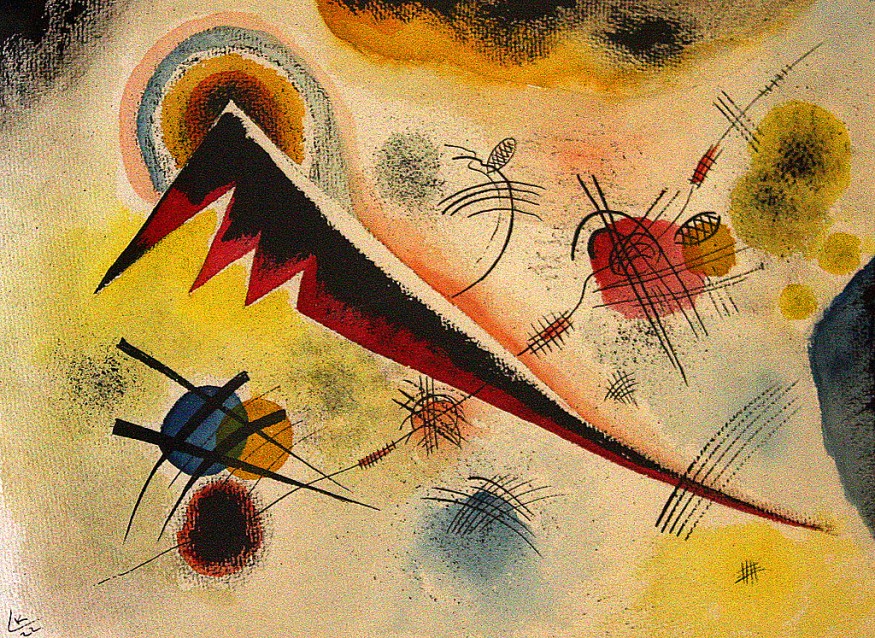
La guerre ne m’a pas séparé de la ville de mes rêves.
Elle apparaissait de moins en moins dans mes songes, il est vrai, mais la vie mettait sans cesse sur mon chemin des gens de là-bas.
̶ Je viens de Wilno. La Yerushalayim de Lita.
J’ai oublié le visage de mon voisin de couchette – déchiquetée et rugueuse, dont les aspérités s’enfonçaient comme des tiques dans mon corps décharné – dans ce train de marchandises qui filait vers l’Est, mais sa voix rauque, étouffée par le chagrin, resta pour toujours gravée dans ma mémoire.
Je ne sais pas qui était ce compagnon de voyage – peut-être était-il un boulanger qui tenait boutique en face de la Grande Synagogue, peut-être était-il un tailleur qui redressait de son art les bossus, peut-être était-il un compositeur-typographe dans un atelier qui imprimait sur du papier bon marché des abécédaires hébraïques, peut-être était-il un scribe qui transcrivait les lignes de la Torah sans commettre de toute sa longue vie aucune faute ?
On le sortit, trempé de sueur et de peine, hors du wagon de marchandises étouffant, quelque part sur un quai de gare près de Sverdlovsk ; on le déposa sur une terre étrangère et glacée, balayée avant l’heure par une tempête de neige russe qui le recouvrit de ses flocons, l’y enveloppant comme dans un linceul.
Dans le martèlement des roues impitoyables qui nous entraînaient vers l’inconnu, je répétais syllabe par syllabe :
̶ Ye-ru-sha-la-yim-de-Li-ta. Ye-ru-sha-la-yim-de-Li-ta…
Était-ce un sortilège où je délirais ? Un sortilège sans doute. Je conjurais ma peur, mon impuissance, je jetais des sorts à la tempête russe, à l’interminable étendue des vastes espaces russes, aux trains russes en approche, qui filaient sans relâche en la direction opposée, vers la guerre, et inondaient notre convoi de vapeurs chaudes de locomotive, de chants tonitruants de soldats et de vagues froides de désespoir.
En repensant à ces journées, je me surprends à penser que la mort de mon compagnon de voyage présageait quelque chose de plus grand que la disparition d’un seul être.
Ce n’est pas seulement son corps que la tempête a recouvert de neige sur ce quai de gare, elle a balayé le chemin de retour vers Yerushalayim de Lita, elle a englouti Yerushalayim de Lita elle-même ; elle a emmailloté dans son linceul ses toits en tuiles, sur lesquels les chats se promenaient comme des anges, et les anges comme des chats, ses pavés, dont chaque dalle était comme un éclat des tables de Moïse, la Grande Synagogue et son Aron Kodesh ; elle a enseveli mes rêves sous ses infranchissables congères.
Non, non, me disais-je pour me donner du courage, aucune tempête au monde ne pouvait engloutir la ville vers laquelle tendaient les cœurs de tous les Juifs de Lituanie ; aucun vent ne pouvait noyer de son souffle l’îlot de la sagesse et de la piété juives dans les limbes de l’oubli. Elle est éternelle, elle demeurera à jamais ! Dieu, notre Seigneur miséricordieux et tout-puissant, ne laissera pas survenir une telle injustice.
J’ai honte de l’avouer, mais dans mes pensées, dans mes rêves, ce n’est pas tant auprès de mon père et de ma mère que je voulais être, qu’auprès de lui, le Tout-Puissant. Que pouvaient-ils, mes parents ? M’habiller et me nourrir, et encore pas assez. Alors que le Créateur pouvait sauver la ville de mes rêves, Il pouvait faire taire toutes les tempêtes, faire fondre toutes les congères.
̶ Got iz a tate. Dieu est notre père, sourdaient de quelque part des mots de consolation.
Qui, dans cette vaste steppe kazakhe, dans ce kishlak[8] miteux où nous vivions, ma mère et moi – si mourir tous les jours de faim c’était vivre – où même les ânes et les moutons regardaient les réfugiés juifs avec curiosité et une supériorité non feinte, comme des extraterrestres, qui aurait cru que la tempête – russe, allemande, lituanienne – serait plus forte que Dieu lui-même ?
Qui l’aurait cru ?
Mais même là, au milieu de ces steppes désolées où rodaient des chacals voraces, au-dessus desquels tournoyaient des aigles qui guettaient leur proie de leur regard acéré, même là, au pied de l’Alatau, dans une bicoque enfumée, brillait encore le précieux joyau décroché de la couronne de l’Yerushalayim de Lita.
Dans cette bicoque vivait Aron Grinblat, diplômé de l’École supérieure d’économie de Zurich, qui travaillait au service de trésorerie du kolkhoze comme simple comptable. À l’époque, dans les campagnes kazakhes, les comptables étaient aussi rares que les astrologues. Comme il s’était avéré plus tard, Grinblat n’était ni comptable ni astrologue.
Avant la guerre, Aron Itzikovich, un homme calme et pieux, travaillait à la Banque juive de Wilno. Le seul signe qui trahissait son érudition et sa piété était la kippa noire élimée dont il ne se séparait jamais – même par de fortes chaleurs – et que le président du kolkhoze Nursultan prenait naïvement pour une tubeteika[9].
Nursultan lui avait plus d’une fois proposé une nouvelle, colorée, faite d’un meilleur tissu, mais Aron refusait obstinément ce cadeau.
Le président du kolkhoze lui pardonnait une autre bizarrerie. Le soir, Aron Grinblat rassemblait les enfants de réfugiés qui fréquentaient l’école kazakhe et leur enseignait en cachette les lettres hébraïques.
A part moi, il y avait parmi ses élèves deux garçons très appliqués qui venaient d’Ouman et de Zhmerynka, une fille originaire de Borissov et un casse-cou qui venait, je crois, de la Léningrad assiégée…
Il nous apprenait non seulement à lire et à écrire, mais aussi à respecter le shabbat et toutes les fêtes juives. L’épouse de Grinblat, Ethel, nous offrait à chacun des cadeaux pour les fêtes : des boulettes de truite et des petits pains d’orge.
Mais ce n’était pas les boulettes de truite ni les petits pains d’orge qui attiraient vers lui les enfants. Le plus gros appât étaient les histoires qu’il racontait sur Wilno, sa ville natale.
Il nous parlait de Gaon Rabbi Eliyahu, le juste parmi les justes et sage parmi les sages, de célèbres érudits et éditeurs juifs, de poètes ayant chanté Yerushalayim de Lita et de riches qui lui avaient accordé leur grâce. Leurs noms résonnaient dans la bicoque exigüe tels des noms d’étoiles – tout autour de nous s’éclairait et au-dessus de chacune de nos têtes apparaissait un halo de cette lumière invisible ; les fenêtres ouvraient non plus sur le kishlak avec ses huttes en terre crue, mais sur la ville où lui, Aron, était né et où, pensait-il, pas une seule trace de la pensée juive, des pas juifs, de la sculpture juive, de voix juives, ne pourrait jamais disparaître.
Quant à moi, je voyais en l’être sec et dissipé qu’était Grinblat, qui parlait couramment cinq langues, non pas un comptable du kolkhoze, ni même un connaisseur de la Torah, mais une sorte de substitut de Dieu dans cette steppe kazakhe inhospitalière. J’étais persuadé qu’il allait retourner dans son Yerushalayim et que nous pourrions, peut-être, y retourner avec lui, si ce n’est en réalité, du moins en rêve. En rêve, le chemin est toujours plus court.
Mais lorsque nous avons déménagé dans l’Oural, ma mère et moi, j’ai appris grâce à une lettre envoyée par Anna Kharina, chez qui nous logions, que Grinblat était décédé.
Comme l’écrivait Kharina, personne ne savait de quoi exactement il était mort. Certains disaient qu’il s’était suicidé, d’autres affirmaient que son cœur s’était arrêté subitement. Il allait rejoindre sa maison, Wilno, Yerushalayim de Lita, et il s’est brusquement arrêté.
Bientôt, écrivait Kharina, Ethel est décédée, elle aussi.
Ils ont été enterrés derrière le kishlak, là où les jardins devenaient des steppes de chacals.
Le président Nursultan en personne a prononcé un discours sur sa tombe.
En homme pieux, Grinblat, aurait bien sûr préféré entendre le kaddish. Mais personne ne pouvait dire le kaddish : il n’y avait pas un seul homme juif dans le kolkhoze.
Ce jour-là, dans la petite ville minière d’Emazhelinskie Kopi, en lisant la lettre d’Anna Kharina, je suis devenu, je crois, adulte.
Ce jour-là, j’ai été envahi par de terribles doutes.
Était-ce seulement pour le comptable et enseignant Aron Grinblat qu’il fallait prononcer la prière du deuil ?
Devait-on aussi dire le kaddish pour mes rêves ?
Et si… ?
Mais, comme nous le répétait souvent mon grand-père : gare à vous si vous enterrez à voix haute ce qui est encore vivant. Prononcez le kaddish et le malheur frappera aussitôt à vos portes.
Je suis arrivé à Wilno au début de l’année 1945. Février touchait à sa fin. Il neigeait sans arrêt, abondamment, et la ville recouverte de son manteau blanc ressemblait à un malade allongé sur de hauts oreillers, rembourrés de plumes d’oie.
Des maisons aux toits arrachés ; des rues éventrées par les lourdes chenilles des chars ; des grappes de soldats de l’Armée Rouge en manteaux raidis par le gel, la shapka tirée sur le front ; de rares passants avec des miches de pain sous le bras ; un cocher solitaire attendant son passager devant la gare ; un cheval remuant ses larges oreilles en feuille de parchemin ; des clochers d’église trouant le ciel couvert de nuages de plomb ; et des fenêtres, des fenêtres, des fenêtres aux vitres brisées, sans rideaux, sans visages, sans voix ; une pancarte cabossée en allemand avec des lettres à peine lisibles… Tout était étranger, obscur, tout inspirait la peur et la suspicion.
L’œil cherchait inutilement un trait, un détail, l’oreille tentait en vain d’attraper un quelconque son qui relierait la ville à celle dont j’avais tant entendu parler et qui avait habité mes rêves d’enfant.
Est-ce vraiment elle, est-ce vraiment Yerushalayim de Lita ?
Est-ce dans cette ville que ma tante Hava, la vieille fille, trouvera son promis ?
Est-ce dans cette ville que le boulanger Rakhmiel ouvrira une pâtisserie en face de la Grande Synagogue, où le Tout-Puissant lui-même viendra chaque matin goûter les si légers feuilletés au pavot, semblables à des papillons ?
Est-ce dans cette ville que l’oncle Leyser sera enterré près de la tombe de Rabbi Eliyahu, le sage des sages ?
Où est-elle, la Grande Synagogue ?
Où est-il, le cimetière où reposent les cendres du Gaon ?
Où sont-ils, les Leyser, les Hava, les Rakhmiel, les Shimshon, les Motele, où sont-ils, les garçons et les filles aux noms mélodieux de rois et de reines – Judith et Ruth, Solomon et David ?
Autour il n’y a que de la neige, de la neige, de la neige.
Ma mère m’a peut-être amené au mauvais endroit ? Peut-être sommes-nous arrivés dans une toute autre ville, ordinaire, banale, maussade et non pas à Wilno, non pas à Yerushalayim de Lita ? Peut-être avons-nous, dans la hâte, pris des billets dans le mauvais sens ?
̶ Dans le bon, répondit ma mère.
̶ Oui… Mais où sont… ? Où sont les… ?
̶ Qui ?
̶ Les Juifs.
̶ Les Juifs, Hirshele est là, soupira-t-elle en pointant la neige de sa main.
On ne voyait rien derrière le rideau de neige. Rien, à part des maisons grises, immobiles et silencieuses, comme des pierres tombales.

Au printemps, lorsque les arbres ont verdi, je suis allé là-bas, à Ponary[10].
L’air était pur et frais. Comme il y a cent ans, à Ponary, les oiseaux chantaient. Ils déversaient leur chant si haut et fort, avec une telle fougue, que même les morts semblaient entendre leurs joyeux piaillements. Quatre-vingt mille morts.
Parfois, les oiseaux quittaient les arbres qui sentaient encore la chair humaine brûlée, descendaient au sol, sur la terre glaise printanière, et, avec leurs petits becs, tiraient du talus un ver de terre indolent.
En les regardant, mon cœur se serrait d’horreur. Il me semblait qu’ils déterraient non pas des vers de terre, picoraient non pas des moucherons assoupis, mais les pupilles du casse-cou Haïmele ou celles de la sauvage Hannele aux yeux noirs.
Ponary c’était au printemps. Avant, il y avait la Grande Synagogue, celle où flottait l’esprit immortel de Rabbi Eliyahu et en face de laquelle le boulanger Rakhmiel rêvait d’ouvrir sa profitable boutique.
Je me tenais devant les ruines de la synagogue et je ne pouvais me départir du sentiment que l’instant d’après, dans une minute ou deux, de ce tas de gravats, de ce mélange d’éternité et de finitude, de cet amas de ferraille vaincue et impuissante s’élèvera Rabbi Eliyahu et, à pleine voix, sur toute la ville, sur toute la Lituanie, sur le monde entier, s’écriera :
̶ Juifs ! Morts et vivants ! Prenez vos barres et vos pioches, vos haches et vos burins ! Accourez de partout – depuis des villages et des villes, des maisons et des tombes ! La Grande Synagogue ne doit pas rester en ruines ! Couvreurs, posez la toiture ! Charpentiers, recouvrez le plancher de nouvelles lattes ! Vitriers, mettez des verres aux fenêtres ! Forgerons, forgez des chandeliers ! Tailleurs, façonnez des talits ! C’est bientôt la fête de Pessah ! La fête de la sortie d’Égypte, la fête de la libération ! Dépêchez-vous, dépêchez-vous, car il n’y a pas de plus grande servitude que l’oubli et la perte de mémoire !
Hélas, ne sont venus ni les couvreurs, ni les tailleurs, ni les forgerons, ni les charpentiers.
Les vivants regardaient les ruines et passaient leur chemin. Personne ne ramassait une poignée de gravats pour les émietter dans sa paume et les parsemer, comme des cendres, au-dessus de sa tête.
L’esclavage soviétique surpassait l’égyptien.
Pendant mes années d’études, comme beaucoup de mes camarades, j’ai aidé à la reconstruction de la ville, j’ai déblayé des routes, défriché des parcs, planté des arbres.
La clémence des vainqueurs s’étendait à tout, sauf au patrimoine juif.
Dans les yeshivas, où de jeunes Maïmonide s’efforçaient depuis des siècles de percer le mystère de la création et du destin de l’Homme, où dans les vignes des hébreux naissait la vérité, avaient élu domicile des institutions soviétiques, employées à recueillir non pas des révélations sur les voies de l’humanité, mais des matériaux de recyclage.
Dans les écoles juives régnaient en maîtres des fonctionnaires anonymes et bornés, qui délivraient des passeports à faucille et marteau ou agrafaient des feuillets aux dossiers personnels des citoyens non-fiables, semi-fiables et fiables.
Les imprimeurs, renommés dans les années d’avant-guerre dans tout le monde juif, publiaient désormais de misérables copies de la Pravda[11] moscovite et du journal Le Communiste, des bulletins de vote qui ne laissait aucun choix et les « grandes œuvres du génie de tous les temps et de tous les peuples » Joseph Staline.
Dans ce brouillard qui s’était épaissi au-dessus de Yerushalayim de Lita, miroitaient toujours un orphelinat juif, qui avait accueilli les enfants ayant réchappé au récent massacre, et une école juive dans laquelle résonnaient encore les lettres d’un alphabet millénaire ; dans l’ancienne prison, que les Allemands avaient créé dans le ghetto, il subsistait un musée juif condamné à une disparition imminente, qui comptait parmi les œuvres exposées non seulement des documents d’archive mais le directeur Gudkovich lui-même et ses quelques collaborateurs.
J’ai vécu à Vilnius pendant près de cinquante ans et j’ai pu encore apercevoir les lambeaux de la ville qui avait peuplé mes rêves, les traces de l’authentique Yerushalayim de Lita, j’ai pu surprendre les éclats de son esprit altier et inébranlable.
Presque entièrement russifiés, parlant un yiddish défiguré par l’exil, ballottés par le tumulte de la guerre vers d’autres royaumes, où le mot « juif » recelait toutes les connaissances sur notre peuple, nous, sa jeune progéniture glacée et affamée, nous courions les soirées littéraires juives, accueillions avec enthousiasme des invités de Moscou – Peretz Markish et Aron Kushnirov – et étions fiers d’avoir pour compatriotes des poètes aussi remarquables qu’Avrom Sutzkever et Hirsh Osherovitsh.
Je ne pourrais jamais effacer de ma mémoire l’impression incomparable que j’avais ressentie lors de la lecture du poème de Sutzkever, Kol-Nidre, par mon oncle – le tailleur pour dames Motl Kanovich. Dans sa maison, avenue Staline, s’étaient réunis tous les amateurs de théâtre et de littérature juive : l’érudit, majestueux tel un empereur romain et légèrement sourd, professeur Rozentalis ; le tailleur Doghim, abrupt comme une sirène de pompiers et à la peau si noire qu’elle paraissait maculée de charbon ; le discret comptable Upnitsky qui, partout où il se trouvât, continuait de compter et de vérifier quelque chose. L’oncle Motl, frêle et souriant (les tailleurs pour dame avaient le sourire dans le sang) lisait, avec une expression de passion qui ne lui était pas naturelle, le poème qui venait tout juste d’être publié. Le petit salon où avait lieu la lecture rappelait le parterre d’un amphithéâtre grec, et le lecteur évoquait non pas un tailleur mais un oracle antique.
Le son de sa voix faisait trembler l’air dans la pièce, la liqueur de cerise tremblait dans la carafe, les flûtes en cristal tremblaient comme des lys, nos âmes tremblaient. Des larmes coulaient sur les joues des auditeurs restés muets.
Moi aussi, je pleurais, sans vraiment comprendre pourquoi.
Il y avait en ces temps suffisamment de larmes, et la poésie n’en était pas la seule raison. Chaque nouvelle année apportait son lot de nouveaux malheurs.
Arriva la terrible année 1953, qui menaçait tous les Juifs de déportation en Sibérie. Dans les maisons juives on faisait sécher des croûtes de pain pour la route. Des maisons juives, on sortait tels des défunts les livres juifs. En hâte, à la nuit tombée, sur un terrain vague non loin de la prison de Lukiškis, nos voisins terrifiés brûlaient tout ce qui était juif, à commencer par l’innocent Mapu au bel esprit et jusqu’au renfrogné et austère David Bergelson.
Seize volumes de l’Encyclopédie juive prérévolutionnaire étaient emportés dans la nuit tels seize cercueils.
Des bûchers allumés pour effacer les potentiels indices, éliminer les preuves matérielles de culpabilité, même si la faute était l’appartenance même au peuple juif, le fait même d’être né sous un toit juif.
La fumée de ces bûchers planait au-dessus de ma jeunesse, empoisonnant mon souffle et mon Avenir. Y a-t-il quelque chose de pire qu’un Avenir brûlé par la peur et l’humiliation ?
Je ne réalisais pas encore pleinement que ce n’était pas le papier qui brûlait, mais la ville de mes rêves, Yerushalayim de Lita, et que je n’étais moi-même rien qu’un charbon de bois, au mieux un tison qui couvait encore.
Combien en restait-il ? Combien se sont éteint dans le vent ?
Parfois, ils faisaient naître des étoiles, telle Nechama Lifshitsaite. Mais les étoiles ne s’attardaient pas longtemps en ce firmament, car il était sans cesse obscurci par des nuages.
Commença l’exil. Pénible mais inéluctable.
La ville de mes rêves, Yerushalayim de Lita, rétrécissait comme peau de chagrin.
Avec une volonté et une obstination dignes des Maccabées, les Juifs se précipitaient à l’OVIR[12], au bureau des visas et de l’enregistrement, comme il le faisaient autrefois pour le service religieux de la Grande Synagogue.
L’unique lieu de rencontre, et le plus convoité, était le quai de la gare de Vilnius, où le mazout et la boue se disputaient les crevasses ; le premier des chemins, comme disaient les cheminots, et le plus sûr, ajoutaient les Juifs.
Le chemin de Yerushalayim de Lita jusqu’à la vraie Jérusalem, l’éternelle et l’irremplaçable.
Au milieu des années 1970, j’accompagnais à la gare un vieil ami. Tandis qu’il montait les marches du wagon, j’attirai son attention sur le numéro « 0 ».
Wagon zéro, mention zéro.
̶ Et alors, qu’est-ce ça peut faire, que ce soit un zéro ? répondit-il calmement. Dès que nous serons arrivés, il y aura une unité devant le zéro.
̶ Quelle unité ? lui demandai-je, curieux.
̶ Celle de la patrie. L’unité suprême de mesure pour tous les Juifs.
Je ne sais s’il a été comblé par cette unité, lui, si prompt à idéaliser l’objet de son désir, ou si, plus tard, il en a été amèrement déçu, mais alors, sur ce quai de gare, où des jeunes hommes dansaient la hora avec fougue, sa réponse semblait plus que convaincante.
̶ On ne vit pas avec des fantômes. Aussi beaux qu’ils soient, un jour ou l’autre les rêves prennent fin.
Comment n’y avais-je pas pensé ? Car mon ami avait sans doute raison : celui qui vit parmi des fantômes, petit à petit se transforme lui-même en fantôme. La Grande Synagogue est un fantôme, le musée juif est un fantôme, les maisons sont des fantômes.
Des fantômes dans le passé, des fantômes dans le présent, et aussi, peut-être, dans le futur. La tante Hava, le boulanger Rakhmiel, l’oncle Motl lisant avec passion et soupirs le Kol-Nidre, le sage des sages Gaon Eliyahu, la veuve Romm…
Même l’être le plus proche de moi, mon père, tailleur par la grâce de Dieu, qui a vêtu la moitié de la ville, s’est soudainement transformé en fantôme.
Tous les jours – tant qu’il pouvait encore se déplacer seul, à ses plus de quatre-vingt malheurs (il appelait ainsi ses années) –, à l’aube, il partait chasser.
̶ Où vas-tu ? lui demandais-je.
Et il me répondait avec sérieux :
̶ Je vais essayer d’attraper un Juif.
Il les « attrapait » au jardin Bernardinskii ; sur la place qui – jusqu’à la déclaration d’indépendance – portait encore le nom de l’immortel Lénine ; sur les rives de la Vilia ; près du nouveau bureau central de poste.
̶ Hier, j’en ai attrapé deux, se vantait-il. L’orfèvre Sholem et le cordonnier… quel est son nom… Neeson.
̶ Et avant-hier ?
̶ Avant-hier, un seul. Le coiffeur Menashe. Sa fille a une Jigouli[13]. Elle a promis de nous amener au cimetière. Au cimetière, il y a beaucoup de Juifs le dimanche… ils errent… ils regardent…
Certains jours, il n’en attrapait aucun. Alors, mon père rentrait à la maison triste, taciturne, plein de ressentiment envers son vieil âge, envers son destin, envers le monde entier.
Le butin diminuait de jour en jour. L’orfèvre Sholem est parti avec ses enfants, le cordonnier Neeson a fait une demande de visa.
Et mon père avait besoin d’au moins un Juif – qu’il ait le même âge ou non, ça n’avait aucune importance. L’essentiel était de trouver un banc libre au jardin Bernardinskii, de s’y asseoir et de plonger dans le chaleureux flot des souvenirs. Et se souvenir, se souvenir, se souvenir : la bar-mitsvah, le mariage, le service militaire dans l’armée lituanienne, polonaise, russe… La Fête de la victoire à Tilsit ou à Lublin…
Aujourd’hui encore, sans doute, des vieillards tel mon père Salomon y errent, à travers des places et des parcs, des quais et des sous-bois.
Ils errent et ne retrouvent pas ce qui a été, ni ce qui n’a pas été. Épuisés, oubliés de Dieu, ils s’endorment malgré eux sous les tilleuls et les érables. Eux aussi, tout comme moi, rêvent de Yerushalayim de Lita, de la ville dans laquelle ils sont nés et dont ils avaient entendu parler dans leur lointaine enfance.
Il ne faut pas les réveiller. Ils n’ont plus assez de forces pour vivre dans la réalité, et il ne leur en reste plus beaucoup pour vivre dans les rêves.
Il n’est pas convenable de dire la prière du deuil – le kaddish – pour la ville. Surtout s’il y reste ne serait-ce qu’un seul Juif, jeune ou vieux, éveillé ou endormi.
Je ne veux pas enterrer ses rues et ruelles, étroites comme des fils, sur lesquels séchait depuis des siècles du linge juif – j’y étends mon amertume et ma tristesse ; je ne veux pas enterrer ses toits en tuiles, sur lesquels les chats se promenaient comme des anges, et les anges comme des chats – je monte en leur sommet fredonner mon amour pour ce ciel, pour cette lune qui a brillé pour des générations de mes frères et sœurs ; je ne veux pas enterrer ses pavés, dont chaque dalle était comme un éclat des tables de Moïse – j’y emmure ma pierre de mémoire, qui brûlera chacun de nos pas et nous rappellera le Massacre, l’anéantissement des milliers et des milliers de vies innocentes.
Je ne veux pas enterrer la Grande Synagogue – je prierai toujours en son sein, et tant que je prierai, personne ne l’effacera de la face de la terre, car la face de la terre c’est mon visage et le tien.
Je ne veux pas enterrer mes rêves.
Qui a dit qu’ils se dissipaient au premier rayon de soleil ? Ils sont le seul soleil pour ceux qui ont perdu ce qu’ils aimaient.
Kfar Saba, 1994
Gregory Kanovitch
Traduction originale du russe par Elena Guritanu
Notes
| 1 | En yiddish : Kugel ! Bagels chauds ! Poisson frais ! [NdT] |
| 2 | Plat traditionnel populaire dans le nord-est de la Pologne [NdT] |
| 3 | En yiddish : conte, racontar. [NdT] |
| 4 | Dais nuptial juif. [NdT] |
| 5 | Bain traditionnel russe. [NdT] |
| 6 | Ici : bedeau, assistant du rabbin. [NdT] |
| 7 | Du yiddish « balagole », cocher. [NdT] |
| 8 | Villages habités par des peuples turcs semi-nomades en Asie centrale et en Azerbaïdjan. [NdT] |
| 9 | Calotte traditionnelle en Asie centrale. [NdT] |
| 10 | Quartier périphérique de Wilno, situé en bordure de la forêt de Ponary, où, entre 1941 et 1944, les nazis avaient perpétré des exécutions de masse, dont les victimes furent principalement les Juifs lituaniens. [NdT] |
| 11 | En russe : « La Vérité ». [NdT] |
| 12 | En russe : ОВИР – Oтдел выдачи виз и регистрации. [NdT] |
| 13 | Première automobile fabriquée par le constructeur russe Lada, produite en Union soviétique entre 1970 et 1988 [NdT]. |










