Dialogue entre Ivan Segré & Gérard Bensussan
Suite de l’entretien d’Avishag Zafrani avec les philosophes Gérard Bensussan et Ivan Segré sur les usages politiques de la tradition juive au sein de la tradition révolutionnaire moderne. Comment penser les processus de sécularisation d’éléments de la tradition prophétiques ou messianiques à l’œuvre à l’extrême gauche, et leur participation aux idées d’émancipation et de rédemption du monde ? Pourquoi cette permanence d’une pulsion théologico-politique dans le contexte de notre modernité politique européenne ?

Avishag Zafrani : Dans quelle mesure la loi mosaïque, ou la dynamique de l’alliance, se distinguent-t-elles du contractualisme issu de la modernité politique européenne – quand bien même, ainsi que vous l’avez montré, elle fait office de paradigme chez Hobbes, Spinoza, mais aussi Rousseau ? Pourquoi n’en « finissons-nous pas avec le complexe théologico-politique », qu’est-ce qui échoue à se désarticuler ?
Gérard Bensussan : Ces vicissitudes, en particulier tout ce qui concerne la vie politique et la répartition des forces politiques en Israël aujourd’hui, illustrent bien la thèse selon laquelle le sionisme sanctionne le retour, ou plutôt le surgissement, du théologico-politique dans le judaïsme – il est le théologico-politique juif. Et c’est à ce titre qu’il rencontre la question du politique, c’est-à-dire la question de la démocratie, de la politique telle qu’elle se configure et se pratique depuis une liberté existentielle, ontologique, « infrastructure des infrastructures » disait Vassili Grossmann pour répondre à la thèse marxiste dans sa langue même. Ce que j’appelle ici démocratie – je suis obligé d’en passer par une petite digression parce que le sionisme relève de ces déterminations générales – c’est un mode d’exister, une pratique. Elle ne se réduit pas à un ensemble institutionnel de règles de droit ou à une donnée de fait, ou de nature. L’existence démocratique précède l’essence de la démocratie, en quelque sorte. Comme forme d’existence, la démocratie autorise la constitution d’un espace singulier au-delà d’elle-même, au-delà de la politique proprement dite. Elle est le régime où la non-politique excède, ou pourra excéder, la politique. On lui reproche parfois son abstraction, son formalisme, comme le font les critiques communistes – mais pas seulement elles, toutes les contestations « radicales » de ses insuffisances. Mais cela tient aux limites qu’elle assigne à son propre champ d’exercice. Elle détermine un partage d’existence, un lieu commun, « tous ensemble dans un lieu » disait Levinas, ce qu’on appelle aujourd’hui le vivre-ensemble. Mais ce faisant elle désigne, au-delà de soi, un impartageable, tout ce qui dans nos existences ne saurait être commun ou partageable. Ainsi considérée, la démocratie constitue la forme contemporaine, et fragile, de notre rapport à la politique. Elle a toujours à en passer par des médiations, des compromis, des négociations – entre le commun partagé et l’impartageable, par des formes diverses et aléatoires d’une transaction entre des pôles conflictuels. La politique démocratique s’exerce sans cesse à médier entre la vérité et le grand nombre, pour reprendre les mots de Tocqueville.
Le sionisme est confronté dans sa spécificité irréductible au même dilemme, autrement articulé. La démocratie – c’est le sens de ce qu’on a appelé de façon sûrement trop lâche, trop vaste, la sécularisation – entend ou voudrait se fonder sur des « valeurs », « humanistes », tout en se pensant et en se pratiquant comme immanence radicale dépouillée de toute référence à une autorité extérieure, transcendante. Cet écart est la figure par où persiste le « théologico-politique », d’une certaine façon, et pour répondre sommairement à votre question. Il ne faut pas songer à le combler, cet écart, ou alors c’est le pire qui advient, une immanence déguisée en transcendance ou une transcendance grimée en immanence. L’écart donne la mesure démocratique de la politique.
La création de l’État d’Israël, puis la vie même de cet État confronté à la revendication d’une autre existence démocratique que la sienne, celle des Palestiniens, ont engagé par la force des choses un ressourcement de la pensée politique, traditionnellement et légitimement rapportée à son origine grecque, du côté de l’Alliance. Il est frappant de voir à quel point il y a là, dans l’Alliance contractée au Sinaï, une ressource de pensée – mais aussi un modèle transposable. Ce serait beaucoup trop long d’en exposer les considérants, et puis d’autres l’ont fait avec compétence. Ce qui m’intéresse, c’est la comparaison suggérée entre l’Alliance et le Contrat, ce qui les approprie et ce qui les sépare, par où bien sûr on retrouverait la question de la « transcendance » – je parle en grec, comme tout le monde en ces domaines. Dans tous les débats du XVIIe siècle sur la république des Hébreux, on disait de l’Alliance qu’elle était justement un « contrat divin ».

Avishag Zafrani : Comment l’Alliance trouve-t-elle ses ressources démocratiques possibles, à partir de quelles notions qui appartiendraient à son histoire ?
Gérard Bensussan : L’Alliance au Sinaï, la Brit, est précédée d’autres alliances ou pactes, avec Abraham, avec Noé, et elle sera suivie par d’autres alliances ou renouvelée, en particulier par la reviviscence prophétique. Elle constitue la forme unique et multipliée dans laquelle Dieu parle aux hommes, et les hommes à Dieu, dans laquelle ils parlementent et décident. La parole, comme parole d’alliance, constitue le pont qui sans cesse franchit l’abîme de la transcendance, c’est ce que disait justement Blanchot. L’Alliance au Sinaï constitue un paradigme de ce que le judaïsme transmet, dans la forme des Dix paroles par exemple, et de façon plus précise dans le Deutéronome, Devarim. Je me souviens de ma surprise quand j’ai lu un jour, au hasard d’un texte, que Hitler, selon un propos rapporté par Rauschning, entendait mener un ultime combat, pour l’humanité disait-il, pour la « délivrer de la malédiction du Sinaï » !
Pour dire les choses très vite, trop vite mais tant pis, et nous revenons par là au tout début de notre conversation : ce qui me paraît central dans l’Alliance du Sinaï, c’est bien le souci constant, farouche, de la justice. Institution du repos hebdomadaire, abominée par Hegel, non seulement dans l’architecture du temps réglée par le travail, mais aussi dans ses répliques, de sept jours à sept ans, s’agissant de l’affranchissement des dettes, des terres, des esclaves ; des villes-refuges ; du talion au sens juridique de contre-point à la vengeance inter-individuelle ; du soin de la vie des hommes, les plus démunis surtout, les proches et les lointains, les siens et les étrangers, jusque dans les règles régissant la construction d’une maison, la détermination des poids et mesures.
L’Alliance est un paradigme politique, marqué par un plébéisme (caractéristique essentielle du judaïsme m’expliquait il y a longtemps Alexandre Derczanski[1] !) qui en démarque « l’esprit » par comparaison ou opposition avec la polis. Justice pour tous, justice tout de suite – c’est certainement ce qui fait que cet « esprit » a été revendiqué par les paysans en guerre contre les seigneurs au XVIe siècle autant que par les descendants d’esclaves en lutte pour leurs droits civiques au XXe siècle, chrétiens pourtant les uns et les autres, et de façon distordue (!), par la pensée politique occidentale. Je voudrais dire un dernier mot sur la comparaison entre Alliance et Contrat. Il me semble que l’entente de l’Alliance sur le modèle hobbesien du transfert des forces, vers Dieu comme le Souverain, et surtout la détermination de « l’État des Hébreux » comme « théocratie » dans le Traité théologico-politique ont lourdement hypothéqué, et de façon intéressée voire malveillante, la pensée de l’Alliance comme ressource du politique.
Ivan Segré : Concernant la distinction entre la loi mosaïque et le contractualisme issu de la modernité politique européenne, la réponse communément apportée, de Strauss à Castoriadis, est que la loi mosaïque relève d’une transcendance « théologique », tandis que le contractualisme relève d’une immanence « politique », ou encore « démocratique ». Et Leo Strauss a même voulu reconnaître là une opposition irréductible entre Jérusalem et Athènes. Je considère pour ma part que cette réponse obscurcit les choses, et à vrai dire les dénature, tant historiquement que conceptuellement. Du reste, on peut très bien considérer que la Bible – comme le Talmud – a été écrite par des hommes, et néanmoins reconnaître le bien-fondé de la loi mosaïque, à force d’étude talmudique, justement. Je prendrai donc les choses d’une manière très différente, tout à l’opposé de Leo Strauss, mais en complément de ce que vient de dire Gérard Bensussan, et pour introduire au vif du sujet, j’avancerai l’analogie suivante : la loi mosaïque est au contractualisme ce qu’est l’interdit de l’inceste au code de la route.
Le code de la route est une illustration acceptable du contractualisme moderne, au moins en ce sens qu’il est profane et formellement égalitaire, chaque conducteur étant l’égal d’un autre devant la loi, même s’il ne dispose pas de la même voiture ; en outre, la cohérence de cette codification assure à la fois la sécurité de tous et un bon fonctionnement du parc automobile, c’est-à-dire une circulation qui donne une liberté de mouvement individuel, moyennant les inévitables contraintes d’une vie en commun : je dois m’arrêter lorsque le feu est rouge, sans quoi c’est l’anarchie, la loi du plus fort, l’insécurité permanente et à terme une moindre liberté de mouvement pour chacun. Mais s’arrêter lorsque le feu est rouge est une norme strictement fonctionnelle qui n’a aucune portée intrinsèque au regard ce que signifie mener une vie bonne, sensée, véritablement humaine.
En revanche, l’interdit de s’unir avec sa mère n’est pas une norme fonctionnelle, c’est une loi dotée d’une portée existentielle intrinsèque puisque, comme le redécouvre et le conceptualise la psychanalyse freudienne, elle tourne le sujet du côté de la vie, tandis que la transgression de cet interdit le tourne du côté de la mort. Dans cette perspective, la loi mosaïque va s’évertuer à scruter, dans l’existence humaine, tous les cas qui peuvent se rapporter, à travers différentes médiations, à cette loi inaugurale – choisir la vie. Par exemple, si on accorde que ma jouissance ne fait pas loi, je vais devoir intégrer, dans mon rapport à la jouissance, l’existence d’autrui, et si j’en scrute les implications, cela peut conduire loin, très loin, jusqu’à des détails de l’existence quotidienne. Tout le monde est d’accord, si je reviens à l’inceste, quant à l’interdit pour un homme de coucher avec sa mère, mais reste à élucider la manière dont un interdit fondateur peut se nicher dans des relations ou des actes de l’existence sans qu’on n’ait aussitôt conscience des significations impliquées, et c’est là un des enjeux de la loi mosaïque et des discussions qu’elle soulève dans le Talmud. Et le fait que l’exposition talmudique de la loi mosaïque soit essentiellement contradictoire, et non occasionnellement, voilà qui signale précisément qu’il ne s’agit pas d’un code de la route, ou d’une régulation gouvernementale de la vie collective, puisqu’une loi dialogique, contradictoire, n’a aucune fonctionnalité : si certains interprètent le feu rouge comme une injonction de s’arrêter, tandis que d’autres l’interprètent comme l’injonction de passer, s’ensuit la pire des anarchies, en termes de circulation routière. En revanche, dans la logique existentielle, celle du Talmud, il est normal que celui qui reconnaît à tel acte, telle signification, soit conduit à l’interdire ou au contraire à le recommander dans telle ou telle situation, alors que celui qui reconnaît au même acte une autre signification sera conduit à penser et agir autrement.

Avishag Zafrani : L’interdit de la loi mosaïque établirait, à l’instar de l’interdit de l’inceste, ce qui distingue l’homme de l’animal ?
Ivan Segré : J’ai pris pour exemple l’interdit de l’inceste, parce que c’est le plus évidemment parlant, mais il en va de même pour l’interdit du meurtre, du rapt, du fait que ma jouissance ne fait pas loi, etc. Bref, ce qui est en cause dans la loi mosaïque, selon moi, c’est l’humanisation de l’animal humain, tandis que dans le contractualisme, tel que le conçoivent notamment Hobbes et, dans une moindre mesure, Spinoza, ce qui est en cause, c’est davantage un dressage de l’animal humain. Et d’ailleurs, il n’est pas jusqu’au code de la route qui ne puisse être interprété, d’une certaine manière, en termes de dressage à vocation politique et sociale.
Cela dit, qu’on se rassure : bien que me situant résolument du côté de la loi mosaïque, il n’en demeure pas moins qu’en règle générale, je m’arrête au feu rouge. On m’objectera alors : si je m’arrête au feu rouge, n’est-ce pas parce que transgresser l’interdit me tournerait du côté de la mort ? Certes, mais à entériner le bien-fondé du code de la route, reste que la relation entre cette loi – s’arrêter au feu rouge – et la question de la vie et de la mort est ici précisément accidentelle, inessentielle, ou strictement fonctionnelle, car si la voie est libre, je m’expose à la police, non à la mort, tandis que l’interdit de l’inceste, c’est intrinsèquement une question de vie ou de mort, quel que soit l’état de la route, et qu’il y ait ou non des caméras de vidéosurveillance.
Mon argument, bien sûr, présuppose qu’on m’accorde l’essentiel, à savoir que la loi mosaïque est foncièrement analogue à l’interdit de l’inceste, si ce n’est qu’elle en poursuit les implications très loin. D’autres jugeront que la religion juive est une formation culturelle particulière, faite de rites et de tabous, comme les anthropologues en connaissent tant d’autres. C’est là un autre problème, qui est au fond celui du Talmud : quelle est l’intelligibilité existentielle de la loi mosaïque ? Et si la vérité talmudique s’expose de manière essentiellement contradictoire, j’y insiste, c’est parce que son enjeu n’est pas le gouvernement des hommes, mais la relation humaine.
Je dirais donc, pour conclure, que la loi mosaïque, en un sens, c’est une manière d’en finir avec le complexe théologico-politique. Pour preuve, dans la Bible, nous l’avons dit, l’autorité gouvernementale, imbrication de transcendance et d’immanence, ou complexe théologico-politique, surgit précisément lorsque les Hébreux ne se contentent plus de la loi mosaïque et demandent à Samuel d’établir une royauté, « comme les nations ». C’est un peu comme s’ils trouvaient qu’il y a plus de commodité à obéir à un code de la route. Et le prophète de les avertir aussitôt que le prix de la sécurité et de la normalisation, ce sera l’oppression.
Avishag Zafrani : Dans un livre consacré à l’élaboration du droit nazi, l’historien Johann Chapoutot[2] montrait comment la loi mosaïque, extérieure à l’homme devenait l’ennemi de la loi de nature sur laquelle devait se fonder une juridiction totalitaire, exterminatrice. La « pulsion faisant droit » est un écho à ce que vous soulignez un peu plus haut, Gérard Bensussan, dans le propos rapporté de Rauschning. Si je prends ce détour, c’est d’une part pour interroger les conditions d’une éthique législative – dans vos termes, Ivan Segré, pensée comme « humanisation » – placée du côté d’une conversion de l’animalité ou de l’état de nature en état de droit haïssable du point de vue totalitaire. Sur quoi reposent ces conditions ? En outre, exercent-elles une limitation d’une « jouissance » mortifère tel que vous le faites apparaître et n’ont-elles pas vocation aussi à limiter l’éventuelle mutation des désirs messianiques en désirs d’apocalypses (de table rase, ou d’effondrement propices au renouvellement du monde) ? En somme, pour revenir au lien qui unirait révolution et judaïsme, n’y-a-t-il pas des éléments juridiques qui empêcheraient des reprises idéologiques de l’eschatologie ?
Gérard Bensussan : Votre question est très chargée : le droit, la révolution, le judaïsme, le « désir d’apocalypse », le contrat – bref la et le politique, la religion et le religieux, et le désir ! Telle que vous la formulez, elle évoque pour moi et convoque d’emblée, par association immédiate, le texte de Benjamin sur la violence[3], fameux mais si opaque, ambigu, énigmatique, violent lui-même au sens où il fait violence à son lecteur, salutairement. Je n’y reviens pas dans le détail, mais je voudrais seulement repartir de l’opposition entre la « violence mythique », animée par un principe directeur, le pouvoir, et la « violence divine » aimantée, elle, par la justice. Cette distinction se substitue idéalement à celle de la légitimité ou pas de telle ou telle violence. La première, la violence « mythique », est une mauvaise violence, elle a rapport au droit, soit pour le fonder soit pour le conserver, et elle combat la violence par la violence, en se réglant sur le seul rapport des forces.
La violence divine, la bonne violence, combat en revanche la violence par la justice. Mais elle ne peut le faire qu’en étant « destructrice sans limites », écrit Benjamin qui se rapporte en particulier à l’épisode biblique où Coré[4] et ses deux cent cinquante compagnons, tous ceux qui représentent et assurent institutionnellement « la domination du droit sur le vivant », je cite le texte, sont anéantis jusqu’au dernier. Comment comprendre la nature de cette violence divine ? Pourquoi et en quoi sa « pureté » s’oppose-t-elle au caractère « sanglant » de la violence mythique, ce sont les mots de Pour une critique de la violence ? Le texte n’hésite pas à défendre une hyperviolence dans l’éradication du droit et de ses porteurs, soit une violence révolutionnaire envisagée comme la plus haute manifestation de la violence « pure » parmi les hommes. Un certain nombre de ces passages, lus littéralement (mais il faut faire l’épreuve de cette littéralité), ont provoqué, chez Marcuse par exemple, un refus indigné – en particulier les développements où Benjamin s’en prend au dogme selon lequel la vie est sacrée et où il va jusqu’à y déceler le signe d’un affaiblissement de la tradition occidentale. On est loin de « l’humanisation » par la Loi, on est loin d’ailleurs de toute anthropologie. Sans compter que le judaïsme, bizarrement convoqué dans ces lignes par Benjamin, pose le choix de la vie comme un précepte éthique majeur. Qu’est-ce qui régit et ordonne la différence de régime qui sépare la violence mythique de la violence divine ? La violence divine n’est-elle pas alors plus violente encore que la violence mythique, puisqu’elle est exterminatrice, « biblique », là où la violence fondatrice de droit, mythique, n’est que régulatrice ?
Le « programme » benjaminien consiste, dans ce texte à la fois génial et très obscur, à interrompre l’état d’exception permanent que signifie et incarne la violence du droit et celle, concomitante, de l’État comme forme expresse de la domination perpétuée – d’où l’aspect restauratif et anti-progressif, au sens messianique-tikkounique, de cette pensée.
On a tenté de lire la violence divine comme une violence sans violence, en quelque sorte, une violence qui serait celle du vivant, la simple manifestation de cette justice vivante qui n’aurait jamais besoin de recourir aux moyens de la violence mythico-juridique, puisqu’elle disposerait des « moyens purs » d’une justice impérissable, révolutionnaire, messianique. Benjamin opposerait une violence-moyen qu’il faudrait condamner car elle ne serait que l’arme de toutes les dominations et de toutes les oppressions, passées, actuelles et à venir, et une violence non-violence qui serait essentiellement l’interruption de la violence-moyen par la justice. Et pourtant, elle en passe quand même par l’hyperviolence!
Je n’ai pas le temps d’entrer dans les difficultés de ce texte, je me contente ici de signaler l’une de ses apories pour mieux déterminer ce que vous appelez « des éléments juridiques qui empêcheraient des reprises idéologiques de l’eschatologie » et qui forment justement ce qui est exemplairement refusé, dans ce texte en tout cas, par Benjamin dans ses ambivalences et ses tentations, dans son vocabulaire, dans la suspension de ses choix.
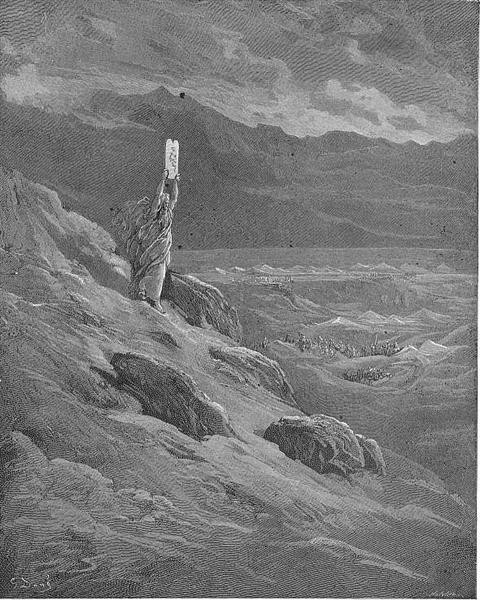
Avishag Zafrani : Comment conjure-t-on l’ambivalence d’une légitimation de la violence ?
Gérard Bensussan : Je pense qu’il faut interroger sa puissance de séduction, s’en déprendre, changer de terrain. Le critère, la mesure et la démesure du politique se règlent, aléatoirement, sur et par la démocratie comme forme d’existence. C’est vraiment la question cruciale, brûlante, qui enveloppe d’ailleurs toujours celle de la révolution, qu’elle soit pensée comme menace séditieuse ou accomplissement d’essence. La démocratie est en crise, nous dit-on, et c’est incontestable. Mais c’est parce qu’elle est la crise, sa figure expressive. Pas de démocratie sans crise, interne, immanente, sans crise et sans critique de l’immanence démocratique et sans autocritique de la démocratie. Se pose alors évidemment, dans le même mouvement, la question du droit, c’est cette question qui anime votre interrogation, si je l’ai correctement entendue, c’est elle qui hante, qui traverse tout le texte de Benjamin. Le droit, c’est la limite et la limite emporte comme chacun sait la possibilité logique de la transgression et le désir métaphysique de l’illimité. Le droit, c’est aussi l’écart, l’inachèvement, la complémentation par la jurisprudence, par l’au-delà du droit, lifnim michourat hadin, notion talmudique hautement stimulante : « Rabbi Yohanan a dit que Jérusalem n’avait été détruite que parce que les juges ont tranché strictement selon la loi, ils n’ont pas su aller au-delà du droit ». Là où il n’y a pas d’écart, y compris du droit avec lui-même, là se tient un péril. Dans Mein Kampf, Hitler écrit que l’État total à venir ne tolèrera aucune différence entre le droit et la morale, aucun écart. Ce propos contient d’avance, si on le prend au sérieux et il fut pris très au sérieux, une réserve inépuisable de violence extrême. Ce qui, là, n’est pas toléré, c’est justement la limite, l’écart, la différance[5], la non-adéquation du droit. Or c’est bien cela qui engage sa perpétuelle déconstructibilité en même temps que son adossement à l’indéconstructible de la justice. Le droit n’est pas toujours du côté de la fixité mortifère qu’y voit Benjamin, il peut le devenir s’il est gravé dans le marbre, ce qu’on dit à la fois de la loi et du tombeau. Mais il peut aussi, comme l’indique le pli du lifnim michourat hadin, anticiper sur l’expression de la justice, son exigence, son impérieuse nécessité, au sens du « il faut » lévinassien. À mon avis, bien des ressources peuvent être trouvées, pour penser la politique par-delà l’énigme benjaminienne, chez Levinas, Derrida et d’autres évidemment, avant eux, et jusqu’au Talmud en personne.
Ivan Segré : Je remercie Gérard Bensussan pour son très beau commentaire du texte de Benjamin. Cela éclaire, en passant, les réserves de Brecht. Et en effet, tout éloge de la violence, fut-elle « divine », risque de flirter avec le « fascisme ». Ceci dit, je reviens à votre question, Avishag Zafrani, laquelle soulève plusieurs problèmes importants et délicats.
Tout d’abord, concernant le nazisme, il me semble qu’il comporte au moins trois dimensions qui, pour intriquées qu’elles soient, peuvent néanmoins être distinguées : une dimension totalitaire, une dimension raciste et esclavagiste et une dimension antisémite. À ce titre, le nazisme est un phénomène pleinement civilisationnel, irréductible à une sorte de sauvagerie naturelle. Je dirais même qu’il porte à une intensité maximale certains éléments amplement attestés de la civilisation occidentale, plutôt qu’il ne ferait table rase des acquis de cette civilisation. Ensuite, concernant la manière dont l’idéologie nazie a cherché à puiser dans une prétendue « loi de la nature » une sorte de normativité valant pour la société humaine, j’observe que c’est principalement vrai dans le cas de l’eugénisme, dont Hannah Arendt s’est employée à montrer qu’il était à l’origine des chambres à gaz. Mais les politiques eugénistes, au XXe siècle, n’ont pas été l’apanage des nazis : des programmes de stérilisation forcée ont été appliqués au sein même des démocraties occidentales, depuis les Etats-Unis jusqu’en Suède. Et le darwinisme social a fleuri d’abord dans les milieux libéraux avant d’inspirer l’idéologie nazie.
Pour ce qui est maintenant d’éclaircir ce que les nazis visaient au travers des « juifs », il me paraît en effet judicieux, pour aborder cette énigme, de partir de ce que Hitler a dit et écrit à ce sujet, notamment dans son livre programmatique : Mein Kampf. Or, à le suivre, le juif est un « ferment de décomposition », c’est-à-dire un facteur de subversion et de désordre racial, social, culturel, civilisationnel, et par exemple un promoteur notoire de « l’art dégénéré », ce qui n’est pas un détail dans la biographie de Hitler, peintre conventionnel et raté. On pourrait donc renverser l’argument que vous avancez au nom de Johann Chapoutot et soutenir qu’aux yeux des nazis, c’est parce que le « juif » n’en fait qu’à sa tête qu’il faut l’éliminer afin de bâtir un empire stable, ordonné, hiérarchisé et conquérant. Rappelons-nous que dans le livre d’Esther, ce qui déclenche la colère de Hamann puis le décret d’extermination des juifs, c’est le fait que Mardochée refuse de se prosterner devant lui.
Je n’en conclus pas pour autant qu’il serait erroné d’identifier dans l’antisémitisme nazi une forme de détestation de la « loi ». Mais en quel sens du mot « loi » ? Certes, le nazisme a détesté le parlementarisme et aboli les règles du jeu démocratique dès son accession au pouvoir (paradoxalement via les urnes), de même qu’il a aussitôt mis au pas les syndicats. Mais je crois que Visconti, dans son film Les Damnés, a raison de situer les choses à un niveau plus essentiel : l’ascension du nazisme y est scrutée au cœur des relations intimes d’une famille de la haute bourgeoisie industrielle allemande, et il n’est pas anodin que l’apogée du film, en quelque sorte, soit une scène d’inceste, le personnage principal, incarnation du ressentiment nazi, violant sa propre mère.
J’en viens maintenant à votre proposition : du totalitarisme nazi, vous tirez apparemment la leçon que l’État de droit au sens parlementaire et libéral, soit le droit que Marx qualifiait de « bourgeois », est un nécessaire garde-fou, et vous observez que la loi mosaïque, entendue comme « éthique législative », pourrait jouer un rôle analogue au regard de « l’éventuelle mutation des désirs messianiques en désirs d’apocalypses ». Concernant votre prémisse, je vous accorde volontiers que le droit bourgeois est de très loin préférable au totalitarisme nazi ou stalinien, mais non sans observer qu’il a néanmoins abrité quelques folies impérialistes et esclavagistes, notamment au regard de peuples étrangers. Reste qu’en effet le fonctionnement des institutions démocratiques garantit un certain nombre de libertés dites « fondamentales » qui, quoique formelles, n’en sont pas moins précieuses. En outre, le formalisme juridique peut abriter ou entériner de réelles avancées sociales, comme il peut entériner des régressions. C’est donc un champ de bataille qui a l’avantage d’être policé, et c’est bien une normativité susceptible d’accueillir l’impératif de justice sociale.

Avishag Zafrani : En quoi la loi mosaïque s’en distingue cependant, selon vous ?
Ivan Segré : Comme je l’ai soutenu plus haut, l’enjeu du mosaïsme, Torah et Mitsvot, n’est pas la régulation formelle des rapports sociaux mais l’humanisation, c’est-à-dire l’émergence et la dynamique de la forme humaine, en hébreu : tsourat adam. Qu’il s’agisse d’une forme émergeante signifie que si notre humanité est pour une part une donnée empirique – soit le fait que les chats ne font pas des chiens -, elle est pour une autre part, plus essentielle, une œuvre à accomplir : nous avons à relayer la Création et à devenir véritablement humain, ce qui suppose sur un versant de ne pas revenir à notre animalité foncière, grégaire ou prédatrice, et ce qui exige sur un autre versant d’accoucher, en quelque sorte, de notre propre humanité. La parole inaugurale de l’histoire abrahamique, « va pour toi », est une parole d’affranchissement, Abram, qui deviendra Abraham, étant appelé à s’affranchir des déterminismes généalogiques, sociaux, idolâtres, afin de construire un nouvel horizon, celui de la « promesse ». C’est donc aussi un appel à aller à la rencontre de sa propre humanité dans un monde, ou une société, dont les valeurs ignorent ou bafouent la sublime vocation de l’être humain créé à l’image du dieu biblique. Si je passe maintenant sans transition de la Genèse au livre de l’Exode, la loi mosaïque serait donc, sur un versant, ce qui interdit de retourner en Égypte et, sur un autre versant, ce qui oriente vers une « terre promise » entendue au sens non pas tant géographique qu’existentiel, politique, poétique et métaphysique. En regard, le contractualisme, à mes yeux, ce serait plutôt une manière de rendre acceptable la vie en Égypte.
En comparaison de l’enfer totalitaire, je ne minimise pas l’avancée que représente le contractualisme, notamment dans sa version démocratique. Et vous avez donc raison de souligner ce point. Mais je maintiens néanmoins son hétérogénéité radicale avec le mosaïsme. Et c’est peut-être en ce sens qu’on peut interpréter la « violence divine » dont parle Benjamin : il s’agirait de penser le caractère irréconciliable de la société bourgeoise avec la « terre promise ». Brecht parlerait donc d’un « fascisme juif » au sujet de Benjamin. C’est peut-être juste, à certains égards. Mais c’est peut-être aussi le symptôme d’une ignorance fondamentale quant à la portée métaphysique, éthique et politique des « dix plaies » d’Égypte dans la Bible.
J’en viens enfin à votre dernière question : qu’est-ce qui peut nous préserver des reprises idéologiques, voire apocalyptiques de l’eschatologie juive ? Eh bien, je vous répondrai, pour aller à l’essentiel, que c’est l’étude de la Torah, Bible et Talmud principalement. Car il n’y a pas de meilleure manière de maintenir vivante et droite l’authentique tradition juive que d’y puiser, chacun à sa mesure, l’inspiration fondamentale d’une existence.
Gérard Bensussan : Je m’accorde en profondeur avec ce que dit Ivan Segré sur l’étude et l’existence, la Torah et la vie, c’est fondamental, et c’est à chacun qui s’y adonne de s’en faire l’humble ou l’orgueilleux puisatier. Je m’accorde pleinement aussi à ce qu’il dit sur la violence – toute violence fut-elle « divine », c’est-à-dire « pure », « révolutionnaire », nous expose au « fascisme », entendu dans un sens non exclusivement politologique bien sûr. Je pense que ce que j’ai suggéré autour de la démocratie consiste justement à tenter de parer à ce péril. À condition, à mes yeux, et c’est une condition décisive, de ne pas réduire la démocratie à une forme institutionnelle, ce qu’elle est aussi sinon elle n’est pas, à une parole abstraite, une déclaration de principes sans valeur et sans efficace. Parce que, dès lors qu’on se tient sur cette position, stérile par ailleurs, on est déjà dans un désir de surmontement de la démocratie, de type heideggérien, ou alors dans la quête d’un passage du simple formalisme bourgeois aux libertés « réelles », de type léniniste, ou encore dans le rêve d’un retour, de type maurrassien cette fois, à une certaine naturalité de la politique, contre tous les artificialismes du contrat. À chaque fois, on est déjà dans le soupçon jeté sur la démocratie – soupçon démocratiquement inévitable, voire bienvenu, mais qui a sans cesse à s’expliquer sur lui-même. C’est en ce sens que je parlais d’existence démocratique excédant, ou précédant, ses formes les plus diverses, sa formalité de droit. Resterait à se demander ce que le plébéisme juif, et ce qui s’y exprime, entre Juges et Rois, apporte à une pensée de la démocratie. J’espère que nous avons contribué, au moins, à poser cette question.
Propos recueillis par Avishag Zafrani
Gérard Bensussan est philosophe, professeur émérite à l’Université de Strasbourg. Il a enseigné dans le monde entier et il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages dont le récent « Miroirs dans la nuit. Lumières de Hegel » (Cerf, 2022). Il publiera au printemps 2023 « La transaction. Démocratie et philosophie » (PUF).
Ivan Segré est philosophe ; ses travaux portent sur le judaïsme et la philosophie classique et contemporaine; il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages dont « Judaïsme et révolution » (La Fabrique, 2014), « Les Pingouins de l’universel. Antijudaïsme, antisémitisme, antisionisme » (Lignes, 2017) et « La Souveraineté adamique. Une mystique révolutionnaire » (Amsterdam, 2022). Depuis 2015, il collabore régulièrement au site d’information alternatif LundiMatin.
Notes
| 1 | Historien et philosophe, spécialiste du monde juif d’Europe centrale, qui joua un rôle important dans le renouveau des études juives et du yiddish. |
| 2 | In La Loi du sang, penser et agir en nazi, Gallimard, paris, 2014. |
| 3 | Walter Benjamin, W. Benjamin, « Zur Kritik der Gewalt », Aufsätze, Essays, Vorträge (Gesammelte Schriften, tome II -1), Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1991, pp. 179-203 ; trad. fr. in W. Benjamin, Œuvres I, Paris, Gallimard, 2000, pp. 210-243. |
| 4 | Personnage biblique qui se rebellera contre le pouvoir détenu par Moïse et Aaron, et ce faisant, souhaitera le rendre au peuple. |
| 5 | La « différance » ne circonscrit pas un objet, elle n’est pas une notion, mais le signe d’un mouvement, d’une force décalée ou d’une dynamique à l’œuvre. |










