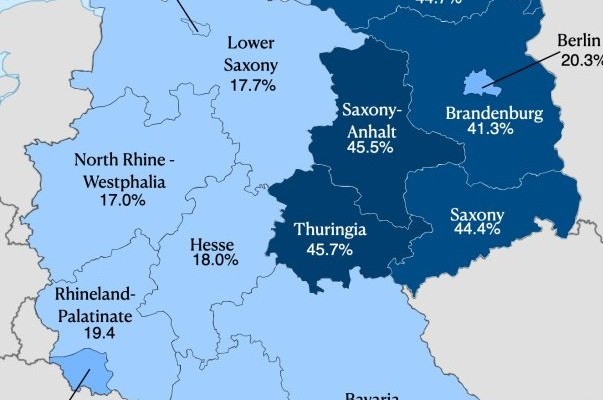À propos du nouveau gouvernement de l’État d’Israël
Comment comprendre la composition du nouveau gouvernement formé par Benjamin Netanyahou qui fait la part belle au sionisme religieux et à un nationalisme lui-même toujours davantage teinté du référent religieux ? Comment la comprendre historiquement et circonstanciellement ? Danny Trom revient sur cet événement, qui marque une rupture dans l’histoire d’Israël et du sionisme lui-même.

Le gouvernement qui vient de se former marque un infléchissement dans l’histoire politique de l’État d’Israël. En apparence, la nouveauté est toute relative. Que le Likoud en soit le parti pivot, que le parti sioniste-religieux y participe ainsi que les deux partis orthodoxes, tout cela ne constitue pas une nouveauté. Le fait marquant tient à ce qu’ils parviennent à former une coalition sans autre concours. Même si cette coalition résulte aussi mécaniquement de l’échec de deux partis à passer la barre fatidique de la représentation parlementaire — le parti héritier du Mapam (gauche travailliste) Meretz et le parti nationaliste palestinien Balad — le fait demeure : son axe trouve son épicentre au carrefour d’un sionisme religieux et d’un nationalisme lui-même toujours davantage teinté du référent religieux. Et même si cette coalition résulte aussi de l’isolement de Benjamin Netanyahou (sur qui pèse à présent l’écrasante responsabilité d’avoir légitimé une extrême droite jusqu’alors bannie) elle apparait soudée par une affinité qui la rend bien plus cohérente que la précédente qui n’avait que le rejet de la personne de Netanyahou pour critère d’unité.
Pour cerner cette affinité, il convient de caractériser brièvement les composantes de cette coalition. D’abord, le Likoud, premier parti de la Knesset, parti nationaliste mais libéral et laïc, attaché à l’État de droit, s’est mué ces dernières années en un parti populiste maniant la rhétorique du peuple contre les élites comme nous la connaissons aussi en Europe et aux États-Unis. Puis, le parti sioniste-religieux dont le poids a été majoré cette fois-ci par l’inclusion d’un parti radical de type apocalyptique, héritier plus ou moins assumé du parti de Meïr Kahane jadis déclaré illégal par la Cour suprême pour cause d’incompatibilité avec les valeurs fondamentales de l’État d’Israël. Enfin, les deux partis orthodoxes, Le judaïsme de la Tora, ashkénaze, demeuré globalement antisioniste, hostile à l’État d’Israël, mais veillant aux intérêts particuliers de la société haredi, et le Shas, parti mizrahi (juif-oriental) qui a adhéré par étapes au sionisme et a pu ainsi étendre sa base électorale à la communauté des mizrahim traditionnalistes. Tous les partis religieux, sionistes ou antisionistes, furent dans le passé des partis d’appoint dans la formation de coalitions souvent larges, alors que désormais, ensemble, ils pèsent d’un poids déterminant. Jusqu’à présent, l’inclusion du sionisme de type religieux aux coalitions passées le neutralisait peu ou prou, mais aujourd’hui il semble pouvoir donner sa pleine mesure parce que sa vision déborde le strict cadre du parti qui s’en revendique. Et puisque c’est lui dont les options inquiètent à juste titre, se pose la question de savoir ce qu’est exactement ce sionisme de facture religieuse qui imprègne une large partie de cette coalition, à l’exception du parti orthodoxe ashkénaze et de l’aile libérale du Likoud réduite à peau de chagrin.
Ce courant, ancien, a été structuré par une petite faction nommée Mizrahi (acronyme de merkaz roukhani, centre spirituel) formée au sein du Congrès sioniste dès sa fondation en 1897 par quelques rabbins dissidents, à une époque où l’ensemble de l’arc du monde juif-religieux en Europe, du judaïsme réformé au judaïsme orthodoxe, réprouvait le sionisme avec véhémence. Ce courant allait se frayer un chemin discret dans le mouvement sioniste, avant de se muer en parti politique sous le yichouv puis dans l’État d’Israël et en s’y rendant parfaitement compatible avec le courant dominant de la gauche socialiste, en participant à diverses coalitions gouvernementales menées par Ben Gourion. Organisé en un parti centriste nommé Mafdal (parti national religieux) lui-même hétérogène (intégrant l’Hapoèl Mizrahi, une aile ouvriériste positionnée à gauche), c’est pourtant de l’intérieur de ce courant que se concoctera à partir de 1967 cette version ultranationaliste du sionisme religieux qui remporte aujourd’hui assez de sièges à la Knesset pour s’imposer en partenaire principal du Likoud.

Qu’est ce qui singularise le sionisme religieux dans la configuration sioniste au sein de laquelle il fut un acteur atypique et marginal ? Le Mizrahi fut le seul parti à penser, a priori, la compatibilité de la tradition religieuse avec la politique sioniste moderne naissante. Contrairement aux autres pôles du judaïsme européen, rétifs au sionisme — soit parce qu’il contredisait le projet d’une confessionnalisation des juifs dans les nations dont ils étaient citoyens, soit parce qu’il enfreignait l’interdit traditionnel de « sauter les barrières de l’exil » — le sionisme religieux forgea une doctrine capable d’infléchir la tradition afin d’y encastrer la politique sioniste moderne : non seulement l’activisme des sionistes est compatible avec la perspective religieuse, mais elle en dit la vérité, dès lors que l’assemblement du peuple sur la terre est non seulement une aspiration du peuple lui-même mais conforme à la volonté divine.
La marginalité de ce courant se mesure à l’aune des deux grands blocs hégémoniques qui confluaient pour former le mouvement sioniste à la fin du XIXe siècle. A l’Ouest de l’Europe, le sionisme de Herzl, celui du juif émancipé, parfois assimilé, ignorant de la tradition ou n’entretenant plus qu’un rapport ténu avec cette dernière, prône une solution moderne au problème européen moderne de l’antisémitisme, par l’édification, de préférence en Palestine mais éventuellement ailleurs, d’un État pour les juifs. Cet État serait minimal, libéral, respectueux des minorités, tolérant à tous égards. A l’Est de l’Europe, le sionisme du juif, il y a peu encore inséré dans la forme de vie traditionnelle qui vacille sous l’effet de la modernisation, manifeste une révolte assumée contre une tradition religieuse réputée passive, en réalisant ici et maintenant une société juive autonome et juste dans son berceau historique. Ces deux blocs géo-historiques rompaient, chacun à sa manière, à son rythme propre, avec la tradition, avec le « ghetto », métaphore d’une communauté traditionnelle passive, sous la coupe de l’autorité des rabbins.
Le sionisme de l’Ouest ignorait tout bonnement la tradition, n’en distillait au mieux qu’un folklore biblique, et transporta en Palestine les valeurs de la démocratie parlementaire et l’ethos libéral qui lui est attenant — valeurs que l’Europe était incapable d’honorer. Le sionisme de l’Est, dans sa mouture marxiste ou socialiste-romantique, porté par un ethos révolutionnaire, reconfigurait l’attente messianique traditionnelle en impuissance et s’activa pour édifier une société politique dont les valeurs puisaient essentiellement dans les utopies émancipatrices européennes. Pris globalement, le sionisme politique est donc l’enfant de l’Europe. Il s’est édifié sur une critique moderne de la modernité politique européenne. Il ne voulait nullement s’en détacher mais plutôt en accomplir les promesses mais ailleurs.
Comment alors le sionisme religieux s’est-il insinué dans cette configuration qui a longtemps imprimé les lignes de clivages qui traversent l’Etat d’Israël, y compris après que le Likoud n’accède pour la première au pouvoir en 1977, y compris lorsque la gauche sioniste perdait progressivement son hégémonie politique acquise sous le yichouv ? Le sionisme religieux se glissa dans la configuration sioniste à partir de tout autre prémisse, capable, pensaient ses doctrinaires, d’englober le sionisme politique dans ses deux variantes modernes : il appuya les sionistes modernes qu’il se figurait comme naïfs ou aveugles, incapables de percevoir ce qu’en réalité ils accomplissaient, à savoir poser les bases concrètes de la venue de l’ère messianique. Involontairement, sans en avoir l’idée, les sionistes modernes sont, tel l’âne du messie, le véhicule qui mène à la rédemption finale (ge’oula) des juifs. Matérialistes et pragmatiques, organisant l’installation du peuple sur sa terre, ils œuvrent, malgré eux, à l’intérieur d’une histoire providentielle. Ou plutôt : la providence agit à travers le mouvement sioniste à son insu, ce qui finirait tôt ou tard par éclater au grand jour. Les sionistes-religieux sont ceux qui en sont parfaitement conscients et le rappellent à qui veut bien entendre.
Ce schème, élaboré au sein du Mizrahi, entretenu et consolidé par ses successeurs, qui perçoit dans la pratique sioniste le prodrome des temps messianiques, n’est pas, en soi, en contravention avec le sionisme politique moderne, bien qu’il lui soit globalement étranger. Car le sionisme religieux ne fait somme toute rien d’autre que recouvrir la réalisation sioniste d’un récit providentiel. Jamais les sionistes hégémoniques ne pensèrent effectivement leurs pratiques dans ces termes, si ce n’est quelquefois dans le sens imagé d’une nation en voie de restauration. Ils percevaient alors le parti sioniste-religieux comme un membre de la famille sioniste encore immature, incapable de s’affranchir complètement de la tradition et le considéraient comme une force d’appoint inoffensive. D’ailleurs, le sionisme religieux lui-même ne tira de sa construction idéologique aucune conclusion ferme. La vision rédemptrice de ce parti, perçu comme centriste, se résumait à l’édification d’une société juive, en toute tranquillité, sur la portion de territoire allouée à l’État d’Israël, certes nimbée de sacralité mais sans que cela n’entraine de volonté d’expansion. Mais dès lors que l’État d’Israël étendit sa maîtrise sur la Cisjordanie suite à la guerre des Six-jours, ce territoire fut compris comme le fruit d’une acquisition, certes involontaire et donc providentielle, un signe que la victoire de 1967 et l’occupation étaient le simple prolongement d’une entreprise sioniste inconsciente d’un plan qui la dépassait et qui a présent trouvait une confirmation éclatante.
C’est alors qu’une fraction toujours croissante du sionisme religieux bascula, d’abord sous l’impulsion des activistes du Gouch Imounim (« Bloc de la foi »), l’ancêtre du mouvement des colons. Des écrits du rav Kook, qui fut le premier grand rabbin de Palestine, on passa à ceux du rav Kook fils qui, lui, en aiguisa la pointe, dans un contexte où la Cisjordanie, désormais sous la main, devint concrètement la terre de Judée et de Samarie offerte à l’appropriation. Du schème messianique, des conséquences fermes furent désormais tirées, qui sont encore celles d’aujourd’hui. D’abord, il convient que les juifs peuplent la terre d’Israël dans les limites dessinées par la promesse biblique, cela par tous les moyens. Non pas pour des raisons de sécurité, non pas en vertu d’une contestation circonstancielle des frontières issues des accords d’Armistice de 1949, pas même sur la base d’une vision romantique nationale comme celle qui sera cultivée au sein du Likoud, mais parce que cette terre appartient, à toujours appartenu, de droit divin, au peuple juif. Ensuite, il convient de resserrer la définition du sujet-récipiendaire de cette terre autour d’un critère strictement halakhique, calé sur le droit rabbinique. Puisque dans l’horizon messianique, peuple et terre sont superposés, la sacralité de la terre est solidaire d’une conception des juifs arc-boutée sur la norme traditionnelle.
Deux demandes fermes du sionisme religieux, exprimées lors des négociations pour la conclusion d’un pacte de gouvernement, traduisent la pente dangereuse dans laquelle le nouveau gouvernement s’engage. Elles portent simultanément sur deux fronts, dont on perçoit trop peu qu’ils sont interdépendants. D’abord que des mesures de toute nature, juridiques et militaires, soient engagées afin que le statut des territoires, occupés et par pans entiers déjà peuplés de juifs, soit fluidifié en vue de préparer à moyen terme leur annexion pure et simple. Ensuite que la Loi du retour soit réservée aux juifs dans leur définition strictement halakhique préemptée par le rabbinat orthodoxe, ce qui suppose l’abrogation de la clause dite des petits-enfants qui, depuis que la Loi du retour fut adoptée en 1950 et amendée en 1970, compte une part maximale des juifs de la diaspora comme bénéficiaire d’une entrée dans l’État et d’une acquisition immédiate de la citoyenneté israélienne.
Disons-le nettement : ces deux orientations contreviennent catégoriquement à l’esprit du sionisme, tel que l’histoire nous l’a légué, au risque d’altérer durablement la forme même de l’État d’Israël dont il est le produit. La terre y fut toujours un bien impérieux mais relatif. Avant que l’État d’Israël n’advienne, le périmètre de la future entité politique juive était fonction du peuplement à une époque où la Palestine n’était pas encore traversée par la logique stato-nationale. La possession de la terre y était strictement corrélée à la majorité numérique et au travail productif, elle n’était jamais pensée comme une propriété de droit divin. Et le peuple y était conçu comme l’ensemble des juifs, tels qu’ils vivaient empiriquement en Europe ou ailleurs, qu’ils soient émancipés ou pas, assimilés ou insérés dans le monde de la tradition. La Loi du retour réfracte cette appréhension des juifs en refusant de faire de « juif » un désignateur rigide, laissant sa définition en suspens pour faire de l’État d’Israël non pas un État juif mais un État pour les juifs, un refuge destiné à une population qui s’éprouve et qui est désignée telle, peu importe la dialectique.
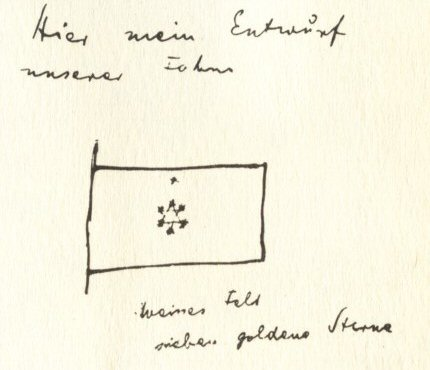
Le sionisme religieux, dans la mouture messianique-nationale qui semble aujourd’hui emporter une première grande victoire déchire le consensus sioniste moderne ou du moins dévoile une potentialité qui était tapie en lui, tel un fauve endormi. Son réveil est multifactoriel : pèsent à l’évidence les dynamiques politiques et démographiques de la société juive israélienne, mais aussi l’effondrement des espoirs d’une paix de compromis avec les Palestiniens ; pèse le recul inexorable de la gauche sioniste qui, comme en Europe, a délaissé la justice sociale pour se centrer sur des revendications libérales-identitaires ; pèse d’un poids important la violence endémique dans les territoires occupés et surtout celle, intracommunautaire, qui éclate sporadiquement à l’intérieur de l’Etat d’Israël. Mais c’est de toute évidence la guerre des Six-jours — guerre préventive qui ne fut pas voulue par l’État d’Israël — qui appuya sur la queue du lion assoupi. Depuis, il ne cesse de rugir. Il ambitionne de dire enfin la vérité du sionisme, si possible en dévorant cette fois-ci l’agneau innocent qui crut être l’héritier de l’Europe, qui crut édifier une société moderne, voire un État moderne débarrassé de ses scories. Sorti de son sommeil et ragaillardi par l’hostilité à laquelle l’État d’Israël fit face en 1967 — une hostilité qui depuis ne s’est jamais complètement démentie — le sionisme religieux projette de détacher l’État d’Israël de la dynamique historique des juifs telle qu’elle s’est déployée dans la modernité européenne et hors de laquelle la proposition sioniste n’eut pas même pu se formuler.
Voilà la question que soulèvent les dernières élections législatives, si l’on admet que la poussée du sionisme religieux nationaliste, désormais arc-bouté sur le culte de la puissance de l’État et incluant une faction xénophobe, ultra-sécuritaire et réactionnaire, en constitue l’événement le plus significatif. Est-il possible qu’un jour l’Etat d’Israël se révolte contre le sionisme politique moderne qui l’a pourtant enfanté ? Est-il possible que, dans la foulée, l’État d’Israël se détourne de la diaspora comme un enfant se détourne de ses parents ? Jusqu’à présent nous préférions fermer les yeux, ne pas y penser, mais dorénavant, oui, cette éventualité ne pourra plus quitter nos esprits. Car désormais le récit providentiel-messianique, auquel nous ne prêtions qu’une attention distraite, n’est plus encapsulé dans une idéologie marginale, il a pénétré de larges couches de l’électorat en s’amalgamant à une crispation nationaliste, comme si le sionisme religieux remportait toute la mise dans un jeu où il n’était jadis, il n’y pas si longtemps, qu’un joueur excentrique. Il menace de tout évidence l’esprit libéral auquel le sionisme doit un État de droit le plus solide qui soit, un État refuge dont la vocation est l’accueil des juifs par temps mauvais, et un État prêt au compromis territorial dès lors que sa sécurité est assurée.
La vague populiste que le sionisme-religieux capte à son profit est-elle en mesure d’effacer d’un trait la sagesse politique accumulée par les juifs le long de leur exil et que le sionisme put, à sa manière, recueillir ? Nous n’en sommes pas là, disent les voix les plus rassurantes, mais cette éventualité se rapproche. Au bord de l’abîme, nous sommes pris de vertige. Chaque juif, qu’il le veuille ou non, aussi critique soit-il du sionisme et de la politique de l’État d’Israël, sent ce qu’il lui doit à défaut de toujours le savoir : la tranquillité existentielle que confère un État destiné aux juifs. À condition que cet État continue de remplir la fonction que nous, juifs d’Europe, ses parents, lui avons confiée.