Dans un monde où l’impuissance collective ébranle les démocraties et nourrit les populismes, le recours au « passage à l’acte » devient tentant. Faust, le personnage emblématique de Goethe, et Walter White, le héros de Breaking Bad, incarnent cette fuite en avant : lorsque la compréhension échoue, la destruction et la refondation s’imposent. Mais dans ces récits de la puissance retrouvée, une figure juive surgit souvent en filigrane, accompagnant l’élan destructeur ou endossant la faute. Dans les moments où la modernité craque, que devient alors la minorité juive, se demande la philosophe Julia Christ ? Alors que nos sociétés écoutent les sirènes des solutions immédiates, elle rappelle que seule une solidarité patiemment construite peut protéger les minorités de la tyrannie du désir majoritaire.

Breaking Faust
« Au commencement était l’acte ». Voici la solution, esquissée par Goethe dans le Faust, par laquelle l’homme moderne – l’homme exclusivement – peut tenter de sortir des embarras dans lesquels il se voit précipité par la modernité. Faust, ce savant universel, qui entre en scène en monologuant sur son désespoir face à un monde de plus en plus éclaté et complexe, impossible à comprendre comme un ensemble qui fasse sens, rentre de sa promenade de Pâques et, galvanisé par son petit tour en ville, se met à retraduire le Nouveau Testament. C’est là qu’il trouve l’issue venant mettre fin à toutes les souffrances de son âme. Il comprend qu’ « au commencement était l’acte ».
Pourquoi Faust est-il de si bonne composition en rentrant de sa balade ? Certes, en participant à ce qui n’est rien de moins qu’un rituel collectif obligatoire le dimanche de Pâques, il a été acclamé par la foule, loué pour son savoir et sa sagesse. Mais parions que ce sont moins les honneurs reçus qui l’ont arraché à sa mélancolie que l’expérience d’une réalité sociale structurée, ordonnée, évidente à ses yeux. Une expérience exactement à l’opposé de celle qu’il fait dans son activité de savant, et dont la perte le conduit à la longue lamentation initiale par laquelle il est entré en scène au début de la pièce. À ce moment initial, après avoir énuméré les disciplines qu’il a étudiées et qu’il maîtrise, Faust en vient à acter l’échec complet de son entreprise et affirme voir « qu’on ne peut rien savoir ». Ce qu’on ne peut pas savoir précisément, et ce qui motive son désespoir, c’est « le lien spirituel qui tient le monde ensemble ».
La désolation qu’éprouve Faust face à cette ultime connaissance, au bout d’une longue vie d’étude, le mène d’abord à chercher son salut dans le retour au prémoderne. Il envisage d’user de formules magiques, puis, eu égard à l’échec ridicule du stratagème, se trouve au bord du suicide. Avant d’aller se promener parmi les paysans et les bourgeois de la ville le lendemain, en ce dimanche de Pâques, l’homme qui nous est présenté n’est qu’une épave déprimée, un être confronté au ratage qu’est sa vie vouée au savoir, impuissant à agir en un quelconque domaine, puisqu’il voit qu’il ne saurait précisément pas comment s’y prendre. Bref, ce n’est là certainement pas un homme en mesure de s’atteler à une tâche aussi considérable que la retraduction du Nouveau Testament.

Ce qu’il vit alors dans la petite ville de province lors de sa sortie dominicale est une double expérience. D’une part l’expérience d’une existence dont le lien interne se manifeste au grand jour, tant l’atmosphère de cette promenade est chargée d’érotisme ; d’autre part l’expérience de l’évidence de la réalité. Tout un chacun y connaît sa place, tout le monde sait comment se comporter, comment agir, qui saluer et de quelle manière, quoi dire et quoi ne pas dire. Même l’érotisme lourd, source potentielle de disruption de l’ordre, est enclos dans des chansons et calembours maîtrisés par tous. Le lien spirituel qui fait tenir ensemble cette réalité est manifeste, et Faust aussi y est pris, puisqu’il sait parfaitement comment agir dans cette réalité. Rien ne lui est étranger, tout est limpide et ordonné : le monde lui répond exactement de la manière dont il prévoit qu’il répondra. Il a beau assommer son assistant marchant à ses côtés par de grands discours sur la solitude du savant et sa distance d’avec le peuple, c’est ici, en dehors de sa chambre d’étude, qu’il est manifestement chez lui. En participant à ce petit rituel collectif de la promenade de Pâques où tout est ordre et simplicité, il perçoit ce lien perdu qui unit le tout. Pour fugace soit-elle, cette vision lui redonne une certaine capacité d’action, ou pour le moins le sentiment de pouvoir agir.
C’est donc dans cette humeur rassurée que, rentré dans son antre obscur, le docteur Faust s’attaque à la traduction du Nouveau Testament. Non pas parce qu’il n’a rien d’autre à faire ce soir d’un dimanche finissant, mais parce que, en paix avec lui-même, il est désormais prêt à entendre la « Révélation », parole divine qui pourrait fixer, une fois pour toutes, le sens de cette réalité qui apparaît à son regard de savant uniquement dans son éclatement insensé. L’expérience de l’évidence lui a donné envie de retrouver ce qui constitue le sens immuable du monde, ce qui fait tout tenir dans son incontestable présence : Dieu.
Or, l’intimité retrouvée avec le monde ne tient que cet instant où Faust ouvre le livre qu’il entend traduire. Dès la première phrase, le doute l’assaille à nouveau. Quel est le problème ? Il est écrit, en grec, « au commencement était le logos ». D’emblée Faust rechigne à traduire logos par « parole », ou « verbe », ou encore « discours », parce qu’il « ne peut donner une telle valeur au verbe ». Il essaie successivement de traduire par « sens », mais rejette ce choix, parce que le sens n’est pas créateur de réalité, puis par « force », mais voit bien que ce choix poserait le problème opposé : on saisirait certes la création, mais dépourvue de sens. Finalement, il s’arrête, heureux de sa trouvaille, à cette formule : « au commencement était l’acte ».
L’acte suppose un sujet, donc une intention, mais il ne dépend pas d’une réponse de la réalité : il la crée. L’acte est meurtrier, ou sexuel, ou révolutionnaire, parfois médical, mais à chaque fois il consiste en une intervention qui n’est pas en quête de réponse. L’acte est bien au contraire le modèle même de l’action où le sujet fait corps avec ce qu’il fait, sans réflexivité aucune, peu importe ce qui s’ensuit, étant entendu qu’il s’agit d’une réalité nouvelle, inconnue, qu’il lui faut alors reconnaître, rétrospectivement, comme ayant été engendrée par son acte. En somme, l’acte, c’est le moyen d’action pour l’homme dans un monde qui a justement perdu toute évidence : il lui permet de ne plus être à distance de ce qu’il fait, de ne plus voir la vanité de ses actions eu égard à l’immense complexité de la tâche qu’il lui faut assumer ; et il lui permet de se rapporter au résultat de l’action, à la nouvelle réalité, pour chaotique qu’elle soit, comme étant bel et bien la sienne. L’acte, c’est une transformation si radicale de la réalité qu’elle en engendre une nouvelle. Voilà qui peut donc paraître une solution à la situation où toute prise sur la réalité semble impossible, tout simplement parce qu’on ne la comprend plus, qu’on n’arrive pas à la connaître, et donc encore moins à la reconnaître et s’y sentir chez soi.

Ce que Faust comprend en disant « au commencement était l’acte », c’est que le rituel de la promenade de Pâques était certes un intermède plaisant, mais que le retour à ce monde perdu de l’évidence lui est impossible. Il est allé trop loin dans l’intelligence de la complexité du moderne, il en sait trop sur toutes les pièces qui constituent le monde, pour que le retour à cette réduction de la complexité lui soit possible. Pour vraie que la vie simple puisse (encore) être pour le paysan de Thuringe (on suppose que le Faust joue dans le pays de résidence de Goethe), elle n’est qu’illusion, leurre, subterfuge pour celui qui voit « qu’on ne peut rien savoir », mais qui, contrairement à Socrate qui savait la même chose et pouvait le savoir sereinement parce qu’il vivait dans une cité bien réglée où tout était évident, a perdu toute confiance dans la possibilité d’atteindre par l’enquête ce qui « tient le monde ensemble ». Voir le monde et la société dans leur complexité, être face à cette monstruosité mouvante et apparemment immaîtrisable, ce n’est pas la même chose que de savoir qu’il y a encore des choses à savoir, en étant tranquillement installé dans un ordre politique et social parfaitement transparent à lui-même. En d’autres termes, Faust est résolument moderne.
L’homme moderne qu’est Faust, saisi par cette expérience paralysante, ne perçoit alors que deux possibilités : le suicide qui mettrait définitivement fin à l’impuissance ressentie, ou bien l’acte, afin de sortir de ce monde sans balises stables pour l’esprit, en en produisant un autre. Soustraction au monde ou création d’un monde nouveau où tout est simple, non pas parce que la complexité objective aurait disparu, mais parce que l’homme crée le monde en fonction de son désir, impose sa volonté contre la réalité, se met au-dessus des lois qui la structurent et qu’il exècre parce qu’elles n’ont rien à offrir que des routines grises et banales bloquant l’accès à la « vie ». Car ces lois-là, les lois humaines, s’avèrent, en ce XVIIIe siècle finissant, être les seules dont on dispose. Réglant le train-train des interdépendances entre les différents groupes de la société selon un ordre banal, elles n’ont pas le panache de la Révélation divine. Elles interdisent juste qu’on couche avec la belle fille du voisin avant qu’on ne l’ait épousée, mais nul salut n’est à attendre d’un tel renoncement. C’est effectivement là une description assez correcte du destin de l’homme moderne : il doit supporter à la fois l’absence de sublime dans les lois humaines (le réglage des interdépendances), donc le fait qu’elles peuvent paraître, à la réflexion, dépourvues de sens profond, et la constante reconfiguration du « tout », c’est-à-dire l’accroissement des connaissances et l’ajustement des lois humaines à cette évolution. Ce deuxième élément l’installe durablement dans l’insécurité quant à sa capacité de savoir de quoi la réalité est faite et, donc, comment y agir ; le premier dans la question du sens de ce qu’il fait quand il parvient à savoir, et donc à faire, quelque chose.
Faust choisit l’acte pour sortir de ce sentiment d’humiliation et d’impuissance. Il choisit l’acte sexuel qui doit le mettre en contact direct avec la vie, puis l’acte meurtrier qui doit ôter tout obstacle à son désir, avant de couper le dernier lien qu’il avait avec ses semblables, le dernier lien de dépendance qu’il avait entretenu dans ce monde, en abandonnant au bourreau la femme qu’il aimait. Dès lors que cela est fait, il peut s’adonner – dans la deuxième partie de la pièce, écrite presque trente ans plus tard – à de grands projets de bâtisseur, de transformateur de la réalité naturelle, et ravager le monde au passage tout en expliquant qu’il agit pour le bien de l’humanité. Finalement, quand le diable qui l’a aidé dans toutes ses entreprises de maîtrise violente du monde s’apprête, au moment de sa mort, à récupérer son âme, cette dernière est sauvée par « l’éternel féminin », donc par le seul élément qui, dans toute la pièce, garde sa consistance. Le « féminin » est éternel au sens où il n’est pas exposé à la complexification de la réalité, garde les routines et le foyer, repose l’homme moderne qui, lui, sait que rien ne tient plus. Rien d’étonnant à ce que Thomas Mann ait choisi le titre « Docteur Faustus » pour le roman dans lequel il essaie de comprendre le nazisme.
Vivre en slip, mourir dans un laboratoire : portrait de l’homme moderne
À la fin de Breaking Bad, Walter White a une dernière entrevue avec sa femme avant de mourir[1]. On connaît l’histoire de cette série culte américaine : Walter White, devenu professeur de chimie au collège après avoir vendu, dans sa jeunesse, ses parts dans une startup de chimie qu’il a co-fondée et qui est désormais une entreprise florissante pesant des milliards de dollars, père d’un fils adolescent légèrement handicapé, mari d’une femme de tête qui se trouve à nouveau enceinte (un accident), travaille après ses cours dans un car wash où il est incidemment obligé de laver les voitures de ses propres élèves pour subvenir aux besoins de sa famille, lorsqu’on lui annonce qu’il souffre d’un cancer du poumon particulièrement agressif. Face à sa finitude, et imaginant sa famille sans ressources dans un proche avenir, il décide de consacrer ses considérables talents de chimiste à la production de Crystal Meth, laissant une trainée de cadavres sur son chemin tout en refusant chaque possibilité de mettre fin à son activité, y compris après avoir ramassé des millions – jusqu’à ce que tous ses concurrents soient morts, et lui le roi incontesté de la production de Meth. L’explication qu’il donne à lui-même, à ses complices ainsi qu’à sa femme lorsqu’elle comprend enfin ses activités est toujours la même : tout ce qu’il fait, il le fait pour sa famille, pour qu’elle puisse vivre confortablement une fois qu’il sera décédé de son cancer.
Le génie de la série consiste à mettre en scène un homme banal, maigrelet, peu viril, vivant dans une relation très égalitaire avec sa femme qu’il a toutefois réussi, quand on fait la connaissance de la famille, à cantonner à la maison pour s’occuper du foyer, ce dont elle se venge par un comportement que d’aucuns pourraient traiter de castrateur. Walter White est raisonnable, responsable, résigné à se contenter des pauvres joies que la vie de la classe moyenne dans une banlieue pavillonnaire de l’Amérique peut offrir. Contrairement à Faust qui enrage de son incapacité de mettre de l’ordre dans un monde dont il découvre chaque jour un peu plus la complexité, il paraît écrasé par la routine de la vie, une vie qu’il ne connaît que trop bien, qui est complètement maitrisable précisément parce qu’il n’y arrive rien. Une vie tellement insipide que même l’activité sexuelle y est réduite à une opération mécanique (on nous fait assister à la branlette, inconclue, que sa femme lui offre pour ses cinquante ans de sa main gauche tout en tripotant de sa main droite sur le clavier de son ordinateur portable pour vendre des objets sur eBay). Sa vie est l’évidence même, rien ne s’y passe, sinon le manque d’argent. Et Walter White semble tout à fait ajusté à cette vie, inoffensif et soumis qu’il paraît, en slip ridicule, avec ses jambes flasques et son petit ventre de quinquagénaire dont il ne se gêne pas – l’incarnation du mari rangé, satisfait de sa vie de famille où on peut paraître sans prendre particulièrement soin de sa personne, si ce n’est en suivant les consignes d’hygiène alimentaire de sa femme (il avale même du bacon végane pour fêter ses cinquante ans). Un homme qui ne présente aucun danger sexuel ou autre pour personne et qui encaisse sans sourciller les humiliations que lui impose son patron du car wash dont la débordante virilité énergétique et sans scrupules est soulignée, précisément, par des sourcils démesurément fournis.

Toutefois, Walter White, tout comme Faust, est un grand savant. Non pas un savant universel qui désespère face à l’augmentation constante des savoirs, mais un virtuose de sa discipline, la chimie, la « science de la matière ». Walter White sait ce qui tient le monde ensemble et rayonne de bonheur dans les moments où il essaie d’inculquer ce savoir profond dans la tête de ses élèves collégiens endormis. Où qu’on regarde, le héros de Breaking Bad sait tout, son monde n’a pas de secret pour lui, et pourtant il choisit l’acte en se lançant dans le business de la production d’une drogue hautement destructive et addictive qui dévaste les individus et consume peu à peu le bonheur pavillonnaire de cette Amérique profonde qu’il a choisie pour asseoir son existence. La transformation de cette vie hautement routinisée où tout est à sa place en crise continue résulte ici aussi, comme dans la pièce de Goethe, d’un acte initial de création, de transformation radicale de sa réalité, précisément la décision de devenir une star de la production du Crystal Meth.
Or cet acte répond moins, ici, à l’insupportabilité de la complexité incontrôlable du monde qu’à l’insupportabilité de la grisaille de son évidence. Tout est réglé, tout est ordonné, aucune initiative n’est à amorcer, aucune action à entreprendre en nom propre ; même la science n’est pas ici source de doute et de déchirement, mais procure une connaissance de l’ordre immuable de l’univers. Ce qui manque à Walter White est pourtant la même chose qu’à Faust : le sens de tout cela. Bien que tout soit clair, cet homme moderne, renvoyé à la question du sens de son existence par l’exposition directe à sa mortalité, ne se retrouve pas dans ce qu’il fait. À aucun moment de sa vie il ne fait corps avec son action, non pas, à l’instar de Faust, parce qu’il serait structurellement distancié de ce qu’il fait, non pas par un surcroît de réflexivité qui crée un abîme d’étrangeté entre lui et la réalité, mais parce qu’il n’y participe pas comme singularité, comme individu réel, comme sujet. La vie ne vit pas, telle est le constat qui engage la carrière de Heisenberg (nom sous lequel Walter White sévit dans le monde de la méthamphétamine). Son sentiment d’impuissance ne résulte pas d’un monde trop complexe et, de ce fait, incontrôlable, mais d’un monde trop contrôlé par l’extérieur. C’est à cet endroit que l’acte intervient, créant une nouvelle réalité qui apparaît à l’entourage de Walter White comme un chaos sans nom, mais qui lui permet d’éprouver son extrême capacité d’apercevoir dans toute situation un levier lui permettant de réagencer la réalité à son avantage. Étant supérieurement intelligent, le chaos lui est favorable, un lieu d’opportunité pour donner de nouvelles règles à ce qui semble incontrôlable, voire inévitablement mortel. Et à chaque fois qu’il le fait, des gens meurent.
Quand il voit sa femme pour la dernière fois et revient sur ce qui s’est passé, elle lui interdit fermement de recourir à sa justification habituelle consistant à rendre compte de la destruction qu’il a laissé sur son chemin par le souci pour le bien-être de sa famille. C’est alors qu’il dit la vérité : « I did it for me. I liked it. I was good at it. I was alive » – « Je l’ai fait pour moi. J’aimais ça. J’y étais bon. J’étais vivant. » À travers son acte initial, cet homme a engendré un monde au sein duquel il a retrouvé une vie qui vivait, dans laquelle il pouvait se sentir vivre. En créant son empire de la drogue, il a réussi à retrouver un rapport immédiat à la réalité, il était dans ce qu’il faisait, pleinement, corps et âme, de la production chimique elle-même jusqu’à l’élaboration complexe de stratagèmes pour faire tomber ses concurrents et les assassiner sauvagement. Aucune de ses actions ne lui était étrangère, ils les assumaient toutes, il ne regrette rien. Aussi Walter White meure-t-il en paix en caressant des cuves d’une cuisine de Crystal Meth consacrée à produire la drogue selon sa formule. Aucun éternel féminin n’est nécessaire pour le tirer vers le haut, le contact froid des instruments de son « œuvre » suffit entièrement à raviver son sentiment d’être vivant. On imagine bien, le jour où un grand écrivain se saisira de la période Trump/Musk, le voir choisir pour titre « When they broke bad »…
Modernité en panne : agir ou disparaître
Deux hommes modernes, à distance de deux siècles, qui choisissent l’acte pour répondre à un même problème : une expérience d’impuissance si grande que la vie n’a plus aucun sens. D’un côté, l’impuissance face à un monde dont la complexité et l’instabilité ont été rendues visibles par l’accroissement des savoirs et de la réflexivité, au point que l’effort de connaissance n’arrive plus à percevoir ce qui le tient ensemble. Ce qui accompagne cette expérience d’impuissance est un sentiment d’insécurité constant et, par contrecoup, une farouche volonté de réduction volontariste de la complexité, la quête de l’immédiateté, de la croyance, de l’affect comme ultimes justifications du faire et du faire faire. De l’autre côté, l’impuissance face à un monde tellement réglé qu’il n’y reste rien à faire pour l’individu. Ce qui correspond à cette expérience de l’impuissance, c’est moins un sentiment d’insécurité – quoiqu’il puisse être perçu, comme dans le cas de Walter White, par le sujet lui-même comme étant à l’origine de son choix de vie banale – qu’un sentiment d’étouffement, une souffrance réelle de l’individu moderne de ne pas être précisément ce qu’on attend de lui, à savoir un individu. Quand Walter White se débarrasse de toutes ses routines, renvoie au diable Vauvert toutes les règles qui ont structuré sa vie, c’est parce qu’il perçoit, au moment de sa mort annoncée qui est inévitablement un moment où la question de la justification individuelle de la vie se pose, une contradiction entre ces règles et ce qu’elles sont censées permettre aux individus dans des sociétés modernes, à savoir la conduite autonome de leur vie.
Dans les deux cas, le monde ne répond pas. Ou bien il ne se laisse plus contrôler par le sujet qui le sait trop complexe pour s’y rapporter activement, donc autrement que sous la forme de la mélancolie clairvoyante mais larmoyante. Ou bien il est parfaitement contrôlable, mais selon des règles qui, à la réflexion, semblent à l’individu ne pas être les siennes, dans lesquelles il ne se retrouve pas comme individu si bien qu’il ne se sent pas vivant dans ce qu’il fait. Dans les deux cas, l’expérience est celle d’une impuissance radicale. Et, arrivé à ce point de prise de conscience, l’individu moderne ne semble avoir que deux solutions : le suicide ou l’acte qui détruit la complexité, et met le désir individuel à la place des règles.
Il faut bien un Juif pour faire le job !
Pourtant, nos deux héros modernes ont besoin de facilitateurs. Aucun d’eux n’arrive à réaliser son projet de création d’une nouvelle réalité sans aide extérieure. Et, dans les deux cas, ces personnages douteux semblent être des juifs. Pour Méphistophélès, le diable auquel Faust a vendu son âme, le texte ne dit pas qu’il serait juif, mais il a toutes les caractéristiques que le discours antijudaïque classique attribue aux juifs, et ce n’est donc pas pour rien que les représentations théâtrales, jusqu’à dans les années 1950 en Allemagne, l’ont souvent représenté sous les traits caricaturaux du juif[2]. Ainsi, lorsqu’il se présente à Faust, se dit-il « l’esprit de négation » qui s’oppose à tout ce qui « naît », une « partie de cette force qui veut toujours le mal », « une part de l’obscurité qui a accouché de la lumière (i.e. Jésus) », « le corps » sans lequel « l’esprit (i.e. qui s’est opposé à la lettre) » ne peut rien faire.

Quant à l’avocat de Walter White, Saul Goodman, les choses sont moins subtilement présentées : Saul n’est en vérité pas juif, mais il s’est donné un nom juif, explique-t-il, puisque dans son métier d’avocat véreux, c’est assurément plus vendeur. Deux faux juifs, deux fantasmes de juifs sans lesquels ni Faust ni Walter White n’arriveraient à quoi que ce soit. Car l’un et l’autre ne sont que des dilettantes de l’acte dans sa dimension de destruction de la réalité. Pour y parvenir, il leur faut des acolytes « juifs », des intermédiaires entre leur désir et une réalité trop solide pour le réaliser, des négateurs de cette réalité : une figure de l’altérité absolue qui non seulement, dans le fantasme sous-tendant la représentation du « juif », n’a aucun attachement au monde que, malgré tout, nos héros de l’acte chérissent, mais qui, de surcroît, a envie (par nature ?) de le nier radicalement et de tirer profit de l’activité d’intermédiaire. Destructeurs d’un côté, parasites profiteurs de la puissance de création de l’homme non-juif de l’autre, c’est ainsi qu’apparaissent ces fantasmes de juifs dans les deux contes. Autrement dit, ce qu’on retient de l’acte pour les hommes modernes non-juifs mis en scène, c’est l’aspect de la création d’un monde nouveau. La destruction du monde ancien qui s’y associe nécessairement ne leur est pas imputable – pour cela ils ont « leurs » juifs qui les accompagnent dans leur tournée de méfaits.
C’est d’ailleurs aussi la raison pour laquelle ces deux héros de la modernité, malgré toute l’inquiétude qu’ils suscitent, sont perçus comme de véritables héros par le public, et sont finalement rédimés. Pour Faust cette rédemption est carrément divine par intercession du féminin, pour Walter White, le bonheur manifeste dans lequel il meurt, libre – la police arrive juste après son décès –, sur fond d’une chanson en hommage à l’amour de la vie d’un homme, tient lieu de rédemption. Les représentants des juifs en revanche, que ce soient Méphistophélès ou Saul, sont dûment punis : le premier doit rentrer bredouille dans son enfer sans l’âme faustienne si longuement convoitée, et le second – nous montre la série Better Call Saul qui fait suite à Breaking Bad – se retrouve, après sa fuite suivant la découverte de l’identité de Heisenberg, frustré, esseulé et angoissé vendeur de Cinnamon Rolls dans un Mall quelconque perdu dans l’Amérique profonde, avant d’aller en prison. L’éternelle errance sans satisfaction, voilà ce qui attend les juifs qui ont le malheur de penser pouvoir s’acoquiner avec la puissance créatrice de l’homme goy moderne…

Cette répartition des rôles, si l’on fait abstraction du scandale antisémite qu’elle présente, révèle surtout une chose : que l’on ne consent pas à examiner la justesse de la position du problème dans ces fables. Autrement dit, ces fables nous racontent aussi que l’on ne veut pas aborder autrement le sentiment d’impuissance qui peut envahir les modernes que par son élimination urgente et radicale. Que, dans cette solution, on attribue aux juifs la part destructrice et seulement facilitatrice, alors qu’on affuble l’homme moderne non-juif de la part créatrice et jouissive résulte peut-être même de cette position du problème de l’impuissance.
Or qu’en est-il de cette impuissance ? Il est indéniable que l’accroissement des interdépendances, qui désormais se tissent au niveau global et incluent un acteur aussi redoutablement non-humain que la nature elle-même, devenues visibles et manifestes pour tout le monde précisément grâce à l’accroissement des savoirs dont ces nouveaux liens exigent la production, a pour effet un sentiment d’insécurité quant à l’action très largement répandu. On ne peut même plus tranquillement s’occuper de son potager sans qu’une journée nationale « jardinage sans tourbe » ébranle les routines de plantation du printemps, pourtant bien innocentes en apparence. Que dire alors des guerres qui sévissent cette fois à proximité de nous, ou du démantèlement d’alliances transnationales qu’on croyait tellement évidentes qu’on n’y réfléchissait même plus ?
De toute part, effectivement, l’évidence de la réalité semble se soustraire. Les genres se troublent, la nature n’est pas une pure factualité dont on peut se servir à volonté, les pays décolonisés ne restent pas dans la sphère d’influence des anciens Empires ni n’aspirent à la démocratie mais concluent des alliances d’intérêt avec des autocraties comme la Russie, les femmes, malgré tous les progrès dans l’égalité, ne cessent de se révolter contre le sexisme, prêtes à aller, pour une part d’entre elles, jusqu’à la sécession (ce que les nouvelles méthodes techniques de reproduction rendent tout à fait possible), des réfugiés de guerre et des réfugiés climatiques arrivent continuellement en Europe, l’islam s’est transformé d’une religion des minorités reléguées à la périphérie des nations en une religion de l’Europe, une nouvelle pandémie pourrait apparaître à tout instant, les réseaux sociaux constituent une source d’information pour une partie non négligeable des citoyens d’Europe, l’alliance transatlantique et la promesse de paix perpétuelle en Europe qu’elle semblait porter est en train de se défaire… La liste pourrait être prolongée. Dans le même temps, à l’autre bout du spectre de l’impuissance, au sein même de cette perte d’évidence, émergent des plaintes quant à une surrégulation de la vie : trop de bureaucratie, trop de règles, trop d’exigences morales notamment dans le traitement des femmes et des minorités, trop de diplômes à passer pour pouvoir prétendre à un travail décent, trop de normes écologiques… Ici aussi la liste pourrait être prolongée. C’est comme si à chaque tentative de régulation de la complexité, réduisant l’insécurité et visant de ce fait à adoucir le sentiment d’impuissance collective, émergeait en face la protestation au nom même de l’impuissance que cette régulation semble imposer aux individus. Faust et Heisenberg constituent les modèles de résolution de ces crises, inévitables dans des sociétés modernes, et ils ne seraient pas des héros-cultes si leur manière de percevoir le problème, ainsi que leur manière de le résoudre par l’acte, ne répondait à des attitudes partagées et produites par ces mêmes sociétés.
Penser moins pour agir plus : les dérives modernes selon Mannheim
On entend depuis un certain temps, et partout depuis le discours de J. D. Vance à Munich et vu les facilités que Trump veut accorder à Poutine, que notre époque ressemblerait terriblement aux années 30. L’histoire se répète ! Voilà le cri d’angoisse censé orienter l’action politique. Car l’Europe, face à ce retour des années 30, doit prendre le contrepied de son comportement de l’époque. De cela du moins, on peut être assuré.

Beaucoup de choses ont été dites sur la « répétition de l’histoire », notamment qu’elle se répète toujours deux fois, « la première fois comme tragédie, la deuxième fois comme farce ». Bien que l’attelage de la Maison-Blanche ressemble beaucoup à une farce, il est difficile toutefois de ne pas voir dans cette histoire de la répétition de l’histoire une tentative délétère de réduire la complexité de ce qui nous arrive. Car s’il y a une chose que l’on a appris de l’histoire, notamment grâce à l’historiographie de l’après 1945, c’est justement qu’elle ne se répète pas. Qu’est-ce d’autre alors que ce cri, sinon une manière de « reprimitiviser » la pensée face à un désordre nouveau qui semble impensable et immaîtrisable, par l’application d’une situation historique que l’on connaît bien pour l’avoir étudiée, et en tentant de se comporter comme si on était dans les années 30 et non pas en 2025 ?
On doit l’expression de « reprimitivisation de la pensée » à l’un des plus grands sociologues du 20e siècle, Karl Mannheim, juif hongrois de langue allemande, qui l’a forgée précisément en entrant dans les années 30[3]. Mannheim, en procédant ainsi, a fait son travail de chercheur, il n’a pas juste tissé un parallèle entre 1929 et 1913 par exemple, pour apaiser à bon compte sa perplexité face à ce qui se passait en Europe dans les années 1920. Il a essayé de saisir ce qui arrivait. Quel était alors son constat ? Que des groupes de plus en plus larges composant les sociétés modernes réagissaient à ces deux phénomènes qu’on a décrits – impression de surcompléxité, sentiment de surrégulation – par une réduction de leur pensée de la réalité. Il a caractérisé au moins quatre variantes de cette reprimitivisation.
Au fond de ces attitudes d’apparences différentes se trouve une même racine : ne pas vouloir savoir.
Soit d’abord la réaction fasciste, décisioniste et vitaliste. Par elle on décide de rétablir une fois pour toutes un sens univoque de la réalité. Ce sens, dans le fascisme, est tiré d’un prétendu savoir sur la vie et l’essence du peuple, ce qui présente un avantage considérable, à savoir un rapport direct à la vie, puisque le sens énoncé par l’idéologie fasciste est présenté comme étant le sens de la vie elle-même. Agir en fasciste, c’est être vivant, c’est prétendre répondre en contact direct de la vie aux exigences de la vie, comprise ici comme une nature qui commanderait inéluctablement l’action. Des énergumènes masculinistes comme Elon Musk, tellement convaincus par leur supériorité naturelle qu’ils disséminent leur sperme autant qu’ils peuvent pour reproduire en masse des êtres identiques à eux-mêmes, et qui par ailleurs sont persuadés que leurs décisions sont naturellement au-dessus des lois, appartiennent à cette forme de reprimitivisation, tout autant que les représentants des partis de l’extrême droite européenne avec leur éternelle rengaine « si on veut, on peut ». Ce qu’on veut en réalité a peu d’importance ; l’essentiel est l’affirmation qu’on imposera une volonté unique contre la réalité et ses différenciations.

Soit ensuite une réaction que l’on peut appeler « phobie des interdépendances », voire « phobie de la dépendance » tout court. C’est encore un ingrédient du fascisme, en ce qu’il hyperbolise un sens univoque de la vie et nie ce faisant la réalité complexe de sociétés hautement différenciées, en constante recherche de leur sens. Mais de nos jours, c’est également la réaction de l’ultralibéralisme qui hyperbolise l’individu et son libre arbitre contre le droit et les règles qui lient les différents éléments des sociétés et accepte comme seul lien, toujours temporaire, le deal qu’il peut conclure sur le moment et toujours défaire.
Soit encore la réaction réactionnaire, qui ne refuse pas les interdépendances mais essaie de les maîtriser par un sens univoque de la réalité, qu’elle tire cette fois-ci non d’une prétendue vie qui imposerait sa loi, mais d’une prétendue culture immuable, baptisée nationale ou même républicaine, l’essentiel étant ici que cette culture soit présentée comme inaltérable.
Soit enfin la réaction que Mannheim appelle « orthodoxie », que l’on pourrait également appeler « délire de toucher »[4]. Il s’agit ici de la réaction intellectuelle par excellence lorsque les élites intellectuelles et scientifiques refusent d’enquêter sur la réalité sociale, sans pour autant vouloir abandonner leur prérogative de dire « ce qui tient le monde ensemble ». Autrement dit, c’est la réaction de la pensée la plus consciente de la complexité de la réalité quand elle ne se donne plus les moyens de la saisir dans son évolution constante et qui, face à son propre renoncement, se cantonne dans une position de toute-puissance abstraite en brandissant de grandes catégories censées décrire ce qui est au fond de toute cette apparente complexité. À l’époque de Mannheim, donc du marxisme florissant, ces catégories s’appelaient « exploitation » et « aliénation », de nos jours, elles se réduisent à une seule : « domination ».
Ce qui unit toutes ces attitudes, malgré les colorations politiques radicalement différentes qui y sont attachées, c’est que ce sont des attitudes à l’origine desquelles se trouve un acte : celui de sortir résolument du domaine du savoir et de la production de savoir. Au fond de ces attitudes d’apparences différentes se trouve une même racine : ne pas vouloir savoir. C’est d’ailleurs ce qui fait que leurs porteurs sont tous habités par une forme de rage particulière. Car ils savent qu’ils ne veulent pas savoir, ne pas vouloir savoir a été une décision initiale sans laquelle aucune de ces attitudes ne pourrait se maintenir. Peu importe l’orientation politique de surface, la haine du savoir et de la connaissance, la détestation de la complexité, de l’enquête, du détail vont alors avec ces attitudes. Dans le même temps, elles se caractérisent par une certaine rage contre soi-même, qui en général se transforme en dureté à l’égard de l’autre[5], car, du fait qu’ils sont modernes, tous les porteurs de cette attitude savent aussi que « ne pas vouloir savoir » n’est pas une option dans des sociétés qui ne peuvent vivre et survivre qu’à condition de produire constamment un nouveau savoir sur elles-mêmes.

Si l’histoire ne se répète certainement pas, la chose est moins sûre pour les attitudes. Après tout, aux défis que posent les sociétés modernes, Faust et Walter White réagissent de la même manière à deux cents ans de distance. Il n’y a pas à s’en étonner, puisqu’on vit toujours dans des sociétés caractérisées par un accroissement constant des interdépendances et du besoin de savoir que cet accroissement engendre, c’est-à-dire par une augmentation de la complexité et des tentatives de la réguler. Si cette continuité entre les sociétés européennes postrévolutionnaires du 18e siècle finissant et celles du présent existe, il s’ensuit que certaines attitudes de réaction peuvent se répéter. D’autant que la reprimitivisation de la pensée n’est jamais qu’une pathologie de la bonne attitude que cette réalité nouvelle fait également émerger, celle que Mannheim appelle « sociologique ». Ce qu’il désigne ainsi est cette attitude de la pensée qui, face au devenir visible des interdépendances entre les groupes qui composent nos sociétés, n’y perçoit pas seulement l’ensemble des différences qui les distinguent les uns des autres, mais également l’intégration toujours nouvelle que produit ce jeu des interdépendances. L’attitude sociologique, c’est celle qui perçoit les nouvelles formes de solidarité qui émergent chaque jour, dans le conflit à coup sûr, mais non pas moins sûrement, de telle sorte que se spécifie à chaque pas le sens de la justice qui oriente effectivement la totalité sociale ainsi formée.
Or, la sociologie naissante, pour positivement qu’elle ait malgré tout évalué la vie morale des sociétés modernes, émettait aussi un avertissement : cette attitude qui se trouve dans les sociétés modernes et qui n’est que transformée en savoir scientifique par les sciences sociales et leurs méthodes, a besoin de ces disciplines pour se maintenir. Si le sens de la justice commun aux membres des sociétés modernes n’est pas démontré par ces sciences, les groupes qui le portent risquent de perdre de vue le lien entre leurs revendications de justice et les nouvelles formes modernes de solidarité qui les nourrissent. Autrement dit, pour que l’attitude sociologique, optimiste sur la capacité d’intégration des nouvelles différences, soit entretenue dans nos sociétés, il faut que des savoirs se déploient qui exposent les normes internes à ce tout d’apparence chaotique et extrêmement complexe que sont les sociétés modernes. Car sans ce travail d’éclairage des normes, l’expérience peut, en effet, en venir à ne plus faire plus aucun sens pour les individus. C’est ce qui advient notamment dans des moments de crises d’intégration vécues sous le signe de la surcomplexité d’un côté, de la surrégulation de l’autre. En ces moments de grande perplexité, il est possible que les membres des sociétés, ni ne comprennent le sens de la réalité, ni ne s’y retrouvent quand ils agissent.
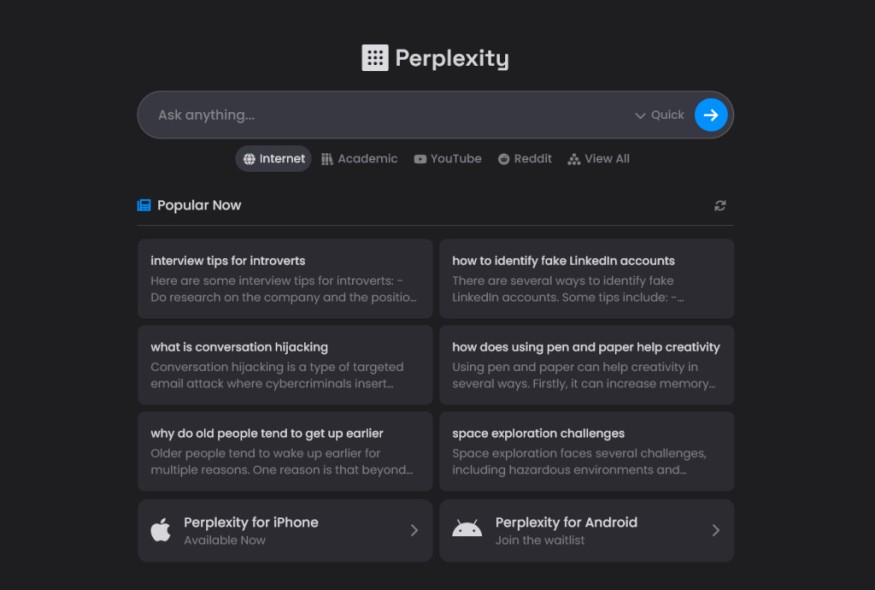
Si bien que, si les attitudes des années 30 se répètent, alors, suivant l’analyse mannheimienne, la faute en revient en partie à des savoirs spécialisés, les sciences sociales, qui ne font pas bien leur travail. Ce dernier ne se résume en effet pas à exposer ce qui ne va pas (c’est là leur tâche qu’on appelle critique) : elles doivent aussi, toujours dans le même mouvement, expliciter ce qui fonde leur propre critique, à savoir la normativité interne aux sociétés, la solidarité qui évolue constamment en fonction des mouvements d’intégration s’y produisant, seul fond sur lequel des pathologies telles que des situations de domination peuvent être perçues comme telles.
La responsabilité des sciences sociales
En termes d’attitude, la reprimitivisation semble prévaloir aujourd’hui sous toutes ses formes. Les populismes souverainistes de tous bords promettent un nouveau contrôle sur une réalité qu’ils s’apprêtent à redéfinir par décision, tout en expliquant que leur décision se brancherait sur une compréhension profonde de la vie des « peuples » qu’ils veulent gouverner. De même, la phobie des interdépendances qui accompagne le fantasme de l’individu enfin libéré de toutes ses entraves, habile et rusé, veillant exclusivement à son intérêt propre et à celui de sa famille, semble une option assez prisée parmi nos contemporains. Pouvoir s’appuyer sur une culture solide et immuable est aussi un fantasme qui en séduit plus d’un. Enfin, les intellectuels qui devraient être critiques de tous ces mouvements, non à cause des contenus qu’ils mobilisent, mais à cause de l’attitude de pensée qui s’y exprime, se refusent à enquêter à leur sujet et se contentent le plus souvent de répéter toujours la même litanie sur la domination censée sévir partout, se repliant ainsi sur des affects moraux qui leur tiennent lieu de politique.
Les juifs, dans cette situation, sont voués à leur perte. Rien ne leur est plus défavorable que des sociétés où le mot d’ordre est un « on ne veut pas savoir ! », et l’attitude qui s’ensuit, celle de personnes qui savent qu’ils ne veulent pas savoir, enragés alors à la fois contre eux-mêmes et contre ceux qui veulent savoir. Le problème n’est pas tant qu’il soit historiquement attesté que la haine de l’intellectualité aille toujours avec la haine du juif. Après tout, si l’histoire ne se répète pas, il n’est nulle raison qu’elle se répète en ce domaine. Le problème systémique que cette attitude pose aux juifs réside ailleurs : il tient au fait qu’ils sont une minorité structurellement minoritaire. Ne voulant ni ne pouvant devenir majoritaires en tant que juifs – y compris, paradoxalement, là où ils le sont de fait, comme en Israël – ils sont particulièrement exposés à ce qui risque de se produire quand ce n’est pas le savoir sur les interdépendances qui guide l’action, mais seulement la décision, l’affect, l’orthodoxie, l’intérêt, la conviction, la croyance ou le désir. Bref, comme toute minorité, mais quant à eux constitutivement, ils ne peuvent pas ne pas pâtir de la reprimitivisation. Car ce sera toujours la décision, l’affect, le système de pensée, l’intérêt, la conviction, la croyance, ou le désir de la majorité qui l’emportera dans la lutte autour de la redéfinition d’une réalité qui aurait enfin, à nouveau, un sens univoque. Pour parler comme le président actuel des États-Unis, ennemi éminent de toute forme de science sociale, ce sera toujours le plus fort qui s’imposera dans les deals.
Que ce soit sous forme de juif prémoderne, ou que ce soit sous forme de juif homogène à la pensée de la majorité moralement pure, donc que ce soit sous forme d’altérité soumise ou d’identité soumise, les juifs n’ont droit de cité, voire d’exister, qu’aux conditions de la majorité.
Il n’y a que dans des sociétés où la politique est informée non seulement par des savoirs techniques et technocratiques, des expertises de toutes sortes, mais aussi par un savoir sur les interdépendances et l’évolution du sens de la justice qui se réalise à travers leur reconfiguration constante, que les juifs peuvent espérer être perçus comme une minorité essentielle à la composition du tout, au même titre que toutes les autres minorités qui peuplent la société. Il n’y a qu’à travers l’intégration réflexive des interdépendances réelles que les juifs, au même titre que les autres minorités, peuvent espérer compter réellement. À partir du moment où nos sociétés ne veulent plus savoir ce qu’est la Shoah et en quoi elle a résulté de leur propre dynamique dévoyée, ce qu’est Israël et comment ce pays est lié à l’Europe et son histoire longue, ce que sont l’antisémitisme et ses manifestations, ce qu’est le peuple juif dans sa diversité, ou encore en quoi se distinguent et s’articulent aujourd’hui la diaspora et Israël, les juifs, du fait de leur position structurellement minoritaire, n’ont aucune chance d’être intégrés dans la nouvelle réalité. Car celle-ci puisera son sens, non pas dans la justice toujours déjà réalisée et en quête d’approfondissement, mais dans le désir de la majorité de « faire quelque chose », voire de refonder le monde. À moins qu’ils n’y trouvent la place que leur passé leur a déjà fait connaître, avant qu’ils deviennent des sujets modernes : celle que ce désir majoritaire, arbitrairement, veut bien consentir à leur assigner.
Jusqu’ici on peut déterminer deux places pour les juifs dans ce jeu de désir. À l’extrême droite et dans l’ultralibéralisme, la place du vassal, du juif prémoderne qui doit quémander sa protection au prince, i.e. au plus fort. Et à l’extrême gauche, dont l’orthodoxie reste arc-boutée sur la dénonciation de la domination, la place du compagnon de route ou du camarade de lutte qui doit se dédire de toute solidarité avec son peuple et son histoire pour rendre hommage à l’humanisme moralement pur de cette gauche, qui jamais, ô grand jamais, ne toucherait à un cheveu des juifs – tant qu’ils pensent exactement comme on leur demande de penser. Ces deux reprimitivisation de la pensée ont quelque chose en commun : que ce soit sous forme de juif prémoderne, ou que ce soit sous forme de juif homogène à la pensée de la majorité moralement pure, donc que ce soit sous forme d’altérité soumise ou d’identité soumise, les juifs n’ont droit de cité, voire d’exister, qu’aux conditions de la majorité. L’impuissance juive dans les sociétés modernes est directement corrélée à la volonté de ne pas savoir des non-juifs, à cet acte par lequel ils sortent d’un accroissement du savoir qui complique tout et les enferme prétendument dans un sentiment d’impuissance insupportable.
Alors les modernes impuissants passent à l’acte. Dans les fables sur deux hommes modernes qui ont choisi cette sortie de l’impuissance, l’acte de création d’une nouvelle réalité dont ils ont défini le sens à partir de leur désir, les juifs qui les ont accompagnés dans cette aventure figurent comme intermédiaires, comme parasites profitant de la puissance créatrice de l’homme non-juif, comme immoraux, poussant nos puissants héros à commettre des crimes qu’ils n’auraient pas osé entreprendre par eux-mêmes, quand bien même ils se sentent enfin vivants en les accomplissant. Ici, les juifs figurent la part maudite dans la création d’un monde nouveau qu’entreprend la majorité en proie aux affres de son impuissance. On sait que les nazis aussi imputaient aux juifs d’être responsables en dernière instance des crimes immondes qu’ils commettaient à leur égard.
Est-ce là la seule place disponible pour les juifs quand les modernes passent à l’acte ? Est-ce que Trump, une fois qu’il aura jeté le monde dans un chaos sans nom, expliquera que c’est la faute d’Israël, qui l’aurait poussé à agir ainsi ? Ce n’est pas exclu. Est-ce que ceux qui, par supériorité morale, prônent en ce moment la condamnation sans appel d’Israël comme État dominateur, accuseront au premier meurtre « antisioniste » qui aura lieu en Europe les juifs de Tsedek de les avoir abreuvés de haine contre Israël ? La chose n’est pas impossible. Pour le moment, on semble s’en tenir des deux côtés du champ politique à une exigence de soumission des juifs. Et qui peut sincèrement juger celles et ceux qui se soumettent, vu l’impuissance objective dans laquelle se trouve la minorité structurellement minoritaire quand la majorité passe à l’acte ?

Toutefois, il n’est peut-être pas trop tard. Il est vrai que de larges pans de la majorité sont séduits par la sortie par l’acte. Mais on n’y est pas encore. Pour le moment nos démocraties, ici en Europe, tiennent bon. L’articulation entre les différentes parties interdépendantes de nos sociétés se règle encore par le droit et non pas par la force. Dans ce laps de temps, où peut-être on peut encore changer la donne, la tâche pour tous, mais pour la minorité sans aucun espoir ni ambition de devenir majoritaire tout particulièrement, ne peut être que de décrire autrement la situation ressentie comme expérience d’impuissance par les Faust et Walter White de ce monde, et d’œuvrer pour que l’attitude sociologique se consolide. C’est-à-dire de tout faire pour que le savoir sur nos sociétés devienne une source d’action et non pas son lieu d’inhibition, et de rappeler que l’interprétation du monde est la condition de sa transformation – en tout cas de ce genre de transformation qui se passe de l’acte.
Julia Christ
Notes
| 1 | Nous renvoyons ici à l’interprétation philosophique grandiose de la série Breaking Bad produite par Christoph Menke, dans son opus magnum Theorie der Befreiung , Berlin, Suhrkamp, 2022. |
| 2 | La dernière représentation célèbre en RFA du Méphistophélès, filmée, qui donne dans la caricature juive est probablement celle de Gustaf Gründgens de 1957 au théâtre de Hambourg. Le film est sur les écrans en 1960. Gründgens, acteur hors pair, ancien mari de la fille de Thomas Mann, Erika Mann (1926-1929) avait fait une carrière fulgurante sous les nazis et commencé à jouer le rôle de Méphistophélès en ce contexte (à partir de 1941) au théâtre de Berlin. |
| 3 | Sur le concept de « reprimitivisation » cf. Karl Mannheim, Le pouvoir de la sociologie, trad. et préface par Dominique Linhardt, Paris, Éditions de l’EHESS, 2024 (sous presse). |
| 4 | Terme classique de la psychiatrie que nous employons ici dans la signification que Freud lui a donnée : un mécanisme de défense contre la réalité (auquel le sujet refuse de toucher), allant avec des rites censés prémunir la sujet contre la réalité qui peuvent être pratiques (rituels) mais également verbales (répétition des toujours mêmes phrase, de toujours la même idée). Ce dont il s’agit, c’est d’un sujet qui essaie de se donner des moyens pour contrôler la réalité qui le menace ; le délire du toucher va en ce sens avec la névrose obsessionnelle et le fantasme défensif de toute-puissance qui l’accompagne. Cf., S. Freud, Freud S., « Obsessions et phobies », in id., Névrose, psychose et perversion, Paris, PUF, 1973. |
| 5 | Sur la dureté pouvant aller jusqu’au désir de destruction de l’autre dû au fait que cet autre se permet d’exprimer des attitudes moralement ou socialement justes à l’égard de la vie que l’individu s’interdit à lui-même en s’endurcissant cf. Th. W. Adorno/M. Horkheimer, « Éléments de l’antisémitisme », in, id. Dialectique de la Raison, Paris, Gallimard, 1979. |











