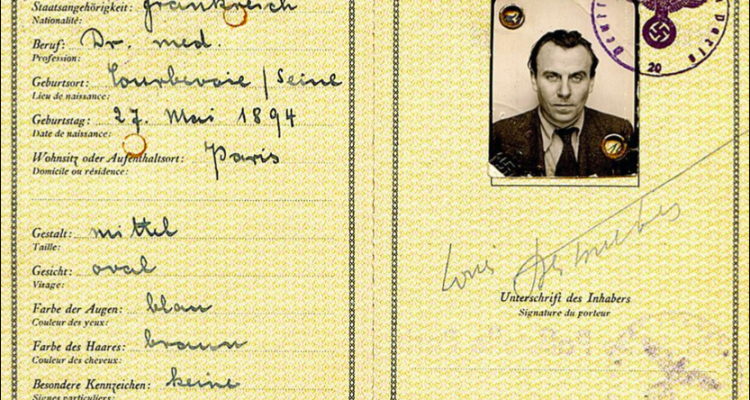Voilà quelques semaines que Gallimard a fait paraître Guerre, le premier des manuscrits inédits de Céline, textes disparus depuis la fin de la guerre et récemment rendus disponibles. Son accueil médiatique est sidérant : une sorte d’extase (quasi) unanime qui épouse sans recul le récit de l’ayant droit de l’écrivain – l’avocat François Gibault, dont la carrière a débuté dans le cabinet de Tixier-Vignacour – faisant du collaborationnisme de Céline et de son antisémitisme exceptionnel une réalité périphérique, à éviter autant que faire se peut dans le discours promotionnel du roman, devenu un best-seller immédiat. Comme le rappelle le spécialiste de Céline, Philippe Roussin, dans K. cette semaine : « Céline est peut-être le seul écrivain dont le patrimoine n’est géré ni par la famille, ni par un éditeur, ni par une fondation, ni par un agent littéraire mais par sa défense. D’où le sentiment d’une œuvre sous tutelle et les biais considérables dans son édition et son interprétation. Cela donne une biographie à décharge [et] l’idée, en 2018, de republier, contre la volonté de l’auteur, les pamphlets antisémites : au total, une entreprise d’effacement, de dé-historicisation et de réécriture visant à réintégrer Céline dans le panthéon national et à en faire une machine à cash. » Au cœur du récit de la défense ? La thèse de l’écrivain lucide comme nul autre à la réalité de la guerre et en croisade contre ses horreurs. Comme l’écrivent Pierre Benetti et Tiphaine Samoyault dans une des rares véritables critiques parues (Comment peut-on lire Céline aujourd’hui ?, En Attendant Nadeau, 5 mai 2022) : « En faisant de Céline un pacifiste traumatisé, on l’absout de toute la violence que son écriture produit sur les êtres qu’elle vise. Comme le reste de l’œuvre, Guerre, tout en étant un puissant récit de convalescence, est un texte de haine et sa haine n’est pas seulement liée à l’expérience du front (nombre de témoins de l’époque s’en sont passés). C’est une haine autorisée, qui a ses cibles favorites, le plus souvent les plus vulnérables et les plus dominés. »
Mitchell Abidor nous avait offert il y a quelques mois un passionnant portrait de Leopold Bloom, le héros d’Ulysse de Joyce. Il fait le portrait cette semaine d’un personnage bien réel, quoiqu’assez romanesque dans son genre, le philosophe Jacob Taubes, à l’occasion de la sortie en anglais de sa monumentale biographie, parue sous la plume de Jerry Z. Muller : Professor of Apocalypse: The Many Lives of Jacob Taubes (Princeton University Press). Issu d’une lignée d’érudits talmudiques, Jacob Taubes (1923-1987) fut considéré par certains comme un génie, par d’autres comme un charlatan, à mesure qu’il arpenta les yeshivas, les monastères et les principales institutions universitaires sur trois continents. Errant entre judaïsme et christianisme, gauche et droite, piété et transgression, il a croisé sur sa routé, et dialogué, avec de nombreux grands esprits de l’époque, de Leo Strauss et Gershom Scholem à Herbert Marcuse, Susan Sontag et Carl Schmitt. La biographie de Jerry Muller montre toutes les tensions de Taubes, les conflits qui traversent sa vie, sa personnalité et son œuvre. Comme l’écrit Mitchell Abidor : « Jacob Taubes était un homme incroyablement compliqué qui s’efforçait d’unir l’impossible. Philosophe de la religion et de la politique, il a passé sa vie à tenter de réconcilier Saint Paul, Jacob Frank et Sabbatai Sevi. Son objectif ultime était le dépassement de la scission entre le judaïsme et le christianisme, en vue de l’explosion de la société existante. Pour Taubes, la Loi juive, à la suite de Paul, n’était plus, puisqu’elle avait été dépassée par l’avènement de Jésus. Et pourtant, dans sa propre pratique religieuse, il était surtout attiré par les sectes juives ultra-orthodoxes de Brooklyn et de Jérusalem, les plus attachées à la Loi qu’il niait intellectuellement comme dans sa pratique théorique quotidienne. »
Pendant des décennies, Anvers fut la plaque tournante du marché du diamant. Et comme le dit un des témoins de ces grandes années à la romancière Nathalie Skowronek, qui fait le portrait d’un quartier et de son activité, « [autrefois à Anvers], nous étions tellement dans la place que les Juifs séfarades et même les Indiens installés à la bourse usaient du yiddish pour faire affaire ». Aujourd’hui, les pierres se négocient aussi à Dubaï, Moscou, Mumbai, New-York et Tel-Aviv. C’est la fin d’un monde que nous raconte Nathalie Skowronek qui s’est promenée dans une ville au milieu des fils, petits-fils et arrière-petit-fils des diamantaires anversois qui comprennent que « pour eux, c’est fichu » et voient que « l’anglais a fini par enterrer le yiddish ».