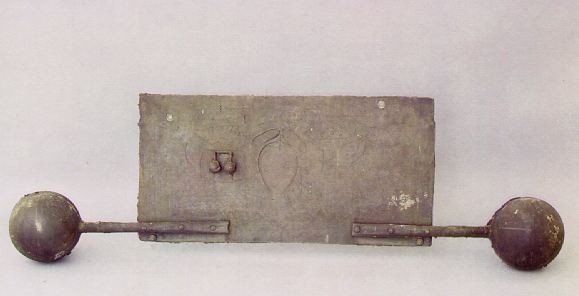Le jugement de la Cour internationale de justice (CIJ) clarifie les coordonnées de la situation telle que l’opinion internationale est appelée à l’appréhender désormais. Rejet, en premier lieu, de l’affirmation de l’Afrique du Sud selon laquelle la guerre menée par Israël à Gaza représente actuellement un génocide au sens condamné par la Convention de 1948. Rejet, aussi, de l’affirmation israélienne selon laquelle le cadre juridique pertinent pour une requête devant la CIJ concernant les responsabilités de l’État juif à Gaza n’est pas la Convention sur le génocide, mais les textes du Droit international humanitaire. En effet, le jugement de la cour établit la plausibilité d’une menace sur les droits des Palestiniens garantis par la Convention de 1948, et prononce donc des mesures conservatoires visant à éviter que ces droits n’en viennent à être effectivement bafoués, c’est-à-dire que le génocide redouté par l’Afrique du Sud finisse par advenir. C’est la prérogative du droit : pas d’être un oracle, mais de fixer un repère commun, et d’avoir autorité pour le faire.
La réponse juridique de la Cour internationale de justice est une chose, mais reste l’effet politique de l’ensemble de la procédure engagée par l’Afrique du Sud. Certes, la Cour n’a pas ordonné à Israël un cessez-le-feu, signifiant par là qu’elle ne pense pas qu’un génocide soit en œuvre du fait de l’opération militaire à Gaza. Cependant, il est notable de voir comment les ennemis d’Israël manifestent un sentiment de victoire. C’est à cette dissonance que le premier des textes que nous publions cette semaine est consacré, s’appuyant en particulier sur la lecture d’un texte d’Aharon Barak, publié sur le site de la CIJ : « Separate opinion of Judge ad hoc Barak ». Ancien président de la Cour suprême, grand défenseur de la démocratie en Israël que le gouvernement de Netanyahou désigne comme un ennemi, Barak a voté – comme juge ad hoc à La Haye pour statuer avec ses collègues sur les accusations de l’Afrique du Sud – en faveur de certaines des mesures conservatoires. Mais sans omettre de souligner que l’Afrique du Sud, en accusant Israël de contrevenir à la Convention contre le génocide, a inversé la réalité politique « en cherchant à imputer à tort à Abel le crime de Caïn ».
C’est aussi à un certain mode d’inversion de la réalité que nous invite à réfléchir Tal Bruttmann dans un entretien qu’il nous a accordé – en partenariat avec Akadem. L’historien de la Shoah et de l’antisémitisme, qui rappelle que « cela fait 40 ans qu’Israël est régulièrement accusé par ses adversaires idéologiques de commettre un génocide » y revient notamment sur ces discours qui considèrent qu’Israël instrumentalise la mémoire de la Shoah en vue de justifier une guerre considérée comme génocidaire, reprenant donc ce trope qui veut que les victimes d’hier soient devenues les bourreaux d’aujourd’hui.
Robert et Gérald Finaly – nés en 1941 et 1942 – sont placés en 1944 au sein d’une institution catholique. Tandis qu’ils échappent ainsi à la déportation, leurs parents sont assassinés à Auschwitz. Après la guerre, leur tutrice refuse de les rendre à leur famille proche. Parmi les motifs qui, d’après celle-ci, justifient leur rétention : le fait qu’ils aient été baptisés. Le philosophe Jean-Michel Rey revient sur « l’Affaire Finaly » et dresse un portrait de la vision qu’avait alors une partie de l’intelligentsia catholique à propos des Juifs et de leur devenir souhaitable selon eux. Où l’on croise le fantôme de Dreyfus, Simone Weil, l’idéologie marcioniste. C’est l’histoire d’une Église qui n’a jamais vraiment renoncé à convertir les Juifs et fait résonner jusqu’en 1950, dans sa prière du Vendredi saint, un « prions pour les juifs perfides… » qui en dit beaucoup sur son désir de les voir, de quelque manière, disparaître.