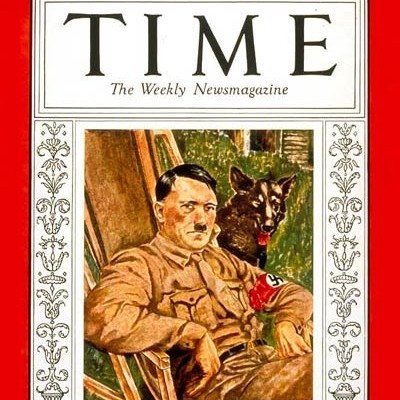Le get, pièce maîtresse du divorce traditionnel, est un acte juridique particulièrement sensible qui semble aujourd’hui concentrer la tension la plus vive entre loi civile et loi juive. Faut-il y lire un lieu d’affrontement ? Astrid von Busekist y voit davantage le lieu de composition d’un pluralisme légal, capable d’honorer la liberté des pratiques religieuses tout en l’infléchissant en direction d’une reconnaissance du principe général d’égalité de tous.

89% des Israéliens qui se déclarent séculiers se prononcent en faveur d’un changement de la législation relative au mariage et au divorce ; 19% seulement des individus qui se déclarent séculiers choisiraient de se marier selon le rite orthodoxe s’ils en avaient le choix ; 68% des Israéliens se prononcent en faveur d’une loi libéralisant le mariage. Le rabbinat et la très grande majorité des orthodoxes ne sont cependant pas prêts à accepter la perte de leur monopole. Le mariage civil existe de facto – un couple peut se marier à l’étranger puis enregistrer son union en Israël depuis 1963, il peut même se marier par zoom[1] – , et les unions civiles sont légales. Cette libéralité de l’État ne résout pourtant pas le problème de la fin du mariage, le get, ce bulletin de divorce que l’on échange, elle offre seulement une alternative à ceux qui ne souhaitent pas se soumettre au circuit rabbinique[2].
La loi est la loi
Nous sommes en Israël, en 2014, et cela fait 14 ans qu’elle attend d’être libérée. Après la découverte de la relation homosexuelle de son mari, elle avait immédiatement demandé le divorce auprès d’un tribunal rabbinique à Jérusalem. Celui-ci met six ans pour examiner la requête, décide finalement qu’elle est justifiée, et ordonne au mari de donner le get. Le mari refuse d’obtempérer. La femme reste enchaînée. Elle l’est pour six années encore : c’est le temps qu’il faut au tribunal rabbinique pour condamner le mari à une peine de prison. La femme avait entretemps porté plainte auprès d’une cour civile pour dommages financiers et détresse émotionnelle. Depuis sa cellule le mari refuse toujours de la libérer. Les enchères montent : il exige désormais que la plainte au civil soit retirée, sinon pas de get. Le président de la Cour suprême rabbinique n’est pas insensible à ce chantage, et, désireux de résoudre enfin cette histoire, menace d’ordonner la mise en liberté de l’homme si la plainte au civil n’est pas levée.
L’épouse, épaulée par une association de défense des agunot, Mavoi Satum, saisit alors la Cour suprême[3]. Celle-ci considère qu’un tribunal rabbinique n’est pas habilité à exiger le retrait d’une plainte. Elle ordonne le maintien en prison du mari. Le tribunal rabbinique propose alors à la femme de renoncer à sa part de l’appartement (valeur estimée : 300.000 NIS). Il se trouve que le mari lui devait déjà environ 1,5 millions de NIS en pension alimentaire [Dans une décision importante, la Cour suprême, sous la présidence d’Aharon Barak, a imposé en 1994 la règle de l’égalité en matière de répartition des biens. Alors que le tribunal rabbinique avait décidé de priver une femme de la moitié des acquêts du mariage sous prétexte que la loi juive ne reconnaît pas la « présomption de coopération », la Cour a jugé qu’une femme ne peut être expropriée lors de la dissolution du mariage.] Contrevenant à la décision de la Cour suprême, le tribunal rabbinique supérieur fait relâcher le mari. Retour à Jérusalem. À la suite des pressions de Mavoi Satum, la femme est entendue à nouveau quelques mois plus tard. Cette fois-ci le Grand rabbin Lau fait partie des dayanim et réussit à convaincre l’homme de renoncer à son chantage et d’accorder le get à sa femme.
La morale de l’histoire ? Le Grand rabbin Lau s’oppose à l’achat d’un Get qui est dû, aux marchandages qui se déroulent « dans l’ombre de la loi[4] », et il a, selon l’avocate de l’épouse, « raisonné en termes de valeurs démocratiques fondamentales, notamment le droit des femmes[5] ».
Nous y voilà. Les histoires de get sont avant tout des histoires de femmes. Il y a certes des cas où ce sont elles qui sont incriminées, elles qui négocient des avantages, elles qui empêchent leurs maris de divorcer, mais ils sont rares. La sanction n’est de toute façon pas comparable, on le sait. Sans get préalable, contrairement au remariage de l’homme, toute union nouvelle a un caractère adultérin pour la femme et s’apparente à un crime capital ; les enfants issus de la nouvelle union sont considérés comme illégitimes, eux aussi adultérins (mamzerim) à la différence des enfants issus d’une nouvelle union de l’homme. Ces enfants ne peuvent contracter de mariage avec un Juif ou une Juive, ils ne peuvent épouser que leurs semblables. Et le stigmate leur survit : ils demeurent mamzerim au-delà de la « dixième génération » (Deutéronome, 23, 2)[6].
Dans la tradition talmudique, le divorce en lui-même n’est pourtant associé à aucun stigmate ; la ketubah est un document qui contient toutes sortes de dispositions et d’arrangements pragmatiques entre époux, notamment les provisions en vue d’une dissolution éventuelle du mariage. Dans Kiddushin (2 a-b) on apprend comment « acquérir » une femme, dans Ketubot (63b, 77a) les bonnes raisons de demander le divorce (les furoncles ou l’incompatibilité sexuelle, l’apostasie). Si le pouvoir de répudiation du mari est presque absolu (Yevamot, 112b, Gittin 90a-b), et les dispositions encadrant le get très strictes, leur caractère prosaïque montre qu’il s’agit d’arrangements de type contractuel. C’est encore pour des raisons pragmatiques que les règles ont été modifiées au XIe siècle sous l’égide du rabbin Gershom de Mayence. Opposé à la polygamie et à l’unilatéralité du divorce, il introduit une disposition qui s’apparente au consentement mutuel entre époux[7]. Ce qui apparaît comme une mesure progressiste signe en vérité la fin du modèle contractuel et prive les époux de règles claires : sans compensations financières, chacun est désormais dépendant du consentement de l’autre et doit négocier les termes pratiques du divorce. Et, en pratique justement, la négociation se fait rarement au détriment de l’homme[8].
Reprenons. Le get doit être donné volontairement, il ne peut être extorqué, il est définitif et se fait en conformité avec les lois de Moïse et d’Israël (« […] Je te libère et te mets de côté pour que tu puisses avoir la permission et l’autorité sur toi-même et marier quelque homme que tu désires. Personne ne peut t’empêcher de ce jour et tu es permise à chaque homme. Ceci est un écrit de dissolution, et un document de liberté en conformité avec les lois de Moïse et d’Israël »[9]). Le billet de divorce est « échangé » devant un tribunal rabbinique qui comprend trois juges.
Ce qui précède montre que les autorités rabbiniques ont un pouvoir étendu, notamment en Israël en raison du double circuit judiciaire. Les rabbins n’hésitent pas du reste à user de moyens extra-légaux comme le blame and shame ou l’interdiction d’accès aux synagogues, mais ils veillent à ne pas compromettre le caractère volontaire du get. C’est dire qu’ils ne sont pas insensibles au fardeau des agunot[10], mais leur position est instable car ils sont aussi les gardiens de la halakha. Les initiatives ne manquent pas, quantité de colloques entre rabbins, universitaires (ou le deux) tentent de trouver une solution satisfaisante pour tous.
Le get est-il un problème posé par la halakha que seule la halakha peut résoudre ? Oui et non. Engagé dans un dialogue timide avec les institutions civiles, le rabbinat invente et s’adapte, avec prudence selon les uns, frilosité selon les autres.
Selon les experts et les militants, les tribunaux rabbiniques sanctionnent rarement les maris récalcitrants, moins encore lorsque les plaignantes sont orthodoxes. Mais il existe des exemples réjouissants où les dayanim jouent pleinement leur rôle de facilitateurs au risque parfois de contrarier leur carrière et de jouer leur réputation, comme Uriel Lavi qui avait décidé de donner le get à une femme dont le mari était dans le coma depuis plusieurs années[11] ; il l’a payé de sa place à la cour suprême rabbinique et a subi des pressions qui confinaient au harcèlement. Sa photo avait été affichée dans les quartiers haredi, la presse haredi l’avait violemment attaqué. Tzipi Livni (Likoud) s’est servie du cas de Lavi pour contraindre les magistrats rabbiniques en les menaçant de ne pas approuver les nominations qu’ils lui proposaient. L’action de Lavi a contribué à enclencher un mouvement important de prise de conscience[12].
La loi de l’État est la loi
Dans la diaspora, le dialogue avec les institutions civiles montre que le droit et la justice peuvent aller de pair, et qu’une inter-légalité originale est possible pour le plus grand bien des agunot. Aux États-Unis, au Canada, au Royaume Uni, le législateur a en effet tenté de résoudre la situation des femmes enchaînées par divers mécanismes de coopération avec le rabbinat. Ici, le sort des femmes se joue à front renversé : les législations civiles sont seules compétentes, mais elles sont liées par leur sphère de justice si je puis dire, elles ne peuvent légiférer que dans leur propre domaine de compétence, le droit de la famille, et elles n’ont aucune prise sur la halakha.
L’histoire de cette entreprise coopérative a connu des hauts et des bas, mais une certaine incertitude juridique aussi jusqu’au vote des « Get Laws » en 1983 et 1992 dans l’État de New York.
Nous sommes aux États-Unis en 1932. Une cour de Pennsylvanie doit statuer sur un accord prénuptial où le mari avait promis de donner le get à sa femme en cas de divorce civil. Elle estima qu’elle n’avait pas « le droit d’ordonner à quiconque d’obtenir un quelconque divorce, qu’il soit civil ou religieux […]. Les tribunaux civils n’ont certainement pas le pouvoir d’ordonner à quelqu’un de suivre les pratiques de sa foi. Cette question dépend entièrement de sa conscience, ou de sa croyance religieuse[13] ». Une décision qui n’est guère différente de ce qui se pratique dans la France laïque. La Cour d’appel de Paris a redit en 2007 que « le gueth (sic) est de nature religieuse et ne peut être apprécié par la justice civile française soumise à son obligation de laïcité[14] ». Le Rapport sur la laïcité dans la justice condamne pourtant cet « immobilisme » juridique, car il est erroné d’affirmer que les condamnations des maris récalcitrants conduirait automatiquement le juge à sanctionner une obligation qui découle de la loi religieuse et donc à accorder à celle-ci des effets civils. « Le juge admettrait [alors] que l’épouse possède un droit à obtenir le get alors qu’elle n’est titulaire que d’un droit à réparation du préjudice qui lui est causé par l’attitude fautive de son mari[15] ». Or il suffirait de distinguer les croyances des pratiques et ne tenir compte que des manifestation concrètes ou les faits observables résultant de la conviction religieuse. Les juristes appellent cela la « factualisation[16] ». S’il y a une incidence grave sur la vie conjugale, le juge devrait avoir la possibilité d’apprécier la rétention du get comme un tort, et éventuellement, par la sanction, au moins retarder le prononcé du divorce civil, comme il est désormais d’usage dans les législations anglo-américaines.
Dans les pays de Common law, le paysage légal a en effet considérablement évolué. On trouve des jugements forts raisonnables sur la dissolution des mariages : « Il est socialement et moralement indésirable de contraindre les couples d’un mariage mort à conserver un statut illusoire et trompeur[17] », dit une décision de 1970. D’autres jugements sont moins délicats dans leur représentation du mariage juif : « Les principes de la loi juive ne sont pas conçus pour promouvoir un équilibre de pouvoir égal entre les parties qui dissolvent leur relation. La loi juive orthodoxe, en accordant au mari une allocation inégale du pouvoir de mettre fin au mariage, permet au mari d’exiger des conditions économiques favorables comme prix du divorce […]. Le mariage en tant qu’institution devrait promouvoir l’égalité plutôt que l’esclavage[18] ». Il existe des dizaines d’exemples comme celui-ci. Certains très explicites dans le but poursuivi : « Puisque l’épouse est âgée de 37 ans, elle fait encore partie de la catégorie des femmes en âge de procréer. Cet aspect de la loi juive affecte donc les droits civils de l’épouse […]. La Common law du vingtième siècle n’est pas rigide au point d’exclure un tel droit du champ d’application des droits civils méritant une protection[19]. »
Quels sont les enjeux ? Dans son dialogue avec le rabbinat, le législateur et le juge doivent s’assurer qu’ils ne contreviennent pas au Premier amendement d’une part, que la liberté religieuse et l’égalité citoyenne soient respectées d’autre part. Pour le rabbinat, il s’agit de contribuer à une législation qui soulage le fardeau des agunot sans enfreindre les règles de la halakha (le get ne peut être ordonné, extorqué), et pour le juge civil de ne pas enfreindre les libertés constitutionnelles. Mais pour cela, il faut qu’il se livre à un exercice délicat de hiérarchisation : de la liberté religieuse ou de l’égalité des femmes et des hommes, quel principe doit-il l’emporter ?
Il faut en convenir, la ligne – entre la préservation de la liberté religieuse et le respect des principes généraux du droit, mais aussi entre les intérêts respectifs des époux – est fine et incertaine.
La liberté religieuse a une double dimension, positive et négative. Positive dans le sens où je dois pouvoir pratiquer ma religion sans contrainte. Négative dans le sens où l’État ne doit pas interférer dans ma pratique privée. L’argument vaut pour les deux époux : le législateur doit prendre en compte la prévention « sincère » du mari à accorder le get à sa femme mais, lorsque celui-ci devient un instrument de marchandage entre des époux placés dans des situations inégales, la liberté religieuse de la femme doit être spécifiquement protégée. Le juge redresse-t-il alors un tort interne à la religion (l’État n’est pas là pour protéger les gens des conséquences de leur affiliation religieuse) ou applique-t-il la règle d’une égalité « restaurative » afin de corriger des normes que n’a pas édictées le législateur civil ?
La réponse la plus claire à cette question fut donné par la Cour suprême du Canada dans un cas fameux, Bruker v. Marcovitz (2007). Résolu par le recours au droit des contrats, la décision affirme que « l’atteinte à la liberté de religion de M. Marcovitz est sans conséquence en comparaison des inconvénients disproportionnés sur la possibilité pour Mme Bruker de vivre pleinement sa vie comme femme juive au Canada[20] ». La rédactrice de l’opinion majoritaire pouvait s’appuyer sur Conseil québécois du statut de la femme qui dit clairement que « le droit à l’égalité des sexes ne souffre pas d’accommodements[21] ».
Cette hiérarchie, cet enchâssement des principes est légitime, du point de vue philosophique, légal et politique. L’égalité prime ici sur la liberté. Ce n’est pas toujours le cas dans les litiges qui impliquent les obligations de croyances. Mais ici le juge a estimé que nier cette hiérarchie reviendrait à dire que le statut de citoyen(ne) est en effet corrompu par l’affiliation religieuse, ce qui va à l’encontre de nos valeurs libérales égalitaires.
Les questions soulevées par ces débats portent en premier lieu sur la latitude du droit et la liberté du juge : de quels instruments dispose le droit pour résoudre des litiges dont l’origine est religieuse ; quelle est la légitimité du juge civil à statuer sur des différends dont l’origine est religieuse ? Coopérer avec les représentants d’un autre ordre c’est admettre la pertinence, pour le droit public, de dispositions dont il ne maîtrise pas les sources. Elles concernent ensuite la protection des minorités (au sein des minorités) dans les sociétés libérales : quelle bonne distance doit-on adopter pour assurer la protection des intérêts minoritaires et le respect de la règle générale ?
La réponse n’est pas simple, il me semble que nos jugements moraux et politiques doivent être informés par le contexte et guidé par une prudence pragmatique. En l’occurrence le danger de contraindre la liberté religieuse des maris en privilégiant l’égalité citoyenne des femmes ne me paraît pas très élevé. La participation des rabbins à la procédure est une garantie de validité halakhique ; le respect de l’égalité entre femmes et hommes une garantie contre une citoyenneté qui serait affectée par nos croyances et nos pratiques. Il est en effet impensable que les croyances deviennent « préjudiciables[22] » et échappent au droit égalitaire.
Dans les affaires de get, il ne s’agit pas de l’immixtion de l’État dans les affaires privés, religieuses, communautaires, ou, au contraire d’une extension du domaine du religieux dans le civil qui provoque aujourd’hui tant de crispations. C’est un exemple de traduction réussi où chacun accepte d’avancer – un peu – sur le terrain de l’autre. Le seuil des interactions entre les démocraties libérales et les communautés de foi n’est pas fixé par avance et qu’il est vain de vouloir désunir le citoyen du croyant. La frontière, on le sait, est précisément ce que deux entités ont en commun
La spécificité des Get Laws est la dimension coopérative entre le civil et le religieux. L’appel astucieux à la vieille règle de la cohabitation respectueuse sous les lois du pays a porté ses fruits : le système judiciaire civil devient un adjuvant et non un concurrent de la halakha, un médiateur ou même une source alternative de législation[23]. Lorsque la religion se rend au tribunal, les meilleures décisions parviennent à trouver cet équilibre pragmatique où les deux sphères, le droit et la loi, s’enrichissent de leur rencontre et effacent temporairement les lignes qui les séparent. Et ce type de pluralisme légal où les parties s’accordent ex ante pour légiférer ensemble, représente un bel exemple de vertu démocratique : respectueux des obligations de croyance, des pratiques religieuses et d’une égalité libératrice pour les femmes.
Astrid von Busekist
Astrid von Busekist est professeur de théorie politique à Sciences Po. Elle dirige la revue Raisons Politiques. Dernier ouvrage paru ‘La Religion au Tribunal. Essai sur le délibéralisme’, Paris, Albin Michel, 2023
Notes
| 1 | Depuis la décision de la Cour de Lod en juillet 2022 les couples peuvent désormais se marier « à distance » [remote appearance marriage] dans l’État de l’Utah aux États-Unis. |
| 2 | Voir Shachar Lifshitz, « Who is Responsible for Finding a Solution to the Plight of Mesoravot get ? », 16 mars 2014. |
| 3 | La loi Mariage et Divorce de 1953 encadre les procédures. Les articles 1 et 2 établissent la juridiction exclusive des tribunaux rabbiniques en matière de mariage et de divorce entre nationaux et résidents juifs selon la loi juive ; les neuf articles suivants détaillent les règles du divorce et de la succession. L’article 6 évoque le get et autorise l’emprisonnement de l’époux récalcitrant, l’article 9 indique que, dans les matières qui ne relèvent pas de l’autorité exclusive des cours rabbiniques, celles-ci sont néanmoins compétentes lorsque les deux parties y consentent. Depuis peu, le partage des bien matrimoniaux n’est plus soumis à l’obtention préalable d’un get. L’article 176 du Code pénal criminalise la bigamie et la polygamie, mais l’article 179 spécifie que cette disposition ne s’applique pas au second mariage des hommes juifs qui ont reçu d’un tribunal rabbinique la permission de se remarier. |
| 4 | Selon l’expression de Robert Mnookin et Lewis Kornhauser, « Bargaining in the Shadow of the Law : The Case of Divorce », Yale Law Review, 88/5, 1979, p. 950-997. |
| 5 | Voir Jeremy Sharon, « Woman Who Was Refused Divorce By Gay Husband For 14 Years Finally Freed », Jerusalem Post, 8 septembre 2014. |
| 6 | C’est ainsi que l’on décrit généralement le statut du mamzer, qui est à la fois une insulte et un stigmate, notamment lorsqu’on traduit, de manière erronée, le terme par « bâtard ». Selon la halakha, ce statut est réservé aux enfants nés d’unions interdites avec une femme « qu’il n’est pas possible d’épouser » pour des raisons diverses qui ne concernent pas seulement le get. |
| 7 | Herem deRabbenu Gershom, Encyclopedia Talmudit, Yad Harav Herzog, 1996, vol. 17, p. 378. |
| 8 | J. David Bleich, « A Proposal to Withhold Divorce Decrees on Grounds of Equity », International Journal of the Jurisprudence of the Family 5, 2014, p. 215-272, p. 217; Irving Breitowitz, « The Plight of the Agunah : A Study in Halacha, Contract, and the First Amendment », Maryland Law Review, 51, 2, 1992, p. 312-421, p. 319-230. Selon une enquête menée par l’université de Bar Ilan et par le Israel Democracy Institute (IDI), un tiers des femmes cherchant à divorcer sont victimes de menaces ou de chantages. |
| 9 | Voir Irving Breitowitz, « The Plight of the Agunah : A Study in Halacha, Contract, and the First Amendment », Maryland Law Review, 51, 2, 1992, p. 312-421, p. 319-230. |
| 10 | À New York un groupe de rabbins a été condamné pour une succession d’expéditions punitives contre des maris récalcitrants. L’un d’eux a écopé d’une peine de prison de 48 mois. Voir Sam Sokol, « New York Rabbis Sentenced For Violently Coercing Divorces », Jerusalem Post, 23 novembre 2015. En mai 2018, le Rabbinat de Grenoble et du Dauphiné envoie un communiqué aux rabbins et responsables communautaires pour demander qu’un fidèle (cité nommément) ne puisse plus être compté dans aucun minyan, ne soit plus admis dans aucune cérémonie religieuse, ne puisse plus monter à la Torah, et soit suspendu de ses fonctions au sein de la communauté. La circulaire demandait par ailleurs que le nom du récalcitrant soit publié « par voie d’affichage communautaire, de presse et sur les réseaux sociaux ». Le document est en ma possession. |
| 11 | Dans un cas rare et célèbre en Israël, le tribunal rabbinique de Safed, dans un document de 91 pages, a prononcé le divorce d’un couple dont le mari était dans le coma depuis sept ans Plonit v. Ploni (2014). Le tribunal était appelé à examiné le get zikkui, un get sans consentement de l’une des parties. Dans une décision très élaborée et en dépit de divers problèmes halakhiques, les rabbins ont accordé le divorce en faisant valoir que celui-ci était dans l’intérêt du mari et qu’il l’aurait autorisé s’il l’avait pu. Voir Yair Ettinger, « Wife With Husband In 7-Year Coma Gets Rabbinical Divorce », Haaretz, 22 mai 2014. |
| 12 | Voir Yair Ettinger, « Rabbinical Judge Who Favored Women’s Rights Blocked From Top Court Promotion », Haaretz, 29 octobre 2015. |
| 13 | Price v. Price, 16 Pa. D. & C. 290, 291 (1932). |
| 14 | CA Paris, 19 déc. 2007, Jurisdata n° 2007-351087. |
| 15 | Voir Elsa Foray, État et institutions religieuses, Presses Universitaires de Strasbourg, 2007, p. 132-133. |
| 16 | Voir Rapport final sur la laïcité dans la justice, p. 359. |
| 17 | Gleason v. Gleason, 26 N.Y.2d 28, 35, 256 N.E.2d 513, 516, 308 N.Y.S.2d 347, 351 (1970). |
| 18 | Golding v. Golding, N.Y. Sup. Ct, N.Y. Law Journal, June 28, 1990, cite par S. Stone, « The Intervention Of American Law in Jewish Divorce », Israel Law Review, vol. 34, 2000, pp. 171-210, p. 196. |
| 19 | Morris v. Morris, 42 D.L.R. (3d) 550 (C.A. Man.), Freedman, opinion minoritaire p. 558-560. Freedman ajoute : « [l]e fait que le contrat [de mariage] soit profondément empreint de considérations religieuses n’est pas déterminant quant à la question en litige. […] Il semble que la véritable raison pour laquelle on s’oppose à l’exécution du contrat tienne simplement au fait qu’il s’appuie sur la religion et que, pour des motifs d’intérêt public, la Cour devrait rester en dehors de ce domaine. Mais les recueils de jurisprudence font état de nombreux cas de tribunaux saisis de litiges ayant une origine ou un fondement religieux. […] Confrontés dans chaque cas à un droit temporel quelconque, les tribunaux n’ont pas hésité à se prononcer sur celui-ci. ». |
| 20 | Bruker v. Marcovitz, [2007] 3 R.C.S. 607, 2007 CSC 54. L’ensemble du jugement est disponible ici : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2397/index.do., ici §92-93. |
| 21 | Droit à l’égalité entre les femmes et les hommes et liberté religieuse, Conseil du statut de la femme, Québec, 2007. |
| 22 | L’expression est de Louis-Philippe Lampron, La hiérarchie des droits. Convictions religieuses et droits fondamentaux au Canada, Bruxelles, Peter Lang, 2012, p. 125. |
| 23 | C’est la vision forte défendue par Suzanne Stone, « The Intervention Of American Law In Jewish Divorce : A Pluralist Analysis », Israel Law Review, 34, p. 171-210, p. 204. |