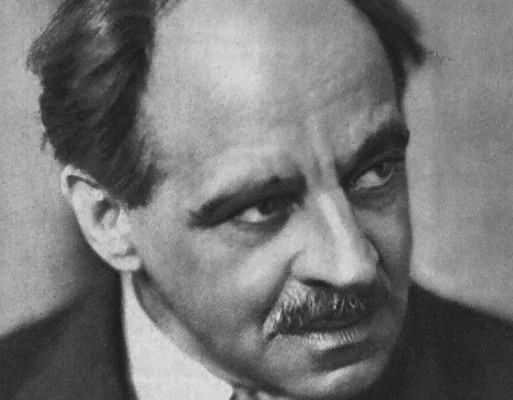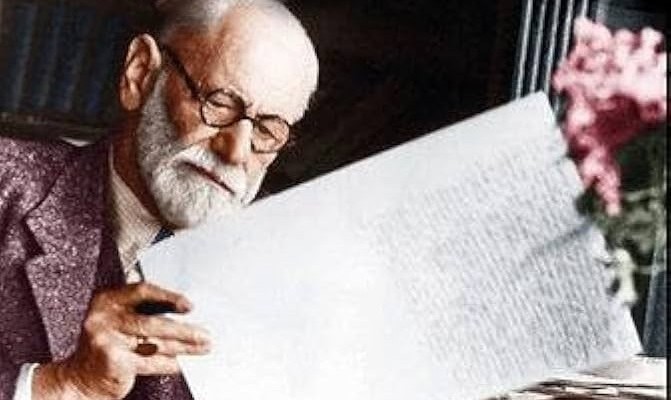En recevant le prix littéraire Elisabeth Langgässer en 2012, Barbara Honigmann a prononcé un discours qui représentait un défi pour elle. Car comment faire le portrait de cette fameuse écrivaine allemande, fervente catholique, si problématique à ses yeux ? Parce que « demi-juive », Elisabeth Langgässer fut interdite de publication par un régime nazi dont elle voulait tant qu’il l’absolve de son origine qu’elle écrivit à Goebbels pour lui demander d’être réintégrée au sein de la Chambre de la littérature du Reich, arguant que son talent provenait exclusivement de sa lignée maternelle, purement aryenne…

Est-ce une dédicace, ou une devise, qu’Elisabeth Langgässer place en tête de son roman Le sceau indélébile ? Commystis commito – « Aux co-initiés ». Les mystes, ce sont les initiés.
Voilà pourquoi il m’est difficile de lire les textes d’Elisabeth Langgässer. Je n’ai pas le sentiment d’être une co-initiée, c’est-à-dire une personne à qui le livre est dédié, une personne pour qui il a été écrit. En revanche, quand je vois écrit To the happy few, la célèbre dédicace de Stendhal, qui est aussi une devise, je me sens, bien évidemment, concernée, même si la différence entre les happy few et les commystis tient à une nuance infime, mais il y a, dans l‘espace de cette nuance, moins de mystère, moins d’obscurité.
Peut-être suis-je un des ultimes rejetons des Lumières, en tout cas, je n’éprouve aucun penchant pour les choses mystiques, et ce qui m’attire dans le judaïsme, c’est son côté clair, sa face diurne, et non son côté mystique, kabbalistique, qu’étonnamment, tant de non-Juifs considèrent comme son trait spécifique. C’est tout le contraire.
Je suis donc juive. Le Prix Langgässer représente pour moi un certain défi, l’œuvre d’Elisabeth Langgässer, sa personne, son histoire me semblant difficiles et problématiques.
Bien sûr, je dois l’accepter dans sa foi catholique et je le fais, mais je ne peux prendre part au combat qu’elle dépeint tout au long de son œuvre, et ce, dans une langue prodigieuse, intemporelle, ce combat mettant aux prises Dieu, Satan, la Providence, la tentation, la résurrection, la divinité du Christ et les Juifs qui, bien que baptisés, demeurent dans l’hésitation, ainsi que l’avènement de leur rédemption et leur renaissance pleines de grâce. Cela vient notamment du fait que tous ces mots que l’on retrouve à toutes les pages servent à véhiculer le message du Christ, que plusieurs générations de mes ancêtres n’ont d’ailleurs pas entendu ou n’ont pas voulu entendre. Qui plus est, je n’aime pas trop les textes porteurs de messages.
Mais d’autres lecteurs d’Elisabeth Langgässer auront aussi des difficultés s’ils ne maîtrisent pas suffisamment le latin pour comprendre cette dédicace qui – volontairement, qui sait ? – les exclut d’emblée, tout comme ils ne parviendront sans doute pas non plus à transposer dans leur propre langue et leur propre réalité ses innombrables références et métaphores issues de la mythologie gréco-romaine, ni à comprendre grand-chose à ses enseignements chrétiens.
Je ne connaissais pas le nom d’Elisabeth Langgässer avant de le découvrir dans l‘autobiographie de Cordelia Edvarson [traduite en allemand sous le titre Gebranntes Kind sucht das Feuer – litt. « chat échaudé cherche l’eau froide »]. Dans la bibliothèque de mes parents, source de mes premières lectures, il y avait les classiques ainsi que des œuvres de Heine et de Rilke, de Mann et de Brecht et aussi une édition, probablement incomplète, des œuvres complètes de Sigmund Freud, publiée par sa fille à Londres (chez Imago), d’où mes parents l’avaient rapportée. Ma mère l’avait ensuite offerte à un ami psychiatre en RDA, qui avait dû être très heureux de ce cadeau, car, bien évidemment, Freud n’était pas édité en RDA. Il y avait aussi Les Thibault, roman de Roger Martin du Gard, Prix Nobel de 1937, un écrivain français du renouveau catholique, dont Langgässer s’est beaucoup inspirée dans les années 1930. Mais, dans la bibliothèque de mes parents il n’y avait aucune œuvre d’Elisabeth Langgässer, et je ne me souvenais pas non plus d’avoir entendu son nom.
C’est dans l’histoire extraordinaire de la survie de sa fille Cordelia – toutes les histoires de survie sont extraordinaires – que je la rencontre pour la première fois, non pas en tant qu’auteur d’une de ses œuvres, mais décrite sous l’angle d’une relation mère-fille compliquée, c’est le moins que l’on puisse dire. Dans ce livre, sa fille raconte quarante ans plus tard, bien après la mort d’Elisabeth Langgässer, l’histoire que sa mère n’a pas racontée, ou, plus exactement, elle rectifie ce que celle-ci n’a fait qu’évoquer de son propre point de vue. Dans une langue claire, sans recourir à une pléthore de termes métaphysiques, elle décrit sa déportation et sa survie à Auschwitz, un lieu bien plus sombre que ne peut l’être toute expérience mystique.
Peu de temps après avoir appris que sa fille a survécu, Elisabeth Langgässer envoie une lettre à celle-ci pour lui demander de lui rendre compte par écrit de son expérience à « A. » ; elles ne se reverront qu‘une seule fois par la suite. Elisabeth Langgässer n’écrit pas le nom d’Auschwitz en entier. Seulement A. En est-elle incapable, n’ose-t-elle pas, faut-il déjà y voir une forme de banalisation ? Sans doute, sinon elle n’affirmerait pas, dans cette même lettre : « En fait, je sais tout [souligné d’un trait], mais ce dont j’ai besoin [besoin!], ce sont des visions réelles ! »
La lecture de ces lignes me donne des frissons, ces propos me révoltent, je n’y perçois aucune sensibilité, en fait, je les trouve indécents. Mais, bien sûr, il m’est très aisé de m’emporter et de juger, de condamner même, ou d’être horrifiée par cette autre lettre datant de 1933, dans laquelle elle supplie d’être réintégrée dans la Chambre de la littérature du Reich, dont elle a été exclue en vertu des lois raciales – bien qu’ayant été baptisée dans la foi catholique, elle était considérée comme demi-juive. Comme arguments, elle mentionne le fait que son talent artistique provient exclusivement de sa lignée maternelle, purement aryenne, qu’elle est en plus mariée à un Aryen et que les maisons d’édition juives l’ont toutes plus ou moins boycottée. N’obtenant pas de réponse, elle décide de s’adresser directement à Goebbels en invoquant les mêmes arguments. Évidemment, celui-ci ne lui répond pas non plus. Elle continue alors, sans grand succès, à tout mettre en œuvre pour rester présente sur la scène littéraire allemande ; elle ne recherche « l’exil intérieur » que lorsque plus aucune autre solution ne s’offre à elle. L’idée d’émigrer ne semble jamais lui avoir traversé l’esprit, alors que ses collègues, amis proches et connaissances quittent le pays les uns après les autres.
Sa correspondance de l’époque la montre à fleur de peau et pleine de suffisance. Je comprends : les temps sont durs, elle veut s’affirmer en tant qu’écrivain, sa position est fragile et menacée, et va le devenir encore plus. Les efforts qu’elle déploie pour s’adapter ne mènent en effet à rien, les lois raciales du Troisième Reich lui interdisant définitivement toute publication.
Au même moment, en 1933, la carmélite Edith Stein écrit son autobiographie Vie d’une famille juive. Il est peut-être injuste de comparer ces deux figures, Elisabeth Langgässer et Edith Stein, mais cette comparaison s’impose à moi. Edith Stein, de dix ans à peine l’aînée d’Elisabeth Langgässer, était manifestement une femme beaucoup plus intellectuelle ; elle a rédigé sa thèse de doctorat sous la direction d’Edmund Husserl et est devenue son assistante à l’université de Fribourg en même temps que Heidegger. Ayant traversé des périodes d’athéisme et d’engagement féministe, elle s’est intéressée aux « questions féminines », sur lesquelles Elisabeth Langgässer a maintenu une position particulièrement conservatrice, invoquant un idéal de maternité et de domesticité auquel, à vrai dire, elle ne correspondait pas du tout dans la vie.

Edith Stein s’est convertie au catholicisme en 1922, à l’âge de 31 ans, dans la petite ville de Bergzabern, non loin de Darmstadt, là où Elisabeth Langgässer travaillait alors comme institutrice. Quelques années plus tard, elle entre au Carmel de Cologne. Dès 1933, à la suite des premières lois et actions anti-juives, époque où elle écrit son autobiographie, elle s’adresse au pape Pie XI, le conjurant, dans des lettres qu’il n’a probablement jamais lues, de rompre son silence : « Nous craignons le pire pour l’image de l’Église si le silence se prolonge. » Lorsqu’elle se fait arrêter avec sa sœur dans un couvent des Pays-Bas, où elle a été transférée entre-temps, elle aurait dit à celle-ci, avant leur déportation : « Viens, nous partons pour notre peuple. »
Ce sentiment d’appartenance au peuple juif, Elisabeth Langgässer ne l’a jamais éprouvé, et elle n’a probablement jamais été en mesure de l’éprouver, du fait, sans doute, qu’elle est longtemps restée dans l’ignorance des origines juives de son père ; aussi est-il difficile, dans son cas, de parler d’une quelconque identité juive qu’elle aurait pu revendiquer, même si on lui en a ensuite imposé une qu’elle a payée au prix fort.
Ceux qui s’intéressent aujourd’hui à Elisabeth Langgässer ont conscience que son œuvre a été éclipsée par son histoire personnelle, celle-ci étant plus dramatique et plus tragique que tout ce qu’elle a écrit. Le « roman de sa vie » dévoile bien plus sur les contradictions et les problèmes insolubles auxquels un être humain, une femme avec un enfant juif, illégitime de surcroît, est confronté sous un régime totalitaire.
Au lieu de s’exiler, comme l’ont fait tant de ses collègues écrivains et amis proches, même non juifs, avec qui elle restera longtemps en contact épistolaire, Elisabeth Langgässer se retire dans ce qu’elle appelle son exil intérieur ; elle se crée un monde parallèle en écrivant son grand roman imprégné de mythologie chrétienne Le sceau indélébile ainsi que des poèmes mystiques sur la nature, alors que pendant ce temps-là, sa fille, elle, porte l’étoile jaune, que Berlin, où elle vit désormais, se fait bombarder et que des convois de déportation partent à trois rues de chez elle, depuis la gare de Grunewald.
Georges Bernanos, en revanche, un écrivain qu’elle admire et qui est lui aussi un représentant du renouveau catholique français, en tire immédiatement les conséquences bien qu’il soit très conservateur, voire monarchiste : il part en exil et exprime en termes clairs son rejet aussi bien du régime de Franco que de celui de Vichy, en profitant ainsi pour régler ses comptes avec eux. Et même s’il a prononcé une phrase qui fait encore débat aujourd’hui – « Hitler a déshonoré l’antisémitisme » –, il a par la suite clairement révisé son antisémitisme chrétien, congénital, si je puis dire – mais celui-ci ne transparaît pas dans ses œuvres.
« Que sont donc ces temps, où/ Parler des arbres est presque un crime/ Puisque c’est faire silence sur tant de forfaits ! », écrivait Brecht, alors en exil en Suède. La poétesse, installée à Berlin, ne semble pas avoir la même perception des choses : elle se réfugie dans ses poèmes sur la nature et dans le roman, qui lui permet, comme elle le dit elle-même, de se créer un temps d’ascèse et de recueillement. Dès les années 1930, elle se compte parmi les « les gens paisibles du pays », une expression désignant tout un groupe d’écrivains chrétiens qui se sont retirés du monde national-socialiste pour se replier dans un monde intérieur chrétien, tournés vers l’isolement et la prière.
L’expression « les gens paisibles du pays » est empruntée au psaume 35. Le terme que la Bible chrétienne traduit par « paisible » est un mot hébraïque, qui, étant rarement employé, a fait l’objet de nombreux commentaires et interprétations. Par analogie avec Job 7 : 5, Rachi et Menahem Hameïri, grands exégètes juifs du Moyen-Âge, l’ont traduit par « cœur brisé » et l‘identifient dans leur commentaire comme une métaphore du peuple juif, dont les ennemis imaginent toutes les stratégies possibles pour les calomnier et se réjouissent de le voir souffrir et se faire sans cesse déporter d’un endroit à l’autre – « Ah! Ah! Nos yeux regardent », dit le verset suivant dans le psaume 35. Je trouve intéressant de voir comment les persécutés aux cœurs brisés sont ensuite devenus les « gens paisibles » dans la lecture chrétienne.
J’ai du mal à comprendre cette notion « d’exil intérieur », car où, « à l’intérieur », doit-il y avoir un exil ? Ne s’agit-il pas plutôt d’un euphémisme pour désigner une posture où l’on préfère détourner le regard, où l’on se rêve vivant à une autre époque, espérant des jours meilleurs ? Ne devient-on pas ainsi un outil du système, du moins un rouage, est-ce ainsi que l’on prend la fuite ? Cette problématique est valable pour tous les régimes totalitaires – à quel moment l’adaptation se transforme-t-elle en collaboration ? Et le système ne peut-il se maintenir que tant qu’il est soutenu par tous ? Il n’est pas agréable de s’interroger sur son degré de complicité individuelle avec un système totalitaire, on préfère se sentir victime.
À propos d’Anna Seghers, qui a survécu à la période nazie en se réfugiant au Mexique après avoir effectué plusieurs escales, Elisabeth Langgässer écrira que celle-ci est « revenue de contrées plus naturelles. » Qu’entend-elle par-là ? Probablement la même chose que la plupart des autres écrivains de « l’émigration intérieure », à savoir que ceux qui étaient rentrés d’exil avaient assisté à la tragédie allemande depuis des loges confortables (des contrées plus naturelles), selon la formule utilisée dans la controverse devenue célèbre entre Frank Thieß, un écrivain de « l’émigration intérieure » que plus personne ne connaît, et Thomas Mann, et qu’Elisabeth Langgässer reprend également dans une lettre adressée à son ami catholique Karl Thieme, émigré en Suisse.
Je trouve que pour une fervente chrétienne cherchant à transmettre le message chrétien dans toutes ses œuvres, Elisabeth Langgässer, se plaint trop, dans ses lettres, d’avoir été elle-même une victime, au lieu de ressentir et d’exprimer de la gratitude pour le fait d’avoir été épargnée. Ne serait-ce pas agir en bon chrétien que de ne pas faire étalage des dangers auquel on a été confronté, du moins pas à ceux qui ont choisi l’exil et qui ont souvent réussi à l’atteindre non sans dommages ? Mais visiblement, Elisabeth Langgässer n’acceptait pas le fait que ces exilés puissent se sentir déracinés, désespérés et en détresse. « Près de trois ans après la guerre, un homme d’esprit, qui plus est un persécuté, ne vit encore que d’aumônes aléatoires. Il y a quelque chose qui ne va pas », se lamente-t-elle auprès de son ami Waldemar Gurian, qui a émigré en Amérique et à qui elle demande de lui trouver d’urgence des commandes, notamment pour une chronique régulière dans un journal américain.
Il est vrai que les Juifs se sentent toujours offensés, trahis même, lorsqu’ils apprennent que l’un des leurs s’est converti à une autre religion, en général au christianisme. Les Juifs considèrent cela comme une désertion, une marque de lâcheté que de ne plus vouloir partager leur destin en tant que minorité et de croire qu’en se faisant baptiser, on se fera une place plus confortable au sein de la société majoritaire – ce que Heinrich Heine appelait « le ticket d‘entrée dans la société ». Je dis bien « croire » car les Juifs baptisés furent pendant longtemps encore tenus pour des Juifs, ce n’est qu’après qu’ils furent reconnus comme baptisés, bien avant que les nazis, conformément à leur idéologie raciale, voient le baptême comme un fait dénué de toute signification. Toujours est-il que de nombreux Juifs appartenant à l’élite culturelle ont manifestement accepté le baptême par conviction religieuse, et en aucun cas par opportunisme social.
Pourquoi en était-il ainsi ?
Depuis que les Juifs vivent en diaspora, et cela fait déjà un bon moment, ils ont développé leur conscience juive en confrontant les riches contenus de la Torah et du Talmud à partir de points de vue toujours différents, contenus qu’ils se sont sans cesse réappropriés et ont toujours réinterprété en fonction des époques et des lieux. « L’instruction », comme on l’appelle généralement, était la patrie des Juifs, qui, au demeurant, vivaient en exil parmi les autres peuples dont ils étaient séparés par des frontières bien délimitées, avec, bien sûr, toujours l’espoir que cet exil prenne fin un jour. Dans le Premier livre des Chroniques (16 : 21), on trouve ce verset : « Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Le Talmud, quant à lui, l’interprète ainsi : « Mes oints, ce sont les écoliers, et les prophètes, ce sont nos savants. »
L’instruction et le savoir sont les seules traditions susceptibles de transmettre un sentiment d’appartenance juive car, contrairement à l’opinion largement répandue selon laquelle le judaïsme se nourrit principalement de la mémoire, celui-ci vit en permanence dans le présent. En effet, s’il n’a pas de présent qu’on puisse mettre en lien avec les textes, il n’est qu’un musée juif, et ce, malgré tous les efforts que l’on déploie pour entretenir le culte, les rites, la cuisine casher et une culture quelconque. Et c’est précisément ce musée juif que les Juifs ont quitté, dès lors qu’ils se sont émancipés et se sont retrouvés sur le grisant « chemin de la liberté ». Ce musée leur paraissait tellement ennuyeux, comparé à Goethe et Schiller et à toutes les conquêtes de la modernité.
Eduard Langgässer, le père d’Elisabeth, était originaire de Mayence, l’une des plus anciennes communautés juives d’Allemagne, la communauté des martyrs de l’an 1096, époque où les croisés de la première croisade, en route pour la Terre Sainte, avaient déjà « vengé le sang de Jésus » sur les Juifs qu’ils rencontraient dans les villes de la plaine du Rhin. Certes, les Juifs les ont affrontés aussi avec des armes, « petits et grands ceignirent leurs reins », peut-on lire dans un récit contemporain, mais ils n’avaient guère de chance contre les croisés aguerris et avides de sang, ni contre la populace, toujours prompte à attaquer les Juifs. Les évêques ont certes tenté de protéger ces derniers, mais sans succès. La communauté de Mayence a disparu dans un suicide collectif. On leur avait donné le choix entre le baptême et la mort, et ils ont choisi la mort. Cet événement a fait l’objet de récits, aussi bien de la part de Juifs que de non-Juifs ; l’un des témoignages les plus marquants est le chant poignant intitulé « Une Tane Tokef », que nous chantons encore aujourd’hui lors du long office de Roch Hachana et à Yom Kippour ; il est d’ailleurs connu d’un large public non juif grâce à la chanson « Who by fire » de Leonard Cohen, qui reste très proche des derniers versets de l’original en hébreu.
Ce texte poétique, le père d’Elisabeth Langgässer a dû l’entendre en version originale, en hébreu, dans la synagogue de son enfance et de sa prime jeunesse, et il ne l’a sans doute pas compris, tout comme il ne devait pas comprendre le reste des prières que l’on y chantait au son de l’orgue. Il est probable qu’Eduard Langgässer, tout comme Franz Kafka, qui le reproche à son père dans sa Lettre au père, ne se sera jamais autant ennuyé de sa vie qu’à la synagogue.
Il existe un nombre infini de témoignages sur ces Juifs qui s’ennuient, leurs pères aussi, déjà, s’ennuyaient. Joseph Roth le décrit ainsi : « Ils ne prient plus dans les synagogues ou dans les maisons de prière mais dans des temples ennuyeux où le service divin est célébré de manière aussi mécanique que dans le premier temple protestant venu. Ils deviennent des « Juifs du temple », c’est-à-dire des messieurs bien élevés, parfaitement glabres, en redingote et chapeau haut-de-forme, et enveloppent le livre de prières dans l’éditorial dans leur journal juif, parce qu’ils croient qu’on les reconnaîtra moins facilement à cet éditorial qu’au livre de prières. […] Leurs grands-pères luttaient encore désespérément contre Iahvé, ils se faisaient mal à la tête à force de se jeter contre les murs tristes de la petite maison de prière, ils appelaient à grands cris le châtiment de leurs péchés et imploraient le pardon. Leurs petits-fils sont devenus occidentaux. Ils ont besoin de l’orgue pour se mettre dans l’atmosphère, leur Dieu est une sorte de puissance naturelle abstraite, leur prière est une formule, et ils en sont fiers ! […] On appelle cela avoir une culture occidentale[1] ». Combien ont déploré ce « judaïsme du temple » vidé de sa substance ! Certains d’entre eux se sont alors convertis au christianisme, Hermann Broch, Edmund Husserl, Max Scheler, Joseph Roth, Alfred Döblin, pour ne citer que des noms connus.
Il y avait donc un grand malaise dans cette culture juive assimilée qui avait assimilé la judéité à la culture environnante jusqu’à ce qu’il ne reste pratiquement plus rien de la lutte avec Dieu dont Israël tire finalement son nom, cette lutte devenue une espèce de convention, une coutume seulement maintenue par courtoisie, pour ainsi dire. Le vide spirituel n’a pas été comblé pour autant. Plusieurs générations ont mobilisé toute leur énergie pour s’adapter, croyant qu’il leur était possible de se « fondre dans un environnement qui, dans l’ensemble, était indifférent ou peu bienveillant à leur égard », comme le constate Gershom Scholem dans ses mémoires De Berlin à Jérusalem. « La capacité à se tromper soi-même fait partie des aspects les plus importants et les plus désolants des relations entre Juifs et Allemands. »
Dans ses journaux et ses lettres, Franz Kafka écrit lui aussi de longs passages sur ce malaise qui imprègne la culture juive occidentale, il se déclare lui-même le plus occidental de Juifs occidentaux tout en déplorant cette situation, car pour le Juif occidental « tout doit être conquis, non seulement le présent et l’avenir, mais encore le passé, ces choses que tout individu a pourtant reçu en partage, même cela il faut le conquérir, et c’est peut-être la tâche la plus rude. »
Ce vide accumulé est sans doute aussi à mettre au compte du judaïsme rabbinique traditionnel, qui n’a pas trouvé de véritable réponse au processus d’émancipation qui a ouvert la voie vers une société plus ouverte. À l’Est, en Lituanie et en Pologne, les écoles talmudiques classiques et les communautés hassidiques parvenaient encore à se maintenir, mais les métropoles juives de l’Ouest, les capitales de l’empire austro-hongrois, Vienne, Budapest et Prague, mais aussi Berlin, Breslau et Francfort ont délaissé ces modèles, les considérant comme « démodés ».
Certes, la néo-orthodoxie, rattachée au nom de Samson Raphael Hirsch, rabbin de Francfort, a tenté de relier à la Torah ce qu’elle considérait comme une culture moderne, tout en s’inspirant de la culture conservatrice de la période wilhelmienne. Hirsch a, par ailleurs, inventé le mot d’ordre Tora im derech erez, la Torah dans le monde, synthèse entre la Torah et la culture au sens large, un projet de restauration qui mourra avec la Shoah. Les représentants de la néo-orthodoxie ont cherché à se démarquer des efforts de réforme entrepris pour transformer la synagogue en un « temple » dans lequel les messieurs glabres, en redingote et chapeau haut-de-forme, espéraient ne plus être reconnaissables en tant que Juifs, tout en étant pourtant encore « hantés par une nostalgie communautaire », comme dit Kafka, qui s’y inclut naturellement.
« L’apprentissage, ce en quoi réside la clé du judaïsme », comme l’a aussi constaté le rabbin Joseph Carlebach au retour de son voyage chez les Juifs d’Europe orientale, a été abandonné en Europe occidentale au profit de représentations théâtrales comme La vie juive, dans laquelle le travail social juif, les associations culturelles, sportives, artistiques et autres ont joué un rôle important et utile, tout en laissant néanmoins l’essentiel de côté. D’aucuns ont estimé que ces activités associatives ne satisfaisaient pas leurs aspirations à une vie juive authentique, car elles ne leur donnaient pas accès à ses trésors intellectuels, ni aux textes talmudiques et post-talmudiques, ni à leurs nombreux commentaires. Plus tard, grâce à la Libre Maison d’Études juives, qu’il avait fondée à Francfort, Franz Rosenzweig a cherché à ramener au judaïsme ces « Juifs cultivés qui voyaient leur patrie spirituelle et intellectuelle en dehors du judaïsme ».

En réaction à ce vide, d’autres s’engageront dans le mouvement communiste qui voit le jour au début du XXe siècle. Ils auront pour idée de créer une société messianique, idée au profit de laquelle le judaïsme a perdu un nombre relativement important de ses enfants, dont mes parents. Mais c’est surtout dans les années qui ont suivi la Première Guerre mondiale qu’on voit émerger de nouveaux espoirs de rédemption au sein du monde juif en mal de repères.
La troisième voie a été celle du sionisme. Celui-ci est devenu une boussole pour de nombreux Juifs, allant jusqu’à les ouvrir à une sorte d’éveil. Partisan, lui, du sionisme culturel, Martin Buber a mobilisé toute une génération de jeunes Juifs en quête de leur âme juive. Beaucoup d’entre eux, soldats lors de la Première Guerre mondiale, avaient à ce moment-là, retrouvé leur fierté d’être juifs, au contact des Juifs de l’Est. C’est dans les tranchées que Franz Rosenzweig, qui avait résisté de justesse à la tentation de se faire baptiser, a écrit non seulement son grand ouvrage L’Étoile de la Rédemption, mais aussi d’innombrables lettres adressées à sa mère, dans lesquelles il lui fait part de ces rencontres en disant que « le Juif allemand moyen ne ressent plus aucune proximité avec ces Juifs d’Europe orientale, […] Le voilà devenu un vrai Philistin, un vrai bourgeois ».
Certains Juifs allemands se sont donc tournés vers l’intérieur du judaïsme, l’idée du sionisme leur ayant fait prendre conscience qu’il n’y avait pas moyen de revenir en arrière, à une époque antérieure à l’émancipation, et qu’il leur fallait désormais s’émanciper en tant que nation. Dans ses Trois discours sur le judaïsme prononcés à Prague devant un public nombreux, dont Kafka et Brod et tout le cercle Bar Kochba, Martin Buber a invoqué le « renouveau juif », une renaissance par le biais d’un retour au « judaïsme originel ». Les sionistes croyaient (et croient encore) que cette œuvre ne pouvait se réaliser que sur « la terre de nos pères ». C’est ainsi que très tôt, de nombreux juifs re-judaïsés sont partis en Palestine pour y construire des institutions culturelles, des bibliothèques, des centres d‘archives, une université. Mais ils sont ainsi restés dans la culture. Il y a une petite anecdote qui raconte que lorsque ces messieurs construisaient quelque chose en Palestine, ils se passaient les briques en se disant : « tenez, docteur », « merci, docteur ».
Même Kafka avait envisagé de se rendre en Palestine, son ancien ami d’école Hugo Bergmann, futur premier directeur de la bibliothèque nationale et universitaire de Jérusalem, lui avait préparé un lit dans son petit appartement. Or, ce n’est pas lui, mais Gershom Scholem qui a passé là ses premiers jours et premières nuits après son arrivée en Terre Sainte.
Dans les années 1920, Franz Rosenzweig et Martin Buber ont retraduit la Bible hébraïque et l’ont intitulée L’Écriture. Il s’agit, après la traduction de Mendelsohn et celle de Leopold Zunz de 1838, d’une nouvelle traduction juive, mais l’objectif est complètement différent. Alors qu’en 1783, Mendelsohn a écrit son texte allemand en caractères hébraïques afin d’inculquer l‘allemand aux Juifs allemands qui parlaient le dialecte judéo-allemand, Buber et Rosenzweig, ont, quant à eux, cherché à donner aux Juifs allemands du XXe siècle, devenus ignorants de l’hébreu, une idée de ce qui se trouve dans l’original hébraïque. Cette œuvre connut un vif succès en son temps, aussi discutable que puisse nous sembler aujourd’hui son langage archaïque et néoromantique déjà critiqué à l’époque. Mais si quelqu’un comme moi l’utilise comme aide pour lire le texte en hébreu, c’est qu’elle peut aujourd’hui encore s’avérer riche d‘enseignements.
À peu près au même moment, Micha Josef bin Gorion se lance dans la compilation et l’édition des Légendes des Juifs, entreprise qui sera achevée après sa mort, en 1921, par son fils Emanuel, un ami proche d’Elisabeth Langgässer. Les Légendes des Juifs sont les textes aggadiques, le midrash, c’est-à-dire les récits, contes et légendes qui entourent et traversent le Talmud et les écrits rabbiniques et qui, tout comme les discussions plus interprétatives, sont source « d’apprentissage » puisqu’ils font pour ainsi dire écho aux passages auxquels ils se réfèrent et qu’ils exploitent et interprètent à l’extrême dans leurs sous-textes et métatextes de manière poétique, parfois aberrante et paradoxale. De grands trésors de la tradition juive ont ainsi été mis à la disposition d’un large public de lecteurs qui, ne maîtrisant plus l’hébreu, les ont alors remisés sur une étagère à côté de leur Goethe ou bien les ont lus en groupe dans une maison d’études juives ou un foyer juif.
Cela dit, la renaissance juive tant espérée n’a pas eu lieu, du moins pas en Allemagne, où se préparait en même temps la domination de ceux qui avaient décidé l’extermination des Juifs et s’apprêtaient à la mettre en œuvre. Les Juifs assimilés et ceux qui cherchaient à faire revivre leur judaïsme, les Juifs orthodoxes et les Juifs athées, les Juifs socialistes et les Juifs communistes, les Juifs conservateurs et les Juifs nationalistes allemands, ainsi que les Juifs baptisés, hommes, femmes, enfants ou vieillards, tous furent expulsés, assassinés, et pas qu’en Allemagne. Seuls les sionistes, qui avaient émigré très tôt en Palestine, ont été épargnés et ont ainsi été confortés dans leur projet.
C’est après la guerre que la renaissance juive s’est concrétisée, en Israël et aux États-Unis ainsi qu’en France, où une nouvelle génération de Juifs cherche à réinventer son ancienne identité en développant de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles conceptions de la vie, dans plein de courants différents. Cela implique également de réussir à comprendre, sous un angle à la fois historique et religieux ce que l’on appelle depuis peu la « Shoah » et que l’on appelait auparavant « l’Holocauste », deux termes issus de langues étrangères qui, à mon sens, masquent plus qu’ils ne nomment des mots comme persécution, extermination, assassinat. On a souvent parlé de l’absurdité de cette tuerie de masse, et l’emploi du terme Holocauste, qui désigne un sacrifice, plus précisément un sacrifice où la victime est entièrement brûlée, provient peut-être de la volonté de donner un sens à cette tuerie. Dans son dernier roman, Märkische Argonautenfahrt (Les Argonautes dans la Marche de Brandenbourg – pas traduit en français), Elisabeth Langgässer a elle aussi, si je comprends bien, interprété l’extermination des Juifs comme un « sacrifice par le feu », bien avant que le terme d’Holocauste ne se généralise. Cette lecture me déconcerte dans les deux cas, et je ne peux pas suivre cette interprétation.
Bien sûr, Elisabeth Langgässer, fervente catholique, est libre de croire en ce qu’elle veut et d‘interpréter les choses à sa façon. Son destin n’est pas juif, même si des lois raciales insensées l’ont ramenée dans le « giron » juif, pour le dire de manière cruelle.
Bien sûr, je ne sais pas non plus exactement ce qu’est un « destin juif », mais je pense que ce serait un destin consistant à assumer son appartenance au peuple juif, en le défendant s’il le faut, comme les héros de Hanoukka qui se sont défendus par les armes contre l’assimilation forcée et auxquels il est finalement arrivé un miracle – le miracle de Hanoukka. C‘est malheureusement le dernier miracle qui est arrivé au peuple juif. Pour les hommes et les femmes qui ont résisté à Mayence, en 1096 et, en 1943, dans le ghetto de Varsovie, il n’y a pas eu de salut miraculeux, ils restent dans nos mémoires comme des martyrs. Leur martyre, ils ne l‘ont pas cherché, les Juifs préfèrent dans presque tous les cas rester en vie, un de leurs commandements disant : « tu choisiras la vie ».
Dans des situations moins dramatiques, il suffit de trancher en affirmant, comme l’a fait Franz Rosenzweig après avoir été longtemps tiraillé par l’idée du baptême : « Je reste donc juif ».
Barbara Honigmann
Discours prononcé à l’occasion de la remise du Prix Elisabeth Langgässer, le 26 février 2012 à Alzey
Traduit de l’allemand par Carole Fily
Notes
| 1 | Joseph Roth, Juifs en errance, Le Seuil, 2009, p.24-25. |