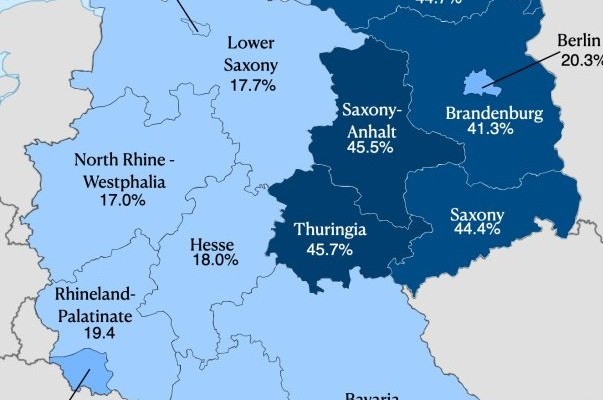Remarques sur les valeurs humaines, en marge de Buber
Sari Nusseibeh, 74 ans, est un philosophe palestinien important qui, après ses études à Harvard, fut le président de l’université arabe de Jérusalem. Ancien représentant de l’OLP à Jérusalem et longtemps acteur des négociations dans le cadre du conflit israélo-palestinien, il est notamment l’auteur de What Is a Palestinian State Worth?[1] et de The Story of Reason in Islam[2]. Dans son texte prononcé le 24 janvier dernier à Jérusalem, lors du colloque « Martin Buber et son héritage » organisé par l’Académie israélienne des Sciences et des Lettres, il propose une analyse philosophique des verbes « appartenir » et « posséder » – dans le contexte de l’équation unique qui, en Israël-Palestine, voit deux peuples pour une terre.
>>> Lire, en introduction au texte de Sari Nusseibeh, « Ce à quoi nous tenons », par Bruno Karsenti.

Le mot « appartenance » est de ceux qui associent et relient. Nous l’utilisons pour désigner à la fois un sentiment que nous avons vis-à-vis de quelque chose distinct de nous, et un sentiment relatif à la possession de quelque chose qui nous appartient. De ce fait, une forte ambivalence est inscrite dans le mot même.
A la réflexion, on perçoit ces deux sens contrastés du mot. En revanche, il n’est pas clair du tout si, au cours de l’évolution de l’esprit de chaque être humain, ils sont d’emblée différenciés. Nous ne savons pas avec certitude, par exemple, si le très jeune enfant sent simultanément qu’il appartient à sa mère et que sa mère n’appartient qu’à lui ou s’il peut distinguer entre ces deux sentiments d’appartenance. Tout ce que nous pouvons dire est que l’une et l’autre option constituent des pulsions fondamentales dans le développement précoce de cette partie du « moi » qui est en charge d’établir des relations entre l’individu et le monde. Bien que la distinction entre les deux sens du terme, possessif et affectif, puisse être clarifiée par la suite grâce à la langue, elle est néanmoins souvent brouillée, comme lorsque le sentiment chez les Juifs de leur appartenance à Sion, par exemple, se confond avec le sentiment que Sion appartient aux Juifs, voire leur appartient exclusivement, ou, à l’inverse, lorsque le sentiment de l’appartenance des Palestiniens à la Palestine se confond avec celui que la Palestine leur appartient, voire leur appartient exclusivement. Mais alors que l’appartenance affective semble être un sentiment que deux personnes différentes peuvent partager à l’endroit de ce qui a sur eux une certaine emprise peu explicable – une ville ou un pays, par exemple – l’appartenance possessive a la signification contraire, à savoir que c’est une personne ou un peuple qui a l’emprise sur cette chose, qu’il la considère comme sienne, comme lorsque je dis que tel ou tel objet m’appartient exclusivement.
Une autre caractéristique intéressante du mot « appartenance » est qu’il contient le verbe « tenir à ». Or « tenir à» renvoie non seulement à la possession, comme dans « tenir une terre », mais, dans la formulation « tenir à », le verbe renvoie aussi à un désir ou à une envie primaire pour ce à quoi j’ai le sentiment d’appartenir ou dont je sens qu’il m’appartient, mais qui est en quelque sorte hors de ma portée. Cela expliquerait pourquoi les Juifs, avant la création de l’État d’Israël, tenaient à Sion comme lieu physique, tout aussi bien que le fait que les Palestiniens, aujourd’hui, tiennent à la Palestine.
J’espère que j’ai réussi à éclaircir un point : à l’exception des sentiments que le nourrisson peut éprouver pour sa mère, ou du sentiment spécial de coappartenance dans un couple où les parties sont « faites l’une pour l’autre », dans tous les exemples de l’appartenance et du sentiment de « tenir à quelque chose » que j’ai évoqués jusqu’ici l’accent porte sur des terres, des choses ou des lieux, et le sujet qui éprouve ce sentiment dans tous ces exemples est un individu ou un groupe.
Par ailleurs, il peut arriver que moi je tienne à appartenir à une communauté. Bien que ce type d’appartenance soit souvent lié à un lieu, il est plus complexe. Je peux avoir un sentiment superficiel ou profond d’appartenance à une communauté, comme être Palestinien ou Arabe ou Musulman ou Juif. Mais peu importe l’intensité du sentiment, je tiens néanmoins à ce que cette communauté soit davantage ce que je crois qu’elle peut ou devrait être, ou ce qu’est sa nature réelle mais enfouie, différente, selon moi, de ce qu’elle est en fait ou de ce qu’elle réalise concrètement. Ici, mon appartenance à une communauté actuelle et vivante – les gens et leur mode de vie – semble être davantage une appartenance à une idée de cette communauté qu’à la communauté elle-même ; par exemple à mon idée de la communauté juive et du fait d’être juif, ou à l’idée du nationalisme palestinien et du fait d’être nationaliste. Ces deux éléments – ce que je pense devoir être réel, d’une part ; et ce qui est vraiment réel, d’autre part – peuvent, à un moment donné, être tellement éloignés et même contraires l’un à l’autre que je peux me trouver dans une situation difficile : soit je me lève et je m’engage pleinement dans une tentative de rendre ma communauté plus proche de la version idéaliste que j’en ai ; soit je me tourne, désabusé, ailleurs, voire vers tous les côtés, pour trouver un réconfort communautaire ; soit encore – ce qui est plus courant – je décide simplement de me laisser aller et de me fondre dans la foule en me débarrassant de ce que je considère comme des désirs idéologiques excessifs.
Mais, contrairement à l’appartenance associée à un lieu physique ou à des objets qui peuvent avoir des significations relevant à la fois de la possession et de l’affect, le fait de s’associer à une communauté n’a généralement qu’une seule signification, affective : dire que c’est ma communauté n’est pas littéralement une prétention à la posséder, mais peut-être un moyen pour amplifier ou souligner sa signification affective – mon appartenance à cette communauté, ou mon auto-identification à son identité collective. Si l’on va plus loin, ou si l’on considère son mode de fonctionnement originel, ce sens affectif peut tout aussi bien être revendicatif qu’empathique, comme lorsque, dans le deuxième cas de figure, on prend instinctivement en charge la détresse de quelqu’un d’autre dans sa communauté, en la considérant comme la sienne, voire en la faisant passer avant la sienne – le pouls de l’un des membres de la communauté battant naturellement dans le cœur de l’autre. Lorsque la communauté s’étend plus loin, ce sentiment instinctif d’appartenance à la communauté peut se transformer en un devoir s’imposant à moi, ou en la soumission à une autorité collective communautaire sur moi – celle d’une famille, d’une tribu et, finalement, d’un État. Mais au moment où ce sentiment d’appartenance assumé se transforme en un devoir formel, il risque de se diviser dans des directions différentes et opposées : une loyauté aveugle envers la communauté ou l’État d’une part, ou une rupture totale de son sens affectif, et un sentiment croissant d’aliénation envers le groupe ou l’État d’autre part. L’aliénation est un terme intéressant dans ce contexte. Typiquement, l’aliénation se produit lorsqu’un individu qui est un membre objectif d’un groupe en vient à sentir qu’il n’appartient plus à ce groupe. Moins typiquement, le sentiment d’appartenance au groupe cache une aliénation inconsciente du sujet, une aliénation de ce qui aurait été son état affectif s’il s’était confronté à lui-même dans un véritable acte d’autoréflexion – bref, une fuite de soi-même. On peut considérer cet état comme celui d’une appartenance illusoire. C’est un état où l’on se permet inconsciemment de faire partie du troupeau.
Enfin et surtout, il y a Dieu, bien sûr, ou les idées sémitiques que nous avons de Lui, et de ce que veut dire « appartenance » dans ce contexte. Il est significatif que nous en soyons venus à entretenir ou à éprouver des sentiments à l’égard de Dieu qui s’apparentent davantage au sentiment que nous pouvons avoir à l’égard d’un lieu qu’à celui que nous avons à l’égard d’une communauté : beaucoup d’entre nous croient à la fois que nous appartenons à Dieu et que Dieu nous appartient, est là pour nous !
Notre relation d’appartenance à Lui est donc à la fois affective et possessive. Par exemple, nous pouvons avoir le sentiment d’appartenir à un Dieu qui est transcendant par rapport à tout et à tous, mais aussi que ce Dieu transcendant nous favorise ou nous appartient plus qu’à tout autre. Ce qui est significatif – et même frappant – dans tout cela, c’est que nous en venons en fait à assimiler ces sentiments concomitants à Son égard à ceux que nous pouvons éprouver à l’égard d’un lieu, et non à ceux que nous pouvons éprouver à l’égard de personnes ou d’une communauté. « Lieu » et « Dieu » en viennent ainsi à sembler plus proches l’un de l’autre à nos yeux que « peuple » et « Dieu ». Et effectivement, nous en venons à accorder plus de valeur au lieu, ou à le considérer comme plus sacré, qu’aux personnes. Il suffit de considérer les massacres commis en Terre Sainte au nom de Dieu pour se rendre compte à quel point cela est vrai.
Il semble cependant que dans le cas de Dieu il y ait un autre sens possessif de l’appartenance – une ramification, qui est peut-être issue de la principale – où « appartenir » en vient à prendre une valeur de jugement, comme dans la phrase « ça appartient à l’histoire ». Ici, on parle de la place où la chose devrait se trouver, de sa place légitime. De même, quand on dit « ça lui appartient », on exprime qu’une décision relève de l’intimité de quelqu’un et que là est sa place légitime. Ce type spécifique d’appartenance possessive permet de contourner ce qui sépare les hommes de Dieu, et qui place le lieu au-dessus des hommes.
Prenons un cas précis : on raconte que le soufi al-Hallaj, au IXe siècle, affirmait qu’il n’avait pas besoin d’aller à la Mecque en pèlerinage vers Dieu puisque Dieu était déjà en lui, et que le pèlerinage qu’il devait donc faire pour atteindre Dieu était le pèlerinage en lui-même. Il est clair qu’il ne revendiquait pas la propriété exclusive de Dieu, mais soulignait que Dieu habite en nous, en tant qu’êtres humains, plutôt que dans un lieu spécifique sur terre, aussi saint que nous puissions considérer ce lieu. De plus, conformément à la tradition soufie, il considérait manifestement l’islam auquel il appartenait comme un moyen spirituel de découvrir Dieu en nous-mêmes, plutôt que comme un système entièrement défini par ses rituels et ses crédos usuels. Convaincu de ce qu’il faisait, Al-Hallaj se sentait en devoir de défendre ses idées, en s’adressant naturellement à sa propre communauté et en s’appuyant sur des épisodes mystiques issus de sa propre tradition religieuse. Mais le fait d’agiter son milieu de cette manière ne fit que provoquer son exécution par les autorités établies. À leurs yeux, il semblait prétendre qu’il était lui-même Dieu. En un sens, elles avaient bien sûr raison. Car pour elles, nous appartenons à un Dieu transcendant qui nous domine et nous favorise par rapport aux autres, alors que pour lui, l’appartenance à Dieu se confondait avec le fait qu’Il habite en nous en ce que nous sommes des êtres humains et que nous ne faisons qu’un avec Lui. Aussi, la distinction d’un individu par rapport à un autre, voire la distinction entre l’identité individuelle et Dieu, s’évanouit-elle complètement !
Mais si le « règne d’en haut » de Dieu peut encourager certains à croire qu’ils sont favorisés par Lui comme individus ou communauté, Son « habiter en nous » réinvente la notion de lieu et donne à penser que Dieu peut ou doit habiter quelque part – une idée qui peut nous forcer à concevoir des lieux ou des personnes dans lesquels Il a pu habiter à un moment donné, plus manifestement que dans d’autres, et avec lesquels, en tant que personnes dans lesquelles Dieu habite, nous devrions être liés, d’une façon ou d’une autre.
Voilà donc quelques-unes des différentes significations de l’appartenance, de leurs différentes nuances, ainsi que des différents sujets et objets associés à toutes ces significations. Des vies entières peuvent, en apparence, se dérouler de manière satisfaisante dans les plis d’un type d’appartenance ou d’un autre, peut-être occasionnellement perturbées par un incident ou un autre, pour ensuite retrouver un état de normalité rassurante. D’une certaine manière, cependant, ces différents aspects de l’appartenance, encadrés par les trois paramètres que sont Dieu, le lieu et le peuple, semblent sous-jacents et persistent à définir la forme triangulaire de l’agitation politique dans laquelle nous, en tant que membres de différentes communautés vivant ici [c’est à dire en Israël et en Palestine], continuons à nous trouver embarqués. Prenons par exemple le lieu et la communauté : ils ne sont généralement pas séparés l’un de l’autre, mais se trouvent liés. Cependant, une fois qu’ils sont dissociés de force, le tableau peut commencer à changer. Le lieu dépossédé peut devenir un agent accélérateur dans la constitution de l’identité de la communauté, comme cela s’est produit dans l’histoire palestinienne récente. Plus lointainement, cela s’est également produit dans l’histoire juive. Dans ces circonstances, le lieu peut devenir, en partie, la source de la mémoire collective et, en tant que tel, le cœur spirituel de la communauté, mais il peut aussi devenir le centre de la foi et de la vision d’une future restitution physique et tant attendue du corps et du cœur. Grâce aux médias modernes, nous avons actuellement accès à un matériel abondant dans la littérature et l’art palestiniens contemporains pour essayer de démêler et de comprendre ce que signifie cette rupture entre le pays et le peuple. Pourtant, malgré cette abondance littéraire et artistique, il est encore difficile de comprendre pleinement ce que signifie l’aspiration à une telle restitution, ou ce que signifie la restitution elle-même. Al-‘Awda est le terme arabe qu’utilisent les Palestiniens pour désigner à la fois quelque chose de tangible et d’identifiable, descriptible, mais aussi quelque chose d’intangible et d’amorphe qu’il est difficile, voire impossible, de décrire, de formuler, ou de faire comprendre aux autres. Aussi compliqué que cela soit, la situation est encore plus difficile lorsque l’on croit que Dieu est un élément essentiel du tableau de la dépossession et de la restitution, et que des souvenirs autrefois vivants doivent être remplacés par des récits religieux. Un exemple éloquent est celui de Yehuda Halevi qui, écrivant au XIIe siècle en Andalousie, est de nos jours plus souvent invoqué pour son poème « Mon cœur en Orient » (qui fut suivi de son pèlerinage à Jérusalem, malheureusement écourté) que pour ses vues théologiques sur la centralité respective du peuple juif et de la Terre Sainte, présentées par le personnage du rabbin lors de son dialogue avec le roi dans son Kuzari. On ne peut s’empêcher de se demander ce que le cœur signifiait ou représentait dans le poème de Halevi, comme on peut – en raison de sa contemporanéité, bien que de manière limitée – se sentir comme associé au souvenir de l’odeur du café préparé par sa mère, dont Mahmoud Darwish nous dit qu’il se languit dans son célèbre poème sur la nostalgie. Dans le cas de Halevi, on se demande si le cœur est théorique plutôt que physique. L’a-t-il littéralement imaginé comme un lieu dont le peuple auquel il appartenait a été dépossédé avant d’être déchiré par les croisés et les musulmans, mais où un royaume juif pourra ou devra à nouveau se lever, un peu à l’image de l’État d’Israël qui a fini par naître, en accomplissement, peut-être, de la promesse spéciale faite par Dieu à son peuple favori, en laquelle il croyait ? Ou bien le cœur auquel il aspirait n’était-il que le récit dénué de vie d’un trésor laissé derrière lui, source spirituelle dont la lumière enfouie dans cette terre ancienne pourrait être utilisée pour éveiller le peuple juif à sa véritable vocation de lumière des nations – comme le suggère son récit dans le Kuzari ? Peut-être n’a-t-il pas séparé ces différentes attentes, peut-être les a-t-il mélangées dans le sentiment de tenir à ce à quoi on appartient. En tous cas, il a vu le lieu, la communauté et Dieu sous un même jour, ou comme une vision unique ne pouvant se réaliser que dans un rassemblement des Juifs et dans la réappropriation de leur terre. Dans ce type de vision, le lieu devient la source de renaissance de la spiritualité et la vocation divine du peuple se réalise enfin. Dieu et le lieu s’emboîtent l’un dans l’autre, l’esprit juif trouvant en quelque sorte un nid pour lui-même sur le rempart qu’ils forment. Nécessairement, dans cette vision, l’ « autre » non-juif est mis de côté comme étant une préoccupation secondaire à l’échelle cosmique.

Mais la dépossession d’une communauté peut, dans son immédiateté, allumer la flamme nationaliste de la nostalgie du lieu, telle qu’elle est inscrite aujourd’hui dans la Déclaration d’indépendance palestinienne écrite par Darwish, Dieu étant amené comme combustible à un stade ultérieur du processus de lutte pour la restitution, longtemps après que les souvenirs vécus ont été enterrés ou objectivés dans les musées ou sur les étagères. Dieu et le lieu en viennent ici aussi à s’emboîter l’un dans l’autre, mais leur union devenant ici peu à peu le cœur même du peuple, comme cela semble avoir déjà commencé à se produire dans le cas palestinien.
Martin Buber était manifestement bien conscient des profonds effets psychologiques qu’exercent sur autrui, d’habitude, les différents types d’appartenance, et il a manifestement partagé lui-même le sentiment croissant de tenir à quelque chose d’absent éprouvé avec sa propre communauté juive en Europe, au moment où le sionisme prenait forme. Mais, en y réfléchissant, il semble avoir eu le sentiment que cet état – bien que symptomatique d’une anxiété croissante dans sa communauté – n’avait pas encore été pleinement compris comme étant en réalité l’expression du fait que l’on tient à quelque chose de beaucoup plus fondamental que le lieu, quelque chose ayant davantage à voir avec Dieu et l’essence de la religion. En examinant de plus près ce que signifie « tenir à » – en somme en revenant à la question de savoir de quelle appartenance résulte ce sentiment languissant – il en est arrivé à concevoir une condition plus primaire qu’il appela « pré-appartenance » : un point spirituellement vierge où l’âme humaine fait face et est confrontée à un espace illimité se présentant à elle, mais dont elle fait partie, et à travers lequel elle respire son existence.
C’est là, croyait-il, dans cet état de pré-appartenance, que se trouvent l’origine et ce à quoi, en fin de compte, tient la condition humaine. Cette pré-appartenance se fragmente ensuite en différents états d’anxiété, une fois que cet espace sans limites se brise en morceaux multiples auxquels nous pouvons chercher – et cherchons effectivement – à appartenir de différentes manières. Dans un court et saisissant passage de la biographie de Buber par Paul Mendes-Flohr, l’auteur mentionne une brève conversation, au début des années soixante, entre Buber et son amie psychanalyste Anna Jokl. Au cours de cette conversation, Buber demande à son interlocutrice – en remettant en question la définition de Freud de la notion d’« angoisse [Angst] » – ce qu’elle pense que cette notion signifie vraiment. « Je crois que l’angoisse [Angst], c’est de ne pas appartenir », lui dit-elle d’une manière quelque peu improvisée. « Oui », en vient-il à penser, « c’est peut-être cela : ne pas appartenir ». Buber croyait-il que tous nos sentiments d’appartenance ne soient, en fin de compte, que les rejetons d’un sentiment qui s’est égaré ? Qu’ils recèlent ce à quoi nous tenons constitutionnellement – à savoir cette phase de pré-appartenance où le monde ne s’est pas encore morcelé en objets limités que nous pouvons voir, sentir, toucher et avec lesquels, depuis, désespérément nous tentons d’établir un lien ? Ou bien, plus prosaïquement, avait-il simplement en tête une phase où le rapport au monde ne passait pas encore par l’expérience effective de la réalité mais, disons, par le fantasme, la toute-puissance de la pensée ? À cette époque, Buber était déjà installé à Jérusalem mais, à en juger par la vie qu’il menait, il ne se sentait pas tout à fait à sa place. Il est raisonnable de supposer, bien évidemment, que son commentaire concernait sa propre situation, à la fois sa manière de se rapporter à sa propre communauté et sa manière d’apercevoir comment sa communauté, désormais incarnée dans un État, se rapportait à « l’autre » non-juif, que nous, Palestiniens, représentions.
Mais il est également possible de supposer qu’en dehors de sa situation personnelle, il réfléchissait à la source de la condition commune de l’anxiété – ce que j’ai appelé plus haut la phase de pré-appartenance ou précédant l’expérience – cet état qui se brise en morceaux au carrefour du « Je », du « Tu » et du « Ça ». Buber explique abondamment la complexion de ce carrefour, mais je veux choisir deux instantanés intéressants tirés de ses écrits, qui peuvent en partie éclairer sa pensée. Le premier concerne la rencontre avec un chat où, de manière tout à fait intéressante (dans la traduction arabe de Je et Tu), apparaît pour la seule fois le mot anxiété, « qalaq ». Buber croit apercevoir une anxiété soudaine dans les yeux du chat. L’espace ouvert familier de son champ de vision a été interrompu par son apparition. Le chat hésite tandis qu’il tourne ses yeux vers lui. Dans ces yeux, Buber imagine voir une lueur de stupéfaction face à la présence de quelque chose d’autre que lui-même qui, d’un coup, occupe son espace familier. C’est une stupéfaction momentanée face à la rencontre, face à lui-même, face à ce que lui, ou cet autre qui est apparu devant lui, est ou peut être pour lui. A-t-il de l’importance pour cet autre ? Est-il quelque chose qui le reconnaît ? Quelqu’un qui pourrait se soucier de lui ? Pour lui, c’est un moment passager qui s’effacera rapidement de sa mémoire lorsqu’il reprendra son mouvement. Pour Buber, c’est une observation ponctuelle de ce moment primordial où l’attention est soudainement attirée par une rencontre avec un « autre » étranger. Cela peut marquer le début d’une relation. Mais laquelle ? Elle peut se terminer comme elle a commencé, le chat retournant dans son monde à lui. Elle peut se terminer par une relation d’appartenance mutuelle. Mais elle peut aussi être d’un type très particulier lorsque celui qui est vu et celui qui voit sont tous deux humains et qu’ils se trouvent tous deux imbriqués dans ce moment de stupéfaction face à ce qu’ils regardent précisément. Puis-je voir, à travers la lueur de ces yeux qui me regardent, cet espace infini auquel je suis spirituellement et originairement connecté ? Pouvons-nous, elle et moi, nous aider mutuellement à comprendre notre connexion réciproque avec cet espace ?
L’autre instantané intervient plus tôt dans Je et tu. L’image que Buber utilise est celle de la naissance, celle d’un nouveau-né qui ne s’identifie pas à lui-même et qui se trouve maintenant devant un espace non discriminé, se sentant lui-même comme une partie dépendante de cet espace ; plus tard, couché dans son berceau, ses bras se tendent doucement dans cet espace comme s’ils cherchaient quelque chose de non identifiable, une ancre ou une source de vie à laquelle s’accrocher, un « autre » invisible qui est ou se trouve dans cet espace, et au contact duquel il cherche inconsciemment à se compléter, à avoir une relation. Il s’agit d’un moment primitif, où le moi inconscient aspire à une connexion avec le monde extérieur et, ce faisant, cherche à tâtons à trouver son propre moi. Il s’agit d’un processus pré-rationnel, préverbal et pré-physique qui, à un moment donné, est rompu lorsqu’un objet physique – un ours en peluche selon la métaphore utilisée par Buber – est placé dans les mains de l’enfant. Le nourrisson dispose alors d’un « ça » mou avec lequel il peut se connecter, avec lequel il peut établir une relation. Désormais, le « ça », comme objet qui lui appartient, sert d’intermédiaire entre la relation « Je-Tu » qui est cette source de vie, peut-être même pour l’obscurcir et l’obstruer. De manière significative, contrairement à l’image de la mère et de son enfant présentée au début de ce texte, c’est la fenêtre vers cette source de vie que l’enfant cherche à travers sa mère ; c’est cet émerveillement stupéfié et cette complémentarité avec l’autre qui le soutiennent comme sujet, plutôt que l’appartenance.

Dans ces images, et dans son récit, Buber souligne le primat existentiel de la relation dans un monde binaire. On n’est un qu’en relation avec ce qui est extérieur à soi ! Mais il s’agit là à la fois de l’expérience réductrice de l’apparition soudaine d’un étranger devant moi, si je suis un chat, et de l’ours en peluche que mes mains touchent soudainement et tiennent fermement, si je suis un enfant ; ou encore il s’agit de cette présence initiale et réciproque de moi-même rencontrant une force vitale intangible qui, elle seule, me permet de faire, pas-à-pas, l’expérience du toucher, du sentir et du voir. Par la suite, il se peut que je perde le contact avec cette présence universelle et que je sois submergé par les ours en peluche de ce monde – par la question de savoir comment je peux en faire l’expérience, les utiliser, vivre avec eux ou par eux, en me satisfaisant ou en me laissant troubler par mes relations d’appartenance possessive et affective à eux et avec eux. Mais, en interagissant avec eux comme je le dois, je peux et je dois néanmoins ne pas perdre de vue la présence réciproque dans laquelle je suis prise avec cette force de vie, et voir la lumière de cette force de vie pénétrer dans les autres, et ainsi voir les autres êtres humains ni comme des instruments ni comme des fins en soi ; ni les voir comme une communauté, la mienne ou celle des autres, mais comme des portails sacrés individuels pour une humanité commune. Il est intéressant de noter que Buber utilise ici une figure géométrique pour souligner davantage le primat de l’individu sur la communauté – la connexion individuelle avec la source primaire. Si Buber croyait en une vocation particulière du peuple juif, il pensait probablement qu’il s’agissait avant tout d’éveiller les humains à la lumière que Dieu infuse en eux, à ce sentiment de « tenir à » qui précède l’appartenance, afin que nous puissions ajuster notre travail dans le monde en y ouvrant nos cœurs. Sa vision du monde transcende donc ou dépasse la forme triangulaire dans laquelle nous nous trouvons. C’est une vision humaniste du monde, dès le début de son engagement actif dans le sionisme, qu’il considérait avant tout comme le besoin du peuple juif de dégager l’humanisme fondamental de son identité juive. Un humanisme divin révélant d’un seul coup qu’il s’agit là du véritable foyer spirituel auquel le peuple juif appartient, de sa véritable identité, et qui ouvrirait la voie à un « vivre ensemble » enrichissant avec le reste du monde, où il croyait apercevoir les prémices d’un humanisme – une illumination morale – qui commençait à laisser sa marque intellectuelle en Europe. Par-dessus tout, son sionisme semble avoir été moins une réaction politique à l’antisémitisme rampant, ou le désir de s’approprier un morceau de terre dans le monde pour l’appeler exclusivement le sien, qu’un acte de tikkun olam qui – si je comprends bien – est une tentative proactive d’apporter une lumière morale au monde depuis le cœur même du judaïsme. Mais pour que cela se produise, les Juifs durent d’abord se retrouver – individuellement, puis en tant que communauté – afin de reconnaître le cœur palpitant en eux.
Mais le rêve de Buber d’une telle illumination et d’une humanité commune qui commencerait à se faire jour en Europe a été anéanti lorsque les Allemands se sont tournés vers l’exclusivisme, s’incarnant en tant que nation dans une machinerie étatique possessive et suprématiste, qui débuta par la mise en œuvre de politiques racistes à l’encontre des Juifs et se termina par des massacres à grande échelle dans le but de faire disparaître de la terre ce qu’ils considéraient comme une saleté s’étant collée à eux. Pour Buber, le nazisme, en tant que nationalisme exclusiviste, a dû apparaître comme l’idolâtrie catastrophique d’une « appartenance » idéologique, un abandon total du « Tu » – à savoir du Dieu dont la lumière est en chacun de nous – en faveur d’un « Ça », une mixture méta-biologique glorifiée par le « nous » appartenant au pays et à l’État, et qui désormais faisait obstacle à la fois à Dieu et à l’être humain. Alors que ses grands rêves se brisaient et que les possibilités de vie des Juifs d’Europe s’amenuisaient, la Palestine, à la fois comme pays et comme Yishuv émergeant, s’imposa à lui comme l’environnement le plus naturel pour semer les graines qui feraient naître le « foyer juif » auquel Buber croyait et qu’il fallait faire naître dans toute sa gloire. Cependant, deux problèmes épineux et intimement liés obscurcissaient sa confiance dans le fait que la semence donnerait une bonne récolte : l’incarnation de la communauté dans une forme étatique exclusiviste, et l’existence d’un autre peuple sur la même terre. Comment concilier l’idée universelle du « vivre ensemble » que constitue le foyer juif avec l’idée d’un État – dont la notion même repose sur l’exclusivisme et la dépossession de « l’autre » ? Comment résoudre la quadrature du cercle ? Ou, pour utiliser l’image du triangle « Dieu, peuple et pays », comment ces trois côtés désolidarisés pourraient-ils être harmonieusement rendus continus comme dans la forme simple d’un cercle ? Buber, avec d’autres, envisagea l’idée de partager le pays avec l’autre dans un ou deux États pour contourner cette question difficile, mais ces idées furent rejetées par un sionisme possessif de plus en plus fort qui poursuivait son propre objectif, ne laissant à Buber rien d’autre que l’espoir d’une part, et une angoisse croissante – une sorte d’état d’appartenance suspendu – d’autre part. C’est cette angoisse – celle de Buber comme d’autres – que beaucoup d’entre nous ressentent aujourd’hui, je pense, et qui m’a incité à aborder la question de l’appartenance.
La mission idéaliste du peuple juif, telle que Buber la concevait, aurait-elle été possible si nous, l’autre, n’avions pas existé et si le monde arabe avait détourné le regard au moment de la création de l’État d’Israël ? La réponse à cette question n’est pas évidente. Peut-être la communauté juive qu’il appelait de ses vœux aurait-elle pu se faire jour comme lumière des nations. Mais il est plus probable qu’Israël aurait été similaire à tout État-nation dans le monde, meilleur que certains, pire que d’autres, sa dynamique interne étant semblable à celle des autres États, et son peuple étant mû par le même type d’instincts, de désirs et d’ambitions que ceux que nous observons partout dans le monde. Séparés ou fracturés à l’intérieur par les différentes conceptions de ce que signifie être juif, ou des désirs variés des différents secteurs de la société, chaque faction ou groupe cherchant à obtenir pour lui-même plus de pouvoir dans la structure politique, bien que peut-être d’une manière moins exacerbée que celle dont nous sommes témoins aujourd’hui et qui est, au moins en partie, causée par le fait que, par pur hasard, nous aussi existons.
Je dis « par pur hasard » parce que nous – les autres personnes qui ont vécu et vivent ici – n’avions pas de projet majeur. Peut-être vivions-nous à la toute fin de tels projets… Nous sommes considérés aujourd’hui, aux yeux des planificateurs sionistes, comme un problème gênant, ou, pour reprendre les mots du raciste Winston Churchill, comme « l’empêcheur de tourner en rond »[3] qu’il faudrait chasser. Mais notre simple existence par hasard est devenue un test, si ce n’est plus, de ce qu’est le sionisme comme projet en devenir, de la direction qu’il prendra et de l’avenir qui l’attend. Ce hasard constitue donc paradoxalement un état de fait qui surpasse de loin toutes les victoires militaires que les sionistes ont remportées sur nous et toute la puissance avec laquelle Israël nous contrôle aujourd’hui. Car, bien qu’il ne soit pas lui-même un élément constitutif du sionisme, il est devenu une puissance ayant la capacité fortuite de définir la nature et l’avenir du sionisme lui-même – s’en tiendra-t-il à son caractère primordialement possessif et exclusiviste ou trouvera-t-il le chemin d’une certaine forme de « vivre ensemble » avec nous ? En regardant cette question à travers les yeux de Buber, on peut se demander si c’est le hasard ou le destin divin qui a fait de nous, Palestiniens, des partenaires réticents dans la construction d’un foyer juif, que ce soit sous la forme d’un État ou d’une communauté.
Seule l’histoire, bien sûr, nous dira à quoi ressemblera notre avenir à deux. Il faut espérer que nous ne verserons pas plus de sang ou ne causerons pas plus de douleur dans le processus, et que nous ne nous laisserons pas entraîner aveuglément par nos idoles en peluche dans une impasse où le sang et causer et la douleur serait la marque de notre existence mutuelle.
Sari Nusseibeh
Ce texte a été lu lors du colloque « Martin Buber et son héritage » organisée par la Israeli Academy of Sciences and Humanities, à Jérusalem, le 24 janvier 2023.
Notes
| 1 | What Is a Palestinian State Worth?, [Que vaut un État palestinien ?] Harvard University Press, 2011. |
| 2 | The Story of Reason in Islam, [L’histoire de la raison en Islam] Stanford University Press, 2016 |
| 3 | Effectivement, Winston Churchill avait dit, en réaction au rapport de la commission Peel de 1937, établie suite aux émeutes anti-juives de la population arabe, particulièrement violentes et meurtrières de 1936, préconisant l’abandon presque total du mandat britannique sur la Palestine et la création de deux Etats : « I do not agree that the dog in a manger has the final right to the manger even though he may have lain there for a very long time. » L’expression toute faite « the dog in the manger » veut littéralement dire « le chien dans le cellier », mais a la signification en français « l’empêcheur de penser en rond ». La phrase complète de Churchill dirait alors littéralement en français : « je ne suis pas d’accord avec l’idée que le chien dans le cellier a un droit ultime sur le cellier, même s’il y traîne depuis très longtemps ». La suite de l’explication, faisant référence aux Indiens de l’Amérique du Nord qui, eux non plus, n’auraient pas de droit sur leur terre à partir du moment où une « civilisation supérieure » apparaît sur la scène, indique que Churchill considérait que le mandat britannique sur la Palestine relevait d’une saine mission civilisatrice. [Note du traducteur]. |