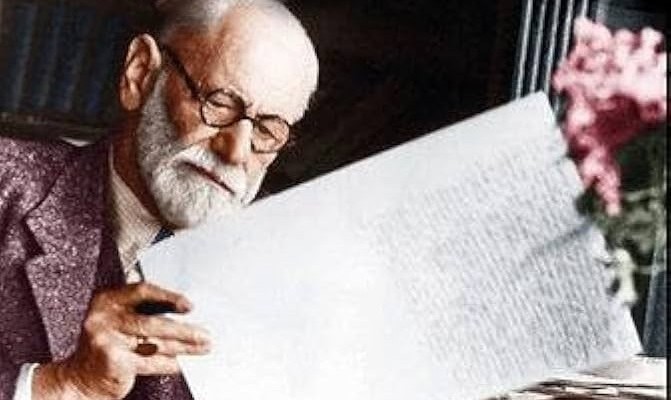En 1929, Albert Londres consacre 27 reportages aux Juifs d’Europe publiés dans Le Petit Parisien. En 1930, l’ensemble est regroupé dans un livre sous le titre Le Juif errant est arrivé. Les Éditions de l’Antilope ont eu la bonne idée de le republier dans leur collection de poche. Du quartier juif de Londres aux shtetls de Pologne et de Hongrie, des quartiers juifs de Varsovie à ceux de Prague, Albert Londres fait un tour d’Europe du monde juif, qui l’emmènera jusqu’en Palestine. Nous reprenons les chapitres 23 et 24 du reportage, consacrés aux massacres de Safed et d’Hébron en 1929.

Lecture du texte par Julien Frégé-Sebag :
[Chapitre 23] Holà ! L’Europe !
Rentré en France, j’en étais là de mon récit quand, au début d’un beau soir, un ami poussa ma porte et me jeta : « On tue tes Juifs à Jérusalem ! »
Je bondis hors de mon encrier.
L’ami me tendit un journal. On les tuait ! On les tuait même quelques mois en avance sur le programme. Alors j’envoyai promener mon porte-plume. Je pris mon chapeau, le train, puis le bateau.
Je repartis pour la Terre Promise.
Comment aurait-on pu croire l’Angleterre sans oreilles ?
Un enfant, même tout petit, pour peu qu’il eût voulu en prendre la peine, eût mesuré, ces derniers temps, l’état de fièvre en terre de Chanaan. N’est-ce pas en avril dernier, à Jérusalem, sur un divan, à la fin d’un dîner, qu’étendu entre Ragheb bey El-Nashashibi, Arabe, maire de la ville sainte, maître du mouvement, et le gouverneur anglais de la même sainte ville, nous pesions tous les trois, la veille de la fête musulmane de Nebi Moussa (prophète Moïse, les Arabes ont adopté Moïse), les chances de calme et surtout les chances de trouble ? Ragheb bey El-Nashashibi n’a pas pour habitude de voiler sa pensée. À la première occasion, il chasserait les Juifs. Ragheb bey ne l’envoyait pas dire au très honorable représentant de Sa Majesté britannique. Et Sa Majesté n’avait que cent quarante soldats en Palestine ?
Mais l’heure n’est pas aux considérations. Arrivons aux faits, et d’abord à Jaffa.
Petite tempête. Brise marine. La chaleur est revenue. Huit jours sont passés. Nous y voici.
Débarquons.
J’en ai fini avec la douane. Le sol est brûlant. J’appelle un arabadji. Le cocher accourt.
— Hôtel Palatin, Tel-Aviv ! lui dis-je. De la tête, l’arabadji fait non et s’en va.
Les cochers arabes ne vont plus à la ville juive. Les cochers juifs ne viennent plus à la ville arabe. Alors ? Vais-je rester là, dans la poussière, à contempler la vieille peau de cochon de ma chère valise, ma douce compagne ? Je pense que l’agence des Messageries Maritimes me tirera d’affaire. Je me dirige vers elle. Je pourrais dire que les rues sentent l’émeute ; ce serait de la littérature. Elles ne sentent que la graisse de mouton. Je vais, m’épongeant déjà, quand, soudainement, dans le temps d’une longue seconde Jaffa change de figure. Les gens courent, s’engouffrent chez eux ou chez les autres. Les rideaux de fer s’abaissent. Les volets de bois sont ramenés avec fracas. Les voitures quittent la station et s’envolent dans des coups de fouet. La panique orientale court la ville.
Qu’est-ce ?
J’arrive au bureau des Messageries.
— Que se passe-t-il ? — Nous ne savons pas. Un homme entre et dit :
— C’est un Arabe qui, en courant, a crié : « Khalas ! » — Que veut dire Khalas ? — C’est fait ! C’est fini ! — Quoi ? — On ne sait pas !
La Palestine, aujourd’hui, est une plaque sensible. On ne savait pas parce que rien n’était fait ni rien n’était fini. La raison revint une heure plus tard.
Qu’a donc vu cette terre depuis mon départ pour être à ce point agitée ? Voici :
Dès le 27 juillet, l’atmosphère s’épaissit à Jérusalem autour du mur des Pleurs. Les musulmans ayant fait revenir le gouvernement palestinien sur sa décision de maintenir le statu quo, ont surélevé sur la gauche une muraille jugée en mauvais état, et, dans le fond de la ruelle, ils ont percé une porte.
Cette porte répond à une urgente nécessité : celle d’embêter les Juifs. Les Arabes commencent. À l’heure de la prière, ils passent. Comme les Arabes se promènent souvent avec des ânes, les ânes suivent, et, comme les ânes sont intelligents, ils ne manquent pas de se lamenter en longeant le mur des Lamentations. La presse juive se fâche. Les Juifs tiennent justement, en ces jours, un congrès à Zurich. Télégrammes à Zurich. Le congrès envoie deux de ses membres à Londres pour protester.
Le 15 août est un jour de deuil juif. C’est l’anniversaire de la destruction du Temple. La veille, les Juifs sont allés en procession au mur. Le 15, ils ont tenu des meetings dans tout le pays contre l’attitude des Arabes. Mais le 15 également se place un fait considérable. Environ quatre cents Jeunes-Juifs ont quitté Tel-Aviv pour Jérusalem et, maintenus par la police, se sont rendus fièrement devant le mur. Là, l’un d’eux se détacha des rangs et prononça un discours. Un autre déploya le drapeau bleu et blanc, nouvel étendard de la terre d’Israël. Ce fut l’acte le moins politique, le plus imprudent commis par les Juifs depuis leur retour en Palestine. Il signifiait aux Arabes que désormais les Arabes n’auraient plus affaire avec les vieux Juifs à papillotes, mais avec eux, les glabres, les larges d’épaules, les costauds à col Danton !
L’impatience, l’orgueil des jeunes troupes apportaient aux ennemis l’occasion attendue.
Les ennemis la saisirent.
⁂
Plus la situation des Juifs s’affirmait en Palestine, plus les privilèges féodaux des chefs arabes se trouvaient menacés. Les temps étaient venus d’arrêter l’invasion juive. Il fallait, pour cela, exciter les fellahs (les serfs) que les Juifs, dans l’ordinaire de la vie, ne gênaient pas outre mesure. Les fausses nouvelles avaient déjà commencé de travailler. Comme au moyen âge, on accusait les Juifs de véhiculer d’ignobles maladies. Le bruit courut qu’ils donnaient des bonbons et des fruits empoisonnés aux enfants musulmans. N’entendait-on pas dire qu’ils s’attaquaient aux femmes voilées ? Mais les preuves manquaient. Le fanatisme religieux serait seul capable de soulever la masse.

L’heure sonnait. Les batteries étaient prêtes. Le grand mufti, très gracieux jeune homme, entra en scène. Des tracts imprimés à la hâte furent envoyés aux imans des villages. Les imans les lurent aux fellahs rassemblés. Il y était dit que le drapeau sioniste devant le mur était le signal de l’attaque par les Juifs des lieux saints musulmans. Le mur, d’abord, n’était-il pas l’un de ces saints lieux ? À ce mur, Mahomet avait attaché Burak, son cheval, avant de le chevaucher pour monter au ciel. Le temps pressait. Les Juifs allaient détruire les mosquées d’Omar et d’Al-Aqsa. Des cartes postales truquées, montrant le drapeau sioniste au sommet d’Omar, passaient de main en main. Les chefs religieux adjuraient le Coran : « Toi, la loi de nos pères, toi que nous avons juré de défendre, indique-nous notre devoir ! »
Il n’en fallait pas autant.
Le 16 août, jour de Mouloud, anniversaire de la naissance du Prophète, deux mille Arabes de Jérusalem quittent l’esplanade des Mosquées, envahissent l’étroit couloir dont le Mur est l’un des côtés. Ils brisent la vieille table de bois du sacristain, déchirent et brûlent les livres de psaumes, arrachent d’entre les blocs les petits morceaux de papier à quoi les Juifs confient leurs naïves prières. Ils battent, sur leur chemin, les vieilles robes de soie qu’ils rencontrent.
Le 17 août, dans le quartier Boukhariote, de jeunes juifs jouent au football. Le ballon, paraît-il, tombe en terre musulmane. Les fellahs attaquent les joueurs et font des blessés. L’un de ceux-là meurt. On l’enterre le 21 août. Les Juifs désirent faire passer le mort devant la porte de Jaffa, comme le veut la coutume quand on honore un mort. La police s’y oppose. Collision. Vingt Juifs blessés. Le grand mufti demande un passeport au consulat de France pour aller respirer l’air sain du Liban. Refusé. Il n’y a toujours que cent quarante soldats de Sa Majesté en Palestine !
⁂
Le vendredi 23 août, jour anniversaire de la Saint-Barthélemy, l’aurore voit des foules d’Arabes envahir Jérusalem. Ils marchent groupés, chaque homme tenant à la main un bâton ou un poignard lame nue. Ils chantent en entrant dans la ville sainte :
La religion de Mahomet
Défend son droit par l’épée,
Nous défendons par l’épée
Le prophète Mahomet.
Le grand jour est arrivé. Les tracts lancés par le gracieux jeune homme n’ont pas manqué leur but. Les manieurs de poignards et les tambours-majors du gourdin descendent vers la porte de Damas. Ils passent justement devant les établissements religieux français, devant l’hôpital, devant Notre-Dame de France :
La religion de Mahomet
Défend son droit par l’épée.
Aujourd’hui, enfants du Christ n’ayez pas peur : l’actualité est aux Juifs… En face de la porte de Damas s’élève une grande bâtisse style château fort ; ce sont les bureaux du haut-commissariat anglais. Six jeunes juifs formant groupe sont là, dehors. Ils feraient mieux de se retirer, de laisser libre champ à la vague fanatique. Ils demeurent, représentant à eux six la révolte de la nouvelle âme juive. Ils en ont assez d’entendre dire que le Juif ne sait que courber le dos. Un orgueil trop longtemps contenu leur fait oublier que l’héroïsme ne marche pas toujours de front avec la raison. L’un des six, un journaliste autrichien, le docteur von Veisel, refuse de céder un mètre de sol à la colonne qui s’avance. Un musulman marche sur Veisel. Les deux hommes s’empoignent. Veisel a le dessus.
— Eh bien ! crie-t-il aux quatre soldats anglais et aux policiers qui sont là, devant les bureaux, l’arme au pied, un homme m’attaque, je le maintiens, venez l’arrêter ! Les agents de l’autorité ne bougent pas. Deux Arabes se détachent à leur tour et poignardent Veisel dans le dos. Les représentants de la loi contemplent le spectacle ; ils ne froncent même pas les sourcils. Pourquoi, alors, se gênerait-on ? Et les musulmans se précipitent sur les Juifs surpris par l’événement. Tous ceux qui passent y « passent ».
Plus on tue de Juifs, plus la police demeure immobile.
Quant au haut-commissariat anglais, il est parti se promener dans les airs, comme un Zeppelin ! Du moins peut-on le supposer, puisque personne, depuis trois semaines, n’entend plus parler de lui !
— Mort aux Juifs !
— Le gouvernement est avec nous !
Ces cris à la bouche, le poignard au poing, les fils du prophète courent dans Jérusalem.
Ils attaquent les quartiers de Talpioth, de Gedud, d’Haavodah, de Beth-Hakerem et de Beth-Wegam, de Romena, de Gibeat-Chaoul, de San-Hedris, de Mahanain.
Ils tuent. Ils chantent.
Deux Anglais, étudiants d’Oxford, voyageant en Terre sainte, se jettent dans l’émeute. Il ne sera pas dit que des Anglais n’essayeront point d’arrêter la danse. Ils adjurent les musulmans. Ils sont jeunes ! Ils ne comprennent rien à la politique !
Et voilà que s’allument les ghettos d’Hébron et de Safed.
Tel Joseph, Gerdi, Nahalal doivent se défendre dans la plaine de Jesraël.
La main-d’œuvre arabe est décidément à bon prix : les assassins n’auront droit qu’à dix cigarettes par tête de juif !
Holà, l’Europe ! on saigne en Palestine !
Le « home national » devient la boucherie internationale !
[Chapitre 24] Les soldats du grand mufti
Il faut raconter Hébron et raconter Safed.
Hébron est en Judée, c’est-à-dire dans les pierres. Dix-huit mille Arabes, mille Juifs, mille vieux Juifs non tous âgés, mais tous vieux : Juifs de l’autre temps, papillotes et caftans !
On est dans Hébron. Rien de plus oriental à offrir au voyageur. Des rues pour drames cinématographiques. Très bien ! Mais tout cela est arabe. Où est le ghetto ? Vous regardez et ne le voyez pas. On vous a dit cependant qu’il était ici, dans ce bazar couvert, entre ce carrefour et cette basse mosquée. Pas de ghetto ! Aucun Juif ! Vous retournez aux renseignements. Alors, on vous donne un guide. Le guide vous ramène dans le bazar couvert et vous arrête entre l’échoppe d’un marchand de babouches et un vendeur d’agneaux écorchés. Là, dans le mur, un trou : c’est une porte, la porte du ghetto. Vous la franchissez courbé en deux ; vous vous redressez, et alors, si jusqu’ici vous n’aviez rien vu, vous voyez maintenant quelque chose. Il ne suffit pas de voir, il faut croire aussi. Ce qui s’offre aux regards est incroyable. Ce ghetto est une montagne de maisons, une vraie montagne avec ses crêtes, ses cols, ses ravins, une petite montagne mal fichue, hargneuse, sans un centimètre carré de terre : toute couverte de maisons, toute ! Pour atteindre le rez-de-chaussée de la deuxième bicoque, il faut passer par le toit de la première. Du toit de la seconde, vous voici de plain-pied dans la troisième. Ainsi pour chacune. Où sont les rues ? Au fait, où sont-elles ? Pas de rues ! Pourtant, je marche et je ne marche pas toujours sur les toits ! Non ! Mais je grimpe des escaliers, j’emprunte un couloir, je me perds dans des labyrinthes. Croyant déboucher sur une place, je me trouve dans une chambre à coucher. Un Juif de grande taille, étendu sur le seuil de sa maison, aurait la tête chez lui, les pieds chez le voisin… un voisin à qui il voudrait du mal, un bras ailleurs et l’autre dans la synagogue ! Trois synagogues communiquant entre elles couronnent le fol État. Le soleil n’a rien de plus extravagant à chauffer sur toute la surface de la terre !
Là vivent mille Hébreux.
Non de ceux qui déployèrent le drapeau au mur des Lamentations ; non mille gaillards de Tel-Aviv ; non plus ces colons durs et décidés de la plaine de Jesraël. Mille Hébreux qui n’étaient point venus en Palestine dans un bateau, mais dans un berceau, mille Juifs éternels. Une famille, une seule, était arrivée récemment de Lithuanie pour vivre en sainteté et non en conquérante sur la terre des ancêtres. Tragique famille !
Amis des Arabes ? Presque. En tous cas, point ennemis. Se connaissant tous, même par leurs noms, se saluant depuis dix ans, depuis toujours. L’Hébron juif était célèbre, non par ses sentiments nationaux, mais par son école talmudique.
Or les Arabes n’attaquèrent pas Tel-Aviv, mais Hébron… mais Safed. Je n’ignore pas que Ragheb bey El Nashashibi, franc comme l’épée, s’excuse en disant : « À la guerre comme à la guerre. On ne tue pas ce qu’on veut, mais ce qu’on trouve. La prochaine fois, tous y passeront, jeunes comme vieux. » Nous faisons expressément remarquer à Ragheb bey que nous ne le mettons pas au défi de tenir sa parole. Il en serait fort capable. Mais l’avenir, aujourd’hui, n’est pas notre affaire.
Le 23 août, le jour du grand mufti, deux étudiants talmudistes sont égorgés. Ils ne faisaient pas de discours politiques, ils cherchaient le Sinaï du regard, dans l’espoir d’y découvrir l’ombre de Dieu !
Le lendemain, dès le matin, des Arabes marquent leur inquiétude sur le sort des Juifs. Tous les Arabes ne font pas partie des fanatiques. La virginité d’esprit n’est heureusement pas générale en terre d’Islam.
— Sauvez-vous ! disent-ils aux Juifs.
Quelques-uns offrent aux futures victimes l’hospitalité de leur toit. L’un d’eux, même, ami d’un rabbin, marche toute la nuit et vient se planter devant la maison de son protégé. Il en défend l’entrée aux fous de sa race.
Lisez.
Une cinquantaine de Juifs et de Juives s’étaient réfugiés, hors du ghetto, à la Banque anglo-palestinienne, dirigée par l’un des leurs, le fils du rabbin Slonin. Ils étaient dans une pièce. Les Arabes, les soldats du grand mufti, ne tardèrent pas à les renifler. C’était le samedi 24, à neuf heures du matin. Ayant fait sauter la porte de la banque… Mais voici en deux mots : ils coupèrent des mains, ils coupèrent des doigts, ils maintinrent des têtes au-dessus d’un réchaud, ils pratiquèrent l’énucléation des yeux. Un rabbin, immobile, recommandait à Dieu ses Juifs : on le scalpa. On emporta la cervelle. Sur les genoux de Mme Sokolov, on assit tour à tour six étudiants de la Yeschiba et, elle vivante, on les égorgea. On mutila les hommes. Les filles de treize ans, les mères et les grand’mères, on les bouscula dans le sang et on les viola en chœur.

Mme X… est à l’hôpital de Jérusalem. On a tué son mari à ses pieds, puis saigné son enfant dans ses bras. « Toi, tu resteras vivante… » lui répétaient ces hommes du vingtième siècle !
Aujourd’hui, elle regardait par la fenêtre, d’un regard fixe et sans larme !
Le rabbin Slonin, si noir, si Vélasquez, est là aussi. Il parle :
— Ils ont tué mes deux fils, ma femme, mon beau-père, ma belle-mère.
Ce rabbin dit cela naturellement, d’une voix de greffier lisant un rapport.
Mais il va pleurer :
— En 1492, ajoute-t-il, les Juifs chassés d’Espagne avaient apporté un rouleau de la Loi à Hébron, un saint rouleau, une divine thora. Les Arabes ont brûlé ma Thora. Et le rabbin Slonin essuie deux larmes sur ses joues d’acier bruni.
Vingt-trois cadavres dans la pièce de la banque. Le sang recouvre encore le carrelage comme d’une gelée assez épaisse.
La religion de Mahomet
Défend son droit par l’épée.
Et vous n’avez nulle idée de la grâce, de la jeunesse, de la douceur, du charme et du teint clair du grand mufti…
⁂
Safed est en Haute-Galilée, à mille mètre dans les airs. Trois cônes de montagnes coiffés de maisons, les maisons fardées au lait de chaux, lait de chaux bleu, ou rose, ou jaune, ou blanc. Au loin, dans un trou, deux cents mètres plus bas que le niveau de la mer, un miroir en forme de lyre : le lac de Tibériade. Miroir ! Lyre ! Tendres couleurs ! Attendez.
Comme ceux d’Hébron, les Juifs de Safed sont des Juifs de l’ancien temps cultivant… le Zohar ! Vieux hassidistes, ils chantent et dansent en l’honneur du Seigneur. Ceux qui, en supplément, tiennent des boutiques dans le ghetto ont fermé leurs boutiques depuis six jours. Nous sommes au 29 août. Ils ne veulent pas exciter les Arabes qui, depuis le 23, se promènent processionnellement poignard et gourdin à la main, et aux lèvres le serment de tuer bientôt les Juifs. Depuis six jours ? Alors, et les Anglais ? Interrogés, ils répondent de Jérusalem que tout va bien. Le 29 août…
Mais voici l’histoire telle qu’on me la conte dans les rues du ghetto de Safed, cure d’air :
— Pardon, monsieur, je suis le fils du vice-consul de Perse…
— Parfaitement ! répondis-je à ce jeune homme. Ils ont bien arrangé votre maison.
— J’étais en vacances chez mes parents. Je fais mes études en Syrie chez les pères français d’Antoura. Depuis dix jours, les Arabes…
— Je sais. Après ?
— Alors, le 29, nous étions tous réunis à la maison. Nous entendons frapper. Mon père va à la fenêtre. Il voit une cinquantaine d’Arabes. Que voulez-vous, mes amis ? leur demande-t-il. – Descends ! Nous voulons te tuer avec ta famille. Mon père les connaît presque tous. Comment ? Vous êtes mes voisins ; je vois, dans votre groupe, plusieurs de mes amis. Depuis vingt ans, nous nous serrons la main. Mes enfants ont joué avec vos enfants. — Aujourd’hui, il faut qu’on te tue !
Mon père ferme la fenêtre et, confiant dans la solidité de notre porte, il se retire avec maman, mes deux sœurs, mon petit frère et moi dans une chambre du premier. Bientôt des coups de hache dans la porte. Puis un grincement : la porte a cédé. Mon père dit : « Ne bougez pas. Je vais encore aller leur parler. » Il descend. Au bas de l’escalier, en tête de l’invasion est un Arabe, son ami. Mon père lui ouvre les bras et va vers lui pour l’embrasser en lui disant : « Toi, au moins, tu ne me feras pas de mal, ni à ma famille. » L’Arabe tire son couteau de sa ceinture et, d’un seul coup fend la peau du crâne de mon père. Je descendais derrière, je ne pus me retenir. Je brisai une chaise sur la tête de notre ami.
Mon père s’affaissa. L’Arabe se baissa et lui redonna onze coups de poignard. Après il le regarda, le jugea mort et partit rejoindre les autres qui pillaient dans la pièce à côté.
— Bien !
— Après avoir pillé ils mirent le feu à la maison. Je fis sortir maman, mes sœurs, mon petit frère enfermés dans l’armoire. Nous allions traîner le père hors de l’incendie quand les furieux revinrent. Voyant du sang dans l’escalier ils dirent : « Les autres l’ont égorgé, cherchons son corps. » Alors, me tournant vers ma grande sœur, je criai en arabe : « Donne-moi le revolver, Ada ! » C’était une ruse. Nous n’avions pas de revolver. Ma sœur fait mine de chercher. Ils ont eu peur ! ils sont partis. »
Voici maintenant un vieillard qui larmoie dans sa blanche barbe. Il tient à me dire qu’il s’appelle Salomon Youa Goldchweig, qu’il a soixante-douze ans, qu’il est né à Safed, qu’il n’avait jamais fait de mal à personne, qu’on est venu chez lui, qu’on a tué sa femme, qu’on a voulu l’assassiner et que c’est quatre de ses voisins qu’il connaissait bien qui ont fait toutes ces choses. Et il me demande : « Pourquoi ? »
Surgit un jeune homme :
C’est Habib David Apriat. Son père était professeur d’hébreu, de français et d’arabe. Trois des anciens élèves de son père, sont entrés chez lui, ont tué son papa, ont tué sa maman, ont coupé les doigts à sa sœur qui a fait la morte sur la maman.
David Apriat s’en va, court. Où va-t-il ? Il revient avec sa sœur — moins deux doigts, et tous deux ils me regardent et le jeune homme répète : « Voilà ! Voilà ! »
Un autre apparaît.
— Je m’appelle Abraham Lévy, je suis sujet français. Algérien. Je suis gardien à l’École de l’Alliance israélite. J’ai tout vu. Quand ils sont entrés à l’école, ils ont dit : « Abraham est de nos amis, il ne faut pas le tuer, mais seulement lui couper les mains. » Je m’étais enfui sur le toit. « Abraham ! criaient-ils, où es-tu ? Tu es notre ami, nous ne voulons que te couper une main ! » Je les connaissais tous. Tous étaient de bons camarades. J’ai pu me sauver.
Et le grand rabbin Ismaël Cohen ?
Trois mois auparavant, me promenant dans le ghetto de Safed, j’avais rendu visite au vieillard. Depuis dix ans, il n’avait plus touché de son pied le raide escalier de son nid de pierres. Quatre-vingt-quatre ans d’âge, une fière tête, un fameux savant du Talmud.
Ils l’ont égorgé aussi !
Je repris le chemin de sa maison. Je gravis l’escalier. La porte n’était plus fermée. Sur le divan où naguère il était assis pour me recevoir, des loques ensanglantées traînaient. Une mare de sang séché, comme une glace vue de dos qui se serait brisée là, tachait le carrelage. Au mur, l’empreinte de ses doigts sanglants.
— Monsieur le grand rabbin, lui avais-je dit, à cette même place, permettez que mon ami Rouquayrol fasse un croquis de vous.
— Chers visiteurs, avait-il répondu, la loi de Moïse le défend, mais Ismaël Cohen ne voit plus clair, il n’en saura certainement rien !
Et il nous avait tendu sa main blanche.
Sa main est là, aujourd’hui, sur le mur, toute rouge !
C’est ce que l’on appelle un mouvement national !