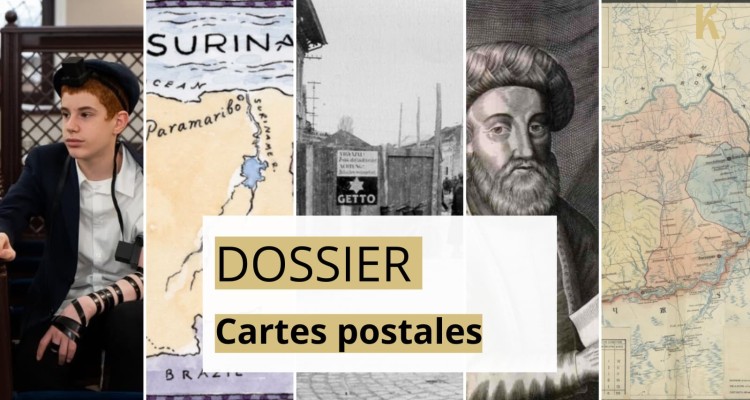Parti à la recherche de Sabbataï Tsevi, de sa tombe, de son héritage surtout, Benny Ziffer, journaliste et auteur israélien, nous invite à un étrange voyage au cœur des Balkans où la présence du faux messie juif et des traces du judaïsme continuent d’infuser imperceptiblement les esprits. Une autre manière de visiter l’Albanie.

Je lève les yeux vers le grand plafond en bois et je vois la peinture d’un paradis renversé. Un champ vert sillonné de canaux d’eau dorée, une fontaine en or au centre et, tout autour, les images de parterres de fleurs et de fruits. Sous le plafond, se trouve une galerie en treillis et, en dessous, des panneaux décorés de peintures de cités imaginaires, une bande avec les 99 noms d’Allah encerclant tout l’espace. Plus bas se trouvent les portes en bois peintes de fleurs aux couleurs joyeuses qui s’ouvrent sur des cellules de retraite. Le tout est baigné d’une douce lumière qui pénètre par de grands vitraux, entre le plafond décoré et les noms d’Allah, diffusant toutes les splendides couleurs de l’arc-en-ciel.
Je suis dans la ville de Berat, sur les rives de la rivière Osum, dans le Centre-Sud de l’Albanie. Le bâtiment que je visite, et dont je m’efforce de voir le plafond, est un tekke, soit le lieu de rassemblement de l’ordre soufi Bektashi, une secte mystique musulmane dont le centre mondial se trouve en Albanie. Mais ce qui a suscité mon intérêt pour ce lieu ne se trouve pas tant vers le haut du bâtiment, que caché sous son sol. C’est ici que – selon une tradition locale sujette à controverse – se trouverait le corps du fameux Sabbataï Tsevi, qui s’est autoproclamé messie juif avant de se convertir à l’Islam. Il y aurait été enterré après sa mort en 1676. C’était dix ans après qu’il eut choisi la conversion plutôt que la décapitation – alternative à laquelle il aurait été soumis par le sultan turc – et qu’il fut envoyé dans ce qui était alors une province reculée de l’Empire ottoman.
J’avais depuis longtemps envie de visiter cette ville, ses ruelles où Sabbataï Tsevi a peut-être marché, ses mosquées où il a prié et le tekke bektashi où il a sûrement intégré la communauté locale des mystiques. Et maintenant que je suis ici, je le comprends parfaitement. Je ne doute pas un instant que, si j’avais vécu dans sa génération, je me serais converti à l’islam en même temps que lui et l’aurais suivi dans son exil albanais. Un soir, autour d’un verre de raki sur les berges de la rivière, nous aurions soufflé et convenu que ce périple n’avait pas été vain : nous étions finalement arrivés dans une région bénie, dont les habitants tolérants acceptent avec un haussement d’épaules toutes les religions et croyances, et ne se soucient pas de savoir si vous pratiquez deux ou trois religions simultanément.

Est-ce parce que les Albanais se sont lassés de la religion en général et de l’islam en particulier, et qu’ils ont perdu tout intérêt pour les tombes des messies du passé, que le tekke a été oublié en 2008, lorsque Berat a été déclarée patrimoine mondial de l’UNESCO et a fait l’objet d’une restauration minutieuse ? C’est possible. Mais, plus récemment, cette négligence a été corrigée : le tekke a été restauré et ramené à la vie, jusqu’à ses derniers détails d’origine, notamment les deux étoiles de David sculptées dans la pierre qui accueillent le visiteur à l’entrée.
« Jusqu’à il y a trois ans, tout était complètement négligé ici » me dit Koran – le nom du gardien du tekke – mais le salut a fini par arriver. Il a pris la forme d’une délégation spéciale d’artistes et d’experts en tous genres de l’Agence turque de coopération et de coordination, un organe gouvernemental disposant de nombreuses ressources, qui a reçu le feu vert du président Recep Tayyip Erdogan pour restaurer la gloire de la Turquie dans le monde en rénovant les sites du patrimoine ottoman, où qu’ils se trouvent. Il n’y a pas si longtemps, la maison où Sabbataï Tsevi est né, à Izmir, a été magnifiquement restaurée, et voilà que le tour de sa tombe présumée à Berat est venu.
Si seulement j’avais pu raconter cela à mon amie Sevin Gerçel. Elle était membre des Dönmeh, la communauté crypto-juive sabbatéenne dont les premiers adeptes se sont convertis à l’islam au XVIIe siècle dans le sillage de Sabbataï Tsevi. Extérieurement, les Dönmeh se comportent comme des musulmans, mais intérieurement, ils continuent de croire en la venue du Messie, à savoir Sabbataï Tsevi. Sevin n’a jamais eu l’occasion de manifester publiquement son sabbataïsme, et lorsque je lui ai dit que je voulais depuis des années visiter le lieu de sépulture de Sabbataï Tsevi, elle m’a répondu : « Vas-y pour moi ». Elle est morte cette année, à Istanbul, après être tombée malade du COVID-19, et j’ai réalisé ce souhait en son nom.
Je me tiens donc dans le tekke de l’ordre Bektashi, également appelé Fraternité Halveti, les yeux rivés sur le plafond, quand soudain je me sens profondément ému. Je réalise que ces dessins de fleurs et de fruits ne me sont pas étrangers, je les ai déjà vus quelque part. Et je me souviens même où : dans les illustrations pour un seder de Tu Bishvat dans la secte sabbatéenne que les enfants de mon ami Sevin – lassés du secret imposé à ce groupe – m’ont montré. Oui, les Sabbatéens ont leur propre version de la Haggadah qui énonce les règles de la fête de Tou Bishvat, appelé par eux Rosh Hashanah La’Ilan, Ilan étant le mot hébreu pour « arbre » – comme Sabbataï Tsevi lui-même était appelé.

Il apparaîtra évident que, concernant le débat sur le lieu de sépulture de Sabbataï Tsevi – que ce soit à Ulcinj, une ville du Monténégro, comme l’indique Wikipédia, ou à Berat, en Albanie – mon vote va à Berat. L’une des raisons est qu’à Ulcinj, tout est fait pour vous persuader que Sabbataï Tsevi est enterré là, et on vous montre une pierre tombale musulmane qui pourrait être celle de quelqu’un d’autre. Tandis qu’à Berat, personne ne se soucie de savoir qui est enterré où. Vous voulez que ce soit Sabbataï Tsevi ? Bien. Près d’une pierre tombale dans la cour du tekke, je demande à Koran « Qui est enterré ici? ». « Quelqu’un d’important », répond-il.
Des histoires de sauvetages jamais racontées
Je suis arrivé à Berat quelques heures plus tôt, convaincu que je retournerai le soir même à Tirana, la capitale. Mais Marius, responsable de la culture à la mairie de Berat, m’attendait avec une offre du maire, Ervin Demo, qui ne pouvait être refusée : passer la nuit dans un petit hôtel typique de style ottoman dans le quartier de Mangalem, et le rencontrer le lendemain matin. En attendant, Marius m’a proposé de me faire visiter les ruelles de la ville.

Le soir est sur le point de tomber. À cette heure, la falaise sur laquelle se dessine une ligne de fortifications de l’ancienne citadelle s’assombrit. Les derniers rayons de lumière éclairent les façades blanches des maisons de l’époque ottomane déployées en terrasses sur les flancs des deux collines du centre de la ville, au bord du fleuve. À droite, le quartier bulgare chrétien de Gorica ; à gauche, le quartier turc musulman de Mangalem. Marius m’a conduit à une place située à l’opposé de la vieille ville, où se trouve un petit musée juif ; en face, une mosquée dédiée au bienfaisant sultan ottoman Bayezid II, qui a offert l’asile aux Juifs lorsqu’ils ont été expulsés d’Espagne en 1492.
Des centaines d’années plus tard, pendant la Shoah, lorsque l’Albanie a été occupée, d’abord par l’Italie puis par l’Allemagne nazie, le peuple albanais a donné refuge à des Juifs, agissant par sens du devoir et de l’honneur. Aujourd’hui encore, des centaines d’histoires de sauvetage n’ont toujours pas été racontées. L’année dernière, Israël a envoyé une aide généreuse à l’Albanie après le grave tremblement de terre qui a frappé le pays, témoignant ainsi de sa gratitude à l’égard du peuple albanais, de son héroïsme et des sacrifices consentis. Depuis lors, les mots « Israël » et « Bibi » (le surnom du Premier ministre israélien d’alors) ont acquis une aura mystique ici, et le nom de l’ambassadeur d’Israël, Noah Gal Gendler, est également prononcé avec révérence.
Il ne m’a donc pas fallu longtemps pour me sentir triplement chez moi ici : en tant qu’Israélien, en tant que Juif et en tant que Turc. Et, pourrais-je rajouter – en tant que personne enchantée par la tolérance de l’Islam mystique en général et de l’ordre Bektashi en particulier.
Les Bektashis sont une branche de l’islam chiite qui compte, selon son dirigeant mondial, Baba Mondi (Edmond Brahimaj), 150 millions de croyants. « Ils avaient la réputation de n’être musulmans qu’en apparence, et de pratiquer entre eux le libertinisme et la « liberté » des enfants de l’esprit », a écrit Gershom Scholem, le grand spécialiste du sabbataïsme. Scholem soutient que Sabbataï Tsevi a été profondément influencé par la communauté bektashi ; après tout, cette secte soufie pratique ses rites mystiques en secret, comme les sabbatéens, mais agit dans la vie de tous les jours comme des musulmans ordinaires. En effet, dans une lettre que Sabbataï Tsevi a écrite dans un hébreu merveilleux depuis l’Albanie en 1673, sept ans après s’être lui-même converti à l’islam, il donne ces instructions à ses croyants : « Coupez complètement les branches de cette foi jusqu’à ce que rien ne reste enfoui dans vos cœurs, sauf la racine seule… Enterrez-la cette foi. »
N’est-il pas logique, alors, d’accepter la croyance locale selon laquelle le corps de Sabbataï Tsevi a effectivement été enterré sous le sol du tekke Bektashi après sa mort en 1676 ?
La personne qui serait sans doute la plus à même de répondre à cette question pour moi est Baba Mondi, que j’avais d’ailleurs prévu de rencontrer le jour suivant, après mon retour à Tirana. Revenu dans la capitale, le souvenir de l’ancienne splendeur de Berat s’est vite embrumé. Le centre de Tirana, connu sous le nom de « Block », est constitué d’immeubles d’habitation dans l’esprit de l’ancien luxe soviétique. Il ressemble étonnamment au quadrilatère Arlosoroff-Ibn Gabirol de Tel Aviv, à une différence près : Tel Aviv ne possède aucun monument comparable à l’impressionnante statue du guerrier Skanderbeg sur la place qui porte son nom au centre de Tirana. Skanderbeg a libéré l’Albanie des mains des Turcs au 15e siècle, et sa statue est symboliquement située entre la mosquée ottomane Et’hem, l’opéra et le musée national.
À mesure que l’on s’éloigne du centre monumental, le paysage urbain devient de plus en plus morose. Pendant un long moment, nous avons traversé les quartiers pauvres de la périphérie de Tirana pour nous rendre au sanctuaire du dirigeant mondial de l’ordre Bektashi. Même Waze s’est embrouillé plusieurs fois avant que nous n’arrivions à une porte derrière laquelle se profilait le sanctuaire, entouré d’un autre jardin d’Eden de roses tranquilles, de cyprès et de carreaux de marbre étincelants, sur fond de plaine verdoyante s’étendant jusqu’au pied du Dajti, la montagne qui domine la capitale. Un derviche m’a conduit à la salle du trône où m’attendait le Baba, avec son imposante barbe blanche et sa longue robe blanche brodée d’or.
J’avais déjà rencontré le Baba auparavant. C’était il y a 15 ans, lorsqu’il était l’invité de la résidence d’artistes d’Herzliya, dirigée par la poétesse Varda Ginosar. L’Albanie venait à peine de se débarrasser de 50 ans d’une dictature communiste meurtrière. Dans la salle faiblement éclairée apparaît un homme coiffé d’un chapeau vert conique de derviche, tandis qu’à ses côtés des musiciens jouent des mélodies turques plaintives. Les Bektashis, nous explique-t-il, contrairement aux autres musulmans, autorisent la consommation de vin et le culte mixte. Une bonne compréhension des principes du bektashisme, ajoute-t-il, passe en partie par des blagues. À cette occasion, il en a partagé une avec nous :
« Un imam prêche à la mosquée sur les méfaits de l’alcool et demande aux croyants : si vous tenez un seau d’eau et un seau de raki devant un âne, lequel boira-t-il ? L’eau, répond le Bektashi. En effet, affirme l’imam. Et pourquoi boit-il l’eau ? Parce que c’est un âne, répond le Bektashi. » Il a ensuite répondu à une question du public : « Sabbataï Tsevi était un derviche juif et un derviche musulman et il a jeté un pont entre les deux religions. »
En souvenir de notre rencontre en Israël, et en souvenir de l’âne qui ne buvait pas de raki, Baba Mondi m’a assis sur le fauteuil doré à côté de lui et a ordonné au derviche qui le servait de m’offrir un verre de raki. Une interprète s’est assise sur le canapé à côté de nous, tête nue. L’islam bektashi n’exige pas que les femmes se couvrent d’une manière particulière. En revanche, les hommes qui envisagent de devenir derviches et de s’initier aux secrets de la religion sont tenus de pratiquer l’abstinence vis-à-vis des femmes.
La signification de l’habit du Baba m’intriguait. Le chapeau conique, appelé taj, représente l’esprit de prophétie. La longue robe blanche, appelée çefçil, symbolise un linceul. Je l’ai donc interrogé.

« Oui », a-t-il dit. « La couleur blanche vient nous rappeler la mort. Que nous devons faire un bilan spirituel avec nous-mêmes. Sur la ceinture, brodée de fils d’or, figurent le nom de l’imam Ali et 12 étoiles exprimant la croyance en l’existence de 12 imams qui sont les successeurs de Mahomet. Le 12e imam a disparu et est destiné à revenir à la fin des temps ».
Baba Mondi a jeté un coup d’œil à sa montre. Un autre entretien l’attendait. Il m’a conduit à travers la roseraie jusqu’au musée des Bektashis et m’a présenté hâtivement plusieurs des objets exposés. Le vaste chaudron et les énormes cuillères en bois qu’il contient servent à préparer l’ashure, un pudding à base de dix types de céréales, de lentilles et de fruits secs, que l’on mange le jour de l’Achoura, qui marque le meurtre de Hussein et de Hassan, les fils d’Ali, lors de la bataille de Karbala en 680 de l’ère chrétienne.
Je voulais qu’il me dise quelque chose sur Sabbataï Tsevi, peut-être sur son lieu de sépulture, mais déjà Baba Mondi avait été accaparé par un intervieweur de télévision et une équipe de cameramen de TV Klan, une sorte d’équivalent de la chaîne commerciale israélienne Channel 12, et il semblait agacé que j’aie empiété sur son emploi du temps. J’ai demandé à mon accompagnateur derviche qui était le journaliste en costume-cravate. « Vous ne le reconnaissez pas ? C’est Blendi ! Blendi Fevziu ! », a-t-il répondu en me regardant avec étonnement. Je l’ai cherché sur Google. Il est l’auteur d’une biographie du défunt dictateur Enver Hoxha et d’autres livres, et anime une émission d’actualité très populaire intitulée « Opinion ».
Moi aussi, une autre conversation m’attendait. À 14 heures, je devais rencontrer le jeune et charismatique maire de Tirana, Erion Veliaj. « C’est une ville qui est devenue une capitale par hasard et qui a grossi en largeur et en hauteur de façon disgracieuse », m’a-t-il avoué lorsque j’ai fait remarquer que Tirana me semblait être la sœur biologique de Tel Aviv.
Les gens prédisent que Veliaj sera le prochain premier ministre de l’Albanie -l’actuel, Edi Rama, a également été maire de Tirana. Veliaj prend un air modeste à la mention de ce fait, mais son comportement tout entier témoigne de son ambition. Il n’y a pratiquement pas de criminalité dans sa ville, insiste-t-il, afin de faire oublier, à juste titre, l’image dangereuse qui s’est attachée à sa ville et à l’Albanie post-communiste en général. Et tout le monde est accepté, toutes les communautés et religions vivent ici en paix.
La première devise de Veliaj est « Tirana n’est pas l’Albanie ». La seconde est « Ne regardez pas en arrière », c’est-à-dire vers la période terrible de la dictature communiste, qui a pris fin dans les années 1990. « C’est comme dans le thriller apocalyptique américain ‘Bird Box' », dit-il. « C’est l’histoire d’une femme avec deux enfants qui sont censés traverser une forêt et une rivière les yeux bandés afin d’éviter des forces surnaturelles qui poussent les humains qui les voient à se suicider. »
Le slogan « Ne regardez pas en arrière » inclut-il également la légèreté avec laquelle il est prêt à raser les quartiers historiques délabrés de la ville pour construire des gratte-ciels ? Lorsque leurs habitants ont manifesté contre le projet, il les a qualifiés « d’hommes de Cro-Magnon » qui « n’ont pas leur place ici » et « n’ont pas de racines dans la ville ». La détermination et la rapidité de la riposte sont l’autre facette du charisme de Veliaj. C’est aussi de cette manière qu’il a surmonté l’opposition à la démolition du bâtiment du théâtre national de Tirana en faveur d’un « grand » projet : une vaste structure en forme de nœud papillon blanc qui va accueillir des troupes de théâtre dans le cadre d’un complexe de divertissement. Le maire et son épouse, Ajola, qui font de fréquentes apparitions dans les colonnes des tabloïds locaux, sont assurément les images de l’avenir glorieux que l’Albanie convoite.
Échos de tortures
Le passé que personne ne veut regarder se profile pourtant à quelques pas de l’hôtel de ville de Tirana, sous la forme de l’entrée d’un bunker, l’un des centaines de milliers construits pendant la brutale dictature de Hoxha. Hoxha a régné pendant quelque 40 ans après la Seconde Guerre mondiale, jusqu’à sa mort, en 1985. Les bunkers ont été conçus pour se protéger d’ennemis qui ne sont jamais arrivés. Ce bunker spécifique, avec ses multiples terriers et couloirs souterrains, a été transformé en musée à la mémoire des victimes du régime communiste et de la terreur infligée aux Albanais. Bunk’Art est le nom du musée, et selon Aurel, l’énergique assistant du maire, qui me dit fièrement qu’il a suivi des cours à l’université de Haïfa, c’est le site le plus prisé des touristes à Tirana.

Il pleuvait à verse dans les rues quand j’ai émergé du souterrain. Où pouvais-je m’abriter ? Dans l’un des élégants cafés qui jouxtent le patio de l’opéra, où je me serais senti comme un étranger parmi les hommes et les femmes en costume d’affaires qui ne semblaient pas se soucier des restrictions liées au COVID-19 ? J’ai préféré m’enfuir dans le musée d’art d’en face, qui était vide à ce moment-là. Je pouvais entendre l’écho de mes pas dans les salles désertes. Je suis passé devant des statues romaines, des icônes byzantines. Dans un coin, une exposition commémore la femme qui est source de grande fierté en Albanie – Mère Teresa : ses perles de prière sont exposées ainsi qu’un hymnaire qu’elle a dédié à un moine nommé Joseph, avec les mots « Soyez purs et modestes comme Marie, saints comme Jésus. »
Je cherchais les toilettes. Les flèches m’ont conduit par erreur vers un débarras, où, le long du mur, alignées et entassées, se trouvaient des têtes sculptées de Staline. J’ai ouvert une autre porte, puis une autre, et je me suis retrouvé dans l’arrière-cour. Là, un énorme Staline en bronze, vêtu d’une tunique militaire, tendait sa gigantesque main. À ses côtés se trouvait un Lénine sans bras et, à leurs pieds, un petit Enver Hoxha en pierre, le nez cassé.
Le lendemain, j’ai découvert que l’arrière-cour du musée jouxte le palais du prince héritier albanais, Leka II, et que chaque fois qu’il se rend sur le parking de la résidence royale, il est confronté aux sculptures. Il s’est ainsi déjà habitué à leur présence. Le jour de son mariage, il a même proposé de leur mettre des nœuds papillon pour qu’elles partagent son bonheur. Il m’a également fait la grâce d’accepter de rencontrer un visiteur venu d’Israël. Auparavant, j’avais fait des recherches sur le web et demandé aux gens comment on s’adresse à un prince héritier qui n’est pas le chef de l’État. Doit-on dire « Votre Majesté » et s’incliner ?
Toutes mes appréhensions se sont dissipées lorsque la porte s’est ouverte et qu’un jeune homme cordial de 38 ans est entré dans le hall de réception. Il s’est immédiatement révélé être un interlocuteur agréable, de sorte qu’il ne m’a pas été nécessaire de m’appesantir plus longtemps sur des questions d’étiquette. Il a immédiatement exprimé son regret de n’avoir jamais visité Jérusalem, Tel Aviv ou Bethléem, et a expliqué, suite à ma question, que contrairement à d’autres monarques qui ont perdu leur trône, la dynastie dont il est le descendant n’a jamais renoncé à la monarchie. Il fonctionne comme un souverain en exil, habilité par la loi à former un gouvernement en exil, à délivrer des passeports, à attribuer des titres honorifiques et, surtout, à attendre patiemment le jour où l’on voudra à nouveau de lui comme roi. Pendant les années de la dictature en Albanie, a rappelé le prince, le simple fait de conserver une photo du roi chez soi était un crime passible de 15 ans de prison.
« Et puis le miracle de la liberté s’est produit », a-t-il dit. Son père, le prince Leka Ier, revenu d’exil à la fin de la dictature, a tenté sa chance. Il aurait facilement gagné le référendum sur le retour de la monarchie, poursuit mon interlocuteur, si les résultats n’avaient pas été grossièrement falsifiés par le gouvernement socialiste qui était au pouvoir à l’époque.
Le prince est assis sur un sofa derrière lequel se trouve un immense portrait de son grand-père, le roi Zog Ier, le jour de son mariage. La ressemblance entre les deux est frappante ! Le grand-père a eu le malheur de régner alors que l’Albanie avait pour voisine, sur la rive opposée de la mer Adriatique, l’Italie fasciste de Mussolini. Zog a quitté l’Albanie en 1939, lorsque l’Italie a envahi le pays avec des forces importantes, et que le roi a compris que son destin était scellé. Un an auparavant, il épousait l’une des plus belles femmes de l’aristocratie européenne, la princesse Géraldine de Hongrie, avec pour témoin le Premier ministre italien, gendre de Mussolini. Zog a reçu d’Adolf Hitler une Mercedes-Benz 540K comme cadeau de mariage.
Il m’a parlé avec passion et amour de Herman Bernstein, le plus proche conseiller de son grand-père. Bernstein (1876-1935) était un journaliste et activiste juif américain, l’un des grands combattants de l’antisémitisme de son temps, auteur d’un livre intitulé « Le mensonge », où se trouvent exposées les intentions malignes qui présidèrent à l’élaboration du document appelé « Protocoles des Sages de Sion ». Il a également publié la correspondance secrète entre le tsar russe et l’empereur allemand, qui est émaillée d’accords mutuels sur les avantages de l’incitation antisémite. Herman Bernstein est devenu proche du roi Zog lorsqu’il était ambassadeur des États-Unis en Albanie au début des années 1930, et leurs chemins ne se sont pas séparés jusqu’à sa mort.
Le prince a également mentionné l’anthropologue britannique d’origine autrichienne Trude Scarlett Epstein, qui, vers la fin de sa vie, lors de sa dernière apparition publique en 2011, a déclaré : « Je dois ma vie à l’Albanie. » Après l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne nazie, l’Albanie a été le seul pays qui a accepté de délivrer à sa famille un visa d’entrée, et de là, grâce à un passeport royal albanais, ils sont parvenus à rejoindre l’Angleterre.

Non, Leka ne regarde pas la série Netflix « The Crown » sur la monarchie britannique. Il en a cependant entendu parler par sa femme, la princesse Ajola. « L’histoire de votre dynastie pourrait donner lieu à une série fascinante », m’aventuré-je. Il ne semble pas enthousiaste. Apparemment, quelqu’un qui est né prince n’a ni besoin ni envie qu’on lui raconte des contes de fées sur les princes. Il est beaucoup plus intéressé par l’histoire de Sabbataï Tsevi, dont il entend parler par moi pour la première fois.
Rivages proches et lointains
« Si vous ne visitez pas Gjirokaster, vous n’avez pas vraiment vu l’Albanie » m’a exhorté l’ambassadeur d’Israël dans le pays, Noah Gal Gendler. « Et en chemin, vous devez absolument passer par Saranda, pour voir les ruines de la synagogue, l’une des plus anciennes du monde ».
Je suis enfin libre de prendre la route comme bon me semble. Mon chauffeur s’appelle Taulant, le même nom que celui de l’ancienne tribu illyrienne qui peuplait jadis la région. Il se révèle être une encyclopédie vivante de l’histoire, de la littérature et de la gastronomie albanaises. Il décrit sa patrie comme « le pays que Dieu a béni, que l’histoire a sauvé et que les politiciens ont saccagé ».
Pour un agneau rôti à l’albanaise préparé dans le pot d’argile noire traditionnel, Taulant est tout disposé à faire un détour de 50 kilomètres et à entreprendre l’ascension du château de Kruje. Là, devant une cheminée à bois, la cuisine du restaurant reprend vie pour accueillir son premier client étranger depuis le début de la pandémie. Pour que notre périple ne se termine pas trop vite, je propose que nous nous arrêtions pour la nuit à Saranda. Je profite de l’excuse de l’ancienne synagogue que j’ai promis à l’ambassadeur de visiter.
Au loin, depuis la promenade de Saranda au crépuscule, une masse sombre semble sortir de la mer. « C’est l’île de Corfou, c’est déjà la Grèce », dit Taulant avec enthousiasme, et il me montre du doigt les lumières scintillantes sur la rive opposée. Pendant les 40 ans de la dictature communiste, les Albanais sont venus dans cette station balnéaire rien que pour pouvoir contempler l’île voisine de Corfou, et rêver de s’y échapper pour retrouver leur liberté perdue. Un homme âgé s’approche de nous et nous demande ce que nous faisons. Je demande à Taulant de lui demander pourquoi, pendant les années sombres, il n’a pas fui l’Albanie. Après tout, on pourrait même traverser à la nage depuis ici.
« Il y a une personne du village qui a essayé de s’échapper de cette manière et qui a été attrapée », répond l’homme. « Il a été attaché à une voiture et traîné dans les rues du village jusqu’à ce qu’il ne reste de lui qu’un morceau de chair sanguinolente, et il a été laissé comme ça, exposé sur le sol pendant quelques jours. »
Tôt le lendemain matin, nous arrivons aux ruines de la synagogue de Saranda. Le site est entouré d’immeubles d’habitation et la mosaïque qui ornait le sol a été déplacée au musée archéologique voisin. Elle représente la ménorah à sept branches, à côté de laquelle se trouvent un etrog (cédrat) et un shofar. Fait rare, les autorités communistes ont autorisé des archéologues de l’Université hébraïque de Jérusalem à effectuer des fouilles.

Un homme – impossible de savoir s’il s’agit d’un gardien ou d’un sans-abri – émerge de la partie centrale du sanctuaire. Il accroche des tapis en lambeaux mouillés par la pluie pour les faire sécher. Je jette un coup d’œil à l’intérieur. Un matelas crasseux et un bureau sur lequel sont posés des sacs et des paquets vides. Il me fait signe de ne pas prendre de photos, et place sa main sur son cœur pour m’implorer. Peut-être pense-t-il qu’Enver Hoxha est toujours en vie, et qu’il pourrait le punir pour quelque chose.
Gjirokaster, le dernier arrêt. Un grand camion bloque l’entrée de la ville. Une grue en décharge, un sapin de Noël géant, arrivé en quatre parties. Comme Berat, cette ville ottomane est également construite à flanc de colline, en terrasses. S’y succèdent des rangées de maisons à deux étages, dont l’étage supérieur est percé de fenêtres grillagées par lesquelles les femmes, autrefois, regardaient dans la rue sans être vues.
À Gjirokaster, deux personnes dont le destin s’est intriqué à celui de leur pays sont nées dans deux maisons voisines : le despote Enver Hoxha et le célèbre écrivain albanais Ismaïl Kadaré, opposant à la dictature, qui vit aujourd’hui à Paris. La maison d’Hoxha a été transformée en musée ethnographique. Mais la pièce où il est né est toujours préservée comme un site patrimonial, avec son portrait au-dessus de la cheminée, de vieux fusils de chasse croisés au mur parmi des tapis tissés, des matelas empilés tout autour dans le style des maisons de village ottomanes, et au milieu le « barbecue » rond qui servait à la fois de chauffage et de cuisine.
La maison dans laquelle Kadaré est né, en 1936, a été rénovée et restaurée au point d’en devenir méconnaissable. Ses livres, traduits en plusieurs langues, se trouvent dans deux bibliothèques en verre à l’entrée. Certaines ruelles de la ville portent le nom de personnages de son roman « Chronique de la ville de pierre », qui se déroule à Gjirokaster.
J’ai tenu compte du conseil donné par le maire de Tirana quelques jours plus tôt : « Ne regardez pas en arrière. » Car si vous tournez votre regard vers le passé, vous risquez d’y rencontrer des monstres dont la vision donne envie d’en finir.
Benny Ziffer
Traduction de Samuel Leenhardt
Benny Ziffer est un auteur et journaliste israélien. Il est né à Tel Aviv, d’une famille émigrée de Turquie en Israël en 1949. En 1988, il est nommé rédacteur littéraire du quotidien Haaretz. Auteur de trois romans, il a également traduit des romans et des poèmes français en hébreu.