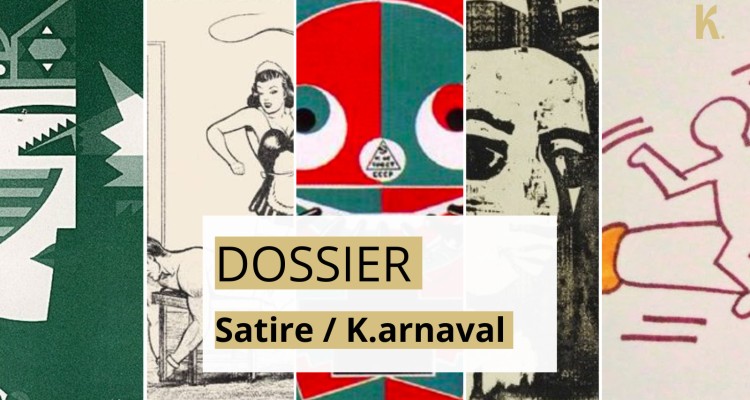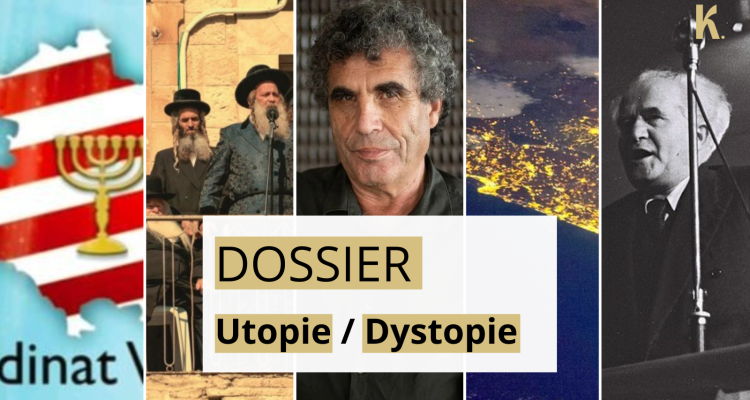K. habitait la grande ville depuis des lustres et personne parmi ses amis ne se rendait plus compte qu’il était né à la campagne. Lui-même avait du mal à croire qu’il avait passé les dix-huit premières années de sa vie au milieu des champs, à faire du vélo sur des petites routes où l’on évaluait la distance parcourue grâce aux bornes de pierre rouges et blanches plantées en terre sur le bas-côté. Il se souvenait avec plaisir des baignades dans une boucle de la rivière, l’été, et de la cueillette des jonquilles au printemps. Pourtant, une ambiance de cette campagne lui avait toujours procuré un certain malaise : les sous-bois. Quand il devait s’y aventurer, notamment quand son grand frère l’entraînait pêcher des têtards de tritons, il était partagé entre l’excitation procurée par la quête de ces petits animaux en devenir et l’embarras inexpliqué que suscitait chez lui ces entrelacs d’arbustes, de fougères, de lierres, cette odeur de mousse, de champignons et de moiteur. Il avait longtemps pensé que cette sensation inconfortable provenait de Jacquou le Croquant, l’un des premiers feuilletons qu’il avait vus à la télévision étant enfant. Il avait été terrifié par ces paysans d’une extrême pauvreté, en lutte contre leur seigneur et oppresseur, qui trouvaient refuge dans des sous-bois où ils dormaient à la belle étoile par tous les temps. Peut-être avait-il peur d’être réduit à cette condition, un jour, dans sa vie… Et sans doute était-ce la principale raison pour laquelle il n’habitait plus la campagne depuis des lustres.
*
K. était né dans une campagne française mais la Pologne n’avait cessé d’habiter sa famille depuis que ses grands-parents maternels en étaient partis, dans les années 1920, pour s’installer à Paris. Sa mère, sa tante se disaient « juives d’origine polonaise », cela suffisait pour que ce pays, ou en tout cas le nom de ce pays, occupât l’esprit de K. Mais il n’en avait aucune image car il n’y était jamais allé et personne ne lui en avait jamais réellement parlé. La Pologne, dans la famille, on n’y était retourné qu’à trois reprises. La première fois durant l’été 1933. La grand-mère avait voulu revoir ses parents, alors elle avait pris sous le bras sa fille de six ans direction Dabielnica. Le grand-père les avait sans doute accompagnées à la gare de l’Est pour prendre le Paris-Varsovie. La seule trace de ce voyage était une photographie sur laquelle posaient la grand-mère (mais elle n’avait pas du tout l’air d’une grand-mère, elle n’avait pas trente ans) entourée de ses parents, elle en perruque, lui en casquette de Juif orthodoxe, et de son jeune frère en costume de l’armée polonaise. Et sur les genoux de la grand-mère, la petite fille de six ans. Tante Régine. De ce voyage, elles étaient rentrées sans encombre au bout de quelques semaines. Traverser l’Allemagne nazie en train n’avait pas été difficile, les lois antijuives ne concernaient encore que les ressortissants du Reich.
Le deuxième retour en Pologne avait eu lieu neuf ans plus tard, en juin 1942. Cette fois, c’était le grand-père qui l’avait effectué. L’histoire ne disait pas s’il avait payé son billet. Elle disait surtout qu’il n’avait pas choisi de le faire, ce voyage, il ne cultivait pas de nostalgie particulière pour son pays natal. Il l’avait quitté avant le service militaire. En tant que déserteur il en avait perdu la citoyenneté et il pensait ne plus jamais y retourner. De sorte que, dans la case « nationalité », sur la liste du convoi dans lequel il avait été jeté à destination d’Auschwitz, il était indiqué « apatride ». De ce voyage qu’il avait effectué contre son gré, il n’était pas revenu.
Deux ans plus tard, en juillet 1944, cela avait été au tour de la petite Régine — elle était devenue une grande et jolie jeune fille de dix-sept ans — de faire le voyage, le même que celui de son père. Même destination. Mais pour Régine, ce deuxième voyage en Pologne n’avait pas été un retour au pays natal puisqu’elle était née en France, la Pologne n’était pas son pays. Elle n’y était allée qu’une seule fois auparavant, à l’âge de six ans, en 1933. Son pays, c’était la France. C’est pourquoi, en 1945, dès que le camp où elle avait été déversée après Auschwitz avait été libéré, elle était revenue à Paris et s’était réinstallée dans l’appartement où elle était née et que ses parents n’habiteraient plus, son père ne rentrerait pas, elle le savait, on ne survivait pas pendant trois ans à Auschwitz, et sa mère était morte de maladie à Paris en 1942, elle l’avait enterrée avant de faire elle-même le voyage en Pologne.
Puis, plus rien, plus de voyage pendant soixante ans. Dans les années 1970, K. s’en souvenait, il était enfant, son père avait proposé à sa mère une petite virée en Europe centrale, pour visiter Prague, Vienne, Budapest… Et il avait ajouté : « On pourra même aller en Pologne si tu veux. » Et la mère avait répondu : « Que veux-tu que j’aille faire là-bas ? » C’est vrai, qu’avait-elle à y faire ? Qu’y avait-il à y voir ? À quel oncle, quelle tante, quel cousin pouvait-on rendre visite ? Aucun. Tous morts. Disparus en tout cas. Peut-être certains avaient survécu cachés, mais alors ils avaient émigré après-guerre, ou ils continuaient à se cacher, on ne pourrait pas les retrouver. Et de toute manière, on ne les connaissait pas, alors pourquoi se découvrir une famille sur le tard ? Juste pour se faire mal ? Juste pour compter le nombre d’années que l’on avait raté, les enfances que l’on n’avait pas partagées, le retard pris que l’on ne rattraperait jamais ?
*
Le temps avait encore passé, K. était devenu adulte. Un jour, dans les années 2000, alors qu’il avait commencé une carrière de professeur d’histoire de l’art à l’université, il avait reçu une invitation à un colloque organisé par le Musée d’art moderne de Lodz. K. avait immédiatement accepté, mais il avait posé une condition : le taxi qui l’attendrait à l’aéroport de Varsovie devrait faire un petit crochet par la bourgade d’origine de sa famille, Dabielnica. Le bourg se trouvait presque sur la route entre Varsovie et Lodz, le détour serait peu contraignant.
Le premier réflexe de K. avait été de consulter l’indicateur des chemins de fer. Dans la famille, on avait toujours voyagé en train pour la Pologne. Depuis les années 1940, les chemins de fer proposaient d’autres options que les trains à bestiaux, on pouvait même voyager en wagon-lit. Mais finalement K. avait opté pour l’avion. Et quand, du hublot de l’appareil, il avait vu, inscrit sur le bâtiment principal de l’aéroport, le mot « Warszawa », un très fort sentiment d’irréalité l’avait envahi. Et ce sentiment avait été plus fort encore quand, quelques heures plus tard, à travers le pare-brise du taxi, il avait découvert « Dabielnica » en entrant dans la bourgade. Il avait vraiment eu le tournis. Ainsi, ce lieu qui était dans toutes les bouches familiales depuis qu’il était né, ce nom qui était comme une ligne de partage des eaux au sein de la famille entre ceux qui y avait grandi et en étaient partis, rarissimes et en voie d’extinction, et ceux qui ne connaissaient de ce lieu que les sonorités du nom, Dabielnica prononcé en yiddish Dabelnitsè et parfois même Dablenitsè ; ainsi ce lieu existait et on pouvait s’y rendre.
Le chauffeur de taxi l’avait arrêté sur l’unique place du bourg, le rynek, la place du marché. Avant de partir, K. avait pris soin d’ouvrir un gros livre qui trônait au milieu de la bibliothèque de sa tante Régine : le livre du souvenir de Dabielnica, publié après-guerre par des survivants juifs originaires de la bourgade. Il y avait recopié une carte sommaire où, outre les principaux bâtiments comme la mairie, l’église catholique, la place du marché, étaient indiqués l’emplacement de la synagogue, du bain rituel et du cimetière juifs.
C’est donc muni de cette esquisse de carte que K. était descendu du taxi et avait commencé à errer dans Dabielnica. Il avait trouvé sans difficulté l’église catholique dans laquelle il n’était pas entré car il était à peu près certain qu’aucun membre de sa famille n’y avait jamais mis les pieds. Mais en levant les yeux vers le clocher et son horloge, il s’était dit que son grand-père adolescent avait dû lever les siens dans la même direction pour regarder l’heure près d’un siècle plus tôt. En longeant la place du marché, il avait songé que son arrière-grand-mère, dont les vieux survivants disaient qu’elle avait « a fabrik de harengs » (il avait vu chez une lointaine cousine une photo de la fameuse fabrik : deux tonneaux et une corde sur laquelle on faisait sécher les poissons) venait sans doute vendre sa marchandise sur le rynek. À l’emplacement de la synagogue, il avait trouvé un cinéma. En observant bien, notamment en détaillant les fenêtres murées, plus cérémonieuses que celles des maisons alentour, il s’était dit que le bâtiment avait effectivement dû être un lieu de culte avant d’être transformé en cinéma. À la place du bain rituel, un terrain vague.
Il avait poursuivi, avait passé un pont enjambant une petite rivière, avait continué la route pendant quelques centaines de mètres jusqu’à un chemin qui s’enfonçait dans un bois, sur la gauche. Il avait monté le chemin pendant encore deux cents mètres jusqu’à apercevoir quelques pierres ornées d’inscriptions hébraïques émergeant d’un tapis de feuille. K. avait atteint le cimetière, dont il ne restait que quelques tombes. Et alors qu’il allait focaliser son attention sur l’une de ces pierres dressées, son regard fut happé par les arbres situés à l’arrière-plan, ce sous-bois. Sa tête commença à tourner et les arbres à bouger. Il fut pris d’une suée. Ces entrelacs d’arbustes, de fougères, de lierres, cette odeur de mousse, de champignons et de moiteur, il les reconnut aussitôt.