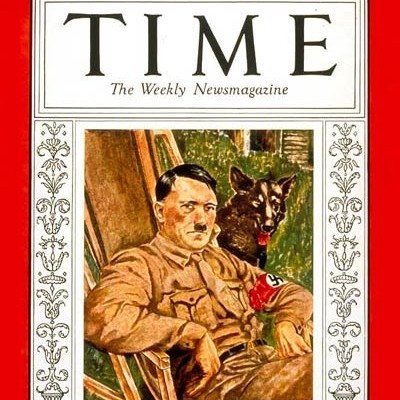Le 26 février dernier, une émeute éclatait sur le campus de l’université de Berkeley à l’occasion de la venue d’un conférencier israélien. Daniel Solomon, doctorant en histoire et premier traducteur en anglais de K., nous relate de l’intérieur l’évènement et le climat menaçant dans lequel il s’inscrit. Alors que la montée de l’antisémitisme vient remettre en question l’exceptionnalisme américain, Solomon interroge la perte de ses illusions, et le sentiment de solitude qui l’accompagne.

Lors de ma première visite des bureaux de K., une conversation avec le rédacteur en chef Stéphane Bou s’est gravée dans ma mémoire. J’étais alors un juif exubérant originaire des États-Unis, qui carburait aux vapeurs de l’ère américaine. Bien qu’étant un historien du judaïsme français, je n’arrivais pas à comprendre l’expérience des juifs français. Selon moi, ils s’étaient engagés dans une voie sans issue après la Seconde Guerre mondiale, abandonnant l’éthique assimilationniste franco-juive au profit d’une forme d’identification plus affirmée. Je détestais le sionisme ardent des juifs français, et idéalisais les dignitaires du Consistoire au dix-neuvième siècle : la France était pour moi Sion. Il me semblait que les juifs français s’étaient aliénés du reste de la population en insistant sur le droit à la différence, et que leur fervente défense d’Israël avait contribué à l’antisémitisme, conduisant le public et nos ennemis à faire l’amalgame entre les juifs en général et l’État juif. Les juifs français avaient été les auteurs de leur propre malheur ; un retour à l’israélitisme indiquait la voie du salut. J’étais alors un enfant et je parlais comme tel. Stéphane m’a répondu avec la patience du paterfamilias. « Tu ordonnes les événements à l’envers », m’a-t-il rétorqué. « Nous n’avons pas déserté la France, ne serait-ce pas plutôt la France qui nous a désertés ? ». Bien sûr, il y avait eu Vichy, et puis il m’a raconté son expérience lors d’un rassemblement après l’assassinat en 2006 d’Ilan Halimi, un juif de la banlieue parisienne : « La manifestation était presqu’entièrement composée de juifs. Quand l’antisémitisme venait de la droite, tout le monde descendait dans la rue. Ce jour-là, les juifs étaient seuls ».
En Amérique aussi, nous sommes maintenant seuls.
Seuls face à la foule, abandonnés par l’administration
Le 26 février dernier, une émeute a éclaté à l’université de Berkeley, après que Graduate Students for Justice in Palestine ait promis une reprise du pogrom du Hamas. En référence au « déluge d’Al Aqsa », le nom de code du Hamas pour son carnage dans le sud d’Israël le 7 octobre, les militants ont accroché à l’entrée principale du campus une pancarte sur laquelle on pouvait lire « Flood Sather Gate ». Ce soir-là, les compagnons de route du groupe, Bears for Palestine, ont honoré leur promesse en perturbant un événement pro-israélien par une manifestation qui a dégénéré en émeute. La foule a brisé des vitres, scandé des chants antisémites et envoyé au moins un étudiant aux urgences. Les participants, dont cet auteur, ont dû être évacués par un tunnel souterrain. Alors que nous nous précipitions dans les entrailles du théâtre, un ami s’est amusé à dire : « Nous voilà dans la même position que Yahya Sinwar ! ».
Nous avions apparemment renoncé à notre droit à la sécurité après être venus écouter une conférence de Ran Bar-Yoshafat, officier de réserve dans les forces de défense israéliennes et habitué du circuit des conférences. L’université avait assuré aux organisations juives du campus à l’origine de l’événement que des officiers de police repousseraient les tentatives de perturbation et feraient respecter nos droits au titre du premier amendement. Mais l’administration n’a pas fait grand-chose pour assurer la sécurité de l’orateur et du public, et encore moins pour protéger leur droit à la liberté d’expression. Défilant sur le campus à la manière d’une milice, les émeutiers pro-palestiniens ont exulté de leur victoire.
Les événements du mois dernier ont fait les gros titres dans tous les États-Unis, mais nous n’en sommes pas arrivés là du jour au lendemain : l’émeute antisémite vient couronner des mois de harcèlement, d’apologie de la terreur et d’explosions occasionnelles de violence sur les campus de la part du mouvement Free Palestine. La réponse de l’université à l’émeute et aux incidents précédents – un cours magistral de lâcheté administrative et de duplicité – est un mauvais présage pour l’avenir du judaïsme américain.
La campagne antisémite de Students for Justice in Palestine (SJP) a commencé le jour-même du pogrom du Hamas, en octobre dernier. Ce jour-là, Bears for Palestine a publié une déclaration louant ses « camarades de sang et d’armes » pour leurs opérations « dans la soi-disant ‘enveloppe de Gaza' ». La même organisation a ensuite organisé des manifestations au cours desquelles les participants ont clamé leur volonté de « globaliser l’intifada » et de « libérer la Palestine de la rivière à la mer ». Les militants, arborant des masques et des foulards palestiniens, ont intimidé le cortège clairsemé des contre-manifestants juifs, ce qui a parfois donné lieu à des altercations mineures, comme lorsqu’un membre du SJP a tenté d’arracher un drapeau israélien des mains d’un individu. Les manifestations se sont déroulées sur la place principale de l’université, juste à côté du bâtiment universitaire où, à l’automne, je donnais un séminaire de première année sur la mémoire de la Shoah. Je craignais tellement pour la sécurité de mes étudiants que j’ai déplacé nos réunions à l’Hillel du campus.
Nous n’en sommes pas arrivés là du jour au lendemain : l’émeute antisémite vient couronner des mois de harcèlement, d’apologie de la terreur et d’explosions occasionnelles de violence sur les campus de la part du mouvement Free Palestine.
La réponse de l’université à ces événements a été timorée et truffée de fausses équivalences. Carol Christ, chancelière de l’université de Berkeley, a reconnu début novembre que « de la peur est générée par la rhétorique utilisée lors de certaines des récentes manifestations sur le campus » – une tournure de phrase éloquente de par son utilisation de la voix passive et son refus de citer des noms. Elle a mentionné les inquiétudes liées à l’antisémitisme, pour immédiatement faire volte-face en condamnant le « harcèlement, les menaces et le doxxing qui ont visé nos étudiants palestiniens et leurs sympathisants ». Elle a même fait remarquer qu’il ne fallait pas assimiler les manifestations pro-palestiniennes sur le campus à un soutien au terrorisme (ce qui semble en contradiction avec les déclarations des manifestants eux-mêmes). Christ a terminé sa déclaration par un appel à honorer l’attachement « durable et inébranlable » de l’institution à la liberté d’expression.
À l’université de Berkeley, cette prétendue position inébranlable sur le premier amendement a consisté à autoriser des groupes pro-palestiniens à bloquer les entrées du campus pendant des heures, semaine après semaine, obligeant les étudiants à contourner le cordon illicite par des chemins couverts de boue.
Les militants pro-palestiniens se plaignent souvent d’une supposée « exception palestinienne » en ce qui concerne le respect du premier amendement. Mais sur le campus de Berkeley, le mois dernier, l' »exception israélienne » était bien visible. Bears for Palestine a appelé les étudiants à mettre fin à l’événement organisé par Bar-Yoshafat, en placardant sa photo sur les réseaux sociaux et en le décrivant comme un « dangereux meurtrier génocidaire ». Dans une menace déconcertante pour les autres étudiants du campus, Bears for Palestine s’est exclamé : « Les meurtriers génocidaires hors de Berkeley ».
L’événement était presque impossible à localiser, le lieu ayant été modifié à la dernière minute pour éviter les heurts. Lorsque je suis arrivé, quelques étudiants anxieux vérifiaient les cartes d’identité à l’entrée. Un maigre cordon de police était également présent. En fin de compte, seules deux douzaines de personnes ont pu entrer dans le bâtiment avant les incidents. Avant que l’événement ne commence à 18h30, la foule de « Free Palestine » a brisé la vitre de l’entrée, forcé une porte pour permettre à d’autres confédérés d’entrer, puis s’est introduite dans l’auditorium. La police, sans doute gênée par les règles d’engagement restrictives de l’université, n’a tenté que brièvement de bloquer le passage des émeutiers. J’ai vu l’une des intruses refuser d’enlever son masque et de fournir une pièce d’identité lorsqu’un policier le lui a ordonné. Au lieu de cela, elle a sorti son téléphone, a commencé à filmer et a prétendu que le policier l’agressait. Personne n’a été arrêté ce soir-là.
La police n’a mis que cinq minutes à capituler devant les émeutiers. Les enregistrements diffusés depuis ont montré que le chef du département leur avait dit de ne pas utiliser leur équipement anti-émeute et que l’événement était annulé. Un représentant de la faculté est arrivé pour nous évacuer par un tunnel souterrain ; j’ai accompagné à l’extérieur une de mes anciennes étudiantes qui était en larmes. Je n’étais pas au courant à ce moment-là, mais nous avons rapidement appris que plusieurs étudiants avaient été agressés et que l’un d’entre eux avait reçu des crachats et été traité de « sale juif ».
L’administration n’a pu se résoudre à utiliser le terme d’antisémitisme qu’une semaine après l’émeute.
La foule a savouré sa victoire lors d’une marche triomphale sur le campus et d’une série de publications en ligne. L’université a adressé cet e-mail à l’ensemble du campus : « L’événement est annulé ; lorsque vous exercez votre droit à la liberté d’expression, veuillez prendre soin de vous et des autres ». Le message ne pouvait être plus clair : l’intimidation et le spectre de la violence collective règnent en maîtres dans cette institution. En une soirée, l’université a contredit quatre mois de communication officielle.
L’administration n’a regagné aucune crédibilité depuis l’émeute. La réponse initiale de Christ a de nouveau consisté en un verbiage de bureaucrate, évitant toute mention de l’antisémitisme comme motif et n’identifiant pas Bears for Palestine comme responsable. Sous l’objet vague « Défendre nos valeurs », Christ a déploré qu' »un orateur d’Israël » ait été empêché de donner sa conférence. Dans des commentaires adressés à Jewish Insider, le porte-parole de l’université, Dan Mogulof, a expliqué que ce choix résultait d’un désir de ne pas particulariser les cibles de l’émeute. Il a également hésité sur la question de savoir si la foule était antisémite, estimant que si l’incident avait été « influencé par l’antisémitisme… ce n’est pas la même chose que de dire que tout le monde était motivé par cela ou s’y était engagé ». L’université n’a pas fait preuve de la même réserve après la mort de George Floyd, exprimant immédiatement sa « solidarité inébranlable avec notre communauté noire » et déplorant l’épisode comme « un meurtre raciste ».
L’administration n’a pu se résoudre à utiliser le terme d’antisémitisme qu’une semaine après l’émeute. Dans un message envoyé le lundi suivant, la chancelière a condamné « l’expression d’antisémitisme » lors de l’émeute et a déclaré que ce qui s’était passé n’était « pas de la désobéissance civile pacifique ». Christ a annoncé que l’université avait lancé une enquête criminelle (les autorités fédérales ont maintenant entamé leur propre enquête) sur la manifestation. Mais le même jour, elle a fait marche arrière dans une seconde communication, laissant entendre que la manifestation n’était pas totalement condamnable : « Les gens devraient également garder à l’esprit que les actions de quelques-uns au sein d’un mouvement ou d’une manifestation ne représentent pas les perspectives ou les valeurs d’une communauté entière. La désobéissance civile peut coexister au sein d’un événement même si certains ou une minorité vont trop loin ». La rétractation partielle de Christ n’a pas suffi à apaiser les organisateurs de la « désobéissance civile ». Bears for Palestine s’est présenté comme la victime d’un « racisme anti-palestinien profondément systémique » ; Graduate Students for Palestine a hurlé que les actions de l’université prouvaient que « le confort sioniste » primait sur « les morts palestiniennes ».
L’administration n’a pas tardé à ajouter des actions sournoises aux paroles évasives. Malgré des promesses contraires, BFP et GSJP ont été autorisés à organiser leurs événements dans le cadre de la « Semaine de l’apartheid », le carnaval annuel de l’hostilité de SJP à l’égard de l’État juif. Les organisations ont bloqué la majeure partie de l’entrée principale du campus avec des banderoles, des cordes et des rubans de sécurité. Les juifs de Berkeley ont été contraints de se frayer un passage au milieu de la foule hostile, au son des haut-parleurs diffusant des bruits de drones et une voix d' »Israélien » générée par intelligence artificielle se vantant de larguer des bombes sur Gaza. Des militants masqués harcèlent les étudiants juifs qui s’approchent de la barrière, leur braquant des appareils photo sur le visage et leur obstruant la vue avec des keffiehs. Plutôt que d’enlever l’installation, la police du campus a été postée sur place pour la protéger.

Un antisémitisme incrusté dans les enseignements académiques
Les dérives de l’université se sont répercutées dans la plupart des coins du campus, y compris dans le mien, le département d’histoire où je suis doctorant. L’histoire a été le microcosme d’un échec institutionnel plus large, dans lequel l' »équité » et l' »anticolonialisme » servent de boucliers à un antisémitisme caractérisé. La réponse administrative y a été tout aussi lamentable.
Si les études supérieures ont une fonction, c’est celle de garantir une confrontation sérieuse des idées, en particulier dans une institution aussi prestigieuse que Berkeley. Mais ici comme ailleurs, « l’anticolonialisme » et « l’équité » ne servent pas de base à une enquête approfondie, mais d’excuse pour se complaire dans l’ignorance. La nouvelle vogue dans le monde universitaire consiste à rejeter l’État juif en tant qu’extrusion coloniale de l’Europe ; Israël doit être exécré au même titre que l’Algérie française ou la Rhodésie. Ce faisant, la nécessité de comprendre l’histoire particulière des juifs, la Shoah et la crise des réfugiés qui s’en est suivie, ainsi que la mosaïque de la société juive contemporaine en Israël, s’évanouit. L’extrême gauche a même décrié l’utilisation du terme « complexité », car il servirait d’écran de fumée pour masquer les méfaits de l’État juif. L’attrait de ce que Harold Bloom a appelé « l’école du ressentiment » réside dans cette capacité à transformer l’ignorance en vertu. Ici, au département d’histoire de l’université de Berkeley, le président de la section locale de l’école du ressentiment est Ussama Makdisi, qui entraîne dans son sillage une véritable coterie de doctorants. Il a écrit ses premiers livres sur l’Empire ottoman au XIXe siècle, mais il est depuis revenu à sa véritable passion : s’en prendre aux juifs. Avant même le pogrom du Hamas, son fil X regorgeait de dénonciations de la « dépravation » des « universitaires libéraux » qui soutiennent l’État juif. Il a également déclaré à un amphithéâtre rempli d’étudiants que les juifs auraient dû fonder leur État dans l’Allemagne d’après-guerre. Le service de presse de l’université l’a récompensé par un article dans lequel il est félicité pour avoir « offert aux étudiants un point de vue unique sur l’histoire contemporaine de la Palestine » et pour avoir « fait passer le peuple en premier ».
Depuis le pogrom du Hamas, son verbiage sur X est devenu de plus en plus véhément : il a accusé Israël de « chasser » les enfants palestiniens « au nom d’Anne Frank », fait l’éloge de Dave Chappelle pour ses sketches antisémites, s’est moqué des juifs de la diaspora en les qualifiant de « narcissiques » parce qu’ils se préoccupent de leur sécurité, et déclaré qu’il « aurait pu être l’un de ceux qui ont brisé le siège le 7 octobre ». Il a harangué les foules qui se sont rassemblées sur le campus pour « libérer la Palestine » et participé à une série d’événements avec Bears for Palestine. Le pogrom du Hamas et la guerre de Gaza lui ont permis de gonfler sa réputation de célébrité universitaire : son nombre d’abonnés est passé de 12 000 à 28 000 sur X, où il fait la promotion de son dernier ouvrage, The Age of Coexistence. Dans ce volume, il s’extasie sur la supposée « convivencia » dans le Levant du XIXe siècle, ruinée par le sionisme… Depuis l’émeute, il a défendu les factieux du campus dans une multitude de messages sur X. Faisant l’éloge d’un article d’opinion paru dans le Daily Californian qui tentait de « contextualiser » l’incident, il a affirmé que tout ce brouhaha n’était rien d’autre qu’un stratagème visant à détourner l’attention du « génocide » à Gaza. Dans une missive envoyée le même jour, il a dénoncé « la campagne de harcèlement, d’intimidation et de manipulation narcissique qui se déroule sur nos campus… et qui vise à s’assurer que nous ne parlons pas de l’effroyable génocide des Palestiniens par Israël ». Les étudiants juifs, a-t-il insinué, ont orchestré une émeute contre eux-mêmes, dans le cadre d’une sournoise stratégie de relations publiques.
L’antisémitisme a contraint un ami juif à quitter ce département, après que la majorité de sa cohorte de première année ait affirmé que « toute résistance est justifiée pour quiconque a de la morale ».
Dans les jours qui ont suivi le pogrom du Hamas, Makdisi a annulé un de ses cours pour les étudiants en première année de doctorat, et exhorté la classe à assister à son « teach-in » (organisé avec BFP), au cours duquel il « historiciserait » et « contextualiserait » les événements du 7 octobre. L’événement a ensuite été annoncé sur la liste de diffusion des doctorants, dans la même chaîne de courriels qu’une réunion d’organisation syndicale. Lorsque j’ai protesté, soulignant la défense véhémente du pogrom du Hamas par la section SJP du campus, un groupe a adressé une lettre me ciblant au président du département. « Nous rejetons les affirmations faites, au sein même de notre communauté, selon lesquelles l’apprentissage de l’histoire de la Palestine équivaut au terrorisme ou à l’apologie du terrorisme », ont écrit les signataires, qui représentent environ la moitié des étudiants de troisième cycle. La lettre ne mentionne pas les victimes du pogrom du Hamas : « Nous pleurons toutes les vies qui ont été perdues, et celles qui seront perdues à la suite de la punition collective brutale de l’État israélien ». Les signataires, qui ont agrémenté leur lettre de l’accusation habituelle de « suprématie blanche » (visant en l’occurrence ceux qui avaient déploré le pogrom du Hamas), ont évoqué « notre obligation d’écouter les universitaires dont les recherches et les expériences vécues sont au cœur de ces questions [Palestine et Palestiniens], et notre responsabilité de veiller à ce que leurs voix soient entendues ». Les signataires prenaient la défense de leur mentor. Les affiches d’otages placées dans notre bâtiment universitaire ont rapidement été arrachées par des étudiants, et certains membres du département ont créé le groupe Graduate Students for Justice in Palestine, à l’origine de l’affiche « Flood Sather Gate ».
Les tentatives des étudiants juifs d’expliquer en quoi ces actions étaient offensantes et déplacées se sont rapidement heurtées à un ostracisme croissant de la part de leurs condisciples, causant leur retrait progressif des espaces et événements du département. L’antisémitisme a contraint un ami juif à quitter ce département, après que la majorité de sa cohorte de première année ait affirmé que « toute résistance est justifiée pour quiconque a de la morale ». Une autre amie m’a dit qu’elle ne viendrait plus à notre bibliothèque parce que « les gens qui s’y trouvent veulent la mort de ma famille ». J’ai reçu un mail d’un confrère me disant « Il ne faut pas te sentir seul… tout le complexe militaro-industriel est derrière toi. Nous enverrons un autre porte-avions pour essuyer tes larmes ». Dans un message ultérieur, il a ajouté : « Je ne suis pas antisémite ; j’en ai juste assez que nous dépensions notre sang et nos ressources pour votre guerre de religion ».
Malgré l’inquiétude dans le département face à cette situation, les administrateurs ont maintenu que la liberté académique et les procédures institutionnelles les empêchaient d’adopter une position claire contre l’antisémitisme qui sévit parmi nous et contre ceux qui l’instiguent. Ces mêmes administrateurs ont également constamment déformé le problème en le présentant comme une question de respect des normes de civilité dans le cadre d’une dissension politique intense. Les étudiants juifs ont parfois eu l’impression de s’adresser à un mur de briques en cherchant à leur expliquer que ce n’était pas le cas.
Le département d’histoire, à l’instar de l’université, s’est montré beaucoup plus virulent dans sa lutte contre le racisme anti-noir. Après la mort de George Floyd, les présidents de l’époque ont fait leur mea culpa : « Notre département, comme notre université, n’est pas assez diversifié », ont-ils écrit. « Nous avons l’obligation de devenir une communauté antiraciste et nous nous engageons à poursuivre cet objectif ». Il semble qu’aucun impératif de ce type ne s’applique à l’antisémitisme.
L’antisémitisme est considéré au mieux comme une préoccupation mineure et au pire comme un manquement excusable de la part des dominés.
L’émeute à Berkeley soulève de sérieuses questions sur la lutte contre la montée de l’antisémitisme aux États-Unis. Certains des outils dont nous disposons pour combattre le racisme aux États-Unis – en particulier la bureaucratie Diversité, Équité et Inclusion, qui occupe une place prépondérante sur les campus américains et dans les entreprises – ne sont pas à la hauteur. Pour la droite et le centre, l’antagonisme entre « l’équité » et la lutte contre l’antisémitisme est quasiment devenu une évidence. Audre Lorde, théoricienne de l’intersectionnalité, a proclamé un jour qu’il n’y avait « pas de hiérarchie des oppressions ». La raison d’être de la gauche militante, cependant, est une tournure post-moderne de « les derniers seront les premiers, et les premiers derniers ». Les juifs, considérés comme blancs ou même « super-blancs », sont relégués au bas de la nouvelle hiérarchie ; l’antisémitisme est considéré au mieux comme une préoccupation mineure et au pire comme un manquement excusable de la part des dominés. Les programmes de diversité, d’équité et d’inclusion, qui promeuvent l’action positive et d’autres politiques « sensibles à la race » comme remède à la discrimination passée, visent aussi directement l’ethos politique dominant pour les juifs post-émancipation, qui ne fut pas tant le socialisme que le libéralisme. L’émancipation dans l’Europe des XVIIIe et XIXe siècles reposait sur l’idée que les juifs devaient être considérés avant tout comme des individus, et non comme les membres d’une masse amalgamée. Malgré l’ambivalence au cœur de l’émancipation, l’éthique libérale a permis aux juifs européens de se hisser en quelques générations au premier rang du commerce, de la culture et de l’économie du continent. L’antisémite, hier comme aujourd’hui, compte les têtes : combien de juifs dans telle profession ou telle institution. Le suprémaciste blanc de l’Amérique profonde et le radical « woke » du campus considèrent tous deux la « surreprésentation » comme une preuve ipso facto d’intention néfaste et de conspiration.
Les organisations juives ont réagi à la montée de la haine à l’encontre de notre communauté en cherchant à l’inclure dans les programmes Diversité, Equité et Inclusion, en intégrant l’éducation à l’antisémitisme dans leurs formations à la lutte contre les préjugés. À Berkeley, le doyen chargé de la diversité envoie désormais des emails pour le Mois de l’histoire juive, ceux-ci ayant été ajoutés à la rotation d’autres communications vitales sur le « Mois de l’autonomisation des transgenres et des non-binaires » et « Devenir une institution prospère pour les LatinX ». On peut supposer que le bureau de la diversité est d’accord sur le fait que sa mission, qui consiste à « perpétuer la beauté au milieu de l’injustice » par le biais de « solutions opérationnelles qui conduisent à un changement transformateur », englobe la lutte contre l’antisémitisme. Mais l’expansion de la bureaucratie DEI semble être une solution douteuse au problème posé : il y a un risque considérable d’alimenter l’antilibéralisme dont se nourrit l’antisémitisme. La lutte contre l’antisémitisme et l' »antiracisme » ont été conçus comme des prédicats mutuellement exclusifs. La disparité dans le traitement de l’antisémitisme et du racisme anti-noir par DEI ne fait qu’entériner ce fait, et indiquer de quel côté penche la balance. La DEI et la « décolonisation » se renforcent également mutuellement dans l’affirmation commune que les groupes historiquement défavorisés ont plus de valeur morale et plus de droits que les autres, y compris le « droit » de commettre des violences insensées.

La fin de l’exception américaine ?
Le public européen pourrait être surpris d’apprendre le nombre de discours odieux qui ont été prononcés sur le campus de Berkeley en l’absence de toute sanction légale. Cela est dû, bien sûr, à la bénédiction ambivalente du Premier Amendement, qui protège les Américains contre les poursuites frivoles pour diffamation que l’on voit souvent dans les tribunaux européens, mais qui permet également aux formes les plus vitrioliques de racisme et d’antisémitisme d’être diffusées en public. Les Américains s’enorgueillissent de la protection inégalée de la liberté d’expression dans leur pays, même si celle-ci n’est pas aussi libre qu’il y paraît : de nombreuses formes d’expression autorisées par la loi sont souvent sanctionnées par les employeurs, les associations professionnelles et d’autres institutions de la société civile. Aucune autre disposition de la Constitution américaine n’est plus vénérée que le Premier Amendement (à l’exception peut-être du Deuxième Amendement, qui garantit le droit de porter des armes). Aux États-Unis, dit-on, nous n’avons pas besoin des lois sur les discours de haine que l’on trouve en Europe – le Nouveau Monde n’a pas à supporter l’héritage funeste de la Shoah. Cette idée perd un peu de son attrait lorsqu’on constate que les formes les plus haineuses de discours mènent directement à la violence physique. Les États-Unis ont connu de plus en plus d’épisodes où ce phénomène est visible, du massacre de juifs à Pittsburgh à la marche des suprémacistes blancs à Charlottesville. Pour moi, le premier amendement reste sacro-saint – l’idée que les services de police et les tribunaux aient leur mot à dire sur le type de pancartes que l’on peut brandir lors d’une manifestation m’offusque viscéralement. Mais les Américains ne peuvent plus se sentir aussi hautains qu’avant à l’égard de l’Europe et de ses lois sur les discours de haine.
Lorsque les premières manifestations de masse ont déferlé sur le campus à la fin du mois d’octobre, j’ai envoyé ce message à un mentor. « Cette manifestation est l’incarnation parfaite de la condition juive. Un groupe minuscule, assiégé, se tient derrière la plus mince ‘protection’ policière, tandis que des maniaques génocidaires nous accusent d’être des génocidaires ; la plupart des spectateurs poursuivent leur chemin », ai-je écrit, à bout de souffle, en marge de la contre-manifestation. « C’est le fardeau de ma génération, je crois, de nous résigner au fait que l’après-guerre américaine a été une parenthèse où l’existence juive était incontestée. Le judaïsme est redevenu une couronne d’épines ».
Je souscris toujours à cette idée : l’exemption insouciante du judaïsme américain de l’un des leitmotivs de l’existence juive – la persécution et l’exclusion – a été définitivement annulée. D’éminents commentateurs sont d’accord – The Atlantic vient de publier un article à sa Une intitulé « L’âge d’or du judaïsme américain s’achève ». En réponse à l’hostilité croissante à l’égard des juifs dans les universités de l‘Ivy League, le directeur général de la Conférence des principales organisations juives américaines a évoqué le précédent de la fondation par les juifs américains d’avant-guerre d’institutions parallèles, telles que l’université Brandeis et l’hôpital Mount Sinai de New York. La sécession ou l’expulsion hors de la société n’est pas exclue : le phénomène est déjà perceptible à une micro-échelle, ici, sur le campus. De nombreux étudiants juifs de Berkeley sont devenus de véritables reclus à Hillel. Je me suis parfois senti tellement épuisé à expliquer aux non-juifs que l’antisémitisme est un ennemi aux mille visages – et qu’il se présente souvent sous la forme de l’antisionisme – que je me suis, moi aussi, retiré dans les espaces juifs.
À une autre époque, un autre juif américain – bien plus éminent que celui-ci – a inventé l’expression « the lonely man of faith« . Joseph Soloveitchik, le plus grand théologien américain de l’orthodoxie moderne, voulait ainsi évoquer l’isolement du juif lorsqu’il s’agit de réconcilier les aspects matériels et spirituels de son être. En m’appropriant cette expression, je vise quelque chose de plus concret : le fossé qui se creuse entre les juifs américains et nos voisins à cause de l’antisémitisme. Je me sens seul. Et nous sommes tous en train de le devenir.
Daniel Solomon
Daniel J. Solomon est doctorant en histoire à l’université de Berkeley. Suivez-le sur Twitter @DanielJSolomon.