La collection « Diaspora », fondée par Roger Errera en 1971 aux Éditions Calmann-Lévy, a été décisive à plus d’un titre pour le public français en général, et pour les juifs de France en particulier. Aux Français non-juifs, elle a ouvert le meilleur accès qui soit au judaïsme. Pour les Juifs eux-mêmes, elle a représenté un appui inestimable pour ressaisir leur situation diasporique après la Shoah. En dessinant le portrait de Roger Errera, Conseiller d’État et Juif français jugeant l’État dans ses dérives possibles, Bruno Karsenti s’efforce de dégager le sens nouveau de cette position diasporique dans l’Europe post-Shoah. Si persévérer en exil est le propre du peuple juif, et que cette condition est modifiée sans être déniée par l’existence de l’État d’Israël, alors c’est une attitude politique singulière qui se dessine.

Le grand livre sur la politique de Vichy concernant les juifs est l’œuvre de deux historiens dont aucun n’est français, ni même européen : Robert Paxton est américain, Michael Marrus canadien. Vichy et les Juifs parut simultanément en français et en anglais en 1981. La seconde édition, de 2015, contient de nouveaux éléments mais pas de correction majeure, car si les études sur Vichy se sont considérablement développées aux cours des dernières décennies, l’autorité du livre est demeurée intacte, l’essentiel de ses conclusions restant incontesté. Elles sont sans appel pour l’Etat français, qui se révèle avoir devancé les attentes allemandes, conçu et promulgué lui-même les lois raciales, voulu la déportation dès 1940, alors que les Allemands n’en voulaient pas encore, et fourni les moyens humains, techniques et logistiques dont les Allemands manquaient pour assurer sa mise en œuvre à partir de 1942. Le livre montre que lorsque les arrestations commencèrent, l’opinion publique française y fut plutôt défavorable, de sorte que les sauvetages se multiplièrent dans le pays. Il montre aussi que cela n’arrêta pas Vichy, dont la politique persécutrice se poursuivit inflexiblement jusqu’à la fin du régime.
L’écriture du livre dura dix ans. Elle fut parsemée de difficultés, faillit même s’interrompre, les enquêtes nécessaires à sa réalisation étant délicates et ardues, accomplies dans des conditions peu favorables et dans un climat de réticence manifeste. Un accord tacite, partagé dans les différentes couches de la société, s’était instauré pour ne pas lever le voile sur cette partie de l’histoire nationale. La politique criminelle de Vichy mise au jour, il ne tenait plus. La déchirure de la trame républicaine paraissait en pleine lumière, à l’encontre de l’habile suture opérée par de Gaulle depuis la libération.
Une époque nouvelle de l’historiographie commençait, signe d’un déplacement notable dans la conscience collective française. Or ce n’est pas à Paxton, spécialiste de Vichy, ni à Marrus, qui ne le rejoignit qu’en cours de route, que l’on devait le projet de ce livre. C’est à Roger Errera, le directeur de la collection Diaspora chez Calmann-Lévy. Après avoir lu le premier livre de Paxton sur l’armée de Vichy, alors inédit en français, il prit contact avec lui en 1971 et le convainquit de se lancer. Il sut le rendre sensible à l’injustifiable absence : rien n’existait sur le sujet, et ce n’est pas depuis la France, peut-être pas même depuis l’Europe, qu’un tel livre pouvait s’écrire. Dans la foulée, il en fixa les objectifs, les soumit à l’historien comme on donne un « carnet de route » : déterminer les parts respectives dans ce qu’il est convenu d’appeler la collaboration, mesurer le rôle exact de Vichy dans la législation antijuive et la politique qui s’ensuivit, établir les responsabilités à tous les niveaux de l’appareil d’État et de l’administration. Pour cela, l’accès aux archives françaises devait être quelque peu forcé, ce dont il se chargea. Il renouvela son appui et son aide, sans relâche, à chaque fois que le doute s’installait. L’enjeu était clair : il s’agissait de mettre l’État français en règle avec son histoire, et d’élever ainsi la société française à un plus haut degré de conscience d’elle-même, ce à quoi elle se refusait depuis vingt-cinq ans.
À la différence des auteurs, Errera était un juif français qui avait une expérience directe de Vichy. Il était né à Paris en 1933, et avait traversé la guerre avec sa famille en fuyant les Allemands et la police française. Ses parents, qui avaient vu leur demande de naturalisation rejetée en 1938, étaient originaires de la très ancienne et autrefois resplendissante communauté juive de Salonique, qui allait être complètement détruite par les nazis en 1943.
L’émigration en France des Errera et Montekio (du nom de l’ascendance maternelle) s’échelonne entre 1916 et la fin des années 20, alors que Salonique venait de passer sous domination grecque et que les conditions de vie des juifs, que leur statut sous le pouvoir ottoman ne protégeait plus, s’étaient rapidement détériorées. L’histoire de la communauté de Salonique, qui remonte à l’Antiquité, est un condensé inouï du judaïsme européen pris sous ses multiples facettes. Les expulsions de la fin du Moyen-âge et de la Renaissance en avaient fait un foyer d’accueil de prédilection pour des juifs de toute provenance, majoritairement des sépharades dispersés après l’expulsion d’Espagne, mais aussi des ashkénazes venant d’Autriche, de Roumanie et de Hongrie. Point d’incandescence de l’épisode sabbatéen au XVIIème siècle – c’est là que les groupes les plus radicaux se formèrent, et que subsista l’essentiel de la secte crypto-juive des Dunmeh, ces sabbatéens décidés à suivre le pseudo-messie jusque dans son apostasie et sa conversion à l’Islam – Salonique connut un nouvel afflux migratoire important au XIXème siècle, notamment de juifs livournais. La ville devint un haut lieu des Lumières juives, produisant un nombre significatif de Maskilim férus de culture occidentale et habités par le rêve de l’émancipation. Le mouvement ouvrier juif, de même, y prit un essor remarquable.
Si le judéo-espagnol, le ladino, eut à Salonique sa terre d’élection, la langue française s’y imposa aussi largement, du fait surtout de la campagne de scolarisation menée par l’Alliance Israélite Universelle en direction des communautés d’Orient à partir des années 1870. De cette émulation culturelle et politique hors du commun sortirent des fruits éblouissants. Mais l’antisémitisme n’y disparut jamais, les conflits politiques régionaux l’attisant sans cesse, pour atteindre un pic dans l’entre-deux-guerres. L’immigration fut alors forte vers l’Europe, et tout spécialement vers la France, portée par une dynamique d’émancipation qui avait dans ce cas des sources multiples et complexes, puisqu’elle renvoyait à une expérience juive déjà ancienne et consolidée. Cette dynamique avait une caractéristique qu’il faut souligner : elle tirait son ressort d’elle-même, de son propre fond de modernité, en somme. C’est là une différence significative avec d’autres situations en Orient, en particulier avec celle des juifs d’Algérie, le décret Crémieux intervenant dans un contexte colonial où l’émancipation, sous l’espèce de la nationalisation française, se formulait comme un don venant de la métropole. Quant aux juifs qui demeuraient encore à Salonique en 1940 (la population, d’environ 50000 âmes, ne représentait plus que la moitié de celle du début du siècle) le piège se referma sur eux et n’en épargna presque aucun. Quatre-vingt-dix-huit pour cent d’entre eux furent assassinés.
Roger Errera était le rejeton de cette longue histoire : celle d’un centre juif de facture très singulière, d’une richesse frappante, mais voué à ne plus exister que par la pensée et la mémoire implantées ailleurs, comme déviées de leur axe. Il est certain que cette histoire fut présente à son esprit lorsqu’il décida de ce que serait sa principale contribution à la vie intellectuelle juive en France : une collection d’ouvrages, en grande partie des traductions, intitulée « Diaspora ».
Pour les générations qui ont grandi et se sont formées dans les années 70 et 80, cette collection est une œuvre unique. Sa sobre couverture dans le style géométrique de l’époque, où le nom de Roger Errera apparait dans un coin ou dans un pli en trompe-l’œil, a acquis rapidement le rôle de balise mentale pour tous les lecteurs avides de choses juives non-religieuses, de textes les mieux fondés qui soient sur le plan historique, politique et philosophique, où le sens spécifique de l’existence juive, au stade auquel elle était parvenue, puisse se reconstituer et s’appréhender. Le meilleur de la production internationale y était représenté. Chaque titre sonnait comme une interpellation sur un sujet vital pour les juifs, depuis le pôle français, mais sans donner à celui-ci aucune prérogative, sinon de servir de caisse de résonnance à un phénomène aux dimensions mondiales – diasporique, donc, en ce sens irréductible et précis. 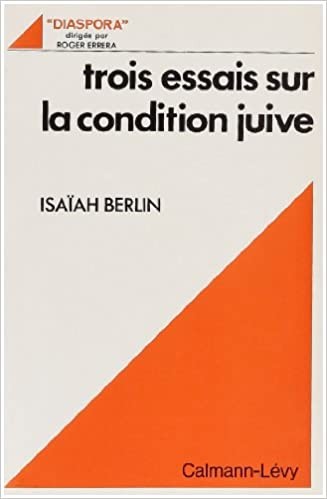
Le catalogue parle de lui-même. Il n’a rien de pléthorique, mais frappe par sa justesse, d’où ressort, sans plan préconçu, un archipel dans lequel on circule sans se perdre. On pense bien sûr aux titres les plus éclatants. Trois livres de Gershom Scholem y parurent, qui présentaient enfin au public français, au-delà de son œuvre d’historien du mysticisme juif, la conception du judaïsme qui la sous-tendait : deux recueils d’abord, Fidélité et Utopie, et surtout Le messianisme juif, traduit et introduit par le dominicain hébraïsant Bernard Dupuy, grand artisan de l’amitié judéo-chrétienne en France, où figurait – comment ne pas le noter ? – l’essai le plus important écrit sur les Dunmeh ; puis, le livre où Scholem relate son amitié avec Walter Benjamin, pièce indispensable pour comprendre leurs œuvres, et pénétrer à travers elles le judaïsme berlinois des années 20 et 30 dans ses contradictions et ses espoirs. C’est là aussi qu’on trouvait les analyses aiguës d’Isaiah Berlin sur les juifs émancipés, ses portraits de Hess, de Marx et de Disraeli, ou encore celles d’Hannah Arendt sur l’antisémitisme – cette même Hannah Arendt que Roger Errera interviewa à New-York en 1973, dans ce qui reste l’un des plus importants entretiens jamais accordés par la philosophe. C’est là encore qu’on pouvait accéder au livre de Michael Walzer sur l’exode et la politique tirée de la Torah, qu’il était possible de contraster avec le portrait des prophètes d’Israël tracé en France par André Neher, autre auteur marquant du catalogue. La singularité du monde juif devenait mieux perceptible, d’autant que les défis qu’il posait au monde chrétien, loin d’être évités ou émoussés dans une conciliation facile, étaient abordés de front dans d’autres ouvrages de la collection.
Mais c’est surtout sur le plan historique et sociologique que l’intitulé « Diaspora » prenait tout son sens. Une place était naturellement faite à l’histoire moderne et contemporaine des juifs de France saisie à différents moments clefs : l’affaire Dreyfus, l’occupation… L’ouvrage de Patrick Girard couvrait la première période de l’émancipation, de la Révolution à l’année 1860, qui coïncide avec la création à Paris de l’Alliance Israélite Universelle (à l’œuvre éducative de laquelle un autre titre était d’ailleurs consacré), signe paradoxal du retour des juifs en politique, hors du cadre de la nation d’accueil dont ils sont citoyens, mais précisément en tant que diaspora active, consciente de son unité transnationale. Encore fallait-il que cette unité dans la dispersion se comprenne jusqu’en ses lieux les plus stratégiques. La collection offrait à cette fin une vue unique sur la situation des juifs dans les grands centres mondiaux, en Union soviétique, aux États-Unis, et, évidemment, en Israël.
On touche le point peut-être le plus remarquable : grâce à ces parutions, on pouvait enfin réfléchir avec lucidité au sionisme et à ses implications réelles, c’est-à-dire à ce que la création de l’État d’Israël changeait exactement pour les juifs de la diaspora. Pour cela, il avait fallu varier les approches : non seulement rendre disponible une histoire complète du sionisme – la synthèse de Walter Laqueur remplissait cet office – mais aussi libérer l’espace des interprétations sur le projet sioniste pris sur toute sa durée, ce à quoi pourvoyaient des essais venant de voix israéliennes et européennes alternées. Cette manière de considérer Israël n’avait pas d’équivalent sur la scène éditoriale française. Que la collection ait pris corps juste après la guerre de 1967 ne doit du reste rien au hasard. Elle venait traduire une perception de soi avivée du côté juif à ce moment précis. Mais elle en révélait aussi la tournure interrogative, après que se furent entrecroisées trois lignes : la peur subite quant à la disparition éventuelle de l’État juif, l’autoanalyse à quoi cette épreuve obligeait tous les juifs d’Europe, qu’ils soient sionistes ou pas ; et enfin l’effort pour scruter l’avenir, puisque celui-ci se déployait désormais à l’ombre d’une victoire qui, en se prolongeant en politique d’occupation, ne pouvait pas ne pas conduire à une crise de légitimité qu’il allait falloir affronter.
La collection de Roger Errera fournissait patiemment, graduellement, tous les moyens pour mener à bien cette réflexion nécessaire dans l’Europe de l’après-Shoah, une Europe où les deux tiers du peuple avaient péri, et où l’existence juive reprenait malgré tout de la vigueur, grandissait. S’aménageaient les conditions pour que puisse émerger en France, dans le centre européen le plus vivant du continent (parce que démographiquement le plus important, mais aussi parce qu’il présentait les ferments d’une intellectualité juive consistante), une nouvelle conscience juive. Il en allait ainsi, en tout cas, dans toute cette période ascendante des années 70 aux années 90, âge d’or de la collection.
Quant à la Shoah, elle était évidemment abordée, mais latéralement, sous certains de ses aspects et par des chemins de traverse. Plus que la destruction elle-même, c’est à la persécution, et donc au processus politique qui y a conduit que l’attention s’attachait. C’est sur cette ligne que s’inscrit le Marrus et Paxton, voulu avec la détermination et l’obstination qu’on a vues dès le lancement de la collection. Que Vichy ne soit pas connu et reconnu dans sa politique antijuive effective et dans ses responsabilités réelles, que cet État persécuteur et criminel ne soit pas vu comme tel, Roger Errera ne pouvait l’admettre, en tant que juif et en tant que français.

Mais quel genre de français? De retour à Paris en 1945, dans un appartement qui avait été pillé, les Errera refont leur vie. Les parents renouvellent leur demande de naturalisation, qu’ils obtiennent en 1948. Le fils, de son côté, entame et accomplit un parcours d’exception: Sciences Po, l’ENA, dont il sort parmi les premiers, ce qui lui ouvre le Conseil d’État. Commence alors une carrière de juriste, magistrat, professeur de droit en France et à l’étranger, membre de nombreuses commissions nationales et internationales, du Comité des droits de l’homme de l’ONU de 1982 à 1986… On n’en finirait pas d’énumérer les hautes fonctions qu’il a occupées, tout en publiant et en enseignant sans relâche sur les droits fondamentaux, les libertés publiques, le contrôle juridictionnel de l’État et les processus de constitutionnalisation, autant de sujets où se croisaient constamment les thèmes du racisme, de l’antisémitisme, qu’il soit social ou d’État, l’oppression des minorités dont l’État risque toujours d’être le promoteur et le bras armé s’il n’est pas soumis au droit, et si le droit ne se pense pas lui-même à partir des droits de l’homme, dans la formulation qu’en donne la déclaration universelle de 1948.
Après son décès en 2014, une allocution fut prononcée au Conseil d’État par son Vice-Président Jean-Marc Sauvé. Elle retrace l’œuvre, imposante, de celui qui est qualifié tour à tour de « juge éclairé » et de « juriste engagé ». On y voit ce qui le distingue parmi ses pairs, et permet à coup sûr de mieux comprendre le style de son engagement : un internationalisme et un comparatisme résolus pour sonder le droit de l’État, tout comme les droits qu’il garantit aux individus et aux minorités. Celui qui ne connaissait Roger Errera que par sa collection découvre un théoricien et un praticien de premier ordre dans son domaine de spécialité, d’amplitude au demeurant très large. Il discerne aussi nettement l’intention qui sous-tend ce trait internationaliste qui le singularise : envisager simultanément l’État du dedans et du dehors, ne se faire son défenseur que sous la condition de son strict respect des droits fondamentaux qu’aucune constitution nationale ne capture ni ne résorbe. C’est alors que le nom de la collection résonne à nouveau : diaspora. Un conseiller d’État membre de la diaspora juive, c’est-à-dire de cette diaspora dont la particularité est qu’elle coïncide exactement avec le fait d’être juif, qu’est-ce donc ? Comment voit-il l’État qu’il sert, c’est-à-dire en l’occurrence qu’il conseille, sans s’épargner le droit de le juger?
Il le voit comme pouvant toujours faillir, à l’égard de toute minorité quelle qu’elle soit. Aussi faut-il que l’on soit au clair sur ce qu’il est et a été, sur ce qu’il fait ou a fait, à chaque moment de son histoire et dans les séquences les plus troublées de l’exercice de son pouvoir. Vichy doit être jugé, en connaissance de cause, au regard des droits des juifs qu’il a bafoués : ceux des juifs étrangers de toute origine, parmi lesquels ces juifs de Salonique à la constitution diasporique si dense et enchevêtrée ; mais aussi ceux des juifs intégrés, de nationalité française, qui furent visés à leur tour.
Juif né Français, intégré en France, et dont l’intégration s’illustre par une trajectoire difficilement égalable dans sa perfection et les hautes responsabilités publiques qu’elle comporte, Roger Errera n’en était pas pour autant grisé : il écrivait, jugeait et réfléchissait toujours sous l’angle de la diaspora qui, par définition, n’a en elle-même pas d’État. Il la portait en lui comme la trace déplacée en France de la communauté de Salonique. Et comme une face lumineuse – ni obscure, ni cachée – de son intégration, il y avait sa collection, dans laquelle quelque chose d’essentiel se traduisait à ses yeux et pour lui-même.
Dans l’entretien avec Hannah Arendt, l’intervieweur, qu’on ne voit pas à l’écran et qui n’apparait d’ailleurs jamais, mais dont on entend régulièrement la voix nette et posée, demande à la philosophe son avis sur le livre du sociologue Georges Friedmann, La fin du peuple juif ? (Gallimard, 1965) et son hypothèse selon laquelle, dès lors que l’État d’Israël existe, les juifs n’ont d’autre alternative que de le rejoindre, ou bien de demeurer dans les autres Etats pour s’y assimiler et finalement disparaître. La réponse d’Arendt vaut d’être citée littéralement : il s’agit, dit-elle, d’une hypothèse « hautement plausible », et « complètement fausse ». Un peu plus loin, elle ajoute : les juifs ne peuvent pas s’assimiler, parce qu’ils sont essentiellement un peuple en exil, une diaspora. S’ils avaient pu s’assimiler, « cela se serait produit depuis longtemps ».
On peut risquer ce commentaire : « hautement plausible » est l’hypothèse de Friedmann, parce qu’elle serait valide pour toute autre diaspora placée dans une situation analogue, en position de retrouver son État et de le rejoindre. « Complètement fausse » se révèle en revanche cette même hypothèse pour la diaspora juive, parce que dans ce cas, « diaspora » prend un sens unique, consubstantiel au peuple. Deux conséquences s’ensuivent : d’abord, il faut évidemment repenser l’État juif, Israël – dont Arendt dit dans le même entretien qu’il est « de fait » le représentant du peuple juif sur la scène des nations, « que cela nous plaise ou non ». Le penser comme une forme inédite d’État, dans la mesure où son peuple le déborde essentiellement, et pas incidemment. Ensuite, il faut considérer que, dans ce cas, l’assimilation est illusoire. Bien sûr, elle peut bien arriver individuellement, au cas par cas et localement, en quelque point isolé du collectif que les juifs constituent ; mais elle ne peut pas valoir massivement et globalement en tant que devenir commun. Là encore, on ne peut que le constater au regard de leur histoire : c’est ainsi que les juifs sont faits.
On imagine sans peine que la réponse d’Arendt rencontrait une conviction profonde chez son intervieweur. Sa question, au fond, le laissait entendre : il y a une différence décisive et précieuse à maintenir entre l’intégration et l’assimilation, parce que la première n’est pas un point d’inachèvement sur la voie qui mène droit à la seconde, mais un état qui a sa structure propre et ses vertus. Pour les juifs qui, alors même qu’existe un État fait pour eux, sont essentiellement une diaspora, il advient que l’intégration se donne précisément comme un geste diasporique. Là réside la singularité et la valeur de leur contribution à la vie des nations où ils sont disséminés, dans et au risque de ce que peuvent toujours devenir leurs États, quels qu’ils soient et sans exception. La diaspora, en somme, n’est pas seulement le nom de la dispersion. C’est aussi celui d’une vigilance qui ne s’éteint pas.
Bruno Karsenti











