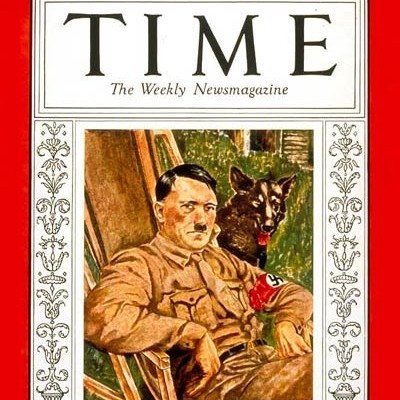Alors que des étudiants pro-palestiniens contrôlent qui peut accéder à l’amphi « Gaza », Clara Levy, ancienne étudiante de Sciences Po et fondatrice de l’association Paris-Tel Aviv, livre un témoignage touchant, et dépité, sur ses souvenirs rue Saint Guillaume. Si les altercations autour du conflit israélo-palestinien, et les suspicions antisionistes à l’égard des étudiants juifs, ne datent apparemment pas d’hier, Sciences Po semble avoir perdu de sa superbe : où organiser l’opposition des points de vue, si les amphis sont inaccessibles ?

Cher Sciences Po,
En juillet, ça fera dix ans. Moi qui me sens encore comme une
« adulescente » en perpétuelle quête de moi-même, j’ai du mal à croire que ça fait déjà une décennie que tu m’as donné ce graal sous forme de feuille cartonnée : mon diplôme.
Je ne vais pas passer par quatre chemins : tu as changé ma vie. Pas par rapport à ce que je suis devenue – j’ai renoncé à ma carrière rêvée en communication politique (dont l’objectif était justement de compter dans la réconciliation au Moyen-Orient – pour le moins ambitieux n’est-ce pas…) mais pour tout ce que tu m’as apporté, et qui a contribué à façonner qui je suis et, même si c’est de plus en plus difficile par les temps qui courent, qui je m’efforce d’être.
Avant qu’on se rencontre, tu n’étais qu’un rêve. Mais était-il seulement le mien, ou bien le fantasme intériorisé de grands-parents qui ont dû fuir, malgré la confiscation de leurs biens, leurs Tunisie et Algérie natales. On appelle ces juifs des « rapatriés », car l’occupant, pour mieux régner, leur a octroyé dans sa fausse mansuétude, la nationalité française. Mais un bout de papier, si précieux soit-il, ne remplace pas des siècles d’histoire. Et pour ces Français de papier, en quête insatiable d’intégration, je fais partie de la première génération, celle des petits-enfants, à être née ici, sur le sol métropolitain, avec un beau numéro de sécurité sociale. « Tu seras ministre » m’invectivait mon grand-père, avec son accent tunisiano-libyien. Alors, à moi la France ! Et j’ai eu mon concours.
Le happy end aurait pu s’arrêter là. Mais alors, il n’y aurait pas d’histoire. Car à nos débuts, Sciences Po, tu n’as pas été très tendre avec moi. Malgré mon beau numéro de sécurité sociale, mon absence totale d’accent, mon éducation parisienne dans les quartiers privilégiés, je m’appelle encore Levy. Hélas, tout n’a pas pu être gommé… Dès mon premier exposé, sur un sujet lambda, avec un partenaire imposé par la professeure, mon binôme enfile fièrement son keffieh – symbole emblématique du combat pour la Palestine. Cela ne me pose aucun problème. Jusqu’à ce qu’à la fin de l’exposé, l’étudiant me glisse à l’oreille : « Je l’ai mis pour qu’on ne m’associe surtout pas à toi ». Nous sommes en 2008. Je ne réponds rien, sonnée. Que sait-il de moi ? De mes convictions politiques ? Attendez… Serait-il possible que dans l’antre de « l’élite », on soit en train de me juger seulement sur ma supposée religion ? Déjà, force est de constater qu’antisionisme et antisémitisme étaient quand même, un peu cousins. « Qu’il aille au diable ! », aurait dit mon grand-père. C’est vrai qu’il en fallait plus pour briser mes rêves. Mais durant cette première année, plusieurs expériences n’ont eu de cesse de me ramener, que dis-je, de me réduire à mes origines : des professeurs qui m’interrogent sur Israël alors que ce n’est pas au programme (l’un d’entre eux est devenu l’un des plus proches conseillers d’un récent Président de la République), des élèves de ma classe (la fameuse « triplette ») qui me harcèlent de blagues sur l’argent, et bien sûr, déjà la comparaison entre la Shoah et Gaza, qu’on me renvoie à la figure – sans que, je le précise, je ne mette JAMAIS le sujet d’Israël sur la table, trop effrayée à l’idée de ne pas me faire de copains. Malgré tous ces efforts pour me cacher, c’était devenu tristement clair : pour certains de ces jeunes étudiants, moi Clara Levy, 18 ans, fille de juifs maghrébins exilés, première génération à être née en France, j’étais en fait Netanyahou. Rien de moins. Que faire de toute cette violence ?
Dès ma deuxième année d’école, je décide de prendre mon destin en main. Là, encore, ai-je vraiment eu le choix ? Peu importe. Apprendre pour me défendre. Je choisis tous les cours sur le monde arabe. Je me souviens de cette période comme d’une forme de boulimie. Combien de livres ai-je lu ? Combien d’apéros au Basile ai-je loupé pour terminer mes fiches sur le roi Farouk, Nasser ou les Mamelouks ? J’étais obsédée. Mais j’avais une règle : sur tous les devoirs évalués par les professeurs, je me tiendrai éloignée d’Israël et de la Palestine. Là encore, si le plan s’était déroulé sans accroc, il n’y aurait pas d’histoire… Alors que je choisis d’écrire ma fiche de lecture sur un essai à propos de la guerre civile libanaise, je réalise que le livre en question est en rupture de stock dans toutes les librairies et indisponible en bibliothèques parisiennes (pas d’Amazon en ces temps lointains). J’explique la situation à mon professeur qui me propose de m’atteler à l’analyse du seul livre non sélectionné par le reste de la classe – ‘Figures du Palestinien : identité des origines, identité de devenir’, d’Elias Sanbar. Première entorse à ma règle. Et quelle entorse… Ce moment, si intense, fait partie de ceux qui m’ont forgée. Et pour ça, Sciences Po, je te dis merci. Merci de m’avoir donné la chance, dans un cadre sain et sécurisant, d’apprendre à réfléchir contre un logiciel de pensée dont j’ai hérité. L’écriture de Sanbar, l’immersion dans sa pensée si fluide, sensible, et pourtant si lointaine, a permis de créer des ponts indestructibles dans mon esprit. Quand j’en parle à un de mes camarades de classe, que je lui partage à quel point cette analyse de texte, pourtant difficile à mener d’un point de vue personnel m’a intellectuellement transcendée du fait de mon héritage sioniste – il me coupe : « …mais on n’peut pas dire ça à voix haute. C’est comme dire « mon héritage nazi ». Wahou. Le mot était lâché. Je n’en revenais pas. Moi, dont la famille ne vient pas d’Europe, mais dont la grand-mère tunisienne me racontait comment elle avait conçu son premier enfant en 1943, tandis que mon grand-père était caché dans sa cave, après s’être enfui des camps de travail allemands. Moi, dont la grand-mère algérienne m’évoquait, sonnée, cet épisode de 1940, quand gamine, elle avait été sommée de quitter sa classe, déchue de sa nationalité française sur ordre du gouvernement de Vichy. « Nazi ». C’était le coup de trop. Après ça, j’ai définitivement jeté la règle à la poubelle, et j’ai encore davantage voulu me concentrer sur Israël et la Palestine. Ce semestre s’est d’ailleurs soldé par un partiel sous forme de dissertation dont le sujet n’était ni plus ni moins : ‘Le conflit israélo-arabe, de 1948 à nos jours’. Oserais-tu encore proposer un tel sujet aux étudiants ? J’ai envie de croire que oui, malgré cette réalité récente qui s’acharne à vouloir transformer mes croyances en illusions.
Arrivée en troisième année, j’ai grâce à toi la chance de m’envoler pour un échange à Melbourne, Australia ! À ma grande surprise, et sûrement du fait de l’anglais, j’y découvre une documentation sur le Moyen-Orient cent fois plus variée et précise que dans les bibliothèques françaises. Là-bas, j’apprends les bases des différents courants de l’Islam, j’étudie l’histoire de l’Islam politique. Alors que la guerre en Syrie éclate, je me focalise davantage sur ce pays. Je continue à questionner le conflit israélo-arabe, la question palestinienne, je commence des cours d’hébreu, et j’étudie même les disparités et la fragmentation de la société israélienne à travers le cinéma. Par hasard, comme si tout devait sans cesse s’entrelacer, je découvre aussi à Melbourne la plus grande communauté de rescapés de la Shoah (après celle d’Israël). C’est peu croyable comme le fait d’être aussi loin me rend paradoxalement plus proche de tous ces enjeux…
Plus j’en apprenais, plus je comprenais que je ne savais rien. Plus j’en redemandais, plus je réalisais enfin ce qu’Yves Lacoste, géopolitologue, voulait nous dire quand il expliquait qu’étudier les rivalités de pouvoir sur un territoire, c’était aussi étudier les conflits ayant pour moteur « les représentations » (qu’on se fait d’un lieu, de soi ou bien sûr, de l’autre par exemple). D’ailleurs, c’est là, et comme cela, que naît L’IDÉE. Celle d’une association, non communautaire, loin des logiques partisanes dans lesquelles s’inscrivent la plupart des démarches sur le sujet en France, qui ferait découvrir la région aux étudiants, en bousculant leurs préjugés. On lèverait des fonds pour un voyage qui nous emmènerait en fin d’année en Israël et en Palestine pour nous confronter à cette diversité de points de vue, de « représentations ». Elle s’élabore autour d’une bière avec d’autres étudiants (non-juifs), qui n’y ont jamais foutu un pied. Ces étudiants sont aujourd’hui des compagnons de route à la vie à la mort ; et ce projet fou, on l’a lancé : il s’appelait PARIS-TEL AVIV, comme le billet d’avion, notre objectif ultime.
Sans ta vie associative omniprésente, Sciences Po, jamais nous n’aurions pu y penser. Tu nous as poussé à nous engager, à ne rien lâcher. Tout existait (j’imagine que c’est encore le cas aujourd’hui…) : des associations sportives à celles autour du tarot, de la cuisine ou même de la conquête de l’espace – il n’y avait pas de limite ! Ah si, une : il fallait réunir 120 votes la semaine d’élection des associations. Combien de kg de Hummus avons-nous préparé ? De falafels ? Il nous fallait sortir de cette image communautaire à tout prix, et nous avions lancé des affiches d’Homer Simpson qui disaient : « si tu n’es pas circoncis, tu peux quand même être notre ami ! ». Je ne sais pas si c’était notre humour douteux ou notre obstination, mais nous avons finalement réuni les votes nécessaires ! Je passe les quelques remarques inappropriées (devenues habituelles à ce stade), le fait que Sciences Po Monde Arabe (SPAM), malgré nos multiples requêtes, n’ait jamais accepté (en tout cas cette première année) de conduire la moindre action à nos côtés – contrairement à l’association franco-iranienne – pour me concentrer sur l’essentiel. À la fin de l’année, et après un travail acharné, nous avions réuni assez d’argent pour que chaque étudiant n’ait que 500€ à payer pour le voyage tout compris (billet, hébergement, pension complète). Les 40 places ont été réservées en moins de 24h, réunissant une dizaine de nationalités différentes, et la liste d’attente était longue comme le bras. Avec l’aide du Consulat de Jérusalem et de l’Union des étudiants juifs de France (nous n’avions pas les moyens de réussir cela sans eux), nous avons pu organiser une journée à Ramallah. Nous y avons rencontré Mohammad Shtayyeh (devenu depuis numéro 2 du gouvernement de Mahmoud Abbas, avant de présenter sa démission il y a quelques jours), mais aussi Sulaiman Khatib, ancien prisonnier de guerre devenu activiste pacifiste, nommé deux fois depuis pour recevoir le prix Nobel de la Paix. Avec lui, nous avons pu aller dans un bar semi-clandestin dans les hauteurs de Ramallah, où les jeunes peuvent fumer la chicha et se baigner dans une piscine. Nous y avons fait la rencontre d’étudiants, dont certains vivaient en camps de réfugiés, et qui, malgré la difficulté de leurs conditions de vie, nous expliquaient travailler à une initiative avec des étudiants israéliens sur des projets cinématographiques. Nous avons aussi rencontré des soldats, de notre âge, qui n’avaient pas d’autre choix que de s’enrôler, des étudiants juifs religieux, des kibboutzniks laïcs très à gauche, des universitaires, des Druzes du Nord, des Bédouins, nous avons même célébré la messe de Pâques à Nazareth en arabe, sans oublier évidemment Jérusalem, le mémorial de la Shoah, la mer Morte et Tel Aviv. Ce tourbillon de points de vue, cette utopie, c’est toi, Sciences Po qui l’a permis. C’est toi qui m’as donné envie de lui donner vie.
Paris-Tel Aviv, après dix ans d’exercice, n’existe plus. Tandis que j’écris ces mots, je me questionne : un tel voyage serait-il encore possible aujourd’hui ? J’ai envie de croire que oui, malgré cette réalité récente qui s’acharne à vouloir transformer mes croyances en illusions.
« Ne la laissez pas rentrer, c’est une sioniste ! » Ces mots ont-ils vraiment été prononcés au sein de ton amphithéâtre Émile Boutmy, cet amphithéâtre où, je l’avoue, j’ai beaucoup joué en ligne à « Tout le monde veut prendre sa place » (car, oui, on faisait ça à l’époque), mais aussi où j’ai célébré l’élection de Barack Obama en dansant sur les tables.Ce sera à la justice de le déterminer. Pour ma part je me contente de constater tristement que ce climat, qui ne date pas d’aujourd’hui, semble s’être empiré.
Sciences Po, toi qui m’as appris la rigueur, l’esprit critique, la nuance et le contradictoire, que proposes-tu ?
Face à cette violence brandie en étendard, à cette lecture politique et donc nécessairement tronquée de l’actualité, qui clive et astreint à choisir un camp – que proposes-tu ?
Face a la banalisation et au dévoiement de mots pourtant si chargés dans l’histoire du peuple juif, tels que « génocide » ou « antisionisme », que proposes-tu ? Si appeler à un cesser-le-feu, à la fin de la politique d’occupation d’un gouvernement, si vouloir deux Etats côte à côte, qui peuvent vivre en paix, c’est être antisioniste, serais-je moi même une antisioniste qui s’ignore ? Face à ces mots-valises qui réduisent la complexité du réel, essentialisent l’autre et amalgament, que proposes-tu ?
Face à tous ces visages recouverts de masques chirurgicaux durant cette occupation d’amphithéâtre et le refus assumé de laisser entrer l’étudiante pour qu’elle ne puisse pas filmer ; face à cette tribune de soutien de la part d’étudiant-es juif-ves, dont on ne peut vraiment savoir qui y souscrit, celle-ci n’étant signée que par des initiales ; face à ces individus qui veulent prendre la parole sans qu’on puisse de fait les contester, que proposes-tu ?
Où est le Sciences Po avant-gardiste du « un tiers de boursiers », du paiement des frais de scolarités en fonction des revenus, de la diversité des origines et des points de vue dans le respect de chacun ? As-tu été si absorbé à camoufler les trop nombreux scandales sexuels des précédentes directions ou encore à chercher comment réinventer les modes de sélections, que tu en as oublié de transmettre tes valeurs et tes fondamentaux ? À force de vouloir coller à l’air du temps, as-tu oublié de rappeler que pour se révolter, il faut aussi se confronter à ce qui nous dérange – quitte à ce que ça nous chamboule un peu ? Es-tu devenu si froussard ?
J’ai vécu aux États-Unis pendant plusieurs années. J’y suis arrivée juste avant que le scandale Weinstein éclate enfin : c’était le début de l’ère #MeToo. Travaillant dans l’industrie audiovisuelle, j’ai été confrontée de plein fouet aux évolutions des mentalités et à la prise de conscience nécessaire de ces discriminations pernicieuses et systémiques : cette fameuse pensée woke (que certains qualifient de courant « identitariste »). Mes souvenirs de 2017-2018 : quel vent de fraîcheur ! Quelle liberté soufflant sur Hollywood ! Quelle jouissance pour la jeune femme que j’étais de voir ce boys club avec lequel je devais composer se défaire petit à petit de ses privilèges ! Je rêvais de voir Idris Elba en James Bond, j’étais ravie qu’on mette davantage en avant des femmes réalisatrices. J’étais convaincue que l’on construisait de nouvelles « représentations » (nous y revoilà, décidément) et qu’on portait la responsabilité de mettre en valeur certaines identités non dominantes dans l’espace public. Cette période a été déterminante pour me faire prendre conscience d’à quel point l’humanisme et l’universalisme pouvaient masquer, voire pérenniser de trop nombreux abus de pouvoir et inégalités.
Oui, il a fallu corriger. Et il le faudra toujours. Mais si Sciences Po m’a appris une chose, que la période actuelle me confirme, c’est qu’un courant de pensée érigée en tyrannie idéologique est dangereux. Que malgré tous leurs défauts, tares et lacunes, on n’a jamais rien fait de mieux que l’humanisme et l’universalisme. Que comme le disait Churchill au sujet de la démocratie, alors attaquée de toute part par les idéologies totalitaires, c’est « le moins mauvais de tous les systèmes ».
Non, je ne suis pas devenue ministre. Loin s’en faut même. Mon grand-père n’avait pas tout bon. Malgré tout, Sciences Po, je ne regrette pas d’avoir croisé ta route.
Par tes innombrables plans en deux parties, deux sous parties, merci de m’avoir appris à penser contre moi-même.
Merci de m’avoir appris à reconnaître et à dénoncer toute forme de radicalité.
Merci de m’avoir donné l’envie de m’investir, de quelques formes que ce soit, dans la vie de la cité.
Merci de m’avoir appris l’histoire de ceux qui ont su braver la peur et faire la paix contre leur peuple.
Merci d’avoir mis sur ma route ceux qui luttent à mes côtés pour chercher ce qui nous rassemble plutôt qu’à ce qui nous divise. Ceux-là mêmes qui me tiennent la main depuis le 7 octobre, ce jour où tout a basculé. Ceux-là mêmes qui ont marché avec moi contre l’antisémitisme, à une époque où on essaie de nous faire croire que c’est d’extrême droite.
Enfin, merci de m’avoir donné le courage d’écrire ces lignes et de prendre la parole, même si j’aurais préféré pouvoir me taire. Sauf que, malgré mon beau numéro de sécurité sociale, mon absence totale d’accent, mon éducation parisienne dans les quartiers privilégiés, je m’appelle encore Levy. C’est forte de ce nom, sans masque chirurgical mais pas sans peur, que je choisis de signer cette lettre.
Merci Sciences Po. À bientôt, j’espère.