À l’approche des élections législatives, et alors que la question de l’antisémitisme se trouve placée au centre du débat politique, la rédaction de K. se devait de s’y positionner. Toutefois, en raison du dilemme, à la fois existentiel et stratégique, que doivent affronter les juifs, il nous a semblé impossible que cette position s’exprime d’un seul tenant : elle devait se cliver. Ce sont donc deux voix juives, celles de Bruno Karsenti et de Danny Trom, qui s’articulent et se répondent ici. Qu’on ne s’y trompe pas : il ne s’agit pas de faire tenir à chacun un pôle du dilemme électoral, mais bien plutôt de le saisir à deux niveaux différents. D’abord, celui du philosophe, qui le pose à partir de ce que représente, ou devrait représenter, la référence à la condition juive pour les juifs eux-mêmes, et surtout pour la gauche et son avenir. Ensuite, celui du sociologue, qui prend en charge la dimension pratique du dilemme, éclairant par les stratégies de persévérance en exil l’embarras et les errements de juifs qui ne savent plus ou chercher leur sécurité.
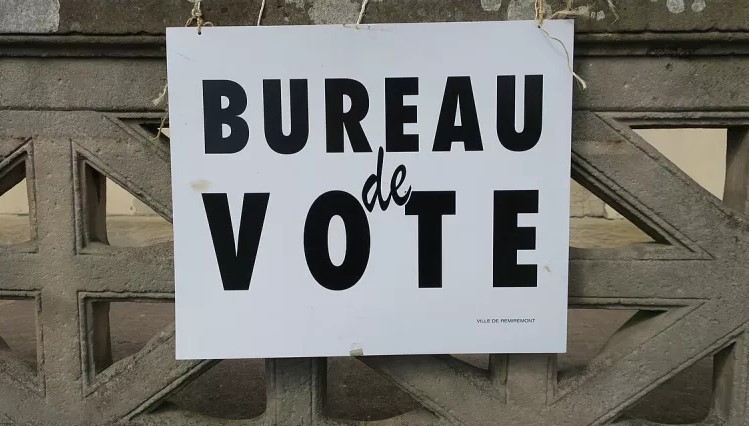
La condition négligée de l’union de la gauche
Par Bruno Karsenti
Les juifs sont, en diaspora, des minorités nationales. Peuple en exil, ils sont structurellement minoritaires dans les États-nations dont ils sont citoyens. Cela ne les oppose pas à la culture majoritaire, mais cela les dispose à son égard d’une manière bien déterminée. Cette disposition emporte une responsabilité et des devoirs, à l’égard d’eux-mêmes comme à l’égard de leur nation d’accueil, celle à la vie de laquelle ils participent. En premier lieu, cette condition fondamentale qui est la leur les dispose à être solidaires de toute minorité potentiellement menacée par le pouvoir en place. De ce fait, ils s’opposent au nationalisme réactionnaire, et à la politique discriminatoire, voire persécutrice qui lui est consubstantielle. S’ils sont fidèles à leur condition juive, ils rejettent inévitablement toute législation qui fait de la préférence nationale, avec sa logique sélective selon des critères d’origine, de race ou de religion, son principe directeur. Ils savent quelle pente est prise dès lors que ce principe est posé. Ils savent aussi que pour le combattre, il faut plus que des compromis ponctuels et des mesures dilatoires dont le seul but est l’accès au pouvoir, ou sa conservation. En tant que juifs, ils perçoivent au plus haut degré la vulnérabilité des minorités, de toute minorité, lorsque l’intégration nationale se transforme en coercition exercée par la majorité.
À l’instant où nous sommes, cette sensibilité est atteinte. À l’heure où la France court le risque d’avoir un gouvernement d’extrême droite, les juifs, pour autant qu’ils sont conscients de leur condition de minorité intégrée dans la nation, se placent aux côtés des communautés prioritairement menacées, c’est-à-dire en l’occurrence des populations immigrées musulmanes et des minorités sexuelles. Ils rejoignent donc les seules forces susceptibles de contrer la tendance nationaliste réactionnaire. Non pas celles qui se posent en rempart tout en misant sur le bénéfice qu’elles croient pouvoir tirer de l’ombre portée de l’extrême droite – manœuvre prétendument subtile que le pouvoir en place a encore tentée en décidant de dissoudre l’Assemblée. Un pouvoir libéral de ce type, dont la seule ressource est la dénonciation verbale de l’extrémisme, et qui affaiblit toujours plus les leviers d’une véritable politique d’intégration, ne peut que contribuer à l’aggravation de la tendance.
Il faut l’affirmer clairement : pour faire pièce au camp réactionnaire, il n’est possible de s’appuyer que sur des forces qui portent une politique liant clairement justice sociale et droits des minorités, et s’engagent dans la formulation d’une vision authentiquement progressiste de la nation et de l’Europe.
Actuellement, ce n’est donc qu’à gauche qu’une issue durable à cette situation peut être articulée, et c’est là que les juifs devraient le plus naturellement du monde trouver leur place.
Or, ce n’est pas ce qui se produit. Il est incontestable que le bloc de gauche qui s’est formé pour répondre au péril réactionnaire comporte en son sein des éléments antisémites. Plus encore, depuis de nombreuses années, avec une précipitation vertigineuse depuis le 7 octobre, ces éléments ont acquis à gauche un rôle structurant, par ignorance et simplification des problèmes que la pensée progressiste doit affronter dans un monde de plus en plus complexe et mondialisé. En réduisant ces problèmes au dénominateur commun « domination », et en associant le nom juif et celui d’Israël à celui des dominants, la gauche a fait entrer l’Europe, et tout spécialement la France, dans un grand moment antisémite. Certes, l’antisémitisme, comme cela a toujours été le cas, puise à des sources situées aussi bien à droite qu’à gauche. Néanmoins, c’est à gauche qu’il a aujourd’hui son barycentre.
Voilà alors le dilemme qui se pose aux juifs : il est de savoir si, pour honorer leur responsabilité – par fidélité à eux-mêmes et à la nation démocratique non-juive dont ils font partie – ils peuvent aller jusqu’à s’allier à des antisémites, et plus encore à ce qu’il y a de plus actif dans l’antisémitisme contemporain, qu’il soit conscient ou inconscient.
La réponse est claire pour nous, si douloureuse soit-elle. Ils ne peuvent pas s’en dispenser. Le malheur des juifs n’est pas seulement de subir une poussée antisémite inédite. Il est de devoir se retrouver aux côtés des principaux agents de cette poussée pour s’opposer au nationalisme réactionnaire, raciste et xénophobe. Il est de ne pas pouvoir s’épargner cette contradiction, et de devoir séjourner en elle, c’est-à-dire de vivre avec. Il est de résister au sein du camp de la gauche et de refuser obstinément d’en être expulsés, quitte à se situer au point de l’espace social où ils auront à affronter l’adversité la plus grande. Le tragique de la condition juive s’accuse et se présente aujourd’hui de cette manière. L’alternative est déchirante, mais elle l’est d’autant plus qu’elle ne comporte pas dans ses options l’ultime confort de la suspension du choix.
Une fois la contradiction posée, une fois posée son inéluctabilité, il est toutefois possible et nécessaire d’agir dans l’espace contraint qu’elle définit. Si le tragique, en l’occurrence, débouche sur l’action et non sur l’inaction, cette action ne vaut qu’à être requalifiée. Il faut donc redéfinir ce que veut dire « choisir la gauche », et le faire avec tout autant de détermination que sur le chemin qui a conduit à cette conclusion.
L’enjeu de l’antisémitisme ne concerne les juifs qu’à la marge. Plus globalement, il est de rendre enfin à nouveau possible, pour quiconque et pour tous, de s’affirmer de gauche de façon conséquente. Quand bien même il n’y aurait plus un seul juif en France à défendre, le problème demeurerait entier, et ne perdrait rien de sa dimension de problème se posant à tous.
Il faut dire, répéter, marteler que l’union à gauche ne se fera qu’à la condition d’affronter l’antisémitisme de gauche, de le nommer et de l’analyser, et de faire de son rejet un principe primordial. Non pas parce que cette union gagnerait alors des voix juives, quantité de toute façon négligeable du corps électoral. Mais parce que c’est seulement à cette condition qu’on fera sauter le verrou qui empêche depuis longtemps la gauche d’articuler son discours de manière conséquente, et de se libérer de ce qui la mine en profondeur. L’antisémitisme de gauche, non-dit ou dénié, est ce qui, actuellement, empêche qu’une véritable alternative sociale et démocratique s’érige contre la déferlante réactionnaire. Car cet antisémitisme est le symptôme de ce qu’une partie de la gauche est prête à détourner et à pervertir la réflexion sur les injustices en la traduisant en purs affects négatifs, autrement dit en niant la pensée qui s’y exprime et en la réduisant à des émotions simples et facilement mobilisables. Cette façon – que l’on pourrait qualifier de populiste – d’envisager, et d’organiser, la mobilisation politique au détriment de la réflexivité trahit ainsi ce qui a toujours été la marque des mouvements véritablement progressistes. Au lieu de chercher à dégager de la critique des injustices un savoir sur les idéaux communs, et de s’en servir pour formuler un projet de transformation sociale vers plus de justice pour tous, cette gauche-là flatte les réactions les plus primaires à l’injustice, en plaquant sur le monde social des schémas d’interprétation manichéens. En cela, elle apparaît à la fois comme une cause et une conséquence de l’incapacité de nos sociétés à organiser une prise réflexive sur elles-mêmes. Montée de l’antisémitisme de gauche et crise du savoir – tout particulièrement du savoir sociologique dans sa fonction critique d’éclairage de l’action politique – sont indissociables. Ils forment ensemble le tourbillon dans lequel la gauche perd pied depuis trop longtemps.
Pour en sortir, il faut avoir le courage de ne pas détourner les yeux. Mais surtout, il faut aller extirper le mal en allant le chercher exactement là où il s’enracine : précisément dans sa dénégation, et dans cette critique sociale et politique en perdition qui ne cesse de le relancer sous des oripeaux qui changent à mesure que les conflits nationaux et internationaux se déplacent et s’aggravent.
On peut à cet égard esquisser un début d’analyse. Les deux points sur lesquels s’appuie cet antisémitisme, s’ils ne sont pas aisément traitables, sont néanmoins aisément identifiables. Le premier tient au refus de distinguer nettement entre une critique antisioniste prônant la destruction d’Israël et une critique des injustices générées par la politique israélienne appelant à leur correction – y compris lorsque cette critique va jusqu’à envisager, par un mouvement qui ne peut toutefois émaner que de la société démocratique israélienne elle-même, un changement constitutionnel. Le second point réside dans le refus de considérer une autre distinction, celle entre racisme et antisémitisme – distinguer n’impliquant aucune hiérarchisation des maux, mais appelant à un auto-examen différent dans chacun des types de discrimination et de violence, eu égard à leurs motivations respectives, et compte tenu du type singulier de minorité que les juifs incarnent.
La gauche ne se refera qu’en se purgeant du type de populisme de gauche qui est devenu le foyer majeur de l’antisémitisme contemporain. Le candidat PS aux Européennes, en mettant en avant son refus de la violence et de la brutalisation des discours, l’avait suggéré de façon assez nette. Pas assez cependant, et la plateforme du « Nouveau Front populaire », en ayant le mérite de mentionner l’antisémitisme au milieu des comportements intolérants, et de les condamner « d’où qu’ils viennent », a fait un pas de plus, qui vient d’être poursuivi par la « Charte d’engagement républicain contre l’antisémitisme » signée par Place Publique, le PS, les verts et les communistes – mais pas par LFI, ce qui montre bien que sur ce point, il est faux de penser que le front soit uni.
Quoi qu’il en soit, pour s’en tenir à la clarification des principes, ce n’est pas encore assez. La gauche doit faire un autre pas – et c’est le pas qui importe vraiment, celui qui assurera qu’aucun propos, acte, ou trope antisémite ne percera à gauche et ne corrompra radicalement ce qui s’y dit et s’y fait. Il faut aller jusqu’à affirmer que l’on combat l’antisémitisme comme un mal dont on sait ce qu’il a de spécifique, d’irréductible aux autres formes de discriminations et de violence à l’égard des minorités, en raison du type de jugement et de motivation qui le sous-tend. Il faut stipuler que l’on sait à quel point il imprègne nombre de discours qui, en disant promouvoir l’émancipation et l’égalité des individus et des peuples, basculent dans la haine des juifs. Et donc que non seulement il y a quelque chose de spécifique dans l’antisémitisme au regard du racisme, mais que parmi les figures que ce mal peut prendre, l’antisémitisme de gauche est lui-même distinct, et doit sa vigueur actuelle à une structure de pensée et une forme de politisation déterminées, bien actives dans certaines franges, qu’elles soient déniées ou pas. Cette dernière distinction est cruciale, puisqu’elle est aujourd’hui l’une des conditions essentielles pour que la gauche arrive à se repenser plus profondément, s’éclaire sur ses propres principes, sur sa manière d’entendre l’égalité et l’émancipation, et renaisse. C’est pourquoi il faut que l’on consente à se réarmer idéologiquement et intellectuellement dans ce combat. Un combat qui tourne autour de la question juive, c’est-à-dire de la condition minoritaire de ce peuple transnational intégré dans les nations, et qui n’est plus depuis un certain temps présent à l’esprit de la gauche, en raison de l’affaiblissement de la réflexion critique qui l’affecte.
Les juifs pourront alors, sans vivre dans la contradiction, faire front commun avec toutes les forces progressistes contre l’extrême droite. On soulignera pour finir cependant un point. C’est que l’enjeu de l’antisémitisme, on le voit, ne concerne dès lors les juifs qu’à la marge. Plus globalement, il est de rendre enfin à nouveau possible, pour quiconque et pour tous, de s’affirmer de gauche de façon conséquente. Quand bien même il n’y aurait plus un seul juif en France à défendre, le problème demeurerait entier, et ne perdrait rien de sa dimension de problème se posant à tous. Il est au cœur de la refondation de la gauche. Il est comme son schibboleth, c’est-à-dire le signe auquel, aujourd’hui, elle peut se reconnaître à coup sûr, et se distinguer complètement de ce qu’elle n’est pas, ou de ce qui n’est qu’une caricature d’elle-même.
Bruno Karsenti
La condition négligée des juifs
par Danny Trom
Les juifs ont formé des minorités vivant dans les « nations » et séparées d’elles. Ce n’est qu’avec la modernité politique qu’ils furent nationalisés, intégrés dans les États-nations. Pour persévérer en exil, ils ont traditionnellement associé deux tropismes alternant en fonction des circonstances, sans contradiction. Par-delà toutes les transformations, cette alternance est encore lisible aujourd’hui, jusque dans les élections législatives actuelles.
Le premier tropisme prend acte de la condition exilique en ménageant aux juifs une place dans la société d’accueil, ce qui supposait la reconnaissance de la légitimité de la loi du pays étranger (le principe dina de-malkhouta dina, la loi du pays est la loi), mais aussi celle de l’existence d’un domaine public auquel ils participent (tikoun medini, la correction ou l’amélioration du pays). C’est sur cette ligne de fond que se sont édifiés leur aspiration à l’émancipation, puis leur attachement à la nation moderne dès lors que s’y affirme et s’y approfondit l’État de droit, la bienveillance à l’égard des minorités, le progrès vers la liberté et l’égalité.
Tout pourrait donc concourir dans les élections législatives actuelles à incliner les juifs à voter pour le Nouveau Front de gauche, s’il était le fidèle successeur du Front populaire de 1936. Or, le populisme à coloration antisémite de LFI, parti pivot de la coalition de l’union des gauches, les en empêche. La dérive de la gauche de la gauche, certes désapprouvée de l’intérieur de l’union, semble néanmoins tolérée, du moins passée par pertes et profits, poussant de très nombreux juifs à exclure le Nouveau Front de gauche de leur choix. Bien entendu, la perspective d’une reconstruction à venir d’une gauche républicaine – expurgée de son populisme qui a l’antisémitisme, ouvert ou larvé, pour corrélat – ne répond pas au dilemme de l’électeur qui va devoir se déterminer dans les jours qui viennent.
C’est précisément ici, dans la crise, que le second tropisme traditionnel qui, avec la modernité, s’était effacé sans avoir disparu, prend le relai. Cette proto-politique juive a consisté à s’assurer de la protection des juifs par le pouvoir en place, selon la logique de l’alliance avec le pouvoir suprême. Se lier au pouvoir pour le persuader de la loyauté des juifs, promettre d’abonder le trésor du roi, invoquer la coutume d’hospitalité du pays d’accueil, cela afin de parer à toute mesure hostile de sa part, venant d’un pouvoir intermédiaire ou directement de la foule, telle était jadis la fonction du diplomate juif dans les sociétés prémodernes. L’avènement de la souveraineté populaire a rendu cette pratique obsolète puisque l’État-nation intègre les juifs comme une partie d’elle et que le souverain populaire rend en principe le surgissement d’une populace hostile impossible.
En principe donc, seule demeure effective la logique du tikoun medini, poussée jusqu’à son indistinction avec la politique progressiste, mais à condition que cette dernière ne se retourne pas contre les juifs. Or, il s’est avéré très tôt que l’antisémitisme pouvait parfaitement prendre la forme d’un mouvement social aux allures progressistes, y trouver même son point d’articulation, dès lors que les juifs figurent le dominant à abattre. Dans ces conditions, qui sont exactement celles d’aujourd’hui, la politique prudentielle visant à s’assurer que le pouvoir issu des élections sera favorable aux juifs, affleure à nouveau. Ici, la politique en tant qu’elle s’inscrit dans l’horizon d’un idéal, atteint ses limites. Ici, la logique de la moins mauvaise solution possible pour les juifs reprend ses droits.
En excluant le RN et LFI, ne reste qu’un centre qui maltraite les couches populaires et polarise la société en prenant, lui aussi, les juifs en otage.
Ce rétrécissement de l’horizon politique des juifs n’est nullement condamnable, puisque c’est la configuration globale qui les y contraint. Il est le produit d’une crise caractérisée par la polarisation du champ politique consécutive à l’effondrement d’un Centre qui, plutôt que de se structurer, a creusé un vide. Dans un contexte où l’on anticipe que le Centre ne sera pas en mesure de gouverner, deux blocs, la gauche unie sous la tutelle de LFI et la droite unie autour du RN, se font face. Se pose alors aux juifs la question de savoir quelle est la moins mauvaise solution, étant entendu qu’elle est celle dont ils pâtiront le moins. Un vote pour un candidat de l’union de la gauche s’il n’est pas LFI est une solution, malgré le risque de renforcement d’une union sous son égide ; un vote en faveur du parti présidentiel ou de la droite républicaine l’est aussi, malgré le risque d’échouer à faire barrage au RN. Vient ensuite la question du second tour, l’arbitrage entre la pire des solutions possibles.
Des voix de gauche clament que l’antisémitisme à gauche est conjoncturel, tandis que celui de l’extrême droite est structurel, de sorte qu’il faut préférer le premier au second. D’autres avertissent a contrario que l’antisémitisme de la droite extrême appartient à une séquence historique révolue, qu’il ira en s’atténuant, tandis que celui de la gauche est l’antisémitisme de l’avenir, promis à prospérer. Faut-il préférer une extrême droite fraichement convertie à l’anti-anti-sémitisme pour mieux stigmatiser les minorités postcoloniales d’un seul tenant, cela afin de mener une politique xénophobe passée au vernis du philosémitisme ? Ce serait la pire solution, qui se retournera fatalement contre les juifs et contre tous. Qu’une voix prestigieuse comme celle de Serge Klarsfeld penche pour cette option, en effaçant la culture politique antirépublicaine du RN et en taisant son programme qui traduit un nationalisme régressif, au plan européen comme au plan du traitement des minorités et plus généralement des libertés publiques, est l’indice du degré de désorientation des juifs au moment du choix. Cependant, ce penchant, il est crucial de le noter, ne cède pas sur ce que Bruno Karsenti nomme la « condition fondamentale » qui dispose les juifs à la solidarité avec toute minorité potentiellement menacée par le pouvoir en place. Il résulte du constat qu’il existe des persécuteurs au sein même des minorités.
La solidarité des juifs avec SOS-racisme fut sans faille lorsque l’égalité de traitement était en jeu, mais lorsque des revendications minoritaires en passent par la dénonciation d’un « philosémitisme d’État », l’alliance horizontale entre minorités atteint ses limites. Car du terreau même de la vie minoritaire s’est déterminée, depuis au moins deux décennies, dans sa version islamiste ou décoloniale, une hostilité à l’égard des juifs qui a instauré un climat d’insécurité chronique et une pression au départ, vers d’autres quartiers, vers Israël ou ailleurs. Et il faut bien le constater, la régulation n’est pas venue de la société civile, tandis que les pouvoirs successifs, malgré les déclarations tonitruantes, ne sont jamais parvenus à freiner cette tendance.
Si donc les juifs, minorité structurelle, sont enclins à se solidariser avec toute minorité persécutée, ils ne le peuvent plus lorsque des fragments de ces minorités conjoncturelles visent une hégémonie de type majoritaire en se retournant contre eux ; ils le peuvent d’autant moins si le seul lieu où les juifs sont parvenus à former une majorité conjoncturelle dans un État refuge est nié jusque dans son existence.
Alors dans l’hypothèse d’un face-à-face RN et LFI au second tour, faut-il préférer une gauche populiste qui espère maximiser les profits électoraux en attisant l’antisémitisme ? L’ascension de LFI apparait nettement comme la traduction politique de cette agitation sociale antisémite, d’une violence au plan de la vie sociale des juifs, appuyée par des montages théoriques qui prospèrent dans le monde de l’opinion autorisée. C’est pourquoi un RN au pouvoir qui se présente subitement en protecteur des juifs, apparaîtra à certains juifs comme cette instance avec qui une alliance les prémunira contre des éléments d’une minorité persécutrice capables de s’allier à des segments majoritaires, dont LFI est la caisse de résonance. Il faut beaucoup d’auto-illusionnement pour le croire ; il faut surtout que l’hostilité à l’égard des juifs ait atteint en France un degré tel, relayée par des porte-voix politiques sonores à gauche qui captent tous les espoirs, pour qu’un parti issu des milieux pétainistes, colonialistes et négationnistes puisse désormais se présenter comme le protecteur des juifs.
Les juifs de France vivent une situation inédite, paradoxale ; un parti réactionnaire issu de la collaboration d’État avec les nazis est aux portes du pouvoir ; mais une populace hostile aux juifs, à travers la figure de Mélenchon, l’est aussi. Le RN est-il sincèrement ou stratégiquement philosémite ? La réponse est qu’il l’est stratégiquement. LFI est-elle stratégiquement ou sincèrement antisémite ? La réponse est qu’elle l’est sincèrement, dès lors qu’elle purge ceux qui ne le sont pas. La mobilisation des Gilets jaunes a bien montré que la foule est biface, elle s’oppose au pouvoir sans que l’on sache si l’antisémitisme qui s’y exprime marque un penchant pour le RN ou LFI.
Reste le Centre que le Président a préempté. Dans certaines circonscriptions, parfois jusqu’au second tour, il s’agira d’un choix possible, issu de l’évaluation de la moins mauvaise solution dans les circonstances. Un pouvoir que l’on sait pourtant déjà perdu. Et un choix qui alimente la dénonciation du philosémitisme d’État, thèse lancinante de l’extrême droite avant qu’elle ne se ravise en dissimulant son antisémitisme, thèse désormais endossée par la gauche de la gauche pour dire l’injustice à l’égard des minorités dites postcoloniales, en faisant, il faut le souligner, ce pari infamant pour ceux, très nombreux, qui en sont issus, que l’antisémitisme y domine sans partage. Voter pour le parti d’un président qui ne sut pas s’il fallait se joindre à la grande manifestation de novembre contre l’antisémitisme que le pouvoir avait lui-même suscité, pour finalement ne pas s’y rendre dès lors que le RN y participa mais que LFI le boycotta, voilà une solution pour le moins sous-optimale. Appuyer un pouvoir qui se tient donc au-delà de l’antisémitisme et de la lutte contre l’antisémitisme, voilà qui suscite le trouble. En excluant le RN et LFI, ne reste qu’un centre qui maltraite les couches populaires et polarise la société en prenant, lui aussi, les juifs en otage.
Alors, pour qui voter ? En attendant que la gauche s’assainisse, ne demeure que le court terme des calculs incertains, des solidarités sans réciprocité, des paris inconsidérés.
Danny Trom











